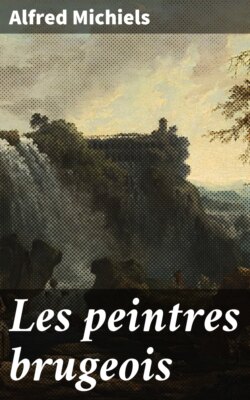Читать книгу Les peintres brugeois - Alfred Michiels - Страница 4
CHAPITRE PREMIER.
Les Van Eyck.
ОглавлениеOpulence de Bruges à la fin du quatorzième et pendant le quinzième siècles.–Hubert et Jean naissent près des frontières allemandes.–Influences qu’ils subissent.–Ils transportent leur atelier à Bruges.–Première gloire qu’ils obtiennent.–Découvertes de Jean Van Eyck.
Les Pays-Bas, vers la fin du quatorzième siècle, étaient la contrée la plus riche du monde. L’Italie seule pouvait, à cet égard, soutenir la comparaison avec eux, mais sans briller d’un éclat supérieur. D’habiles princes avaient dès longtemps favorisé l’industrie et le commerce dans ces grasses plaines, où toutes les circonstances leur étaient d’ailleurs propices. Au milieu du treizième siècle, Marguerite de Constantinople, d’abord comtesse de Hainaut, puis de Flandre, abolit la servitude dans ses domaines et releva le front de ses sujets courbé vers la glèbe. Le rustre affranchi travailla plus courageusement; ni les fatigues, ni les dangers ne le rebutèrent; il demanda au sol, il chercha sur les flots orageux le bien-être et l’opulence dont il voyait jouir les seigneurs. En1218, la comtesse Jeanne, sœur aînée de Marguerite, avait accordé aux villes flamandes, surtout à Lille, Dam et Gand, de nombreuses immunités. Lorsque la puissance des communes devint plus grande, elles obtinrent, elles conquirent d’autres privilèges. Les citoyens qui exerçaient le même état se rapprochèrent et s’entendirent, les corporations d’arts et de métiers se fondèrent, la bourgeoisie s’organisa, défendit ses intérêts et passa même peu à peu de la crainte aux menaces. La plus ancienne charte relative à ces corporations, en Belgique, est une ordonnance de Guy, comte de Flandre, promulguée l’an1294. Elles avaient pour chefs des doyens qui, gouvernant le populaire, étaient des hommes redoutables, des espèces de seigneurs industriels. La Hanse teutonique, formée au déclin du treizième siècle, en associant les villes les plus importantes du nord de l’Europe, accrut leur pouvoir, leur richesse et leur audace. Lubeck fut la capitale de cette ligue imposante, Bruges en devint le chef-lieu dans les Pays-Bas; trois cents marchands s’y établirent afin de diriger tout le commerce néerlandais. Ce comptoir, du reste, ne fut inauguré qu’après l’an1364: la cité flamande comptait alors soixante-huit corps de métiers, et possédait une chambre d’assurance depuis1310.
Sous Edouard III, selon Peuchet, les fabricants des Pays-Bas exportaient, chaque année, de l’Angleterre cinquante mille ballots de laine. Des flottes de50, 60et100navires, chargés de cette précieuse dépouille, quittaient souvent les ports de Londres et de Southampton. L’Espagne en fournissait à Bruges quarante mille sacs. De Foë assure que, de1327à1577, deux cent trente millions tournois furent dépensés pour les achats. Louvain, au commencement du quatorzième siècle, renfermait plus de quatre mille maisons logeant des drapiers et cent cinquante mille manœuvres. En1389, Gand contenait quatre-vingt mille hommes en état de porter les armes: la draperie occupait quarante mille métiers, et, dans une émeute, sous Louis de Mâle, ceux qui se livraient à cette profession réunirent dix-huit mille combattants. Les ouvriers de toutes les catégories ayant fait construire, à la même époque, une église en l’honneur de la Vierge, sur le mont Blandin, ne donnèrent qu’un denier de gros par tête pour couvrir les frais. Les demeures des tisserands formaient vingt-sept quartiers ayant leurs doyens, qui obéissaient à un doyen supérieur. Au son de la grosse cloche, nommée Roland, les cinquante-deux états se groupaient sous leur bannière et accouraient sur la place du marché, où il n’était pas rare que vingt-cinq mille hommes fussent assemblés en quelques minutes.
Durant l’année1370, trois mille deux cents métiers en laine fonctionnaient sur le territoire de Malines, soit dans la ville, soit au dehors. Berthoud, le plus riche négociant de l’endroit, faisait alors un immense commerce avec Damas, Alexandrie et autres grandes cités. Son contemporain, Jean Paty, marchand et prévôt de Valenciennes, étant allé à Paris pendant qu’on y tenait la foire, acheta d’un seul coup toutes les denrées qui s’y trouvaient, pour faire parade de son opu lence. Dix ans après la date mentionnée tout à l’heure, u les seuls orfèvres de Bruges étaient déjà si nombreux qu’ils pouvaient marcher en corps de bataille sous leurs propres drapeaux.» Plus d’un siècle et demi auparavant, la prospérité devait y être fort grande: le luxe des dames étonna la reine de France, pendant la cérémonie où Philippe-le-Bel reçut le titre de comte. « J’avais cru, dit la princesse, être la seule reine présente dans ces lieux, mais je m’aperçois que Bruges en renferme plus de six cents.» Les bourgeois de quarante-huit villes s’étant réunis à Tournay, en1394, pour disputer le prix de l’arbalète, rendez-vous auquel se trouvèrent des Parisiens, ce furent ceux de Bruges qui déployèrent le plus grand luxe; ils étaient au nombre de dix, habillés tout en soie et en damas, et portant de magnifiques chaînes d’or. Leur ville brillait d’une telle splendeur, possédait tant de beaux édifices et de larges places, où circulait la multitude, où le soleil épanchait librement ses rayons, que, pendant le quinzième siècle, Eneas Sylvius la mettait parmi les trois plus belles du monde. Les navires s’y rendaient en foule de tous les pays: cent bâtiments et même davantage entraient quelquefois dans le port de L’Écluse, depuis le lever du soleil jusqu’à la nuit tombante. Un canal unissait le port à la ville; on y amenait donc les marchandises avec une grande facilité.
Voilà sur quel théâtre allait se déployer le génie de la première école flamande. Nul autre ne pouvait lui être aussi propice. Il devait y rencontrer l’appui, la fortune, les hommes de loisir, les goûts fastueux qui permettent aux arts d’atteindre une vigueur inaccoutumée. L’orgueil même des bourgeois l’y appelait: quand le luxe matériel est parvenu à ses dernières limites, on ne saurait l’augmenter qu’en y joignant le luxe intellectuel. On recherche alors ces productions dont la valeur n’a, pour ainsi dire, point de bornes.
La ville de Maes-Eyck, dans le Limbourg, ville appartenant au duché de Gueldre, fut le lieu où naquirent les artistes supérieurs qui devaient féconder les germes encore stériles de la peinture néerlandaise. Maas-Eyck veut dire Eyck-sur-Meuse; en adoptant le nom de leur cité maternelle, ils rejetèrent la syllabe accessoire et explicative, pour ne garder que la syllabe principale.
Hubert vint au monde en1366. Quel fut son maître? On l’ignore. Les peintres n’étant alors regardés que comme des manœuvres, on ne prenait pas note de leurs actions; leur naissance, leurs idées, leurs joies, leurs malheurs, on ne s’en souciait guère; on payait leur travail et on les oubliait. Hubert était âgé de vingt ans, lorsque le sort lui octroya un frère, un ami et un disciple. Jean Van Eyck étudia sous lui dans la maison paternelle et tint probablement le crayon dès son enfance. L’amour du beau semble d’ailleurs avoir distingué toute cette famille: leur sœur Marguerite obtint par ses ouvrages une brillante réputation. Éprise de son art, pleine du fier enthousiasme auquel le talent doit sa puissance, et qui le console au milieu de la douleur, quand celle-ci n’en éteint pas la flamme divine, elle secoua le joug des penchants vulgaires. Pour que rien ne troublât son cœur et sa pensée, ne détournât son regard des formes sublimes qui lui apparaissaient, elle voulut demeurer vierge; comme les saintes du moyen-âge faisaient vœu de chasteté, dans l’espoir de plaire au céleste époux, elle n’eut de maître que son génie et d’aspiration que vers l’idéal. Son art fut une espèce de cloître, où elle s’enferma, où elle chercha la solitude et le recueillement, où elle mourut de cette douce mort qui achève une tranquille existence.
Quoique l’on n’ait point de détails sur leurs parents, tout prouve qu’ils jouissaient de quelque fortune. L’instruction donnée à leur petite famille ne permet pas de croire qu’ils traînassent leurs jours dans la misère. Leur second fils avait une science peu commune de leur temps. Barthélémy Facius le loue d’avoir étudié soigneusement la géométrie, les livres de Pline et des autres anciens. Il savait en outre le peu de chimie alors connue et l’art de distiller. La composition très-souvent profonde de ses tableaux, ses découvertes de plusieurs genres montrent qu’il avait l’habitude de réfléchir. Non-seulement il avait reçu la plus belle éducation, mais il ajouta ses propres vues à l’enseignement de ses instituteurs. Son âme ne fut pas un champ de glaces, champ stérile où vient expirer la lumière; elle se féconda sous le rayon qui la touchait: un suave printemps naquit de cette double influence.
Il révéla dès son bas âge beaucoup de pénétration et de sagacité. Il y joignait un excellent caractère, une élégance naturelle de gestes et de tournure, un goût décidé pour les arts. Hubert se fit sans doute une joie d’instruire un pareil élève et celui-ci l’aima, le respecta toujours avec une sorte de vénération filiale. Ils peignirent ensemble jusqu’à la mort d’Hubert; plusieurs tableaux de Jean, où il a tracé l’image de ce guide chéri. le soin même de l’exécution et le sentiment qui l’anime, témoignent encore aujourd’hui de son affectueuse reconnaissance. Marguerite travaillait près d’eux, soit à orner des manuscrits, soit à répandre sur des panneaux la grâce de son cœur. Ileût été doux de les voir ainsi réunis, pendant un beau jour d’automne. Contemplé en imagination, ce groupe pieux et méditatif nous explique d’avance l’intime poésie que l’on admire dans les ouvrages de l’époque.
Mais si l’on ne connaît pas le nom de l’artiste qui forma Hubert et vint, comme les beaux anges du quinzième siècle, annoncer la parole de Dieu sous le toit paisible des Van Eyck. on sait quel point du ciel abandonna l’étoile voyageuse qui s’arrêta, plus brillante que jamais, sur la demeure de ces nouveaux élus. Toutes nos recherches ne nous ont point fait découvrir en Belgique les ébauches premières, qui ont pu conduire au style de peinture immortalisé par l’école de Bruges. Des essais peu remarquables, des badigeonnages historiés, des miniatures sans caractère spécial, un tableau disparu, deux autres que ne distingue aucun mérite transcendant et, pour ainsi dire, prophétique, sont les seuls ouvrages qui nous restent de la fin du quatorzième siècle. Il y a un abîme entre les créations des frères Van Eyck et ces tentatives imparfaites. Or, les beaux-arts ne procèdent point à la manière des jongleurs, n’exécutent pas de sauts périlleux: ils ont une marche suivie et continue. Les productions intermédiaires que l’on ne trouve point dans les Pays-Bas, on les trouve d’ailleurs en Allemagne, sur les bords du Rhin. En1370, maitre Wilhelm ou Guillaume s’établit à Cologne: il était né au hameau de Herle, près de la ville. Dix ans plus tard, il avait déjà une réputation éclatante et passait pour le meilleur peintre de l’empire germanique. Il forma un élève d’un talent admirable, Stephan ou Étienne: celui-ci exécute, en1410, la fameuse Adoration des Mages, où brillent les qualités suprêmes de ce noble style. Charmante vision de la beauté pure et sainte, de la beauté chrétienne par excellence, un moment aperçue à travers les brumes du Nord! On dirait que le ciel s’entr’ouvrit aux yeux de l’artiste et lui laissa voir dans ses profondeurs la cohorte angélique des divines fiancées. Il leur donna sur ses panneaux toutes les grâces de l’âme et toutes celles du corps: une gaieté douce, un frais sourire, presque imperceptible, des chairs potelées, arrondies, blanches et virginales, expriment en elles la paix du cœur. Les nuances, les lignes, les attitudes, les figures, les chevelures même épaisses, lustrées, ondoyantes, respirent le charme d’une vie harmonieuse. Jamais la piété n’a revêtu des formes plus enchanteresses: nulle prédication ne vaut un regard de ces yeux candides, et ces bouches muettes ont plus d’éloquence, persuadent mieux que les docteurs de l’Église. Un fond d’or les environne comme une sorte de gloire. Leurs pieds sans tache ont pour appui une terre couverte de fleurs. Un trône, avec son dais, une tapisserie, un monument resplendissent parfois derrière elles. La chaste élégance de leur costume ajoute une nouvelle séduction à leur infaillible prestige.
Maes-Eyck est peu éloigné de Cologne; il n’est pas non plus fort distant de Maestricht, et ces deux villes jouissaient, dès le treizième siècle, d’une grande renommée en fait de beaux-arts. Hubert n’avait que quatre ans, à l’époque où Guillaume vint se fixer dans la première, et sans doute offrir au public un talent déjà mûr. Son école et le petit Van Eyck grandirent à la fois; lorsque le jeune homme put donner des preuves de mérite, le style de Guillaume régnait sur tout le pays et avait obtenu un succès général. Peut-on admettre, avec la moindre apparence de raison, que l’influence de ce maître célèbre n’atteignit pas le novice habile, mais encore inexpérimenté? Il est donc vraisemblable qu’il imita d’abord sa manière, qu’il erra quelques années dans le jardin merveilleux de l’idéal. Il eut toujours des souvenirs de ce paradis primitif: un rayon, qui s’en est échappé, illumine les vierges du tableau de Gand. Si nous avions pu étudier à Vienne les seules productions qu’il ait peintes sans l’aide de son frère, nous apprécierions dans quelle mesure il se laissa modifier par le génie de Guillaume et d’Étienne.
Quoi qu’il en soit, un jour vint où la maison paternelle ne lui suffit plus. Peut-être avait-il conduit son père et sa mère au champ du dernier sommeil, peut-être vendait-il mal ses tableaux dans le Limbourg et la renommée de Bruges fut-elle comme une trompette qui l’attira vers l’Occident. Pour un motif ou pour l’autre, ou pour tous deux ensemble, il quitta son pays natal. La distance fut bientôt parcourue: les frères et la sœur virent se déployer devant eux la métropole commerciale des régions du Nord.
Ils trouvèrent dans ce second domicile plusieurs avantages. Non-seulement ils se défirent mieux de leurs panneaux historiés, non-seulement la présence d’une population active, riche et nombreuse les stimula; mais l’aspect de la ville, de la foule qui s’entre-heurtait au milieu des rues des places, des promenades et des carrefours, excita leur verve par lui-même et flatta leur imagination. C’était une résidence agréable et pittoresque. Des portes gothiques avec des tourelles en trompe, de hautes églises, de brillantes chapelles, des canaux où se pressaient les navires immobiles, que des centaines de ponts enjambaient, où les maisons reflétaient leurs sculptures, leurs vitrages multipliés, leurs cabinets suspendus, les grandes fenêtres de leurs oratoires, la halle couronnée de son beffroi gigantesque, les eaux jaillissant des fontaines composaient, à n’en pas douter, un ensemble radieux, magnifique, inspirateur. Le long des quais, des monuments, ondoyait une multitude bariolée. L’Anglais aux cheveux roux, les blonds négociants de l’Allemagne, l’Espagnol cuivré, le nègre d’Afrique, l’Italien, l’Arabe, les Turcs de Smyrne et de Judée, les hommes des nations les plus diverses et les plus lointaines se mêlaient et circulaient parmi les habitants. Ils offrirent à nos voyageurs de précieux modèles qu’ils copièrent avec soin, dans leurs tableaux des rois-mages entre autres.
Une fois qu’ils eurent choisi une demeure, ils purent travailler sans encombre. La ville ne renfermait point d’artistes célèbres: quelques enlumineurs seulement y ornaient les manuscrits; des peintres vulgaires y ébauchaient un petit nombre de scènes religieuses. Un de ces tableaux primitifs subsiste encore dans la chambre des marguilliers, à l’église St-Sauveur. Il représente Jésus sur la croix: les teintes en sont pâles, comme celles de tous les ouvrages à la gomme et à l’eau d’œuf. Le Rédempteur n’est pas mal dessiné, même sous le rapport anatomique. Trois anges verts recueillent le sang que laissent échapper ses blessures. A gauche, deux saintes femmes et saint Jean soutiennent Marie qui tombe en défaillance. La tête de la Vierge est régulière et ne manque pas de beauté. A droite nous apparaissent quatre hommes: l’un d’eux, portant une dalmatique, montre la victime au reste du groupe, en disant: «Vere Dei Filius erat iste.» Ces mots sont écrits sur le fond d’or gauffré, où se détachent les personnages. Du même côté, on voit dans une niche sainte Barbe avec sa tourelle et des cheveux crêpés, qui s’élargissent en éventail. A l’autre bout du panneau, sainte Catherine occupe également une niche; une roue charge une de ses mains, un glaive arme l’autre, et elle foule un roi sous ses pieds. Ce morceau n’a pas, à beaucoup près, le fini des Van Eyck. Les chairs sont très-blêmes, les doigts effilés outre mesure et d’un mauvais dessin. L’homme qui a exécuté cette page ne pouvait être un concurrent pour les deux frères. Ce n’est pas que les arts ne fussent encouragés dans une certaine limite: les comtes de Flandre avaient des peintres officiels. Le portraicteur chargé de ces fonctions par Louis de Mâle se nommait Jean de Hasselt, et recevait tous les ans vingt livres de gros. Les ducs de Bourgogne eurent aussi leurs artistes: Melchior Broederlain travaillait pour Philippe-le-Hardi et touchait trois cents francs de pension. La confrérie brugeoise de St.-Luc existait déjà au quatorzième siècle, selon toute apparence, mais nulle preuve certaine ne le démontre. En1450, elle fil bâtir une chapelle à son usage et se composait de trois cents membres. Tous n’étaient pas des peintres: elle renfermait, comme du temps de Karel, des architectes, des sculpteurs et même des teinturiers. Ils songeaient plutôt à leur salaire qu’à la gloire, aux besoins de leur famille qu’aux discours et aux jugements de la multitude. Les deux frères ne se virent donc point en butte à la jalousie, à de lâches intrigues: une paix profonde les environna; ils occupèrent seuls tout le domaine de l’art et furent les princes de la peinture; merveilleuse situation qui double les forces du génie!
On pourrait s’amuser à reconstruire par la pensée l’intérieur du logis où ils vivaient. En cherchant quelle forme de maison, quelle espèce de mobilier ils ont le plus souvent reproduits, on saurait d’une manière presque infaillible quels étaient ceux qui frappaient habituellement leurs regards. Je ne me suis pas livré moi-même à cet examen, par de bonnes raisons: toutefois il m’est permis de dire que l’on remarque dans les salles, dans les ameublements dont leur pinceau fidèle traçait l’image, une propreté, une coquetterie, une poétique élégance, qui révèlent les soins d’une femme et sont dûs vraisemblablement aux efforts de Marguerite. Ils nous mettent sous les yeux des chambres pittoresques, avec un lit régulièrement drapé, que couronne un dais pompeux et qu’enveloppent de brillantes custodes; les poutrelles vernies rayent le plafond, une mosaïque de carreaux forme le sol; des vitres nombreuses, maintenues par un châssis de plomb, étoilent les fenêtres, qui sont munies de volets articulés, où rayonnent des clous métalliques. Un fauteuil en bois sculpté se dresse près du chevet, un prie-Dieu dans le même goût orne le devant de la salle. Une petite fontaine de cuivre, luisante comme de l’or, y darde ses minces filets que reçoit une vasque très-simple, ou des fleurs s’épanouissent au milieu d’une jardinière, qui n’est autre chose qu’un pot flamand. Tout respire l’aisance, l’ordre et le bien-être.
Mais s’ils ne rencontraient point d’obstacles au dehors, les frères laborieux en trouvaient un grand nombre dans l’imperfection des moyens employés jusqu’alors par les artistes. Ces moyens étaient réellement très-bornés: on délayait les couleurs dans de l’eau, où on avait fait dissoudre soit de la gomme de cerisier, soit de la gomme de prunier; puis on les appliquait sur des panneaux qui avaient reçu une impression à la colle. Le vermillon, la céruse et le carmin, ne se mêlant pas à la gomme, étaient seuls broyés avec du blanc d’œuf. On étendait par-dessus la peinture un vernis composé de gomme arabique et d’huile de lin bouillies ensemble. La colle de parchemin servait en outre à fixer les ors. Mais ce genre de peinture était peu solide: les couleurs restaient pâles, et quoique les artistes de Cologne en eussent augmenté l’éclat, elles ne pouvaient soutenir la comparaison avec les teintes des objets naturels. On faisait aussi usage de l’huile de lin; les nuances étaient alors plus brillantes; malheureusement ce procédé exigeait une patience à toute épreuve, car chaque fois qu’on avait appliqué une couleur, on ne pouvait en superposer une autre, si la première n’était pas séchée; ce qui devenait d’une lenteur fastidieuse et eût glacé le plus ardent génie. Encore fallait-il que l’on put exposer l’ouvrage aux rayons du soleil. Puis les fonds d’or qui luisaient derrière les personnages groupés ou séparés, les nimbes métalliques environnant les têtes, semblaient découper les figures, leur communiquaient la roideur de la pierre et fatiguaient les yeux de leur pompe inintelligente, monotone, sans proportion avec le coloris. Les deux artistes, mais surtout Jean, lutlaient pleins d’impatience contre ces difficultés. Elles ne les empêchèrent pas néanmoins de déployer le rare talent qu’ils devaient à la nature. Ils peignirent, selon la vieille méthode, une foule d’ouvrages, qui excitèrent l’admiration et dans le pays même, et dans tous les royaumes où ils furent transportés. Il est donc présumable qu’un certain nombre de tableaux, qui passent pour avoir été faits à Cologne, sont des produits de leurs mains. On obtiendrait de curieux, d’importants résultats, si on exécutait des recherches, en ne perdant point de vue cette idée. Le génie des Van Eyck était un don naturel, qui précéda l’invention de la peinture à l’huile, et se révéla dès qu’ils touchèrent des crayons.
Cependant tous les artistes de l’Europe étaient las comme eux d’avoir à leur disposition de si faibles ressources. Tous ambitionnaient un nouveau procédé, qui leur permît d’obtenir plus d’éclat et de morbidesse, qui rendit leurs lignes plus fermes, leurs couleurs plus attrayantes, qui donnât moyen de les fondre harmonieusement, de ne pas les appliquer à la pointe du pinceau, car c’était ainsi que l’on travaillait. Un grand nombre avaient fait des expériences inutiles: Baldovinetti et Pesello multiplièrent leurs efforts, avec une obstination glorieuse, mais ne réussirent pas mieux que les autres. Ils voulaient augmenter non-seulement la splendeur, mais encore la solidité des images. Les peintres italiens s’étaient même réunis pour traiter cette question. Ailleurs, le désir n’était pas moins vif: en Espagne, en France, au delà du Rhin, tous ceux qui reproduisaient la face humaine aspiraient à voir s’opérer dans la technique de l’art de grandes améliorations. L’honneur d’en reculer matériellement les bornes était réservé au pays pratique par excellence.
Jean, comme on le pense bien, s’occupait d’autant plus de la réforme universellement désirée, qu’il savait la chimie. Un jour, ayant terminé un panneau, qui lui avait demandé beaucoup de temps et de soins, mais dont il était d’ailleurs satisfait, il le vernit et l’exposa au soleil. Soit que la chaleur fût très-grande, ou que les ais fussent mal joints, ou qu’il eût mal choisi le moment, les planches se désunirent et de larges crevasses sillonnèrent le tableau. Van Eyck, dans son chagrin, résolut de prévenir un second accident de la même espèce. La détrempe lui répugnait déjà; ce fut le tour du vernis qu’on employait alors. Appelant à son aide les connaissances dont il était maître, il chercha s’il ne pourrait point composer un nouvel enduit, qui sécherait à l’ombre. Il essaya de plusieurs substances, pures ou mélangées. Il trouva que l’huile de lin et l’huile de noix perdaient le plus prompte ment leur humidité, surtout quand on les avait fait bouillir. Il y ajouta des essences, qui, par leur évaporation, accélérèrent encore ce résultat. Mais c’est le propre des âmes fortes de rêver toujours le mieux. Il poursuivit donc ses tentatives et eut la joie d’agrandir sa découverte. Il observa que les couleurs se délayaient très-bien dans l’amalgame composé par lui, qu’elles en recevaient un éclat extraordinaire, s’étendaient, se maniaient plus facilement et bravaient d’ailleurs les atteintes de l’eau: le vernis même cessait d’être utile. Quelques épreuves lui donnèrent la certitude qu’il ne se trompait point; il exécuta d’abord de petits ouvrages, puis de plus grands et finit par jouir de son secret dans toute sa plénitude. Grâce à lui, un procédé tellement vicieux qu’on n’en faisait point usage était devenu un moyen admirable, unissant la promptitude à l’excellence.
On était alors en1410. Jean Van Eyck parcourait sa vingt-cinquième année: à cet âge, l’esprit possède une grande force et y joint une souveraine indépendance. L’habitude ne l’a pas engourdi, ne l’a pas plongé dans un sommeil funeste; au moindre obstacle, il se cabre et s’impatiente. Les hommes supérieurs conçoivent presque toutes leurs idées fondamentales entre dix-huit et vingt-cinq ans: ils passent le reste de leur existence à les approfondir, à les mettre en œuvre, à les répandre autour d’eux et à former des adeptes. C’est au printemps que se nouent les fruits dont l’automne voit rougir la pulpe.
La découverte du jeune peintre excita bientôt une surprise générale. On transporta de ses panneaux en France, en Allemagne, en Italie, et, dans la disposition où se trouvaient alors les artistes, ces ouvrages produisirent un effet merveilleux. Les frères avaient d’ailleurs gardé habilement leur secret; ils se renfermaient dans leur atelier, de manière à ce que personne ne fût témoin de leur travail. Une sorte de mystère les enveloppait donc, eux et leur invention. Les princes recherchaient leurs tableaux. Le duc d’Urbin, Frédéric II, fit l’acquisition d’un de ces chefs-d’œuvre, qui représentait une salle de bain; Laurent de Médicis acheta un St-Jérôme et d’autres pièces. Des marchands florentins envoyèrent de la Néerlande au roi de Naples, Alphonse Ier, un grand panneau où se pressaient de nombreuses figures: tous les habitants du pays voulurent voir ce prodige. Les hommes du métier s’attroupaient devant les brillantes images; ils les flairaient et s’étonnaient de leur vive odeur, puis, rentrés chez eux, beaucoup essayaient d’obtenir les mêmes résultats: vains efforts qui échouaient l’un après l’autre!
Mais, si le procédé lui-même éveillait l’admiration, l’usage qu’en faisaient les deux peintres n’excitait pas moins d’enthousiasme. Au roide éclat des fonds d’or ils substituaient des perspectives pleines d’illusion. La nature s’y réfléchissait avec une telle vigueur que son image l’éclipsait elle-même. Ici l’on voyait une campagne, où se dressent de plantureuses collines, vêtues d’herbe et de mousse, couronnées tantôt de feuillages épais, tantôt de constructions féodales: un chemin y passe entre des rocs nus, mais doux à l’œil et finement exécutés; une rivière coule au milieu du paysage, sereine, limpide, bordée de fleurs; quelque ville gothique apparaît dans le lointain et perce de ses clochers le velours bleu du ciel. L’artiste poussait l’exactitude jusqu’à rendre les sentiers presque invisibles qui traversent les champs, et longent ou coupent les voies plus fréquentées. Sur d’autres panneaux se déroulaient de magnifiques intérieurs, soit une église romane aux lourdes colonnes, étalant la broderie de ses chapiteaux, les cintres purement accusés de ses voûtes et l’ombre mystérieuse de ses grandes nefs; soit une cathédrale en arc pointu, légère, svelte, diaphane, groupant ses minces colonnettes, ouvrant ses larges fenêtres, épanouissant l’orbe de ses rosaces, effilant ses ogives téméraires et laissant tomber de ses vitraux un jour mélancolique; soit une chambre opulente, qui fait rêver le bien-être, assoupit la lumière et verse dans l’âme du spectateur une profonde paix. Si la chimie avait rendu un service éminent au jeune Van Eyck, ses connaissances géométriques lui en rendaient un second: créateur pour la deuxième fois, il trouvait les principes et révélait la magie de la perspective. Chose frappante et qui montre comme, à une époque donnée, le flux de la civilisation pousse tous les esprits vers les mêmes plages! le désir, la nécessité de rendre les effets du lointain préoccupaient alors de nombreuses intelligences. Pietro della Francesca, Paolo Uccello, Léon Baptiste Alberti, contemporains des Van Eyck, songeaient à les reproduire et cherchaient une voie pour atteindre ce but. Vasari loue les perpectives au crayon du premier: il cite du deuxième une hutte vue à distance, qui excita vivement l’attention, parce qu’elle était dessinée d’après les lois de l’optique: mais il relève aussi dans leurs esquisses plusieurs fautes contre ces mêmes lois. Ils traitèrent du reste le sujet par écrit, mais leurs opuscules n’obtinrent pas les honneurs de l’impression. Léon Baptiste Alberti composa trois livres sur la peinture, dont la plus ancienne édition parut à Bâle en1540. Ils ne devancèrent point toutefois le grand penseur du Nord: deux d’entre eux étaient à peine sortis de l’enfance, lorsqu’il abordait cette région inconnue; Paolo Uccello lui-même avait quelques années de moins. La surprise extraordinaire que firent naître en Italie ses derniers plans, surprise attestée par Facius, auteur de l’époque, montre d’ailleurs qu’ils y semblaient totalement neufs. L’homme venait de conquérir l’étendue; près de l’espace réel il pouvait déployer des espaces imaginaires, des espaces sans bornes, et entrainer la rêverie dans l’immensité.,
Mais cette découverte n’était pas simple: elle en renfermait deux autres, comme nous l’avons va; elle permit à Jean Van Eyck de créer le paysage et de retracer l’intérieur, soit des édifices religieux, soit des monuments civils et des demeures particulières.
Sur ses gazons, sur les plates-bandes de ses jardins, au milieu de ses fraîches campagnes, dans ses beaux vases de cuivre, il dessina des fleurs élégantes, vraies comme la nature, idéales comme la poésie. L’œillet, la pensée, la marguerite, la violette, le mélilot d’or s’épanouirent sous ses doigts; le lys ouvrit ses blanches pétales pour décorer les Annonciations; les rosiers se chargèrent de touffes vermeilles pour couronner les groupes de l’Agneau mystique.
Entre les herbes, dans le feuillage de ces plantes gracieuses, Jean Van Eyck peignit des animaux de toute sorte: la pie, le merle, le rouge-gorge, le chardonneret, le paon majestueux, la vive alouette, le lièvre, le lapin, le cerf gambadèrent, trottèrent, voltigèrent au milieu de ses points de vue. Les oiseaux de passage, emblèmes de l’espérance, y traversèrent l’azur du firmament, où le spectateur les suit d’un œil pensif. Les climats lointains fournirent même leur tribut à ces grandes solennités de la nature: la perruche frissonna entre les mains du Christ, sur les genoux de sa mère.
Ce n’était pas encore assez pour ce vaste génie. De même qu’il sentait la noblesse, la pureté des sujets chrétiens, il sentait le charme prosaïque des sujets vulgaires. Des hauteurs de l’inspiration, il descendait peu à peu, comme un cygne qui reploie ses ailes, dans les vallées fécondes de l’existence commune. Enfant d’une région positive, il n’oubliait pas la vie habituelle. On admirait au quinzième siècle, chez un cardinal Octavien, un tableau de genre assez hardi: on y voyait de très-belles femmes, sortant du bain et toutes nues, sauf un léger voile qui cachait leur sexe; l’une d’elles, aperçue de face, était placée de manière que son dos se réfléchissait dans un miroir, en sorte qu’on la distinguait parfaitement des deux côtés. Une lanterne éclairait la pièce et semblait vraiment lumineuse; on y remarquait une vieille femme en sueur, un chien qui lappait de l’eau. Une ouverture ménagée habilement laissait découvrir, dans les lueurs du soir, des montagnes, des bois, des villages, des forteresses, des hommes et des chevaux, si bien exécutés qu’ils paraissaient à une grande distance les uns des autres. Mais ce qu’on ne se lassait point d’examiner, c’était un miroir où tous ces objets se trouvaient réfléchis comme dans une glace véritable. Jean avait aussi fait un paysage, au milieu duquel des pêcheurs poursuivaient une loutre. Même lorsqu’il ne traitait point de semblables données, lorsqu’il exécutait et vivifiait un épisode religieux, les détails de ses fonds tenaient beaucoup du genre. Les formes, les circonstances de la vie journalière y sont reproduites avec le plus grand soin. Ce fut comme une révélation de la poésie intime.
Une espèce de travail bien différent, où l’homme oublie le réel et s’aventure dans les campagnes sans bornes du monde abstrait, l’allégorie, tenta le pinceau de Jean Van Eyck. Son ouvrage le plus étendu, la célèbre Adoration de l’Agneau mystique, n’est qu’un vaste symbole. Il se fit un plaisir de le considérer, de l’exposer dans tous ses détails et dans toute sa profondeur. Les liens qui l’unissent à la Bible, à l’Évangile, aux questions religieuses et à la destinée humaine sont indiqués l’un après l’autre. Karel Van Mander parle d’un tableau, où un jeune homme et une jeune fille se tendaient la main en signe d’alliance, et où la Fidélité les rapprochait pour les unir. Ces emblèmes devinrent très-fréquents dans la seconde moitié du seizième siècle. Quoique ce chemin aride, soit peu favorable aux arts qu’il détourne de leur vrai but, l’étonnant chercheur eut du moins la gloire de l’ouvrir.
La figure humaine avait jusqu’alors été reproduite d’une manière défectueuse, quand il s’agissait d’en peindre les caractères individuels. On dessinait bien les lignes générales, les formes communes à toute l’espèce, mais les variétés accablaient, mettaient en défaut l’inexpérience de l’artiste. Les moyens étaient d’ailleurs si bornés qu’on ne pouvait rendre les tons infinis de la chair. Jean Van Eyck créa le portrait. Avec son procédé, il imita les nuances les plus vives, les teintes les plus légères, il dégrada subtilement les couleurs; la perspective ne lui fut pas d’un moindre secours: il en appliqua les principes à la face de l’homme, il accusa d’une manière fort habile les divers plans qu’on y remarque, les saillies, les biais et les cavités; sa pénétrante observation lui permit d’ailleurs de l’étudier sous tous les aspects, d’en saisir toutes les modifications. Ses panneaux, pleins d’une admirable exactitude, réfléchirent les traits des princes et des bourgeois, comme une source immobile, qui dort dans l’ombre et le silence, au milieu d’une antique forêt. Les paysages de ses fonds augmentent la similitude. Le chanoine Van der Paele, Philippe le Bon, Isabelle de Portugal, Nicolas de Maelbeke, Jean de Leeuw, Judocus Vydt, sa propre femme, son frère et lui-même brillent ainsi dans le miroir trouvé par son génie.
L’art du peintre verrier lui eut aussi des obligations. Jusqu’alors on coloriait le verre dans la masse et il fallait employer un morceau différent pour chaque teinte du vitrail. On multipliait donc les sinuosités du cadre métallique. Jean Van Eyck empêcha la matière colorante de pénétrer toute l’épaisseur du verre; il sut l’arrêter, par un coup de feu dirigé à propos, avant qu’elle l’eût assombri d’outre en outre; elle atteignait la surface, mais épargnait le fond. Il creusait ensuite la première à l’émeril, jusqu’à la portion demeurée blanche ce champ recevait un émail d’une autre nuance ou d’une autre couleur; on obtenait de la sorte des fragments très-étendus, sans avoir besoin de recourir aux châssis de plomb. Ces facilités nouvelles changèrent le goût et les habitudes des peintres verriers; aux mosaïques transparentes de l’âge antérieur succédèrent les tableaux diaphanes comme ceux de Cologne et de Sainte-Gudule. Le Limbourgeois fit une révolution complète.
Telles furent les découvertes de cet homme extraordinaire. La peinture à l’huile, la perspective, le paysage, les intérieurs, les animaux, les fleurs, les scènes de genre, l’allégorie, le portrait et l’art du verrier occupèrent tour à tour son esprit. Ces ressources et ces formes acquirent seulement alors une haute valeur: il les introduisit le premier dans le domaine absolu de l’art, où ne pénètrent ni la complaisance, ni les jugements relatifs. Il changea en vérités puissantes d’imparfaites ébauches, en méthodes vigoureuses d’inutiles moyens. Il a parcouru toutes les voies où ont marché plus tard les peintres flamands; ceux-ci ont été des hommes spéciaux: l’un a colorié des scènes religieuses, l’autre des intérieurs, des paysages, le troisième des tableaux de genre, des portraits, le dernier des fleurs, des animaux, des toiles grotesques; chacun a fait son choix, la division du travail a été appliquée à la peinture. Jean Van Eyck, leur maître et leur précurseur, n’a rien divisé; il a conduit de front les talents, les essais les moins pareils; il lança dans la carrière ce noble attelage, le stimula d’une façon égale et le tint réuni d’une main toujours ferme, toujours habile. En lui nous apparaît la synthèse de l’art des Pays-Bas; un rayon divin tombe de sa lumineuse couronne sur le front de tous ses héritiers. Ce qu’Ho mère fut pour la Grèce, il l’a été pour la Néerlande; les peintres flamands lui durent l’inspiration, comme les poètes antiques l’allaient chercher dans les récits de l’aveugle immortel. C’est une des plus grandes intelligences que Dieu ait armées de sa force créatrice; on peut même dire que, parmi les initiateurs à l’amour du beau, il n’en est pas un seul auquel des renseignements positifs et des preuves matérielles permettent d’attribuer un nombre égal de découvertes. Dans l’empire des beaux-arts, il règne donc, jusqu’à nouvel ordre sur le trône glorieux de l’invention.
Qui le croirait cependant? Monté si haut, parvenu si loin, après avoir si fort agrandi l’horizon de la peinture, après avoir développé son talent au delà de toutes les bornes connues, il se trouvait lui-même trop faible pour sa tâche! Plein de cette aspiration illimitée, qui emporte le génie dans les espaces, comme l’oiseau Roc emportait Sindbad le voyageur, il discernait au loin des régions splendides qu’il n’espérait pas atteindre: ses couleurs étaient sans doutes brillantes, ses lignes nettes, ses fonds charmants, son pinceau véridique, mais il ambitionnait, il rêvait bien autre chose! Au fond de son intelligence rayonnaient de plus merveilleux tableaux: là, les formes paraissaient exquises, les teintes lumineuses comme dans la nature, les campagnes fraîches et vivantes; le soleil portait un diadème de flamme, la rosée tremblait sur les feuilles, l’herbe croissait et verdoyait, les fleurs entr’ouvraient leurs douces corolles ou penchaient leurs têtes languissantes. Que devenaient les panneaux près de ces magiques visions? Ils semblaient ternes, froids, insipides. L’artiste écrivait donc au bas de la peinture infidèle, sur le cadre même qui l’environnait: Als ikh kan, Comme je puis, selon mes forces. Mots touchants, devise noble et candide, où étaient exprimées la conscience ingénue du peintre et la grandeur qui lui faisait dominer ses propres ouvrages! Signe d’une époque de foi, d’amour et de calme inspiration! Souvenir d’un enthousiasme qui remplissait le cœur de l’artiste et que bien peu d’hommes possèdent maintenant!