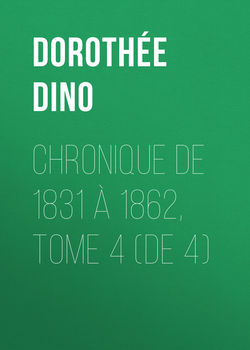Читать книгу Chronique de 1831 à 1862, Tome 4 (de 4) - Dorothée Dino - Страница 1
1851
ОглавлениеSagan, 1er janvier 1851.– Cette date fait naître plus de pensées sérieuses et graves qu'elle ne permet d'espérance et qu'elle n'offre de joies. Que nous donnera cette année que nous inscrivons aujourd'hui pour la première fois? Que de mystères elle renferme!
Sagan, 7 janvier 1851.– Je pars dans quelques heures pour Berlin où la grippe règne épidémiquement. D'après les derniers relevés, soixante mille personnes en étaient atteintes. Cette vilaine grippade, partout où elle a régné, a été le précurseur du choléra. Ainsi, il se pourrait bien que ce grand moissonneur se réveille sur nouveaux frais pour une nouvelle récolte. A la garde de Dieu!
Je pense trouver Berlin fort à la paix pour ce qui regarde l'est de l'Europe. C'est pour l'instant le principal. Quant à Dresde, je ne crois pas qu'on y parvienne à résoudre promptement toutes les questions pendantes. L'équilibre est bien difficile à retrouver, après de si formidables secousses.
Berlin, 9 janvier 1851.– Le Cabinet Manteuffel a eu la majorité dans les deux Chambres, pour empêcher la reprise de la discussion de l'Adresse1. Tous les ministres, à cette occasion, ont fort bien parlé, déclarant qu'ils étaient décidés à briser sans retour avec la révolution.
Je ne sais pas encore grand'chose, n'ayant vu que la Mission anglaise. A tout prendre, j'ai cependant aperçu que si les gens sages sont satisfaits de la paix, chacun se sent plus ou moins humilié des reculades nécessaires; on reste abattu et sérieux. M. de Manteuffel, que j'ai rencontré sortant de la Chambre, et qui a arrêté ma voiture, m'a dit qu'il était fort préoccupé des nouvelles de France; que Hatzfeldt, dans ses dépêches, le préparait à de nouvelles crises.
Berlin, 11 janvier 1851.– On est assez sérieux ici, socialement. Hier cependant il y a eu un joli concert à Charlottenburg, et les physionomies étaient assez ouvertes. M. de Manteuffel est retourné à Dresde, pour y passer quarante-huit heures et prendre congé du prince Schwarzenberg qui repart définitivement pour Vienne. Dresde marche clopin-clopant; cependant, on y cherche, et on croit y trouver une solution. Il est question, mais vaguement encore, d'envoyer le comte d'Arnim-Heinrichsdorf à Vienne.
On se montre, ici, très préoccupé des destinées de la France et de l'état critique qui s'y révèle de plus en plus. M. de Persigny a laissé un triste renom. On est satisfait de son successeur, qui a une chétive mine, mais qui est poli et sans jactance2.
Humboldt se porte étonnamment bien, mais sa politique est, à mes yeux, moins belle que sa mine.
Berlin, 15 janvier 1851.– Les agitations politiques parisiennes préoccupent ici3, mais cependant l'attention du public est toujours principalement tournée vers Dresde d'où il paraît que le baron de Manteuffel est revenu de bonne humeur, il y a deux jours. Hier au soir, ses salons étaient remplis. J'y ai paru un instant, tout le parti conservateur s'étant promis de s'y rendre.
M. Thiers est aux pieds de Mme de Seebach, disant qu'elle n'est pas jolie, mais qu'elle a de l'élégance dans l'esprit. On dit aussi qu'il écrit souvent à la Reine des Pays-Bas, et que ces commerces féminins le consolent des mécomptes de son ambition.
Berlin, 17 janvier 1851.– J'ai vu hier la Reine, qui était venue de Potsdam pour voir la nouvelle chapelle que le Roi a fait construire dans le Château, et où on a fait le premier essai de la musique qui y sera exécutée demain à la fête des Ordres4. Cette chapelle, dans le style byzantin, est grande et vraiment très belle; les proportions en sont vastes, la coupole surtout imposante. La musique y fait un fort bel effet.
La seconde Chambre paraît pousser le Cabinet à la dissolution, en le taquinant et l'entravant sans cesse.
La première Chambre est aussi ministérielle que la seconde l'est peu.
Berlin, 19 janvier 1851.– Je vois avec peine qu'en France le gâchis est à son comble; c'est le nivellement le plus complet. Pas un nom, pas une individualité qui ressorte et qui se détache sur ce fond boueux.
Ma vie ici est sans chocs, sans contrariétés, mais aussi sans grand intérêt, et les journées effiloquées par mille petites obligations sociales me laissent l'âme assez vide. Il n'y a ni grandes fêtes, ni grandes fatigues, mais une mauvaise coupe d'heures, et une série de petits devoirs auxquels on ne peut se refuser, qui heurtent ma paresse et effarouchent ma sauvagerie, deux dispositions qui vont fort en augmentant.
Berlin, 23 janvier 1851.– M. de Radowitz est revenu avant-hier d'Angleterre, ce qui fait naître bien des inquiétudes, et aussi bien des espérances, et jette, de toutes parts, une certaine agitation dans les esprits surtout, le Roi ayant dit tout haut, à table, qu'il l'avait appelé auprès de lui.
Berlin, 25 janvier 1851.– Avant-hier, à un grand dîner chez Prokesch, le ministre d'Autriche, on m'a assuré qu'à Dresde tout allait bien entre la Prusse et l'Autriche, mais que les petites puissances leur donnaient beaucoup de fil à retordre. En attendant, il y a tous les jours ici des revues pour inspecter les régiments de la Landwehr, qui rentrent dans leurs foyers; cependant, le désarmement ne va pas aussi vite que le voudrait le ministre des Finances, et que les populations le demandent.
Berlin, 1er février 1851.– J'ai dîné avant-hier à Charlottenburg, avec le comte de Sponneck, danois arrivant de Vienne et s'arrêtant ici pour y terminer l'interminable question danoise.
Quelqu'un de fort avant dans la haute diplomatie me disait hier que, depuis que Schwarzenberg avait écarté Schmerling du Cabinet de Vienne, il s'y était grandement fortifié et avait éliminé un dangereux intrigant. Ce n'est pas un autrichien qui m'a tenu ce langage.
Berlin, 5 février 1851.– L'Archiduc Léopold est venu, de Hambourg, faire une pointe ici. Il y est arrivé hier; je l'ai vu le soir, en petit comité, chez le ministre d'Autriche. Il est grand, beau, gai, naturel, aimable, avec cette rondeur et cette bonhomie autrichienne qui a de la grâce. Il m'a beaucoup plu. Aujourd'hui, il y a parade en son honneur à Potsdam, demain ici. Il repartira le 8, je crois, pour son corps d'armée.
Berlin, 7 février 1851.– A la Cour, avant-hier, tout avait fort bel air; les femmes en grand habit; le cercle suivi d'un superbe concert exécuté dans la grande salle blanche. Le Roi portait le cordon de Saint-Étienne, en l'honneur de l'Archiduc.
Hier matin, pour le même objet, grande parade. Le soir, grande soirée chez le ministre d'Autriche, où tous les Princes, par exception, se sont rendus, sauf le Prince de Prusse.
Le Roi, après la parade d'hier, a porté, lui-même, le grand cordon de l'Aigle noir à l'Archiduc. Pendant la parade, il a fait jouer l'air national autrichien. Que tout cela est étrange par la rapidité des changements de scènes, sans transition! Ce qui est triste, c'est qu'il n'y a là aucune garantie contre un changement également rapide en sens contraire.
Berlin, 23 février 1851.– Les nouvelles de Dresde ne semblent pas très rassurantes; les petites puissances se montrent toujours difficultueuses, récalcitrantes; les grandes puissances qui pourraient, qui devraient s'entendre pour les soumettre, se combattent par des rivalités hors de saison.
La France proteste contre l'incorporation des provinces lombardo-vénitiennes; la Prusse veut ravoir Neuchâtel; Mazzini agite l'Italie et aiguise partout des poignards; ses émissaires arrivent même dans le Nord, et la police prussienne commence à avoir l'éveil sur leur présence ici, mais cette police est d'une maladresse proverbiale. Le Hanovre se met aussi à faire son petit bout de libéralisme, intempestif, incommode, déplorable, et cela parce que le vieux Roi baisse visiblement, que son ministre principal est actuellement M. de Münchhausen, qui a des tendances pour le parti de Gotha5 et qui est soutenu par la toute-puissance de la comtesse de Grote, dont il est le gendre. Les intrigues Bunsen-Cobourg-Gotha brochent sur le tout. Le Prince Albert, qui voit son frère sans enfants, vise à l'agrandissement du duché de Cobourg et à la formation d'une espèce de royaume de Thuringe pour son second fils, et il s'agite, à cet effet, par tout moyen.
La Reine Victoria a invité le Prince et la Princesse de Prusse à venir à Londres pendant la fameuse Exhibition6.
Sagan, 1er mars 1851.– Me voici rentrée dans mon silencieux séjour, qui m'a souri à travers le neigeux linceul qui le recouvre. Je m'étais couchée tard, avant-hier, à Berlin, ayant été au bal donné par mes amis les Radziwill. J'avais eu, à la veille d'un départ, grande envie de m'en dispenser, mais ils tenaient à ma présence, surtout au souper, afin de me placer à côté du Roi, qu'on prétend que je fais causer, et que je divertis plus qu'une autre. Je ne le pense pas, car je me trouve on ne saurait moins divertissante, mais enfin j'ai voulu être agréable à de bons et excellents amis d'enfance, et je suis restée. A ce bal, le ministre Manteuffel est venu dire au Roi qu'il venait de recevoir par télégraphe la nouvelle que lord Stanley avait accepté le Ministère, et qu'il allait dissoudre la Chambre des Communes. A l'examen, il s'est trouvé que cette nouvelle venait, non pas de Londres, mais de Paris, et par voie télégraphique il est vrai, mais adressée à une maison de commerce; les Westmorland la mettaient donc en doute. La grande affaire de l'Europe entière, c'est la retraite de lord Palmerston; si elle ne se vérifie pas, on n'aura rien gagné7.
Sagan, 7 mars 1851.– Les tristes prévisions que j'entends faire sur l'état politique du monde me préoccupent d'autant plus que je voudrais fort, du mois de mai prochain en un an, voir la France, l'Allemagne et l'Italie se maintenir sans nouvelles explosions. Mais quelle outrecuidance que de jeter ses regards et de pousser ses exigences aussi loin! Hélas! Possédons-nous seulement le lendemain?
Sagan, 9 mars 1851.– Je vois avec douleur lord Palmerston reprendre sa place. Lors même qu'il n'y resterait pas longtemps, il aurait toujours le loisir d'y faire du mal, surtout d'en faire au Continent déjà si malade; il faut, hélas! si peu de jours pour faire un mal incalculable!
Sagan, 19 mars 1851.– J'ai reçu hier une lettre de Mme Alfred de Chabannes qui habite Versailles, mais dont le mari est à Claremont. Elle est dévouée à la Maison d'Orléans, mais comme elle est sensée et éclairée, elle juge sans aveuglement, et j'ai été frappée de trouver ce qui suit dans sa lettre: «Mes amis de Claremont vont dans l'abîme. Quel horrible article dans l'Indépendance belge, en réponse à la lettre si digne du Comte de Chambord8.
«Je suis au désespoir. Nos bonnes têtes, les conservateurs habiles, passent aux légitimistes, les brouillons, tels que Thiers et autres, aux républicains modérés. Ma chère Duchesse d'Orléans sert de prétexte à ces derniers; ils la trompent; leur plan est d'avoir Mgr le prince de Joinville pour président de la République, et c'est là le vrai but de la proposition Creton9; c'est l'anguille sous roche que Berryer a devinée. Les douleurs de cette pauvre Duchesse d'Orléans sont les miennes; elle maigrit, elle change; ils la tueront à force de tracas. Elle va retourner à Eisnach; la Reine sa belle-mère se rendra en Belgique; les Aumale et Joinville à Naples, les Nemours en Autriche.»
Dans une lettre que j'ai reçue du marquis de Dalmatie, il me répète à peu près les mêmes choses, disant que Thiers, honni, conspué par tous les partis, impopulaire partout, n'en reste pas moins le plus actif et le plus habile instrument du mal. Il déplore, non moins que ma cousine de Chabannes, qu'à Claremont on soit aussi complètement la dupe de Thiers, qui règne absolument sur les esprits de cette pauvre famille. Le Marquis en revient au reproche qui devient bien général contre la Duchesse d'Orléans, celui de ne faire que de la politique personnelle; répétant qu'elle ne voudra jamais de la fusion, qu'elle se complaît dans le rôle de chef de parti, rôle que la fusion ferait cesser. Quant à ses beaux-frères, M. Guizot dit d'eux que ce sont d'excellents fonctionnaires, mais pas des Princes. Les légitimistes, ajoute le Marquis, qui avaient fait de grandes avances, qui se berçaient de l'espoir de toucher à la fusion, ont été tout à coup réveillés de leur rêve, quand on est venu leur demander, un peu trop naïvement, de jouer le rôle de dupes, et, après leur avoir refusé toute garantie, leur dire: «Remettez-vous-en à la loyauté de M. Thiers», qui, au même moment, était en intrigue avec la Montagne. La bonhomie des légitimistes ne pouvait aller jusque-là. Thiers a alors fait croire à Claremont que les légitimistes s'étaient indignement conduits et que l'honneur exigeait que les Princes d'Orléans rompissent tous les fils avec Frohsdorf; ils ont donné dans le panneau, et leurs dernières lettres détruisent toute espérance de fusion. Ils s'enveloppent, disent-ils, dans leur dignité, et ils congédient leurs troupes.
Pour cela, il n'ont pas grand'chose à faire.
Sagan, 21 mars 1851.– J'ai reçu une lettre de M. Molé, la plus coquette, la plus cajolante, la plus complimenteuse, la plus flatteuse, la plus tendre, la plus admiratrice qui se puisse imaginer. C'est à l'occasion du mariage de sa petite-fille, Mlle de Champlâtreux, avec le fils aîné du duc de Noailles, qu'il rompt un long silence, disons mieux, un profond oubli. Il y a deux pages sur ce mariage, une sur la politique, une autre tout imprégnée des échos du passé, de sa jeunesse, de la mienne, quoiqu'elles ne se soient jamais confondues, mais elles se sont envisagées, elles ont suivi deux routes parallèles, qui, par cela même n'ont pu se toucher, en étant, cependant, bien rapprochées.
Sagan, 14 avril 1851.– Les gazettes apportent aujourd'hui la nomination du nouveau Ministère français, et, en même temps, je trouve dans l'Indépendance belge un long article à la louange de l'énergie et de l'habileté du nouveau Ministre de l'intérieur, M. Léon Faucher, qui serait, dit-on, l'âme et le véritable chef du nouveau Cabinet. Si telle est, en effet, l'importance du personnage, il faut espérer qu'une main ferme arrêtera, momentanément du moins, le torrent socialiste, et qu'il y aura sursis aux explosions jusqu'en 185210.
Sagan, 16 avril 1851.– J'ai reçu, hier, plusieurs lettres de Paris, une, entre autres, de M. de Barante, qui représente la France comme fort malade, à la vérité, mais qui ne croit à aucune explosion prochaine, et qui semble ne prévoir de conflit sérieux que pour 1852. Il ajoute que c'est l'opinion des faiseurs de toutes les nuances; mais les faiseurs sont sujets à illusion, preuve le 24 février 1848.
L'Indépendance belge continue à prôner les mesures énergiques prises dès le début par M. Léon Faucher contre les socialistes. Dieu veuille qu'elles soient efficaces!
Sagan, 20 avril 1851. Jour de Pâques.– Un beau soleil éclaire la fête de la Résurrection. Que ne peut-il rajeunir ce vieux monde politique, comme il ravive la nature! Car, quant à l'âme, il ne dépend que d'elle de se raviver et de s'embellir; il lui faut, à la vérité, plus d'un effort pour y parvenir; souvent une santé éprouvée suffit pour paralyser la meilleure volonté; je m'en aperçois sans cesse à moi-même, qui, depuis deux jours spécialement, suis reprise d'à peu près toutes mes misères de l'année passée. Mon voyage de France pèse sur moi; pourtant, il faut y avoir été une dernière fois avant de mourir. La première communion de ma petite-fille Marie11 est une circonstance spéciale. Je voudrais parler à mes hommes d'affaires, voir mes petits-enfants que je ne connais, ou pas du tout, ou que peu, visiter le tombeau de mon oncle12 avant de prendre place dans le mien, serrer la main de deux ou trois personnes qui m'ont conservé bon souvenir, et puis en avoir fini. Mais je m'arrête, je suis en sombre disposition.
Sagan, 6 mai 1851.– Je n'entreprendrai pas mon voyage in good condition ni in good spirits. Je ne sais trop où je vais, je me sentirai seule et destitude13. Comme ce n'est ni par légèreté, ni par goût de changement ou futilité, mais bien pour accomplir un devoir de haute convenance, que je m'engage dans cette route, je veux espérer qu'elle ne me sera pas fatale.
Voilà la correspondance Mirabeau-La Marck livrée au public14. Je suis on ne saurait plus curieuse du livre et des articles qu'il provoquera dans les journaux et revues.
Hanovre, 15 mai 1851.– J'ai fait tout ce que je m'étais proposé de faire à Berlin et à Potsdam, où l'indisposition de la Reine et le voyage à Varsovie occupaient tous les esprits15. Il est question d'une visite de l'Empereur de Russie à Olmütz, d'y réunir les trois potentats du Nord. On espère les Majestés russes à Berlin, pour l'inauguration, fixée au 31 mai prochain, du beau monument de Frédéric le Grand16. Ici, à Hanovre, on est redevenu fort prussien, depuis la course que le vieux Roi a faite à Schwerin et à Charlottenburg.
Bruxelles, 16 mai 1851.– Arrivée hier soir ici, je viens de recevoir une très gracieuse lettre de la Reine Marie-Amélie, qui m'annonce que le Roi Léopold, voulant profiter aussi de ma présence, m'engage à dîner demain à Laeken, mais que je devrais arriver une heure avant, pour qu'elle puisse me voir seule.
J'irai dans la matinée, aujourd'hui, voir les Metternich.
Paris, 19 mai 1851.– Me voici dans Babylone. J'y suis arrivée hier à cinq heures du soir. A Laeken, j'ai été touchée de l'accueil qui m'a été fait par belle-mère et gendre; mais j'ai été effrayée du changement du prince de Joinville, complètement sourd, courbé, voûté, grisonnant, abattu, silencieux, sauvage. Il me semble que si on le voyait ainsi en France, il n'y paraîtrait redoutable à personne.
Paris, 23 mai 1851.– Je voudrais pouvoir écrire longuement, mais on sait ce que c'est qu'un vol à travers Paris. J'y suis traquée, abîmée, et cependant je ne le quitterai que le 31, et cela sur le désir de l'évêque d'Orléans17, que j'ai vu longuement hier. Il veut faire route avec Pauline et moi; il veut me montrer lui-même l'établissement de la Chapelle18 où sont mes petits-fils; il veut que je dîne à l'Évêché; bref, il veut de si bonne grâce qu'il n'y a pas moyen de s'y refuser sans en avoir une très mauvaise.
J'ai fait la connaissance de M. de Falloux, qui a parfaitement répondu à l'idée que je m'en étais faite, et c'est une chose qui, en bien ou en mal, se rencontre fort rarement. J'ai vu bien d'autre monde encore; mais l'intérêt qu'offre la curiosité satisfaite me manque complètement, car je n'ai plus aucune curiosité, du moins celle des personnes, et le temps me manque pour satisfaire celle des choses. J'ai été cependant avec la maréchale d'Albuféra assister à une représentation d'Adrienne Lecouvreur à la Comédie-Française, mais cela m'a fait veiller, car tout se passe bien tardivement ici; on y dîne aussi très tard, et cela ne me va pas du tout.
Je n'ai point encore vu la princesse de Lieven, malgré deux essais réciproques; mais il me faudra aujourd'hui passer sous les fourches caudines.
Paris, 25 mai 1851.– L'horizon politique s'obscurcit sur nouveaux frais. Les Burgraves croient à des éruptions volcaniques pour le mois de juin. Est-ce du 15 au 20, ou du 20 au 30 que la bombe éclatera? Voilà où on en est.
Une espèce de Jacquerie a commencé en Berry aux environs du château du duc de Mortemart19. On y met le Château en état de défense.
Paris, 27 mai 1851.– M. de Falloux viendra assister à Marmoutiers à la première Communion de Marie20. Il paraît qu'il m'a prise à gré; c'est on ne saurait plus réciproque. Je lui sais d'ailleurs bien bon gré de m'avoir offert quelqu'un à estimer au complet. Lui, l'Évêque et le cher Chatelain sont ici les êtres avec lesquels je me plais, sans oublier cependant le doux et aimable Barante.
Paris, 31 mai 1851.– Hier, à dîner, chez M. Molé, on parlait de votre livre21, dont, en tout, on parle beaucoup, pour louer le rôle que vous avez dans cette publication, ainsi que la manière dont vous l'avez saisi et rempli. Celui que vous donnez à M. d'Arenberg et le jour sous lequel vous l'avez placé l'ont fort grandi aux yeux de tous. Quant à Mirabeau, il me semble diminué, amoindri dans l'opinion qu'on avait de ses ressources d'habileté, sans se relever du mépris qu'inspirait son caractère.
J'ai dîné avant-hier chez Mme de Lieven. J'ai eu la satisfaction qu'elle m'a trouvée stupide et qu'elle me l'a dit assez clairement pour me faire espérer qu'elle le dirait et répéterait dans ses lettres vertes, si fort en circulation dans toute l'Europe22. Du reste, tout s'est passé très poliment entre nous. Seulement, elle a voulu me produire à son Club du dimanche23, à quoi je me suis absolument refusée, mais sous des prétextes plausibles et qui n'avaient rien de désobligeant.
Je pars ce soir. Je passerai la journée de demain à Orléans, et après-demain j'irai à Valençay.
Valençay, 3 juin 1851.– Je me sens fort tristement émue ici, par ce qui est resté, par ce qui a été déplacé, par les ressemblances, par les différences…
Valençay, 5 juin 1851.– Mme de Hatzfeldt est arrivée ici seule24, son mari ayant été retenu à Paris par l'intempestive éloquence du Président au banquet de Dijon. A cette occasion, on m'écrit de Paris ce qui suit: «L'incartade du Président à Dijon assombrit encore notre horizon. Elle remet tout en question et la discorde éclate plus violente que jamais. La dégradation du gouvernement, obligé de nier et de se rétracter, est à son comble et ne profite cependant à personne. Je ne crois pas la tranquillité matérielle en jeu pour le moment, mais le chaos de 1852, l'œil seul de Dieu peut le percer.»
Rochecotte, 14 juin 1851.– Je suis arrivée ici hier dans la soirée, ce qui n'a pas laissé de m'émouvoir. On inflige de grands supplices, soit au cœur, soit à la conscience, par cette vie rétrospective que je mène depuis près d'un mois; je veux espérer qu'elle est salutaire à l'âme.
Le Mans, 20 juin 1851.– M. de Falloux est arrivé avant-hier à Rochecotte. Il nous a apporté les lettres familières du comte Joseph de Maistre, qui viennent de paraître, et nous en a lu quelques-unes, qui sont dignes de ce grand penseur et de cet écrivain si original.
Les deux premiers volumes de l'Histoire de la Convention par Barante se publient ces jours-ci. Il est heureux que cette terrible époque soit traitée par un honnête homme.
Paris, 27 juin 1851.– Je pars demain pour Bruxelles; je serai, Dieu aidant, à Bade le 1er juillet.
Il y eut ici une interruption dans la correspondance, qui ne reprit qu'après le séjour de Bade.
Wurtzburg, 11 août 1851.– Nous sommes arrivées ici sans encombre. Hier au soir, nous nous sommes fait conduire au vieux Château de Heidelberg. Le soleil s'est couché pittoresquement derrière les ruines; l'air, la couleur, le paysage, tout était beau.
Aujourd'hui, j'ai beaucoup lu: j'ai fini les deux volumes de M. de Maistre; je les ai lus crayon en main. Il se trouve dans cette correspondance des lettres de M. de Bonald que je préfère à celles de M. de Maistre; aussi élevées, elles sont plus simples, plus serrées, et plus françaises en fait de style. Cependant, je suis assez sous le charme de M. de Maistre, quand il est sérieux; je ne l'aime guère quand il plaisante, quoique l'esprit ne manque jamais, seulement ses ailes ont quelquefois du plomb dans leurs plumes. M. de Maistre, le fils, a eu une heureuse et vengeresse idée en publiant les lettres de l'abbé de Lamennais et de M. de Lamartine adressées à son père, et qui, par la différence du point de départ, font encore mieux ressortir l'infamie du point d'arrivée.
Bamberg, 17 août 1851.– Les journaux qui nous ont été prêtés ici à l'auberge disent que décidément le prince de Joinville accepte toutes les candidatures: députation, présidence, tout lui convient; il se prête à tout. Il ne manquait que cet abaissement de plus pour assurer le progrès des rouges, car les légitimistes, auxquels à Claremont on a refusé la fusion, préféreront voter pour les candidats de la Montagne, à voir revenir un Orléans sans un Bourbon, et les bonapartistes en feront autant. Il paraît qu'un manifeste fort travaillé du prince de Joinville va être lancé dans le public. En attendant que je le lise, j'ai lu aujourd'hui le petit volume de la comtesse Hahn, intitulé De Babylone à Jérusalem. Il est intéressant, surtout pour qui connaît ses précédents ouvrages, pour qui la connaît elle-même. Il est d'ailleurs intéressant pour la foi; il est écrit avec verve et talent; il répond aux objections courantes des gens du monde ignorants contre le catholicisme; mais je ne suis pas bien sûre que sa conversion, du reste fort sincère, lui ait fait rencontrer en chemin l'humilité; je serais un peu tentée d'en douter; il faut bien qu'elle parle d'elle puisqu'il s'agit de son voyage spirituel, mais il y a façon de le faire; puis, tout en abjurant tous ses écrits précédents, tout en répétant qu'elle n'en sait plus une ligne, qu'elle a tout oublié, elle se cite elle-même sans cesse… Ce petit livre peut avoir une utilité réelle pour les autres; c'est donc une œuvre méritoire; mais lui sera-t-il utile à elle? Il me semble que si j'étais son confesseur, je dirais que non; mais, comme je n'ai point ce difficile honneur, je n'ai point à me faire une opinion à cet égard.
Taunenfeld, près Lœbichau, 20 août 1851.– J'écris d'un pavillon, à une lieue de Lœbichau, que j'ai habité dans mon enfance, qui m'appartenait, dont la situation est fraîche et jolie, et où ma sœur s'est établie pendant qu'elle fait faire des réparations urgentes à Lœbichau. Je vais aller tout à l'heure, dans la partie sombre du parc, où un tertre de gazon sans clôture et une croix de fer indiquent le lieu de repos de notre mère et de notre sœur Pauline25. Je n'aime pas cette façon presque païenne, du moins peu catholique, de déposer des restes chéris. Encore est-il trop heureux que la croix s'y trouve! Mais ce bois ouvert, ces allées tournantes, ces massifs de fleurs jardinières, tout cela m'est parfaitement antipathique. J'aime une certaine austérité recueillie (qui n'ait rien de trop lugubre) pour les tombeaux; mais, avant tout, une défense sûre contre toute profanation, une barrière qu'il faille ouvrir, un verrou à tirer, une cloche à sonner. Ce n'est pas le hasard d'une promenade, peut-être joyeuse, qui doit nous conduire auprès de ceux qui nous ont quittés pour nous attendre ailleurs. Il faut savoir qu'on va à eux, il faut le vouloir, et y arriver dans une certaine disposition de l'esprit, du cœur, de l'âme…
J'ai reçu une lettre de Paris, de ma cousine Mme Alfred de Chabannes, dans laquelle il y a le passage suivant:
«Ici, la situation politique devient honteuse pour ma couleur. La candidature du prince de Joinville a reçu son adhésion, s'appuyant sur les républicains avancés. Je doute qu'on sache le fond de cette intrigue à Claremont; même, j'en suis sûre, le Journal des Débats qui nous était favorable ne suivra pas cette ligne désastreuse. Si, du moins, Mme la Duchesse d'Orléans voulait comprendre tout ce qui se passe, et qu'elle restât en Allemagne au lieu de n'y faire qu'une course. Thiers est au fond de toute cette détestable intrigue; il joue la Princesse et cela depuis longtemps. Il jouera de même le prince de Joinville, pour consolider la République à son profit personnel. Il est bien douloureux de voir ceux qu'on aime lancés à pleines voiles sur une semblable mer, celle des révolutions. J'en suis au désespoir.»
Sagan, 8 septembre 1851.– J'attends aujourd'hui le Roi pour dîner, et demain dans l'après-midi, il continuera sa route. Heureusement que la pluie diluvienne d'hier a cessé et que, pour l'instant, le soleil luit et le ciel est pur.
Sagan, 10 septembre 1851.– Le temps n'est pas beau ici; cependant, il n'est pas tombé une goutte de pluie pendant le temps que le Roi a bien voulu y rester. Seulement, s'il faisait clair, il faisait froid. Mais cela n'a pas empêché le Roi de vouloir se promener à pied, en phaéton, de vouloir tout regarder, de s'amuser des progrès qu'il remarque entre chacun de ses voyages. Il était de la meilleure humeur du monde, content de tout, gracieux, en train, drôle; bref, tout à fait entraînant comme il sait l'être; pour moi, plus affectueux que jamais. En m'embrassant à l'adieu, il a passé à mon bras un petit bracelet fort simple et d'autant meilleur goût, sur lequel se trouve gravé: Donné par l'amitié. Un petit médaillon s'y trouve accroché, contenant, sous de l'émail bleu, des cheveux de la Reine. Quel dommage que cet aimable homme soit… Roi!
Il avait dans sa suite, très nombreuse, un officier autrichien, le baron de Hammerstein, qui lui avait été assigné pour l'accompagner dans les États autrichiens et auquel il a fait la politesse de l'inviter à le suivre jusqu'à Berlin.
J'ai lieu de croire que le Roi a été content de son passage par l'Autriche, et que la satisfaction a été réciproque à l'entrevue d'Ischl26.
Sagan, 20 septembre 1851.– Voilà la duchesse de Maillé morte; voilà la vicomtesse de Noailles morte. Ces deux dames n'avaient que quelques années de plus que moi. Toutes deux bien douées, encore à l'âge où l'on peut se croire un certain sursis; l'une portant avec courage de grands désastres, l'autre jouissant d'une très belle existence. Rien n'y fait, rien n'abrite le bonheur, ni l'infortune; si j'avais quelque chose à apprendre sur ce grave chapitre, ces deux événements me frapperaient encore plus, mais, en vérité, je suis bien habile sur le néant. Disons-nous, au milieu de tout ce qui périt et de cette banqueroute absolue qui est la vie, que l'affection, celle que nous ressentons nous-mêmes, encore plus que celle que nous pouvons inspirer, est un bien, un trésor, qu'il nous est accordé d'emporter dans le grand par-delà. Quoi de plus beau, en effet, que de se sentir encore, au couchant de la vie, la faculté d'aimer, de croire et par conséquent d'espérer.
Sagan, 1er octobre 1851.– Non, je ne crois pas que l'âme la mieux préparée, la plus détachée des choses d'ici-bas, soit pour cela obligée d'éteindre tous les besoins du cœur. Je crois au contraire que rien n'est plus doux, plus tendre, plus dévoué que l'âme détachée, parce qu'elle ne doit être détachée que de l'égoïsme personnel; par conséquent, elle doit se faire toute à tous, aimer mieux, aimer avec une abnégation plus parfaite.
Sainte Thérèse dit que la grande punition infligée à Lucifer était de ne plus pouvoir aimer. Il y a des dévots secs, arides, impitoyables, orgueilleux; ou bien il y a des ascétiques qui, ermites dans une grotte sauvage, ont rompu tout commerce avec les hommes. Mais ces ermites eux-mêmes se sont mis à aimer les oiseaux, à nourrir les hôtes des bois, à aimer la nature et les créatures ailées ou sauvages, et à les apprivoiser, tant l'homme a besoin d'aimer. Nous ne serons jamais des dévots desséchés, ni des habitants du désert. Nous serons tout simplement des chrétiens dociles, humbles, ne craignant pas la mort, résignés à vivre, aimant ceux qui sont doux et honorables à aimer, et attendant en charité, paix et confiance que Dieu nous appelle et nous juge dans sa miséricorde. C'est là, je crois, le vrai travail chrétien. Le desséchement est un piège du démon; le détachement de soi et non pas des autres, c'est là l'œuvre de Dieu.
Voilà mon petit traité. A mon sens, on peut parvenir à résoudre le problème sans arriver à la démence de Pascal. Cruelle solution qu'un Dieu de bonté et d'équité ne saurait préparer à notre faiblesse!
Sagan, 7 octobre 1851.– Le duc de Noailles finit une lettre, en réponse à mon compliment de condoléance sur la mort de la Vicomtesse, par ces mots: «Tout le monde ici est triste, l'Élysée est triste, les fusionnistes et les légitimistes sont tristes, les orléanistes ne sont pas gais; la confusion est au comble, les divisions sans bornes et la prévision impossible.»
J'ai reçu hier la visite d'une belle dame, ou, du moins, d'une jadis belle dame parisienne, légitimiste de tout temps, enfin, de la marquise de La Roche-Lambert, née de Bruges, tante d'un des élèves de notre collège de Sagan. Elle revenait de Frohsdorf et retournait en France. Elle a voulu voir son neveu en passant et a cru devoir me remercier de l'intérêt que j'ai témoigné à cet enfant. Elle a déjeuné chez moi. Une de ses raisons, m'a-t-elle dit, pour demander à me voir, a été de me rapporter des paroles de Mme la Dauphine. Celle-ci lui ayant demandé quelle route elle prendrait pour retourner en France, Mme de La Roche-Lambert lui a répondu qu'elle passerait par Sagan embrasser son neveu et qu'elle me verrait en passant. Sur cela, Mme la Dauphine aurait répondu: «Ah! Dorothée. J'ai toujours eu du faible pour elle, car je l'ai connue bien jeune à Mittau, avant son mariage. Dites-lui que je me souviens d'elle, avec intérêt.» J'avoue que j'ai été fort touchée, mais fort étonnée de ces paroles, qui, du reste, me sont fort précieuses. M. de Falloux et le duc de Noailles m'avaient, à la vérité, répété que j'étais en fort bonne odeur à Frohsdorf, mais je pensais que c'était tout au plus chez la seconde génération.
Berlin, 13 octobre 1851.– Je suis arrivée avant-hier soir ici. Hier, j'ai fait ma cour à Mme la Princesse de Prusse. J'ai vu Humboldt, Prokesch et d'autres encore. De nouvelles, je n'en entends pas. Je crois qu'il n'y a rien à savoir pour le moment. On dit M. de Manteuffel s'affermissant dans le pays et auprès du Roi, content des différentes Diètes provinciales; mais à tout prendre, on sommeille. Espérons que ce sommeil est un véritable repos d'où ressortiront le calme et l'équilibre. Cela dépend de la France: je vois tous les regards se porter vers elle avec anxiété.
Sagan, 20 octobre 1851.– Me voici rentrée depuis hier dans ma cellule. J'ai eu très froid en route, mais le ciel était pur, et le soleil reflétait ces joyeux rayons sur ces teintes chaudes et variées de l'automne, qui me plaisent tout particulièrement. Je vais maintenant me caser ici pour de bon. Je n'ai plus de courses à faire; je ne m'attends plus à des visites dans cette saison avancée; je vais me mettre à lire, à peindre, à broder, à écrire, à gouverner ma maison et mes établissements de charité, à faire planter, bref, à remplir mes journées le moins mal possible, c'est-à-dire le plus utilement pour mon âme et pour le bien-être de mes entours.
Sagan, 24 octobre 1851.– La mort de Mme la Dauphine27 est un événement qui ne saurait passer inaperçu. Les grandes infortunes, toujours portées avec la plus noble et la plus simple dignité, lui assignent une place tout à part dans notre déplorable histoire contemporaine. Il ne lui a manqué qu'un peu de charme et de grâce, pour la mettre au-dessus des plus grandes victimes de tous les siècles.
Sagan, 5 novembre 1851.– Le Roi de Hanovre est au plus mal. Cette mort ne sera pas un petit événement à travers les difficultés allemandes, ce fils aveugle et les intrigues anglaises.
Sagan, 12 novembre 1851.– Il me revient qu'on est très blessé à Frohsdorf: 1o de la brièveté du deuil pris à Claremont pour Mme la Dauphine; 2o de ce qu'on n'ait pas écrit au Comte de Chambord, à l'occasion de la mort de son illustre tante, à lui qui avait écrit lors de la mort de Louis-Philippe; 3o de ce qu'on s'est borné à un message verbal de condoléance, confié au duc de Montmorency, sans même le charger d'aller à Frohsdorf, mais seulement de le transmettre à quelque chef légitimiste présent à Paris. J'avoue que je ne puis blâmer le ressentiment que l'on éprouve de cette façon si peu sympathique, si peu respectueuse envers le malheur des aînés.
Sagan, 14 novembre 1851.– J'ai achevé hier la lecture des Souvenirs du chancelier de Müller, de Weimar. C'est celui dont M. de Talleyrand parle dans son morceau sur l'entrevue d'Erfurt. Dans ces Souvenirs, il est sans cesse question de mon oncle, avec une grande vérité de détails et une justice rare qui m'a fait plaisir. Le tout est un petit volume pas du tout difficile à comprendre, simplement écrit, bien pensé, clairement exprimé, et donnant un tableau parfaitement exact de l'Allemagne sous l'Empire. Ce M. de Müller n'a rien de commun avec l'historien Jean de Müller.
Sagan, 16 novembre 1851.– Le Roi de Hanovre s'éteindra sous peu, s'il ne l'est déjà. On se querellera sur la tutelle. Ce sera un point en litige de plus, du provisoire en herbe, vice inhérent à un siècle tout à la fois paresseux et inquiet28. Et la France? si ardente et si molle, si agitée et si insouciante? Contrastes merveilleux et déplorables que ne simplifieront pas messieurs les Burgraves. Ils me font l'effet de momies en service extraordinaire29.
Sagan, 17 novembre 1851.– Je nie que ce que vous appelez30 ma haute raison n'ait pas besoin des enseignements de la mort. Qui de nous peut se croire assez détaché pour n'en avoir nul besoin? Pour ma part, j'en suis fort nécessiteuse au contraire, et j'espère que ma pauvre âme en tirera profit. Toutes les lectures, les méditations n'approchent pas, dans l'impression qu'elles produisent, du spectacle réel. Il est bien grave et plein de révélations. D'ailleurs, je ne me fais aucune illusion sur l'état de ma santé, et je la crois assez profondément ébranlée pour, peu à peu, chausser mes sandales. C'est un bon emploi de solitude. J'ai trouvé, il y a quelque temps, dans le prophète Osée, un passage que je pourrais à bon droit fixer sur la porte de cette maison-ci: «Je l'ai conduit dans la solitude, et là lui ai parlé au cœur.»
Je suis enchantée que Mgr Dupanloup veuille vous faire voir ses matériaux sur M. de Talleyrand31. Je crois que plus on fouillera, plus on recueillera sur son compte, et plus on découvrira de contrastes. Telle est la condition de presque tous les hommes qui, avec une bonne nature et des facultés distinguées, ont été jetés dans un monde corrompu, dans une position fausse, et dans les orages révolutionnaires. L'essentiel est de montrer l'excellent de la nature primitive, et, tout en reconnaissant les graves erreurs, de prouver qu'elles n'ont jamais été jusqu'à la cruauté ni jusqu'à la bassesse. Quelque distrait que soit le public par les grands tremblements de terre actuels, il reviendra un temps où la curiosité, l'intérêt se réveilleront pour un passé plein d'enseignements. On y cherchera la vérité. Elle est si souvent dénaturée, si difficile à retrouver que ceux qui travaillent à la dégager de ses nuages seront des bienfaiteurs de l'avenir.
Sagan, 1er décembre 1851.– Nous voici au début du dernier mois d'une année, qui, à travers plus d'une épreuve, sera peut-être regrettable en comparaison de cette date 1852 qui semble devoir résoudre bien des problèmes. Ces solutions seront-elles lumineuses? je ne le crois pas; sanglantes? j'en doute; boueuses? je voudrais presque en répondre. Si telle est la destinée politique de la vieille Europe, tâchons du moins que, dans la vie intime, tout soit clarté, douceur, paix et confiance; cela peut se conserver à travers tous les orages, toutes les catastrophes, et c'est à cela qu'il faut s'attacher avec persévérance et fermeté.
Sagan, 4 décembre 1851.– Les nouvelles télégraphiques de Paris me jettent depuis hier dans une grande agitation32. Je ne m'étendrai pas ici sur les réflexions, prévisions, qui se pressent en foule dans l'esprit de tous à de pareilles extrémités. L'année 1851 n'a pas voulu laisser à son héritière le soin de justifier les prédictions qui s'y attachaient; elle s'est chargée de la déflorer.
Sagan, 6 décembre 1851.– Les projets me semblent plus jetés au hasard que jamais par le coup de tonnerre parti de France. On m'écrit de Berlin que l'on s'y attend à ce que le Président, pour distraire les rouges, voudra les jeter hors des frontières par une guerre étrangère. J'avoue que je n'y crois pas pour l'instant. Il a trop de difficultés intérieures, qui réclament d'autres remèdes qu'une guerre étrangère; pendant qu'il porterait ses troupes contre le dehors, le pays resterait livré aux démagogues, et c'est ce qu'il ne saurait, ce me semble, risquer. Il doit être uniquement occupé du résultat de ce suffrage universel dont il évoque l'épreuve dans ce mois-ci. C'est là aussi ce qui doit occuper l'Europe entière, car si les rouges triomphent en France, leur sanglant succès sera assuré, ou du moins tenté partout, et partout probable. Je n'ai aucune nouvelle directe de France depuis la crise du 2. Mme la Duchesse d'Orléans comprendra-t-elle enfin, hélas! après coup, le guêpier dans lequel l'héroïque Thiers et consorts l'ont fait tomber? La fusion, qui aurait pu sauver les principes et la civilisation entière, est maintenant hors de propos. M. Thiers à Vincennes, le douteux Changarnier sous les verrous, la candidature Joinville couverte de ridicule, Mme la Duchesse d'Orléans reste la grande coupable aux yeux de l'Europe33. Et voilà où conduisent l'esprit faux chez tous et l'ambition personnelle chez les femmes, à qui il n'est permis d'en avoir que pour autrui. Mais à quoi servent toutes ces réflexions? Hélas! à rien, qu'à reconnaître une fois de plus le profond aveuglement de l'humanité.
Sagan, 9 décembre 1851.– Mme d'Albuféra me mande que rien n'égale les fureurs de Mme Dosne34. On ne relâche pas en masse les députés faits prisonniers le 2, mais tantôt l'un, tantôt l'autre, les orléanistes et les montagnards les derniers. Le carnage a été très grand à Paris. Si le Président comprend bien sa mission, il terrassera les rouges. C'est le meilleur, le seul moyen pour se perpétuer au pouvoir, car il gagnerait ainsi la reconnaissance de toute l'Europe. On me mande de Vienne qu'on y est très favorable au Président, surtout, je pense, aux mesures énergiques de son coup d'État. Il me paraît que Thiers, en cage, est plutôt l'objet du ridicule qu'il n'a la gloire du martyre.
Sagan, 11 décembre 1851.– Les nouvelles de Paris m'intéressent. Voilà les mesures de déportation qui prennent rang dans toutes celles que le coup d'État a enfantées. Il ne s'agit ni de l'exalter, ni de le stigmatiser pour le moment. Il s'agit d'en observer les conséquences, et, si elles tournent à l'ordre, à la conservation, si l'anarchie est terrassée, si les intérêts matériels de la société sont sauvés, il faudra bien chanter le Te Deum. Mais quand tout cela origine d'une dictature militaire, sans l'appui d'un principe, d'une tradition, sans le prestige d'une gloire personnelle, sans dynastie, sans entourage, on se demande où est l'avenir, et tous les calculs humains restent sans base. On en est donc réduit à ces intérêts matériels dont je parlais tout à l'heure, et qui, momentanément, semblent protégés. Le commerce, le crédit, la valeur des propriétés, tout cela peut avoir et aura probablement une résurrection, dont il faut jouir avec reconnaissance, avec prudence, et surtout sans aveuglement.
Sagan, 13 décembre 1851.– J'ai eu hier une lettre de Paris, qui me dit que l'état des provinces est assez mauvais; que, dans le centre de la France surtout, il y a eu bien plus d'horreurs commises qu'on ne le dit. Rien ne peut mieux servir le Président, car sa seule force est dans la terreur que causent les rouges, mais cette force est réelle et augmente en raison de ce que ceux-ci démasquent leurs infâmes projets. On me dit aussi qu'il est fort question d'envoyer à la Martinique les généraux prisonniers à Ham35. On n'y va pas de main morte! Du reste, Changarnier, avec son système de bascule, ses finasseries et tromperies entre Frohsdorf et Claremont, n'a que ce qu'il mérite.
Sagan, 15 décembre 1851.– Je trouve qu'on donne trop d'importance à M. Thiers. En Allemagne, il eût été sans inconvénient, car on lui eût fait partout assez mauvais accueil, mais à Claremont, il sera très nuisible, à moins que les derniers événements n'aient fait ouvrir les yeux sur le fallacieux de ses avis, et le danger de ses directions. Mais les esprits faux se refusent à la lumière, et je n'en connais pas de moins juste que celui de Mme la Duchesse d'Orléans.
Sagan, 17 décembre 1851.– J'ai reçu une lettre de mon fils Alexandre, qui avait vu M. de Falloux à son passage par Orléans, se rendant en Anjou après sa sortie de prison à Paris36.
Mme d'Albuféra me mande que rien n'égale la division des familles: les plus proches s'invectivent, d'anciens amis se brouillent, il n'y a plus de salon possible. Elle me mande aussi, comme un fait certain, que les brigands ont saccagé un couvent de femmes en Nivernais.
Les embarras financiers de la France pourraient bien devenir le nœud gordien de la destinée du Président. Tout est énigme en ce moment, et la solution n'a pas plus de vraisemblance pour une chose que pour une autre. Le point essentiel reste l'extermination des rouges, car ils ruineraient le pays tout autant, plus même, en y joignant les incendies, les pillages et les massacres. Puisse le Président les extirper. Parfois, la crainte du contraire me prend, car c'est une hydre à cent têtes qu'il s'agit d'abattre.
Sagan, 18 décembre 1851.– J'ai reçu une lettre du duc de Noailles dont je vais faire quelques extraits: «Au fond, et en prenant l'ensemble de la situation, l'état de l'Assemblée, la division des partis, l'impossibilité de la fusion, l'épouvantable organisation du socialisme et des sociétés secrètes, l'imminence du péril en 1852, l'événement qui s'est accompli est heureux. C'est ainsi que le sentent tous les esprits réfléchis et sensés, c'est ainsi que je l'ai senti du premier moment. Il a été accompli avec une habileté, un ensemble, et dans des proportions qui le rendent véritablement prodigieux; le 18 brumaire n'est qu'un petit garçon auprès du 2 décembre. Cet événement, heureux pour le présent, n'est même pas malheureux pour l'avenir: à mes yeux, l'orléanisme a été à peu près tué avec la République, et la légitimité est l'héritière directe de la phase actuelle; seulement, on ne sait pas quand la succession s'ouvrira… Cela sera-t-il court?
«Cela pourra être long. Il reste certain que le despotisme militaire pouvait seul nous tirer de l'état où nous étions, et des dangers que nous courions. Il faut que ce despotisme dure encore, car le mal est immense et profond; ce qui se passe dans les provinces le fait bien voir! Il faut que l'œuvre entreprise s'accomplisse, c'est ce que je ne me lasse pas de répéter et de faire arriver à ceux qui gouvernent, par les voies qui me sont ouvertes. Il faut déraciner le socialisme et les sociétés secrètes; il faut en briser tous les cadres, enlever dans chaque département l'état-major de ces sociétés, frapper sur tous les chefs aux différents degrés, terrifier les autres, leur montrer leur impuissance et les décourager à jamais! On me dit que telle est, en effet, l'intention.
«Je crois que le Président aura un grand nombre de voix; les légitimistes et conservateurs voteront pour lui ou s'abstiendront.
«Les princes d'Orléans, et surtout la Duchesse, sont atterrés; ils étaient dans la plus complète illusion, surtout sur les sentiments de l'armée. La Duchesse était convaincue qu'elle serait au premier jour aux Tuileries. On avait saisi, il y a six semaines (par le moyen d'un domestique), une lettre de M. Roger du Nord à la Duchesse d'Orléans, où il lui disait que tout était prêt, que Thiers assurait que dans un mois tout serait fini, et qu'on était sûr de Changarnier (qui, en même temps, par parenthèse, se promettait à nous). Le Président a cette lettre.
«La vie du Président est fort menacée; il s'attend à être tué; il s'occupe de former d'avance une espèce de gouvernement militaire pour le cas de cet événement, qui serait bien malheureux pour tout le monde dans le moment actuel.
«Il y a, dans les actes du Président, depuis le 2 décembre, une douceur et des égards très marqués pour le parti légitimiste. Nous verrons la suite de ces grands événements; c'est le premier pas de fait pour remonter l'échelle sociale.»
Sagan, 28 décembre 1851.– Les journaux apportent des nouvelles d'Angleterre: la démission donnée et acceptée de lord Palmerston. C'est un soulagement universel, et qui déroutera la démagogie autant, pour le moins, que les coups d'État du Président. Mes vieilles rancunes et mes indignations subséquentes saluent cette chute ministérielle à cris de joie. Pourvu qu'elle soit définitive, et que ce méchant brandon soit éteint pour de bon! Hélas! Cette chute a été tardive: le mal s'est fait trop longtemps pour n'avoir pas creusé profondément; mais enfin, il vaut mieux un arrêt tardif qu'une durée indéfinie.
1
La Commission pour rédiger l'Adresse en réponse au Discours du Trône venait d'être nommée par la Chambre, lorsque M. de Manteuffel monta à la tribune et donna lecture du décret royal de prorogation de la Chambre au 3 janvier 1851. Ce jour-là, le Bureau de la Chambre venant d'être de nouveau nommé, l'extrême droite, unie au Ministère, déclara qu'il n'y avait plus lieu de discuter une Adresse, la situation politique étant changée.
2
Ce successeur fut M. Armand Lefebvre, qui arriva à Berlin le 20 novembre 1850 et y demeura jusqu'en février 1852.
3
Les sourdes menées bonapartistes amenaient à tout instant des conflits, des dissentiments qui entretenaient l'agitation publique; à une revue à Satory, Edgar Ney ayant engagé plusieurs régiments à crier: «Vive l'Empereur!», le général Changarnier avait répondu par un ordre du jour où il défendait à ses troupes de faire entendre aucun cri politique. Le général Changarnier fut bientôt destitué et, le 3 janvier, le Ministère, ne rencontrant ni sympathie ni respect dans la Chambre, donna sa démission.
4
Frédéric Ier s'était fait couronner Roi de Prusse le 17 janvier 1701 et avait institué, le lendemain, l'Ordre de l'Aigle noir. Il ordonna que, pour perpétuer le souvenir de son couronnement et de la fondation de cet Ordre, cette fête fût célébrée chaque année. Cette tradition est pieusement conservée à la Cour de Berlin sous le nom de fête des Ordres.
5
L'Assemblée nationale de Francfort ayant complètement échoué dans son œuvre, Gagern, qui n'avait pas renoncé à régler les affaires de l'Allemagne, invita les députés à se réunir à Gotha pour y délibérer sur l'ébauche d'une Constitution, ayant pour point de départ la réunion de l'Allemagne sous la prépondérance de la Prusse, à l'exclusion de l'Autriche. Cent trente députés environ se rendirent à cet appel. Les disputes furent tris vives au sein de cette Assemblée, qui fut promptement l'objet des attaques et des moqueries du pays. On appelait ses membres die Gothaer ou le parti Gotha.
6
La première exposition universelle. C'est le Prince Albert, mari de la Reine d'Angleterre, qui en était l'instigateur.
7
Le 22 février 1851, le Cabinet de lord John Russell, dont lord Palmerston faisait partie, se sentant faible et prévoyant de grandes difficultés financières, avait déposé sa démission entre les mains de la Reine, au sujet de la discussion du budget. La Reine voulut alors confier le Ministère à lord Stanley, mais sur les instances du duc de Wellington, elle décida lord J. Russell à garder ses fonctions. Le 3 mars suivant, lord J. Russell annonça donc, à la Chambre des Communes, que le Ministère whig conservait le pouvoir.
8
A la suite de la réunion de Wiesbaden, il fut publié, au nom du Prince prétendant, un manifeste, signé par M. de Barthélémy, où le système de l'appel au consentement de la nation était absolument rejeté comme étant la négation du principe de l'hérédité monarchique. C'est à cette lettre que l'Indépendance belge répondit, le 13 mars 1851, par un article non signé, des plus injurieux pour la Royauté.
9
La proposition Creton, relative au rappel des lois d'exil contre les Bourbons et les d'Orléans, avait été amenée le 1er mars à la Chambre. Ce rappel n'aurait pu être obtenu que par l'accord des deux branches qui n'avait pas encore été rendu possible. Les légitimistes acceptaient ces lois d'exil, car ils étaient désireux de les maintenir pour le compte des orléanistes; M. Berryer, au nom de leur parti, proposa d'ajourner la proposition Creton au 1er septembre. Toute la Montagne vota avec les orléanistes et M. Berryer, avec les légitimistes, continua de faire campagne pour le triomphe de l'idée monarchique, sans favoriser les menées de l'Élysée.
10
Le Cabinet français du 14 avril était ainsi composé: M. Baroche aux Affaires étrangères; M. de Chasseloup-Laubat à la Marine; M. Léon Faucher à l'Intérieur; M. Rouher à la Justice; M. Buffet à l'Agriculture et au Commerce; M. de Crouseilhes à l'Instruction publique; M. Fould aux Finances; le maréchal Randon à la Guerre.
11
Marie de Castellane.
12
Le prince de Talleyrand à Valençay.
13
De l'anglais: ni avec entrain, ni en bonne humeur: je me sentirai seule et délaissée.
14
Le comte de La Marck ayant légué sa correspondance avec Mirabeau à M. de Bacourt, celui-ci la publia en 1851, en la faisant précéder d'une préface historique qui fut assez remarquée.
15
Le 17 mai, le Roi de Prusse se rendit à Varsovie, où il se rencontra avec l'Empereur et l'Impératrice de Russie. Le 26, les deux souverains partirent ensemble jusqu'à Oderberg; le Roi se dirigea alors sur Breslau, tandis que l'Empereur Nicolas allait à Olmütz, où il conféra avec l'Empereur d'Autriche. C'est là que M. de Manteuffel, qui venait de remplacer M. de Radowitz comme premier ministre, se rendit pour déclarer au prince Schwarzenberg que la Prusse accordait à l'Autriche la présidence de la Diète germanique de Francfort, humiliation qui amena Sadowa quinze ans plus tard.
16
Les Majestés russes n'assistèrent pas à cette inauguration.
17
Mgr Dupanloup.
18
Les évêques d'Orléans possèdent, à quelques kilomètres de la ville épiscopale, une jolie maison de campagne au bord de la Loire et près du petit bourg de la Chapelle Saint-Mesmin. Ils y ont établi un petit séminaire. L'abbé Dupanloup, quand il prit possession de l'évêché d'Orléans, s'occupa beaucoup de cet établissement d'éducation, et réussit à y élever les études à un point remarquable.
19
A Meillan, dans le Cher.
20
Marie de Castellane fit sa première Communion le 22 juin 1851 dans le couvent des Dames du Sacré-Cœur, établi à deux kilomètres de Tours, dans l'ancienne abbaye des Bénédictins, fondée en 371 par saint Martin, évêque de Tours.
21
Extrait de lettre. La correspondance Mirabeau-La Marcq venait d'être livrée au public par M. de Bacourt.
22
Mme de Lieven, qui souffrait des yeux, avait adopté pour écrire un papier vert qui frappait plus dans un temps où ce genre était à peu près inconnu.
23
A Paris, la Princesse recevait tous les dimanches soirs.
24
Mlle Pauline de Castellane, fille du Maréchal, avait épousé le comte de Hatzfeldt, ministre de Prusse à Paris. Devenue veuve, elle épousa en secondes noces, en 1851, le duc de Valençay, fils aîné de l'auteur de la Chronique.
25
La duchesse de Courlande et la princesse de Hohenzollern.
26
Le Roi et la Reine de Prusse étaient arrivés à Ischl le 31 août et s'y étaient rencontrés avec l'Empereur d'Autriche. Le prince Schwarzenberg et M. de Manteuffel assistèrent à cette entrevue.
27
La duchesse d'Angoulême était morte à Frohsdorf le 19 octobre 1851.
28
Il n'y eut ni régence ni tutelle en Hanovre, Georges V succéda à son père malgré sa cécité, le Roi Ernest-Auguste ayant, dès 1843, tranché la question, en établissant que les actes présentés à la signature du futur monarque seraient lus en présence de douze témoins et contresignés par le secrétaire de ce comité.
29
On appelait du nom de Burgraves quelques politiques rétrogrades, membres de la Commission de l'Assemblée législative chargée de préparer la loi du suffrage restreint, dite loi du 31 mai. La plupart étaient des chefs d'anciens partis monarchiques comme Thiers, Molé, Broglie. Les républicains les regardaient comme des politiques usés et impuissants.
30
Extrait de lettre.
31
Intéressé par le caractère si complexe de M. de Talleyrand, qu'il avait pu suivre de près, l'abbé Dupanloup, devenu évêque d'Orléans, avait passé de longues années à recueillir une série d'actes publics ou privés, concernant les diverses périodes de la vie du Prince. Cette collection de lettres et de documents forme quatorze volumes: Mgr Dupanloup y a joint un récit des derniers moments du Prince de Talleyrand dont il a été déjà question dans le deuxième volume de la Chronique. Tous ces papiers et manuscrits se trouvent à l'heure actuelle dans la possession de M. Bernard de Lacombe, Mgr Dupanloup les ayant légués à son père, M. Hilaire de Lacombe.
32
Dans la nuit du 1er au 2 décembre, le Prince Louis Bonaparte, ayant fait garder à vue le président de l'Assemblée, avait fait arrêter les principaux chefs des partis républicain et monarchistes, puis, par deux proclamations, déclaré l'Assemblée dissoute et le suffrage universel rétabli. Il procéda ensuite à un plébiscite qui lui donna la Présidence pour dix ans. La force armée et les commissions mixtes ayant fait justice des récalcitrants, ce coup d'État, préparé avec l'énergique concours de M. de Morny, du général de Saint-Arnaud et du préfet de police, M. de Maupas, triompha de toutes les résistances.
33
M. Thiers, qui croyait la branche aînée des Bourbons frappée d'une impopularité irrémédiable, avait approuvé et appuyé avec énergie l'opposition faite par la Duchesse d'Orléans à un accord entre la branche aînée et la branche cadette. Regardée comme le principal obstacle d'une si désirable réconciliation, les partisans de la fusion accusaient la Princesse d'avoir, par ses fautes, contribué plus que toute autre chose à ramener l'Empire au pouvoir. Ils avaient aussi trop mis leurs espérances dans le général Changarnier qui, loyal mais présomptueux, jouait serré les légitimistes et les orléanistes les uns contre les autres, ne donnant aucun signe de ses intentions réelles, mais ne voulant, dans le fond de sa pensée, que poser la couronne sur la tête qui devait la porter, en tenant à la poser lui-même. Son attitude énigmatique l'avait rendu suspect aux yeux de plusieurs.
34
A cause de l'arrestation de M. Thiers.
35
Les généraux Le Flô, Changarnier, Lamoricière et Bedeau.
36
M. de Falloux, ainsi que le duc de Luynes, le comte de Rességuier et bien d'autres, avait été emprisonné au Mont-Valérien, lors du coup d'État du 2 décembre.