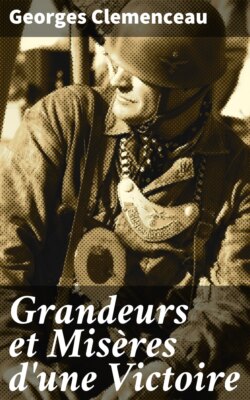Читать книгу Grandeurs et Misères d'une Victoire - Georges Clemenceau - Страница 6
L’UNITÉ DU COMMANDEMENT
ОглавлениеSur quoi me suis-je fondé pour appeler le général Foch au commandement suprême? Les notes du général Mordacq me permettent de suivre les batailles du futur chef des Alliés:
«Après les combats de Lorraine, le 29 août 1914, le général Foch quitte le commandement du 20e corps d’armée pour prendre celui d’un détachement d’armée destiné à couvrir plus efficacement la gauche de la 4e armée et à réaliser la soudure de celle-ci avec la 5e.
«Ce détachement deviendra bientôt la 9e armée, à la tête de laquelle le général Foch va prendre une large part à la bataille de la Marne.
«Le général Joffre, estimant «la situation stratégique excellente et conforme au dispositif recherché», prescrit, le 4 septembre au soir, de reprendre l’offensive le 6 au matin et de concentrer sur la 1re armée allemande les efforts des armées alliées de gauche.
«Le 6 septembre, déclenchement général de l’attaque. La 9e armée est au centre. C’est là précisément que les Allemands portent leur principal effort. En réponse à la manœuvre de l’armée Maunoury sur la droite allemande, de Moltke fait donner à fond l’armée de Bülow qui comprend la garde et les meilleures troupes de l’Allemagne, sur le centre français et, par conséquent, sur la 9e armée.
«Cette armée est arrêtée, dans son offensive. Il lui est impossible d’atteindre son objectif: la région au nord des marais de Saint-Gond. En fin de journée, elle en borde péniblement les débouchés du sud.
«La gauche, violemment attaquée, livre des combats acharnés à Mondement (division marocaine). La 42e division parvient à rejeter la garde dans les marais de Saint-Gond. Le 11e corps d’armée qui tient la droite résiste péniblement aux attaques allemandes[4].
«9 septembre.—La situation devient grave: la garde prussienne enlève Fère-Champenoise, les 9e et 11e corps reculent. Le général Foch, sans se laisser troubler par cette situation, rend compte au G. Q. G. et conclut: «J’ordonne à nouveau de reprendre l’offensive[5].»
«Et, en effet, renforcé du 10e corps d’armée, il lance une nouvelle contre-attaque sur Fère-Champenoise.
«10 septembre.—Il reprend l’offensive sur tout son front: après des combats acharnés, Fère-Champenoise est reprise. Les Allemands dans la soirée battent en retraite et sont refoulés au nord des marais de Saint-Gond.
«11 septembre.—La poursuite commence, facilitée par un corps de cavalerie (général de l’Espée) que le général Joffre met à la disposition du général Foch. On se dirige sur la Marne que la 9e armée aborde le 12 septembre entre Épernay et Châlons. On fait de nombreux prisonniers; on capture des vivres et des munitions en quantité considérable.
«Le haut commandement allemand avait donné l’ordre de retraite générale le 10 septembre au soir.
Après la bataille de la Marne, l’État-Major allemand avait aussitôt préparé une nouvelle manœuvre d’enveloppement contre l’aile gauche française. Le haut commandement français, de son côté, cherchait à envelopper la droite allemande, d’où les batailles de Picardie et d’Artois, et la «course à la mer».
Dans les premiers jours d’octobre 1914, la situation pour les Alliés est grave: Lille menacée par la cavalerie allemande, la Flandre ouverte, toutes les forces ennemies remontent de plus en plus vers le nord, et menacent de crever le front d’un moment à l’autre.
C’est alors que le général Joffre, le 4 octobre, confie au général Foch (dont la 9e armée est dissoute) la mission de coordonner toutes les forces engagées entre l’Oise et la mer: armées de Castelnau et de Maud’huy, groupe de divisions territoriales du général Brugère, troupes de la place de Dunkerque.
En même temps l’armée anglaise est transportée dans les Flandres (région d’Hazebrouck-Ypres).
«9 octobre.—La place d’Anvers capitule, l’armée belge de campagne qui y était investie peut gagner la côte, et, le 11 octobre, vient occuper la région entre Ypres et la mer. Le roi Albert fait connaître qu’il sera heureux de se prêter entièrement à la coordination que le général Foch avait mission d’établir entre les efforts de tous.
«Plan allemand.—Après la chute d’Anvers, les Allemands, poursuivant leur plan primitif, vont essayer de tourner le dispositif allié en allant au besoin jusqu’à la mer, et prennent pour objectifs: Dunkerque, Boulogne, Calais.
«A la marche sur Paris succède—comme l’annonce la presse allemande—la marche sur Calais. Pour atteindre leur but, les Allemands ne concentrent pas moins de 600 000 hommes en Belgique et dans les Flandres.
Les Français, informés de cette énorme manœuvre, appellent en Belgique toutes leurs réserves disponibles.
«20 octobre.—Le transport de l’armée anglaise s’est effectué dans de bonnes conditions. Elle est complètement groupée dans la région d’Ypres.
«L’armée belge organise la ligne de l’Yser.
«Tous ces mouvements des armées belge et anglaise ont été couverts par les deux corps de cavalerie française.
«On peut donc dire que le 20 octobre la «course à la mer» est terminée, la barrière est établie. Il reste à la maintenir, c’est ce qui donnera lieu à la bataille de l’Yser.
«21 octobre.—La situation des Alliés est la suivante:
«A droite, les Anglais (3 corps d’armée).
«Au centre, les Français (3 divisions, les fusiliers marins, une brigade belge).
«A gauche, les Belges (6 divisions).
«A l’extrême gauche, la 42e division française.
«En face de quoi les Allemands disposaient:
«1o de la IVe armée: 6 corps d’armée;
«2o De la VIe armée: 5 corps d’armée.
«22 octobre.—Pour déjouer le plan allemand, le général Foch, d’accord avec le maréchal French et le roi Albert, donne l’ordre d’attaquer. La bataille de l’Yser commence.
«Au nord, les Belges et les Français attaquent vigoureusement, mais une violente contre-attaque allemande, appuyée par une artillerie lourde formidable, arrête net leur offensive, et bientôt il faut recourir à l’inondation pour endiguer la ruée allemande. On ouvre les écluses de Nieuport et l’eau envahit toute la vallée de l’Yser entre Nieuport et Dixmude.
«Le 30 octobre, les Allemands se lancent néanmoins encore à l’assaut, mais ils sont arrêtés et, le 2 novembre, ils sont obligés de repasser l’Yser après avoir abandonné une partie de leur artillerie.
«Au sud, dans la région d’Ypres, les Anglais, le 23 octobre, ont pris à leur tour l’offensive dans la direction générale de Courtrai. Du 23 au 28 octobre, elle se déroule dans d’excellentes conditions. Mais à cette date les Allemands, avec six corps d’armée, contre-attaquent vigoureusement et enfoncent le front anglais.
«C’est alors que le général Foch met à la disposition du maréchal French la valeur de trois corps d’armée français. Les Allemands attaquent de nouveau en force et obligent les Alliés à reculer. Le maréchal French, à ce moment, prépare son repli à l’ouest d’Ypres. Le général Foch parvient à lui faire abandonner ce projet—acte capital qui décida du succès. Les Alliés contre-attaquent et arrêtent les Allemands.
«Du 1er au 6 novembre, la bataille fait rage sur tout le front; mais malgré les efforts surhumains des Allemands, ils n’arrivent pas à percer. On continue à se battre; toutefois on peut dire que le 15 novembre la grande bataille de l’Yser est terminée. Les Allemands n’ont pu passer et atteindre la mer—leur objectif. Leurs pertes sont énormes. La garde est décimée, et plus de 250 000 hommes à terre. Du côté des Alliés elles sont aussi considérables. De part et d’autre on est épuisé, mais on s’organise.
«Cette immense bataille de l’Yser était la conclusion de «la course à la mer». Les Allemands, après avoir essayé—sans succès—de tourner la gauche des Alliés, avaient ensuite entrepris cette marche nach Calais qui pouvait, en effet, au point de vue stratégique, leur procurer des résultats considérables. Le 15 novembre 1914, ils sont obligés d’y renoncer. Cette bataille d’Ypres, si elle ne fut pas une victoire des Alliés, trop décimés pour l’exploiter, fut, bel et bien, pour les Allemands, une défaite caractérisée.
«Le succès était nettement dû au général Foch qui, sans titre officiel, avait su imposer sa volonté aux Alliés, dans la conduite des opérations, par son énergie, sa ténacité, son inaltérable confiance. En résumé, c’est lui qui, de tous points, dirigea la gigantesque bataille de l’Yser—et lui qui la gagna. Si elle avait été perdue, c’est lui qui en aurait porté la responsabilité.»
Je n’ai pas à faire apparaître ici les sombres réalités de notre situation militaire d’avant guerre. On sait que le premier effet de notre impréparation fut d’ouvrir le territoire français à l’ennemi. Personne ne s’est présenté jusqu’ici pour prendre la responsabilité de notre manque d’artillerie lourde à tir rapide, ainsi que de la scandaleuse insuffisance de nos mitrailleuses, fautes si graves que, sans les réactions de la Marne, de la frontière à Paris, notre territoire, se trouvait emporté. Si beau qu’il fût, le redressement de la défaite ne pouvait épuiser l’élan de l’offensive ennemie. Le résultat de la première bataille fut de décider que la guerre poursuivrait son cours en territoire français où les armées allemandes se mirent à organiser le ravage systématique de nos villes industrielles et de nos campagnes, avec l’asservissement des populations.
Qui donc est responsable de cette faute initiale? Ne peut-on nous le dire, ou, tout au moins, feindre de le chercher? Si jamais l’historien s’avise de poser timidement cette question, j’en profiterai pour lui en poser une autre. Était-il interdit de prévoir que l’Allemagne ferait faillite à sa propre signature en violant la neutralité belge? Qu’est-ce donc qui pouvait l’empêcher de prendre à cet effet certaines dispositions militaires? Qui donc ne connaissait l’état d’esprit allemand? Qui donc pouvait croire qu’un obstacle moral était de nature à arrêter hommes ou chefs, un seul moment? J’ai eu sous les yeux l’ouvrage du colonel Foch sur les principes de la guerre. J’ai vu avec effroi qu’il n’y était pas dit un mot de la question de l’armement. Une métaphysique de la guerre! Il n’est cependant pas indifférent de savoir si l’attaque de la catapulte ou du canon à tir rapide peut nous mettre dans le cas de varier nos moyens de défense. Des questions de cet ordre valent cependant qu’on s’y arrête.
Quelle différence des états d’âme de l’un et de l’autre côté du Rhin! En Allemagne, tous les excès d’autorité pour machiner l’homme en vue de la plus violente offensive. Chez nous, toutes les dissociations de l’indolence, et le repos sur de grands mots.
Les lettres échangées entre le roi d’Angleterre et M. Poincaré à l’heure de la déclaration de guerre témoignent suffisamment des communes angoisses des peuples intéressés. Habile et prudemment rédigée, la lettre de M. Poincaré était, en somme, une demande de secours. Amicale, mais évasive, la réponse de George V aboutissait à un refus provisoire de concours. L’Angleterre, encore moins préparée que nous, comprenait tardivement qu’elle allait jouer sa partie. Qu’il lui vînt une heure de fléchissement, et tout pouvait être perdu. La violation du territoire belge devait mettre un terme à ces hésitations.
Les préparations d’alliances pour une guerre inévitable s’annonçaient dans l’incohérence. Il n’en pouvait être autrement puisque l’avantage d’une prévision organisée ne se manifesta que du côté allemand, maître de l’offensive. Aussi le premier mouvement des Alliés, aux heures difficiles, fut-il d’une réclamation universelle en faveur d’une suprême autorité militaire. Mais toute armée est l’expression supérieure du nationalisme en action. Les chefs de la puissance nationale qu’elle représente ne cèdent pas aisément sur ce point, et ce fut même du peuple le moins militaire, le peuple américain, qu’au moment décisif, survinrent les plus grandes difficultés d’exécution.
Dès le début de la guerre, en France, le sentiment populaire avait mis l’espoir du succès dans l’unité de commandement, et lorsque l’expérience ainsi que le raisonnement s’accordèrent sur ce point, il ne resta plus qu’à s’entendre sur le choix du stratège[6]. Il n’y eut jamais, à ma connaissance, l’ombre d’un débat sur le principe, pas plus que sur le personnage à qui le poste éminent pouvait être confié[7]. Point de concurrents. Le seul nom de Foch fut prononcé. Le principal est que Foch avait développé des qualités de premier ordre en de dures rencontres qui appelaient surtout des miracles de résistance, tandis que Mangin, avec ses violences de caractère, avait pu fournir des miracles d’offensive. Tous les deux avaient logiquement ce grave défaut de ne pouvoir supporter le pouvoir civil—lorsqu’ils n’en avaient pas besoin.
Pétain, qui n’était pas un moins grand soldat, avait des jours éclatants et des jours d’équilibre. En de mauvaises rencontres, je l’ai trouvé d’héroïsme tranquille, c’est-à-dire maître de lui-même. Peut-être sans illusions, mais sans récriminations, il était toujours prêt aux sacrifices personnels. J’ai plaisir à lui rendre cet hommage. On lui a beaucoup reproché les propos pessimistes de son État-Major. La vérité est, je crois, que le pire ne lui faisait pas peur et qu’il l’envisageait sans effort dans une inébranlable sérénité. Mais son entourage faisait trop facilement accueil aux mauvaises paroles. Quelques embusqués d’état-major s’en paraient la boutonnière avec des conclusions qui n’étaient pas celles du chef—inébranlablement demeuré grand soldat.
Cette effroyable guerre nous a fait apparaître de bons généraux, et beaucoup de ceux qui ont le droit de hasarder un jugement nous diront peut-être que Foch est le plus complet d’entre eux. Les esprits simples, qui sont le nombre, aiment à juger les hommes en bloc, d’une qualification approximative qu’ils veulent définitive. Mais la nature humaine est trop complexe, trop variable, pour se prêter d’emblée à ces procédures sommaires, d’où la plus belle sincérité n’arrive pas toujours à dégager la véritable formule d’une énergie en cours. Le général Foch, qui n’était pas surabondant en nuances, possédait-il, à côté des talents stratégiques, les aptitudes de diplomatie d’un chef international? Mais n’anticipons pas.
La difficulté venait surtout du côté britannique, où notre influence militaire était d’autant plus grande que nous n’en faisions pas étalage. Je demeurai très sobre de conversations à cet égard, sachant, d’ailleurs, par notre constant ami, lord Milner, que le problème allait lentement mais sûrement vers l’heureuse solution.
C’était revenir de loin. Nous avions eu trop de guerres avec les Britanniques pour que l’idée de mettre leurs soldats sous le commandement d’un Français leur parût aisément tolérable.
Le jour[8] où j’en parlai pour la première fois au général sir Douglas Haig, en déjeunant à son quartier général, le soldat se leva, comme mû par un ressort, et les deux mains au ciel, s’écria:
—Monsieur Clemenceau, je n’ai qu’un chef, et je n’en puis avoir qu’un. C’est mon roi.
Mauvais début. Les conversations suivirent sans donner de résultats, jusqu’à la journée de Doullens, où, sous la pression des événements, lord Milner, après un bref colloque avec le maréchal Haig, m’annonça que l’opposition au commandement unique était abandonnée.
Le reste suivit. Mais il fallut encore plusieurs étapes pour arriver à une formule qui réalisât approximativement toutes les conditions d’efficacité supérieure aux mains d’un chef unique.
La résistance en Angleterre venait moins de l’armée que du Parlement et surtout de «l’homme de la rue». L’idée de voir un général français commander à des généraux britanniques leur fut longtemps insupportable. L’argument semblait plus topique, lorsqu’on alléguait notre commun insuccès de 1917 sous le commandement provisoire du général Nivelle. Mais ce n’était là qu’un argument d’apparence, valable seulement parce qu’on n’osait pas formuler l’argument du fond.
C’est à Doullens que Foch, sans la permission de personne, s’imposa pour le commandement. Pour cette minute, je lui demeurerai reconnaissant jusqu’à mon dernier souffle. Nous étions dans la cour de la mairie, sous les yeux d’un public frappé de stupeur qui, de toutes parts, nous posait cette question: «Les Allemands viendront-ils à Doullens? Tâchez qu’ils n’y viennent pas.» Parmi nous, le silence, coupé soudainement de cette exclamation d’un général français qui, me désignant sir Douglas Haig, à proximité, me dit tout bas:
—En voilà un qui sera obligé de capituler en rase campagne avant quinze jours, et bien heureux si nous ne sommes pas obligés d’en faire autant.
D’une bouche autorisée, ce propos n’était pas de nature à confirmer la confiance dans laquelle nous voulions nous obstiner.
Une rumeur, Foch arrive, entouré d’officiers, et, de sa voix coupante, dominant tout:
—Vous ne vous battez pas. Moi, je me battrais sans m’arrêter. Je me battrais devant Amiens. Je me battrais dans Amiens. Je me battrais derrière Amiens. Je me battrais tout le temps[9].
Il n’est pas besoin de commentaire à ce discours. J’avoue que, pour moi, j’eus beaucoup de peine à ne pas tomber dans les bras de ce chef admirable, au nom de la France en suprême danger.
A l’heure où nous avions retrouvé Foch disgracié au poste de chef d’État-Major général, il avait déjà inscrit à son compte deux grandes actions d’éclat dans l’ordre de la résistance.
Sur la Marne et sur l’Yser, il avait atteint au plus haut dans la résistance éperdue qui, par l’autorité de sa parole, avait fixé le maréchal French sur le terrain de la bataille, et, par son seul exemple, il avait maintenu sa troupe invincible sous l’effort terrible de l’ennemi. Les Allemands avaient résolu de vaincre à tout prix. Immuable dans l’extrême péril, Foch avait jeté ses hommes jusqu’aux extrémités de la folle bravoure qui emporte le combattant au delà du devoir. Ce jour-là, ils entrèrent tous ensemble dans la gloire des héros de l’antiquité.
Enfin, dans la Conférence de Doullens[10]—dont les péripéties ont été maintes fois racontées[11], on finit par s’accorder sur ce texte:
«Le général Foch est chargé, par les gouvernements britannique et français, de coordonner l’action des armées alliées sur le front occidental. Il s’entendra, à cet effet, avec les généraux en chef, qui sont invités à lui fournir tous les renseignements nécessaires[12].»
Ce n’était qu’une amorce, mais décisive. Le titre de commandant en chef n’était pas encore accepté par les Anglais. A Beauvais[13], je proposai de charger le général Foch de «la direction stratégique» et la formule fut acceptée. Le texte du nouvel accord fut le suivant:
«Le général Foch est chargé par les gouvernements britannique, français et américain, de coordonner l’action des armées alliées sur le front occidental. Il lui est conféré, à cet effet, tous les pouvoirs nécessaires en vue d’une réalisation effective. Dans ce but, les gouvernements britannique, français et américain confèrent au général Foch la direction stratégique des opérations militaires.»
Sur la demande des Anglais, on ajouta la phrase suivante:
«Les commandants en chef des armées britannique, française et américaine, exercent, dans sa plénitude, la conduite tactique de leurs armées. Chaque commandant en chef aura le droit d’en appeler à son gouvernement, si, dans son opinion, son armée se trouve en danger par toute instruction reçue du général Foch.»
Afin de préciser les avantages attachés au titre finalement obtenu, je priai le général Foch d’écrire aux gouvernements alliés. Dans ses lettres, il faisait valoir cet argument: «Il me faut persuader au lieu de diriger. Un pouvoir de direction suprême me paraît indispensable à l’achèvement du succès.»
Tout cela prit du temps. Sur mes instances réitérées, j’obtins enfin une réponse de M. Lloyd George: le gouvernement anglais ne voyait plus, disait-il, aucun inconvénient à ce que le général Foch prît le titre de commandant en chef des armées alliées en France[14]. Le même jour, l’excellent général Bliss, après une entrevue avec le général Mordacq à Versailles, me faisait dire au nom du président des États-Unis: «Je me porte garant que notre gouvernement ne verra que des avantages dans l’unité du commandement.»
Pour moi, il s’agissait moins des formules que des actes qui en dérivent. Déjà, à Clermont (Oise)[15] Pershing était venu se mettre à la disposition de son nouveau chef avec une émouvante allocution dont le souvenir est resté vivant parmi nous. En même temps, le général Pétain s’était hâté de venir, lui aussi, prendre les ordres du général Foch. De toutes parts, l’accord s’annonçait. On était aux portes de l’action décisive.
De savoir quel usage fut fait de ce commandement supérieur, c’est une question que l’histoire militaire aura charge d’éclairer. Pour beaucoup de raisons, je ne suis pas convaincu qu’il ait joué, dans la conduite de la guerre, le rôle décisif que l’opinion publique incline à lui prêter. Il faudra que cette histoire soit écrite par d’autres que ceux qui l’ont vécue. Il faudra nous dire quelle somme d’obéissance fut demandée et obtenue et dans quelles circonstances, et pour quels résultats. Nous n’en sommes pas encore arrivés là.
Il faut bien dire que, dans l’exercice du commandement unique, le généralissime, parfois, s’est abandonné à des hésitations, à des tempéraments d’autorité propres à laisser dans le flottement les résultats attendus. D’autre part, je crois pouvoir dire que le commandant de l’armée britannique ne se soumit jamais complètement aux directives du général Foch trop inquiet, peut-être, d’éviter toute difficulté avec les deux grands chefs qui lui étaient théoriquement subordonnés.
Puis vint le mauvais jour du Chemin des Dames. Pour obtenir de nouveaux effectifs et confirmer l’autorité du général Foch[16] je fis insérer dans le message des chefs de gouvernement à M. Wilson[17] la phrase suivante: «Nous estimons que le général Foch, qui mène la campagne actuelle avec une habileté consommée, et dont le jugement militaire nous inspire la plus grande confiance, n’exagère pas les nécessités actuelles.»
Le principal embarras vint, à ce moment[18], de sir Douglas Haig qui, suivant son habitude, ne voulait pas permettre au généralissime de déplacer des réserves de l’armée anglaise pour en faire usage sur le front français[19]. Les Anglais voulaient surtout protéger les ports de la Manche. Rien de plus naturel. Le général Foch, qui avait des divisions françaises dans les Flandres, ne voulait pas les rappeler parce que c’était là qu’il attendit l’attaque allemande avant et après l’effondrement du Chemin des Dames. Il me saisit de la question. Je m’étais interdit les discussions d’ordre purement militaire, mais j’avais le droit, et même le devoir, de m’enquérir pour savoir si le commandement suprême fonctionnait à souhait.
| [4] | 7 et 8 septembre. |
| [5] | Ce simple mot, à cette heure décisive, caractérise le soldat. |
| [6] | Dans un excellent article de la Revue des Deux Mondes (15 avril 1929), le général Mordacq a remarquablement élucidé cette question. Plus tard, il a repris et développé son œuvre en un volume où le maréchal Foch est traité avec l’honneur qui lui est dû. On sait que le général Mordacq, l’un de nos meilleurs divisionnaires, était le chef de mon cabinet militaire. J’en connais qui ne le lui ont pas encore pardonné. |
| [7] | Lord Milner, afin d’apaiser les susceptibilités du soldat britannique, avait eu l’idée de me donner le titre, pour passer la fonction à Foch comme chef d’État-Major général. On ne m’en parla point. Est-il besoin de dire que je n’aurais jamais accepté cette étrange combinaison. |
| [8] | Janvier 1918. |
| [9] | Je ne manquai pas de rapporter ces paroles à M. le Président de la République, qui les cita dans son allocution au grand soldat en lui remettant le bâton de maréchal de France, par moi-même proposé. |
| [10] | 25 mars 1918. |
| [11] | «...On avait pris rendez-vous pour 11 heures à Doullens, située sensiblement à mi-chemin entre les G. Q. G. français et anglais. A 11 heures précises, M. Clemenceau et moi arrivions sur la place de la Mairie, place désormais historique. Peu après survenait M. Poincaré, accompagné du général Duparge... Le maréchal Haig était déjà là, en conférence à la mairie avec ses commandants d’armée: les généraux Horne, Plummer et Byng...Puis ce fut le général Foch, plus calme que jamais, mais dissimulant mal néanmoins son ardent désir de voir les Alliés prendre enfin des décisions logiques...Enfin, le général Pétain arriva à son tour, assez soucieux....Il faisait froid, et, pour se réchauffer, on se promenait par petits groupes dans le square qui se trouve devant la mairie, les petits groupes s’arrêtant de temps en temps pour engager la conversation.La scène ne manquait pas de grandeur et d’originalité: sur le chemin qui borde le square même, on voyait passer des troupes anglaises, qui se retiraient lentement, avec ordre, sans donner la moindre trace d’une émotion quelconque: le flegme britannique dans toute son acception; puis, à chaque instant, semblant tout près, une violente canonnade: c’était le canon allemand, qui, en effet, était là, à quelques kilomètres, rappelant à la réalité et faisant songer «à la grande partie qui était en train de se jouer».Tous ces hommes qui étaient là dans ce modeste square, tous ces Français qui étaient très au courant de la situation, se rendaient bien compte de l’importance de cette journée. Voilà pourquoi, sous des dehors calmes, au fond, une grande angoisse étreignait leur cœur.Mais le temps passait, et les Anglais n’arrivaient toujours pas...Midi... Toujours personne...Enfin, à midi cinq, débouchèrent les automobiles de lord Milner, accompagné du général Wilson...Alors commença la conférence franco-anglaise; il était midi vingt.M. Clemenceau posa aussitôt la question d’Amiens. Le maréchal Haig affirma qu’il y avait là, en effet, un malentendu; que non seulement il n’avait jamais songé à évacuer Amiens, mais qu’il avait bien la ferme intention de réunir toutes les divisions dont il pourrait disposer pour renforcer sa droite, qui, évidemment, constituait son point faible, et par conséquent celui des Alliés. Il tiendra donc au nord de la Somme, il en répond absolument; mais, au sud de cette rivière, il ne peut plus rien; il a d’ailleurs mis sous les ordres du général Pétain tous les éléments de la Ve armée qui restent... Ce à quoi répond le général Pétain: «Il en reste bien peu et, en vérité, on peut dire que cette armée n’existe plus.» Le maréchal Haig ajouta encore qu’il serait peut-être obligé de rectifier sa ligne devant Arras, mais ce n’était pas encore certain; il espérait même pouvoir éviter ce pis aller. Tels étaient les moyens dont il disposait; à son tour, il demandait aux Français de vouloir bien exposer les leurs.La parole fut alors donnée au général Pétain, qui exposa la situation telle qu’il la voyait et telle qu’elle était en réalité, c’est-à-dire assez sombre, et fit ressortir toutes les difficultés auxquelles il se heurtait depuis le 21 mars. Il ajouta que, depuis la veille, depuis l’entrevue à Compiègne, il avait recherché tous les moyens pour parer à cette situation et qu’il était heureux de pouvoir annoncer qu’il arriverait peut-être à jeter vingt-quatre divisions dans la bataille, mais, bien entendu, des divisions qui étaient loin d’être fraîches et dont la plupart venaient de se battre. En tout cas, il estimait que, dans une situation pareille, il fallait ne pas se laisser bercer par des illusions et voir, bien en face, les réalités, et par conséquent ne pas se dissimuler qu’un temps assez considérable serait nécessaire pour amener à pied d’œuvre ces unités. Quoi qu’il en soit, il avait fait l’impossible pour diriger dans la région d’Amiens touies les troupes disponibles, n’hésitant pas même à dégarnir—au delà de la prudence—le front français au centre et à l’est. Il demandait donc que le maréchal Haig voulût bien en faire autant de son côté.Le maréchal Haig répondit qu’il ne demanderait pas mieux «d’en faire autant, mais que, malheureusement, il n’avait plus aucune troupe en réserve et qu’en Angleterre même il ne restait plus d’hommes capables d’entrer immédiatement en ligne».A ce moment, il y eut «un froid» et, pendant quelques instants, personne ne prit la parole. Le loyal exposé de la situation que venait de faire le général Pétain avait, naturellement, profondément impressionné les assistants et surtout les Anglais. On en trouve la trace dans le rapport de lord Milner: «Le général Pétain, dit-il, donnait une impression de froideur et de circonspection, comme d’un homme qui joue un jeu prudent (playing for safety). Aucun de ses auditeurs n’était très à son aise, ni très convaincu. Wilson et Haig ne l’étaient certainement pas. Wilson poussa même une exclamation qui avait presque le caractère d’une protestation. Foch, qui avait été si éloquent la veille, ne disait pas un mot. Mais en regardant son visage,—il était assis juste en face de moi,—je voyais bien qu’il était mécontent, très impatient, et qu’il pensait évidemment que les choses pouvaient et devaient aller plus vite.»Cette sorte d’entr’acte de silence et de gêne ne pouvait se prolonger longtemps. M. Clemenceau fait un signe à lord Milner, et, l’emmenant, dans un coin, lui pose aussitôt la question: «Il faut en finir... Que proposez-vous?» Il a senti, en effet, que, cette fois, la question est mûre, et, en habile manœuvrier, il tient à laisser aux Anglais l’initiative de la demande que la France préconisait depuis des mois, mais toujours sans obtenir satisfaction. Lord Milner est très net: il propose de confier au général Foch la direction générale des armées française et anglaise, seule solution logique, à son avis, dans la situation actuelle. M. Clemenceau appelle aussitôt le général Pétain et lui fait part de la proposition de lord Milner. Très noblement, le général répond qu’il est prêt à accepter tout ce qui sera décidé dans l’intérêt de son pays et des Alliés. Lord Milner procédait de même, pendant ce temps, auprès du maréchal Haig, qui, lui aussi, ne voyant que l’intérêt général, accepta immédiatement la solution proposée.M. Clemenceau rédige aussitôt la note suivante:«Le général Foch est chargé... etc... etc...Général Mordacq, le Commandement unique (p. 77 à 88). |
| [12] | Voir en appendice le texte officiel du Rapport que lord Milner, membre du War Office, fit à son gouvernement sur son voyage en France (fin mars 1918.) |
| [13] | 3 avril 1918. |
| [14] | Le 14 avril 1918. |
| [15] | Le 28 mars 1918. |
| [16] | 2 juin 1918. |
| [17] | Ce n’est qu’à la demande expresse de M. Balfour que la déclaration du général Foch fut communiquée au président Wilson, tant au nom du gouvernement français que du gouvernement britannique. |
| [18] | Juin 1918. |
| [19] | Je ne connais rien des rapports de sir Douglas Haig avec Foch. Je crois pouvoir dire que le commandant britannique ne se rendit jamais complètement. On pense bien que je ne posais pas de questions trop précises aux chefs militaires, dans cet ordre d’idées. |