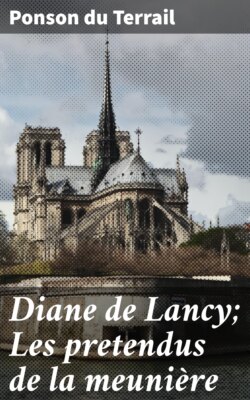Читать книгу Diane de Lancy; Les pretendus de la meunière - Ponson du Terrail - Страница 5
II
ОглавлениеOn était au mois de juillet 1815. C’était le matin vers neuf heures, sur le boulevard de Gand, au Café de Paris. Les alliés encombraient encore les rues de la capitale, et les uniformes les plus bizarres, les plus variés, depuis le bonnet fourré des Cosaques jusqu’à la pelisse du hussard hongrois, se croisaient dans tous les sens.
Le Café de Paris, qui, dès cette époque, jouissait de la vogue qu’il possède aujourd’hui encore, était le rendez-vous de deux camps bien opposés qui recherchaient toutes les occasions possibles de se trouver mutuellement en présence.
Le premier se composait de quelques officiers de l’empire, mis en demi-solde par le nouveau régime, glorieux parias qui pleuraient leur général et protestaient à coups d’épée, chaque matin, dans les allées du bois de Boulogne, contre l’envahissement de notre territoire. Le second se recrutait de quelques majors prussiens et autrichiens et d’un petit nombre de gentilshommes récemment rentrés en France, qui s’indignaient de l’épithète ridicule de voltigeurs de Louis XV.
Chaque jour, d’une table à l’autre, dans un corridor, sur les marches du perron, un regard, un défi, étaient échangés, et on allait se battre. La police avait fini par ne plus s’en mêler, tant le fait se renouvelait fréquemment.
Or, ce jour-là, vers neuf heures, dans le grand salon du Café de Paris, deux officiers de l’ancienne armée française fumaient en prenant du chocolat, et causaient à voix basse. Ils étaient vêtus du costume de ville, mais leur longue moustache retroussée et la façon toute militaire dont était boutonnée leur redingote ne laissaient prendre le change à personne sur leur profession.
Le café était à peu près désert à cette heure matinale, et l’un des deux officiers disait à son camarade:
—Je vous avoue, mon cher, que, malgré mes opinions royalistes, dont je ne me suis jamais départi, du reste, et pour lesquelles Sa Majesté l’Empereur daigne faire quelque cas de moi, je ne serais nullement fâché de rencontrer un major prussien qui voulût bien me permettre de l’envoyer dans l’autre monde pour me venger ainsi de nos humiliations et de nos revers.
—Et moi, répondit le second interlocuteur, je tirerais volontiers l’épée contre un émigré.
—Vous n’êtes pas gentilhomme, vous, mon cher Roland, et cela vous est permis. Mais moi, je suis baron, et ne puis oublier que les émigrés sont tout simplement mes parents, mes amis, mes coreligionnaires. Ils ont suivi leur roi, je suis demeuré pour servir mon pays. C’est la seule différence qui existe entre nous.
Au moment où le baron achevait, deux hommes portant l’uniforme de capitaine au chevau-légers entrèrent et vinrent s’asseoir à une table voisine. A l’empressement que montra le garçon à leur arrivée, il était aisé de les reconnaître pour des habitués, et l’officier de l’Empire tressaillit tout à coup lorsque le maître de l’établissement, s’approchant lui-même, eut dit à l’un d’eux:
—Monsieur le chevalier de Lancy désire-t-il déjeuner?
Celui qu’on venait de nommer le chevalier de Lancy était un homme de quarante-cinq à quarante-huit ans, de haute taille, à la figure basanée, aux cheveux noirs, à peine argentés çà et là d’un filet blanc. Il avait le geste impérieux, l’œil fier, la mine hautaine. Il entama presque aussitôt avec son ami une conversation dont les premiers mots étaient évidemment désagréables aux deux officiers de l’empire, car celui qui avait tout à l’heure avoué son titre de baron se leva et vint à lui:
—Monsieur, lui dit-il poliment, deux mots, s’il vous plaît.
—Je vous écoute, monsieur.
—Vous êtes le chevalier de Lancy?
—Pour vous servir, monsieur.
—Gentilhomme du Morvan?
—Précisément.
—Et le fils du marquis de Lancy, mort il y a trois ans?
—Vous touchez juste.
—Me permettez-vous, à mon tour, de vous décliner mon nom?
—Je l’attends avec impatience, monsieur.
—Eh bien, monsieur, je suis le colonel baron de Vieux-Loup, votre voisin de terre.
—Ah! ah! dit le chevalier.
—Vous savez, reprit le baron, que nos deux familles ont toujours eu l’une pour l’autre, et cela à travers les siècles, une vieille antipathie...
—Dont la cause première se perd dans la nuit des temps, riposta le chevalier.
—Pardon, reprit le baron, je crois que vous faites erreur, et si vous voulez bien me le permettre, tandis qu’on apprête votre déjeuner, je vous ferai l’historique de notre haine commune. Elle remonte au règne de Charles IX.
—En effet, je crois me souvenir.
—Attendez, chevalier: Enguerrand, baron de Vieux-Loup, était capitaine aux lansquenets; Guy, marquis de Lancy, cornette aux Suisses. Dans la nuit de la Saint-Barthélemy, ils voulurent sauver la même dame; la dame sauvée, ils engagèrent le fer et firent coup fourré.
—Vous avez raison, dit le chevalier.
—Sous Louis XIII, poursuivit le baron, mon trisaïeul Gaston de Vieux-Loup servait aux mousquetaires; le vôtre, Hector de Lancy, était guidon aux gardes de Son Éminence. Ils se croisèrent un jour dans le grand escalier du château de Rueil. L’épée du baron s’accrocha dans les chausses du marquis; ils se regardèrent, se souvinrent de la fin tragique de leurs aïeux et dégaînèrent sur-le-champ.
—Mon père m’a conté cela, interrompit le chevalier.
—Le marquis fut tué roide, et le cardinal, qui montait l’escalier en ce moment, le reçut tout sanglant dans ses bras. Ceci lui procura même l’occasion d’un joli mot; il dit au baron: «Vous m’avez fait une mauvaise plaisanterie, monsieur, et si ma robe n’était rouge, le sang de mon garde me couvrirait des pieds à la tête.»
Sous Louis XIV, poursuivit de Vieux-Loup, nos pères se firent protestants; le roi leur retira leur droit de chasse et en investit les Lancy. D’où il résulta que Louis de Vieux-Loup coupa le jarret au lévrier favori du marquis, son voisin, lequel lui envoya deux balles dans le bras et le lui cassa roide.
Depuis lors les Lancy et les Vieux-Loup évitèrent de se rencontrer; leurs chiens ne chassèrent jamais ensemble, et quand il y avait fête à votre manoir de la Fauconnière, on éteignait un candélabre dans le Grand salon de notre château de la Châtaigneraie. Voilà, monsieur, l’histoire précise de notre animosité.
—Eh bien? demanda le chevalier.
—Eh bien, monsieur, reprit le baron, il me paraît raisonnable et bien que cette animosité se perpétue. Que vous en semble?
—Mais, dit le chevalier avec hauteur, je n’y vois aucun inconvénient, monsieur.
—Et tenez, reprit le baron, le hasard me paraît s’en mêler singulièrement à propos.
—Vous trouvez?
—Parbleu! nous nous rencontrons ici, dans ce café qui est presque un champ de bataille. Vous êtes capitaine de chevau-légers, émigré rentrant. Vous avez le verbe hardi et le geste hautain du vainqueur; je suis, moi, colonel d’un régiment de la garde impériale, rangé et parqué parmi les vaincus, contraint de voir les officiers russes et prussiens fouler les boulevards de Paris, et voici que nous nous trouvons en présence, et chacun dans un camp opposé.
—C’est juste.
—Les Vieux-Loup et les Lancy des âges éteints ne trouvèrent jamais une plus belle occasion de croiser le fer, n’est-ce pas?
—En effet, dit le chevalier.
—Vous plairait-il me donner votre heure?
—Ce sera la vôtre.
—Quant à l’arme, inutile d’en parler. Entre gentilshommes, on choisit l’épée.
—J’allais vous le dire.
—Eh bien, tenez, poursuivit le baron, voici précisément un cabriolet de régie, nous avons un ami chacun, allons voir où en sont les jeunes pousses au bois de Boulogne.
—Monsieur, répondit le chevalier, j’ai une autre proposition à vous faire.
—Je vous écoute, monsieur.
—Le maître de l’établissement a ici une grande considération pour moi.
—Vous me paraissez la mériter de tout point, monsieur.
—Il se fera un plaisir de nous prêter un de ses cabinets, le plus large.
—A quoi bon?
—Le roi n’aime pas les duels; au bois de Boulogne, une égratignure fait scandale.
—Comme il vous plaira, monsieur.
—Me donnerez-vous le temps de déjeuner?
—Parfaitement; je sais par expérience qu’un galant homme se bat médiocrement à jeun.
Le chevalier déjeuna, le baron acheva son cigare, puis ils montèrent au premier étage avec leurs témoins, s’installèrent dans un cabinet dont on avait tout exprès enlevé les meubles, et ils mirent l’épée à la main.
A la troisième passe, le chevalier de Lancy reçut un coup de quarte dans la poitrine et tomba sans pousser un cri.
La mort avait été instantanée.