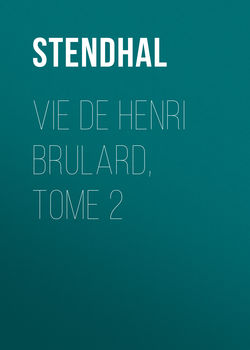Читать книгу Vie de Henri Brulard, tome 2 - Стендаль (Мари-Анри Бейль), Stendhal - Страница 3
CHAPITRE XXXII 35
ОглавлениеJ'avais donc un certain beau littéraire dans la tête en 1790 ou 1797, quand je suivais le cours de M. Dubois-Fontanelle; ce beau était fort différent du sien. Le trait le plus marquant de cette différence était mon adoration pour la vérité tragique et simple de Shakespeare, contrastant avec la puérilité emphatique de Voltaire.
Je me souviens, entre autres, que M. Dubois nous récitait avec enthousiasme de certains vers de Voltaire ou de lui, où il y avait: dans la plaie … retournant le couteau. Ce mot couteau me choquait à fond, profondément, parce qu'il appliquait mal ma règle, mon amour pour la simplicité. Je vois ce pourquoi aujourd'hui; j'ai senti vivement toute ma vie, mais je ne vois le pourquoi que longtemps après.
Hier seulement, 18 janvier 1836, fête de la catedra de Saint-Pierre, en sortant de Saint-Pierre à quatre heures, et, me retournant pour regarder le dôme, pour la première fois de ma vie je l'ai regardé comme on regarde un autre édifice: j'y ai vu le balcon de fer du tambour, je me suis dit: je vois ce qui est pour la première fois; jusqu'ici je l'ai regardé comme on regarde la femme qu'on aime. Tout m'en plaisait (je parle du tambour et de la coupole), comment aurais-je pu y trouver des défauts?
Voilà que par un autre chemin, un autre côté, je reviens à avoir la vue de ce défaut que j'ai noté plus haut dans ce mien véridique récit, le manque de sagacité.
Mon Dieu! comme je m'égare! J'avais donc une doctrine intérieure quand je suivais le cours de M. Dubois, je n'apprenais tout ce qu'il me disait que comme une fausseté utile. Quand il blâmait Shakespeare surtout, je rougissais intérieurement.
Mais j'apprenais d'autant mieux cette doctrine littéraire que je n'en étais pas enthousiaste.
Un de mes malheurs a été de ne pas plaire aux gens dont j'étais enthousiaste (exemple Mme Pasta et M. de Tracy); apparemment, je les aimais à ma manière et non à la leur.
De même, je manque souvent l'exposition d'une doctrine que j'adore: on me contredit, les larmes me viennent aux yeux, et je ne puis plus parler. Je dirais, si je l'usais: Ah! vous me percez le cœur! Je me souviens de deux exemples bien frappants pour moi:
1° Louange du Corrège à propos de Prud'hon, parlant à Mareste dans le Palais-Royal, et allant à un pique-nique avec MM. Duvergier de Hauranne, l'aimable Dittmer et le vilain Cavé.
Le second, parlant de Mozart à MM. Ampère et Adrien de Jussieu, en revenant de Naples vers 1832 (un mois après le tremblement de terre qui a écorné Foligno).
Littérairement parlant, le cours de M. Dubois36 (imprimé depuis en quatre volumes par sou petit-fils, Ch. Renauldon) me fut utile comme me donnant une vue complète du champ littéraire et empêchant mon imagination d'en exagérer les parties inconnues, comme Sophocle, Ossian. etc.
Ce cours fut très utile à ma vanité en confirmant les autres définitivement dans l'opinion qui me plaçait dans les sept à huit garçons d'esprit de l'Ecole. Il me semble toutefois que Grand-Dufay était placé avant moi; j'ai oublié le nom des autres.
L'âge d'or de M. Fontanelle le temps dont il parlait avec attendrissement, c'était son arrivée à Paris vers 1750. Tout était plein alors du nom de Voltaire et des ouvrages qu'il envoyait sans cesse de Ferney. (Etait-il déjà à Ferney?)
Tout cela manquait son effet sur moi, qui abhorrais la puérilité de Voltaire dans l'histoire et sa basse envie contre Corneille; il me semble que dès cette époque j'avais remarqué le ton prêtre du Commentaire de Voltaire dans la belle édition de Corneille avec estampes, qui occupait un des hauts rayons de la bibliothèque fermée de glaces de mon père à Claix, bibliothèque dont je volais la clef et où j'avais découvert, ce me semble, la Nouvelle-Héloïse quelques années avant, et certainement depuis Grandisson37, que je lisais en fondant en larmes de tendresse dans un galetas du second étage de la maison de Claix, où je me croyais en sûreté.
M. Jay, ce grand hâbleur, si nul comme peintre, avait un talent marqué38 pour allumer l'émulation la plus violente dans nos cœurs et, à mes yeux maintenant, c'est là le premier talent d'un professeur. Combien je pensais différemment vers 1796! J'avais le culte du génie et du talent.
Un fantasque faisant tout par à coup, comme en agit d'ordinaire un homme de génie, n'eût pas eu quatre cents ou trois cent cinquante élèves, comme M. Jay.
Enfin, la rue Neuve était encombrée quand nous sortions de son cours, ce qui redoublait les airs importants et emphatiques du professeur39.
Je fus ravi, comme du plus difficile et du plus bel avancement possible, quand, vers le milieu d'une année, ce me semble. M. Jay me dit avec son air majestueux et paterne:
«Allons, monsieur B[eyle], prenez votre carton et allez, allez vous installer à la Bosse40.»
Ce mot: monsieur, d'un usage si fréquent à Paris, était tout-à-fait insolite à Grenoble, en parlant à un enfant, et m'étonnait toujours, à moi adressé.
Je ne sais pas si je dus cet avancement à quelque mot de mon grand-père adressé à M. Jay ou à mon mérite à faire des hachures bien parallèles dans la classe des Académies, où depuis peu j'avais été admis. Le fait est qu'il surprit moi et les autres.
Admis parmi les douze ou quinze bosses, mes dessins aux crayons noirs et blancs, d'après les têtes de Niobé et de Démothène (ainsi nommées par nous), surprirent M. Jay, qui avait l'air scandalisé de me trouver autant de talent qu'aux autres. Le plus fort de cette classe était un M. Ennemond Hélie (depuis notaire en cour); c'était l'homme le pins froid, il avait été, disait-on, à l'armée. Ses ouvrages tendaient, au genre de Philippe de Champaigne, mais c'était un homme et non un enfant, comme nous autres, il y avait de l'injustice à le faire concourir avec nous.
Bientôt à la Bosse j'obtins un prix. Nous l'obtînmes à deux ou trois, on tira au sort et j'eus l'Essai sur la Poésie et la Peinture, de l'abbé Dubos, que je lus avec le plus vif plaisir. Ce livre répondait aux sentiments de mon cœur, sentiments inconnus à moi-même.
Moulezin, l'idéal du provincial timide, dépourvu de toute idée et fort soigneux, excellait à tirer des hachures bien parallèles avec un crayon de sanguine bien taillé. Un homme de talent, à la place de M. Jay, nous eût dit en nous montrant Moulezin: «Messieurs, voilà comment il ne faut pas faire.»Au lieu de cela, Moulezin était le rival d'Ennemond Hélie.
Le spirituel Dufay faisait des dessins fort originaux, disait M. Jay, il se distingua surtout quand M. Jay eut l'excellente idée de nous faire tous poser tour à tour pour l'étude des têtes. Nous avions aussi le gros Hélie, surnommé le bedot (le bête, le lourd), et les deux Monval, que leur faveur aux mathématiques avait suivi à l'école de dessin. Nous travaillions avec une ardeur et une rivalité incroyables deux ou trois heures de chaque après-midi.
Un jour qu'il y avait deux modèles, le grand Odru, du latin, m'empêchait de voir; je lui donnai un soufflet de toutes mes forces en O41. Un instant après, moi rassis à ma place en H, il tira ma chaise par derrière et me fit tomber sur le derrière. C'était un homme; il avait un pied de plus que moi, mais il me haïssait fort. J'avais dessiné, dans l'escalier du latin, de concert avec Gauthier et Crozet, ce me semble, une caricature énorme comme lui, sous laquelle j'avais écrit: Odruas Kambin. Il rougissait quand on l'appelait Odruas, et dirait kambin, au lieu de: quand bien.
A l'instant, il fut décidé que nous devions nous battre au pistolet. Nous descendîmes dans la cour; M. Jay voulant s'interposer, nous primes la fuite; M. Jay retourna à l'autre salle. Nous sortîmes, mais tout le collège nous suivit. Nous avions peut-être deux cents suivants.
J'avais prié Diday, qui s'était trouvé là, de me servir de témoin; j'étais fort troublé, mais plein d'ardeur. Je ne sais comment il se fit que nous nous dirigeâmes vers la porte de la Graille, fort incommodés par notre cortège. Il fallait avoir des pistolets, ce n'était pas facile. Je finis par obtenir un pistolet de huit pouces de long. Je voyais Odru marcher à vingt pas de moi, il m'accablait d'injures. On ne nous laissait pas approcher; d'un coup de poing, il m'aurait tué.
Je ne répondais pas à ses injures, mais je tremblais de colère. Je ne dis pas que j'eusse été exempt de peur si le duel eût été arrangé comme à l'ordinaire, quatre ou six personnes allant froidement ensemble, à six heures du matin, dans un fiacre, à une grande lieue d'une ville.
La garde de la porte de la Graille fut sur le point de prendre les armes.
Cette procession de polissons, ridicule et fort incommode pour nous, redoublait ses cris: Se battront-ils? ne se battront-ils pas? dès que nous nous arrêtions pour faire quelque chose. J'avais grand'peur d'être rossé par Odru, plus grand d'un pied que ses témoins et que les miens. Je me rappelle du seul Maurice Diday comme mon témoin (depuis plat ultra, maire de Domène, et écrivant dans les journaux des lettres ultra, sans orthographe). Odru était furieux.
Enfin, après une heure et demie de poursuite, comme la nuit approchait, les polissons nous laissèrent un peu de tranquillité entre les portes de Bonne et Très-Cloîtres. Nous descendîmes dans les fossés de la ville, tracés par Louis Royer, à un pied de profondeur, ou nous nous arrêtâmes sur le bord de ces fossés.
Là, on chargea les pistolets, on mesura un nombre de pas effroyable, peut-être vingt, et je me dis: Voici le moment d'avoir du courage. Je ne sais comment, Odru dut tirer le premier, je regardai fixement un petit morceau de rocher en forme de trapèze42 qui se trouvait au-dessus de lui, le même que l'on voyait de la fenêtre de ma tante Elisabeth, à côté du toit de l'église Saint-Louis.
Je ne sais comment on ne fit pas feu. Probablement, les témoins n'avaient pas chargé les pistolets. Il me semble que je n'eus pas à viser. La paix fut déclarée, mais sans loucher de mains ni encore moins embrassade. Odru, fort en colère, m'aurait, rossé43.
Dans la rue Très-Cloîtres, marchant avec mon témoin Diday44, je lui dis:
«Pour ne pas avoir peur, tandis qu'Odru me visait, je regardais le petit rocher au-dessus de Seyssins45.
– Tu ne dois jamais dire ça, une telle parole ne doit jamais sortir de ta bouche», me dit-il, en me grondant ferme.
Je fus fort étonné et, en y réfléchissant, fort scandalisé de cette réprimande.
Mais, dès le lendemain, je me trouvai un remords horrible d'avoir laissé arranger cette affaire. Cela blessait toutes mes rêveries espagnoles: comment oser admirer le Cid après ne s'être pas battu? Comment penser aux héros de l'Arioste? Comment admirer et critiquer les grands personnages do l'histoire romaine dont je relisais souvent les hauts faits dans le doucereux Rollin?
En écrivant ceci, j'éprouve la sensation de passer la main sur la cicatrice d'une blessure guérie.
Je n'ai pas pensé deux fois à ce duel depuis mon autre duel arrangé avec M. Raindre (chef d'escadron ou colonel d'artillerie légère, à Vienne, en 1809, pour Babet).
Je vois qu'il a été le grand remords de tout le commencement de ma jeunesse, et la vraie raison de mon outrecuidance (presque insolence) dans le duel de Milan, où Cardon fut témoin.
Dans l'affaire Odru, j'étais étonné, troublé, me laissant faire, distrait par la peur d'être rossé par le colossal Odru, je me préparais de temps en temps à avoir peur. Pendant les deux heures que dura la procession des deux cents gamins, je me disais: Quand les pas seront mesurés, c'est alors qu'il y aura du danger. Ce qui me faisait horreur, c'était d'être rapporté à la maison sur une échelle, comme j'avais vu rapporter le pauvre Lambert. Mais je n'eus pas un instant l'idée la plus éloignée que l'affaire serait arrangée.
Arrivé au grand moment, pendant qu'Odru me visait et, ce me semble, que son pistolet ratait plusieurs fois, j'étudiais les contours du petit rocher46. Le temps ne me sembla point long (comme il semblait long, à la Moskowa, au très brave et excellent officier Andrea Corner, mon ami).
En un mot, je ne jouai point la comédie, je fus parfaitement naturel, point vantard, mais très brave.
J'eus tort, il fallait blaguer; avec ma vraie résolution de me battre, je me serais fait une réputation dans notre ville, où l'on se battait beaucoup, non pas comme les Napolitains de 1836, parmi lesquels les duels produisent très peu de cadavres, ou point, mais en braves gens. Par contraste avec mon extrême jeunesse (ce devait être en 1796, donc treize47 ans, ou peut-être 1795) et mes habitudes retirées et d'enfant noble si j'eusse eu l'esprit de parler un peu je me faisais une réputation admirable.
M. Châtel, une de nos connaissances et de nos voisins, Grande-rue, avait tué six hommes. De mon temps, c'est-à-dire de 1798 à 1805, deux de mes connaissances, le fils Bernard et Rover Gros-bec, ont été tués en duel, M. Rover à quarante-cinq pas, à la nuit tombante, dans les délaissés du Drac, prés l'endroit où fut établi, depuis, le pont de fil de fer48.
Ce fat de Bernard49 (fils d'un autre fat, depuis juge à la Cour de Cassation, ce me semble, et ultra), ce fat de Bernard reçut au moulin de Canel50 un petit coup d'épée de l'aimable Meffrey (M. de Meffrey, receveur général, mari de la dame d'honneur complaisante de Mme la duchesse de Berry. et depuis heureux héritier du gros Vourey). Bernard tomba mort, M. de Meffrey s'enfuit à Lyon; la querelle était presque de caste, Mareste fut, ce me semble, témoin de Meffrey et m'a raconté la chose.
Quoi qu'il en soit, je gagnai un remords profond:
1° A cause de mon espagnolisme, défaut exilant encore en 1830, ce que Fiore a reconnu et qu'il appelle avec Thucydide: Vous tendez, vos filets trop haut.
2° Faute de blague. Dans les grands dangers, je suis naturel et simple. Cela fut de bon goût à Smolensk, aux yeux du duc de Frioul. M. Daru, qui ne m'aimait pas, écrivit la même chose à sa femme, de Vilna, je pense, après la retraite de Moscou. Mais, aux yeux du vulgaire, je n'ai pas joué le rôle brillant auquel je n'avais qu'à étendre la main pour atteindre.
Plus j'y réfléchis, plus il me semble que cette dispute est de 1795, bien antérieure à ma passion pour les mathématiques, à mon amitié pour Bigillion, à mon amitié tendre pour Mlle Victorine.
Je respectais infiniment Maurice Diday51:
1° parce que mon excellent grand-père, ami peut-être intime de sa mère, le louait beaucoup:
2° je l'avais vu plusieurs fois en uniforme de soldat d'artillerie et il était allé à son corps, plus loin que Montmélian:
3° enfin, et surtout, il avait l'honneur d'être amoureux de Mlle Létourneau, peut-être la plus jolie fille de Grenoble et fille de l'homme certainement le plus gai, le plus insouciant, le plus philosophe, le plus blâmé par mon père et mes parents. En effet, M. Létourneau leur ressemblait bien peu; il s'était ruinoté et avait épousé une demoiselle Borel, je crois, une sœur de la mère de Victorine Mounier, qui fut cause de mon abandon de l'état militaire et de ma fuite à Paris en 1803.
Mlle Létourneau était une beauté dans le genre lourd (comme les figures de Tiarini. Mort de Cléopatre et d'Antoine, au musée du Louvre). Diday l'épousa par la suite mais eut bientôt la douleur de la perdre, après six ans d'amour; on dit qu'il en fut hébété et se retira à la campagne, à Domène52.
Après mon prix, au milieu de l'année, à la Bosse, qui scandalisa tous les courtisans plus avancés que moi à la cour de M. Jay, mais que personne n'osa dire immérité, mon rang changea au dessin, comme nous disions. Je me serais mis au feu pour obtenir aussi un prix à la fin de l'année; il me semble que je l'obtins, sinon je trouverais le souvenir53 du chagrin de l'avoir manqué.
J'eus le premier prix de belles-lettres avec acclamation, j'eus un accessit ou un second prix aux mathématiques, et celui-là fut dur à enlever. M. Dupuy avait une répugnance marquée pour ma manie raisonnante.
Il appelait tous les jours au tableau et en les tutoyant MM. de Monval – ou les Monvaux, comme nous les appelions, parce qu'ils étaient nobles, lui-même prétendait à la noblesse54, – Sinard, Saint-Ferréol, nobles, le bon Aribert, qu'il protégeait, l'aimable Mante, etc., etc., et moi le plus rarement qu'il pouvait, et quand j'y étais, il ne m'écoutait pas, ce qui m'humiliait et me déconcertait beaucoup car, les autres, il ne les perdait pas de l'œil. Malgré cela, mon amour, qui commençait à être sérieux, pour les mathématiques, faisait que quand je trouvais une difficulté je la lui exposais, moi étant au tableau, H55, et M. Dupuy dans son immense fauteuil bleu de ciel en D; mon indiscrétion l'obligeait à répondre, et c'était là le diable. Il me demandait sans cesse de lui exposer mes doutes en particulier, prétendant que cela faisait perdre du temps à la classe.
Il chargeait le bon Sinard de me lever mes doutes. Sinard, beaucoup plus fort mais de bonne foi, passait une heure ou deux à nier ces doutes, puis à les comprendre, et finissait par avouer qu'il ne savait que répondre.
Il me semble que tous ces bravés gens-là, Mante excepté, faisaient des mathématiques une simple affaire de mémoire. M. Dupuy eut l'air fort attrapé de mon premier prix, si triomphant, au cours de belles-lettres. Mon examen qui eut lieu, comme tous les autres, en présence des membres du Département, des membres du jury, de tous les professeurs et de deux, ou trois cents élèves, fut amusant pour ces Messieurs. Je parlai bien, et les membres de l'administration départementale, étonnés de ne pas s'ennuyer, me firent compliment et, mon examen terminé, me dirent:
«Monsieur B[eyle], vous avez le prix; mais, pour notre plaisir, veuillez bien répondre encore à quelques questions.»
Ce triomphe précéda, je crois, l'examen de mathématiques et me donnait un rang et une assurance qui pour l'année suivante forçaient M. Dupuy à m'appeler souvent au tableau.
Si jamais je repasse par Grenoble, il faut que je fasse faire des recherches dans les archives de la Préfecture pour les années de 1794 à 1799 inclusivement. Le procès-verbal imprimé de la distribution des prix me donnerait la date de tous ces petits événements dont, après tant d'années, le souvenir me revient avec plaisir. J'étais à la montée de la vie, et avec quelle imagination de feu ne me figurais-je pas les plaisirs à venir?.. Je suis à la descente56.
Après ce mois d'août triomphant, mon père n'osa plus s'opposer d'une façon aussi ferme à ma passion pour la chasse. Il me laissa prendre de mauvaise grâce son fusil et même un fusil de calibre de munition, plus solide, qui avait été fait de commande pour feu M. Rey, notaire, son beau-frère.
Ma tante Rey57 était une jolie femme que j'allais voir dans son joli appartement, dans la cour du Palais. Mon père ne voulait pas que je me liasse58 avec Edouard Rey, son second fils, inique polisson lié avec la pire canaille. (C'est aujourd'hui le colonel d'artillerie Rey, insigne Dauphinois, plus fin et plus trompeur à lui tout seul que quatre procureurs grenoblois, du reste archi-cocu, bien peu aimable, mais qui doit être un bon colonel dans cette arme qui a tant de détails. Il me semble qu'en 1831 il était employé à Alger. Il a été amant de M. P.59)
36
… le cours de M. Dubois (imprimé depuis en quatre volumes …– Dubois-Fontanelle, Cours de Belles-lettres. Paris, Dufour, 1813-1820, 4 volumes in-8°.
37
… Grandisson …– Roman épistolaire de Richardson, publié en 1753.
38
… ce grand hâbleur, si nul comme peintre, avait un talent marqué …– Variante: «Ce grand hâbleur, qui avait si peu de talent comme peintre, en avait un fort grand… »
39
… les airs importants et emphatiques du professeur.– Variante: «Maître.»
40
… allez vous installer à la Bosse.– Au verso du fol. 466 est un plan de l'Ecole centrale.
41
… je lui donnai un soufflet de toutes mes forces en O.– Suit un croquis des places respectives des élèves autour des modèles.
42
… un petit morceau de rocher en forme de trapèze …– Suit une silhouette du rocher. – A ce sujet, voir plus haut, t. I, chapitre XVI, p. 187-188.
43
Odru, fort en colère, m'aurait rossé.– Plan du lieu du duel et de la position des adversaires.
44
… mon témoin Diday …– Ms.: «Baudry.»
45
… le petit rocher au-dessus de Seyssins.– De nouveau une silhouette de ce rocher.
46
… j'étudiais les contours du petit rocher.– Pour la troisième fois, Stendhal figure la silhouette de ce rocher.
47
… en 1796, donc treize ans …– Ms.: «10 + 3.»
48
… le pont de fil de fer.– Le pont suspendu, aujourd'hui situé à l'extrémité du cours Berriat.
49
Ce fat de Bernard …– A ce duel figuraient: MM. Didier, Madier de Montjeau, de Vourey et de Mareste. (Note au crayon de R. Colomb.)
50
… au moulin de Canel …– Voisin du cours de Saint-André.
51
… Maurice Diday.– Ms.: «Baudry.» Stendhal avait d'abord écrit: Diday, puis a remplacé ce nom par celui de Baudry.
52
… et se retira à la campagne, à Domène.– Erreur. Il fut directeur des contributions indirectes et n'a quitté cette administration que pour prendre sa retraite, de 1830 à 1833, je crois. (Note au crayon de R. Colomb.) – Pierre-Maurice Diday épousa, le 20 octobre 1808, Marie-Caroline-Ernestine Létourneau. – Suit un croquis de la vallée du Graisivaudan, «vallée admirable»; Stendhal y a figuré Grenoble, Saint-Ismier, Domène et Fort-Barraux, et, à Saint-Ismier, les maisons de MM. Bigillion et Faure.
53
… je trouverais le souvenir …– Variante: «Je me souviendrais.»
54
… lui-même prétendait à la noblesse …– Dupuy portait le nom de Dupuy de Bordes.
55
… moi étant au tableau. H …– Suit un croquis du jeune Beyle au tableau. (Voir notre planche.)
56
Je suis à la descente.– Au-dessous, Stendhal a figuré la courbe de son existence. La période culminante va de 1810, «ma nomination d'auditeur, 3 août 1810», à 1821, «mon retour de Milan, en juin 1821».
57
Ma tante Rey …– Sophie-Eléonore Beyle, née le 6 janvier 1752, avait épousé M. Rey, notaire à Grenoble.
58
… que je me liasse …– Variante: «Que je fisse amitié.»
59
– A la fin du chapitre, au verso du fol. 500, Stendhal note: «En sept quarts d'heure, de 483 à 500, dix-sept pages.»