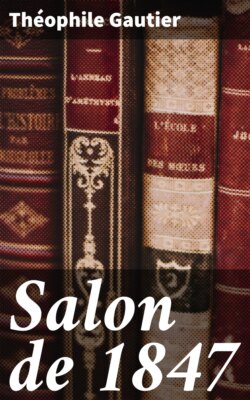Читать книгу Salon de 1847 - Theophile Gautier - Страница 6
III
ОглавлениеLe Sabbat des Juifs à Constantine, tableau refusé de M. Théo dore Chasseriau. — MM. Gérôme, — Horace Vernet, — Ziégler, — Laëmlein, — Hippolyte Flandrin.
Sans la niaise férocité du jury qui a refusé M. Théodore Chasseriau, il se serait établi une lutte bien intéressante entre l’Orgie romaine et son Sabbat des juifs à Constantine, toile de sept mètres, composition immense, de la plus audacieuse originalité, où le jeune peintre, encore tout doré du soleil d’Afrique, a renfermé une éblouissante vision d’Orient dans ce fin contour grec qu’il semble avoir emprunté aux artistes de Pompeï et d’Herculanum, et qui en faisait l’élève chéri du maître le plus sévère. Rien n’est à la fois plus barbare et plus pur, plus arrêté et plus flamboyant; on dirait un rêve peint; mais ce rêve si éclatant, si bigarré, si splendide, si plein de rayons de soleil et d’yeux de diamant, c’est la vérité, c’est la vie. Nous qui avons passé par cette rue dont les maisons s’étagent sur des escaliers renversés, qui pouvons saluer comme des connaissances ces belles têtes au vague sourire, au regard chargé de mystère, nous nous sommes cru transporté sur l’aile de l’oiseau-roc ou sur le tapis des quatre Fakardins dans le nid de vautours d’Achmet-Bey.
N’est-ce pas une honte et une infamie que quelques membres de l’Institut, dont les noms sont inconnus et les œuvres risibles, aient eu l’outrecuidance de rejeter un tableau de cette importance, qui, outre le mérite qu’il renferme, est le premier où l’Orient moderne soit représenté avec les proportions et le style de l’histoire? Est-il national de fermer les portes du Louvre à un ouvrage dont l’étrangeté même témoigne de notre gloire? En effet, ces figures chimériquement réelles, ces costumes fabuleusement vrais, ces maisons d’une exactitude invraisemblable, tout cela est devenu une ville française. Ces fantômes bariolés sont nos compatriotes. Le tableau ne fùt-il pas — ce qu’il est — de première force, cette idée de révéler à la France les physionomies de l’Afrique, de lui présenter, comme en un bouquet, les plus purs types de ces belles races qui nous sont maintenant soumises, ne valait-elle pas d’être prise en considération, et d’amener à l’indulgence les esprits timides ou retardataires qu’auraient pu alarmer la fierté du dessin et la fougue de l’exécution?
Est-ce qu’ils savent d’ailleurs ce qu’ils veulent, ces juges iniques ou absurdes, et souvent l’un et l’autre? N’ont-ils pas repoussé, l’année dernière, une Cléopâtre se faisant piquer par l’aspic, du même peintre, sujet classique s’il en fut, et traité avec une élévation de style, une correction de dessin, une fermeté de pinceau et une puissance de couleur admirables? Ce cadre, l’un des plus beaux de l’école moderne, semblait un carton de M. Ingres coloré par Titien.
Heureusement pour M. Chasseriau, sa belle chapelle de Sainte-Marie-l’Égyptienne, dans l’église de Saint-Merry, et ses gigantesques peintures murales au palais du quai d’Orsay, qui ne contiennent pas moins de deux cent trente figures, et qu’il vient d’ouvrir au public, cassent violemment l’arrêt du tribunal prévaricateur; les juges prévenus auront beau lui fermer le Louvre, personne ne croira que l’auteur de la Vénus Aphrodite, des Troyennes au bord de la mer, du Christ descendant du jardin des Olives, ne mérite pas un coin dans une exposition où M. Heim, l’un des juges, obtient un succès de fou-rire, par la peinture la plus grotesque qui ait jamais fait la grimace entre quatre morceaux de bois doré.
N’y a-t-il pas en outre une absurdité patente à ce qu’un jeune homme chargé, par la direction des Beaux-Arts, du travail le plus vaste de ce temps-ci, et à la plus belle place qui existe peut-être à Paris, soit jugé indigne d’appendre une toile sur la tenture verte, à côté de ces affreux portraits de bourgeois et de cucurbitacées pour lesquels le jury montre toujours la plus paternelle indulgence?
On dit qu’effrayés des clameurs qu’ils soulèvent et de la réprobation publique dont ils sont poursuivis, ces inquisiteurs de l’art, ces faiseurs d’exécutions secrètes, qui ont, pour noyer les jeunes réputations, un canal Orfano sous un pont des Soupirs, ont pris, à la fin, leur triste besogne en aversion; à leur chevet d’assassins se dressent, la nuit, les spectres des tableaux tués par eux, et, comme le meurtre d’une pensée est tout aussi grave que celui d’un corps, et qu’il vaut tout autant prendre la vie à quelqu’un que lui prendre la gloire, ils sont en proie à des insomnies amères et à des remords cuisants; ils vont, à ce que l’on assure, adresser une pétition au roi pour le supplier de les débarrasser de ces fonctions d’exécuteurs des basses œuvres. S’ils se repentent, à tout péché miséricorde...
Puisque nous sommes malheureusement privé du plaisir de rendre compte du Sabbat des juifs à Constantine, félicitons-nous de ce que le jury ait laissé passer, par distraction apparemment, un charmant tableau plein de finesse et d’originalité d’un jeune homme dont nous entendons parler pour la première fois, et dont c’est le début si nous ne nous trompons: nous voulons dire les Jeunes Grecs faisant battre des coqs, de M. Gérôme.
Ce sujet, tout vulgaire en apparence, a pris sous le fin crayon et le pinceau délicat de M. Gérôme une élégance rare et une distinction exquise; ce n’est pas, comme on pourrait le croire, au choix du thème adopté par l’artiste, une toile de petite dimension, comme cela est habituel pour de semblables fantaisies. Les figures sont de grandeur naturelle, et traitées d’une façon tout historique.
Il faut beaucoup de talent et de ressources pour élever une scène si épisodique au rang d’une composition noble, et que ne désavouerait aucun maître.
Au pied du socle d’une fontaine tarie où s’adosse un sphinx de marbre au profil écorné, et qu’entourent les végétations des pays chauds, arbousiers, myrtes, lauriers-roses, dont les feuilles métalliques se découpent sur l’azur tranquille de la mer, séparée de l’azur du ciel par la crête violâtre d’un promontoire, sont groupés deux adolescents, une vierge et un éphèbe, qui font battre les courageux oiseaux de Mars.
La jeune fille s’accoude sur la cage, qui a contenu les belliqueux volatiles, dans une pose pleine de grâce et d’élégance. ’Ses mains effilées et pures s’entre-croisent et s’arrangent heureusement; un de ses bras presse légèrement sa gorge naissante, et le torse prend cette ligne serpentine si cherchée par les anciens; la cuisse, vue en raccourci, est dessinée savamment; la tête, coiffée avec un goût exquis d’une couronne de cheveux blond-cendré, dont les tons fins et doux tranchent à peine sur la peau, a une mignonnerie enfantine, une suavité virginale; les yeux baissés, la bouche entr’ouverte par un sourire de victoire, car son coq paraît avoir l’avantage, la jeune fille suit la lutte avec cette attention distraite d’un parieur sûr de son fait.
Rien n’est plus joli que cette figure couverte seulement d’un bout de draperie blanche et jaune que retient sur le glissant du contour un léger cordon de pourpre; cet assemblage de tons très-doux et très harmonieux fait valoir la blancheur dorée du corps de la jeune Grecque.
Le garçon, les cheveux ornés de quelque folle brindille, de quelque feuille cueillie au buisson, s’agenouille et se penche vers son coq, dont il tâche d’exciter la valeur. Ses traits, quoique rappelant peut-être un peu trop le modèle, sont dessinés avec une finesse extrême; on voit qu’il suit de tous ses regards et de toute son âme les péripéties du combat.
Quant aux coqs, ce sont de vrais prodiges de dessin, d’animation et de couleur; ni Sneyders, ni Veeninex, ni Oudry, ni Desportes, ni Rousseau, ni aucun de ceux qui ont peint des animaux n’ont atteint, après vingt ans de travail, la perfection où M. Gérôme est arrivé tout d’un coup.
Le coq noir et lustré de reflets verdâtres, qui ne touche plus la terre, et s’élance le col recourbé, son triple collier de plumes se hérissant, l’œil furibond, la crête sanglante, le bec ouvert, les pattes ramenées au poitrail, et présentant à l’adversaire deux étoiles d’ongles menaçants et d’éperons formidables, est une merveille de pose, de dessin et de coloris.
Le coq au pelage cuivré de nuances rousses, qui s’écrase contre le sol, relève la tête sournoisement, et tend son bec comme un glaive où doit s’embrocher son trop fougueux adversaire, n’est pas moins digne d’admiration.
Ce qu’il y a surtout de remarquable dans ces coqs, c’est qu’à la plus parfaite vérité ils joignent une élégance, une noblesse singulières. Ce sont des coqs épiques, olympiens, et tels que Phidias les aurait sculptés aux pieds d’Arès, le dieu farouche enfanté par Hêrê sans la participation de Zeus.
Enfants et coqs font du tableau de M. Gérôme une des plus charmantes toiles de l’exposition. Quel délicieux dessus de porte pour la salle à manger d’un roi ou d’un Rothschild!
Cette année, Horace Vernet a fait trêve à son épopée d’Afrique. Il ne couvre plus tout un côté du salon de ses panoramas militaires tracés d’une main si prompte et d’un pinceau si alerte.
Deux tableaux composent tout son bagage: l’un est le Portrait équestre du roi au milieu de ses fils; l’autre, une Judith, thème favori auquel l’artiste aime à revenir.
Très-probablement Horace Vernet n’obtiendra pas, avec ce portrait, le succès que lui ont valu, auprès du public, la Smala et la Bataille de l’Isly; c’est pourtant une des meilleures choses qu’il ait faites; mais il n’y a là ni sujet, ni drame, ni palanquins se renversant avec des dromadaires qui les portent, et répandant sur le sable leur charge de femmes comme un écrin qu’on jette à terre et dont s’égrainent les bijoux, ni avare sauvant son trésor, ni négresse idiote agitant le hochet de la folie au milieu du tumulte et de l’épouvante; aucun de ces épisodes demi-grotesques dont la foule est si friande. Mais ces chevaux vus de face présentent des difficultés de raccourci que personne à coup sûr n’eût pu surmonter aussi heureusement qu’Horace Vernet. Ils sont bien dessinés, bien peints, sauf quelques nuances criardes, quelques brillants outrés; qui n’appartiennent qu’au vernis de la Chine de lord Elliot, et dont jamais la robe d’un quadrupède n’a pu se lustrer, pour moirée et soyeuse qu’elle fût. Le frisson de la lumière chatoie vivement, nous le savons, sur le poil d’une bête de race bien nourrie et pleine de vigueur; mais nous ne pensons pas que les éclairs métalliques dont flamboie le cheval noir, ou plutôt violet, qui piaffe à la gauche du roi, aient jamais illuminé le poitrail d’aucun coursier.
Les personnages, d’une ressemblance suffisante, sont bien en selle, sans roideur, et suivent bien le mouvement de leurs montures.
Au fond, par derrière, à travers une grille surmontée d’un écusson fleurdelisé, on aperçoit, au milieu de la cour du palais de Versailles, un Louis XIV de bronze chevauchant fièrement sur un coursier d’airain.
Cette disposition bizarre et nécessaire de six personnages équestres, qui s’offrent tous de front au spectateur, préoccupe d’abord l’œil, qui ne sait trop où s’arrêter, mais qu’attirent bientôt et que ramènent au centre de la composition le blanc argenté du cheval que monte le roi et la lumière plus largement répandue sur le noble père de cet escadron de princes.
Nous trouvons le fond un peu trop étroit; quelques pieds de plus dans tous les sens eussent donné de l’air et de la grâce au groupe des cavaliers.
La Judith nous semble un des tableaux les plus malheureux d’Horace Vernet. Même dans ses toiles les plus rapidement brossées, il y a toujours du mouvement, de l’adresse, de l’esprit, une sûreté d’emporte-pièce dans la touche; ici, nous le disons à regret, tout est gauche, pénible, maladroitement emmanché ; la composition a toutes les peines du monde à se loger dans le cadre. Le malheureux Holopherne, outre le désagrément d’avoir eu la tête coupée, éprouve encore celui de ne savoir où mettre ses jambes, et se contourne dans une mare de sang de la façon la plus incommode pour lui et pour le spectateur. Judith, au bout d’un bras d’une roideur automatique, tient un yatagan émaillé de caillots pourpres, et jette de l’autre la tête du général assyrien dans un cabas de tapisserie, substitué, on ne sait pas trop pourquoi, au sac biblique tenu ouvert par la servante traditionnelle. Horace Vernet a commencé depuis longtemps cette mascarade à la bédouine des sujets de l’Ancien Testament.
Nous ne protesterions pas contre ces fantaisies, car nous admettons très-bien, dans le Mariage de la Vierge de Raphaël, le jeune homme en pantalon rouge qui brise des baguettes sur son genou; et nous ne sommes nullement choqué des anachronismes de costume des maîtres vénitiens, parce qu’ils sont involontaires et naïfs; si les plis du bournous étaient agencés dans un grand style, si toutes les petites verroteries de la toilette arabe étaient rendues avec largeur, et si, à défaut de la vérité historique, la vérité humaine, la vérité éternelle, brillait dans la figure; si cette Judith avait le corps d’une des filles des tribus errantes, les formes fines et nerveuses, le feu dans l’œil, le souffle dans la narine, la palpitation du cœur sous un sein ému, que nous importerait qu’elle fût accoutrée en femme de Tuggurt ou de Biskarra, au lieu de porter les habits somptueux d’une riche veuve de Béthulie?
Cet ajustement romanesque n’est pas même arrangé avec l’élégance qu’on est en droit d’attendre des costumes de fantaisie. La ceinture, placée très-bas, allonge démesurément le torse et fait paraître court le reste du corps. Pourquoi aussi cette large plaque d’un rouge équivoque qui tache la robe de la sainte meurtrière vers le milieu de la cuisse gauche? Cela donne à la scène un air de boucherie dégoûtant.
Nous ne sommes pourtant pas bien petite maîtresse en fait d’art. Les écorcheries de Ribera, les supplices de Zurbaran, toutes les atrocités de l’école espagnole, toutes les sauvageries de Salvator Rosa et de Michel-Ange, de Caravage, n’ont rien qui nous répugne et nous fasse reculer; déchirez les poitrines à pleines mains, faites couler des cascades d’entrailles et ruisseler à flots le sang sous la hache des tourmenteurs; peignez des têtes coupées avec leurs vertèbres blanches dans la sombre pourpre; bleuissez de coups et de meurtrissures la chair livide du Christ et des martyrs: c’est bien, nous ne détournerons pas les yeux; mais alors, soyez violents, soyez féroces, soyez terribles, sauvez-nous du dégoût par l’effroi; ayez l’affreuse beauté qui rend un cadavre de l’Espagnolet l’égal d’une nymphe du Corrège; mais, pour Dieu, point d’horreur cotonneuse, point de tuerie mollasse, point de caillots de sang en gelée de groseille. Que le bourreau puisse apprécier vos décapitations!
M. Ziégler, lui aussi, a fait une Judith; car ce sujet, mis à la mode par la tragédie de madame de Girardin, foisonne au Salon, où l’on en compte cinq ou six. Il l’a entendu d’une façon toute différente; ce qui prouve qu’il n’y a pas, à vrai dire, de sujet, mais bien mille manières de sentir.
La Judith de M. Ziégler est logée plus à l’aise dans sa toile que celle d’Horace Vernet. Elle l’occupe toute seule.
L’instant choisi par le peintre est celui où l’héroïne transportée d’enthousiasme approche des murailles de Béthulie. — Dans l’exaltation du triomphe, elle a marché vite, et sans doute laissé en arrière sa servante au pas alourdi.
Un ciel épais comme l’ivresse, noir comme la mort, et que zèbrent à sa portion inférieure quelques estafilades rouges que l’on prendrait pour des coups de sabre, l’aurore qui se lève louche et sanglante sur une crête de collines sombres, sert de fond à la figure qui tient d’une main le glaive, et de l’autre élève la tête d’Holopherne, qu’elle semble montrer aux habitants de Béthulie, qu’on ne voit pas, mais qu’on peut supposer penchant le corps hors des créneaux, et s’élançant, par les portes trop étroites, au-devant de la libératrice.
M. Ziégler a cherché pour sa Judith un type oriental et cruel qu’il a réalisé à souhait; cette femme, au corps souple et vigoureux, au teint de bistre, aux cheveux et aux sourcils bleus, aux grands yeux sauvages cernés de grhôl, au nez aquilin, aux lèvres arquées fièrement, malgré sa beauté incontestable, nous semble une mortelle de bien farouche approche, et Holopherne, au moins, n’a pas été pris en traître.
La tête du malheureux général assyrien, que brandit la virago, a encore quelques restes de frisure à la barbe, et une natte à moitié défaite se mêle à ses cheveux coagulés par le sang, détail ingénieux, qui montre que la mort a surpris Holopherne au milieu de voluptés dans une nuit de débauche.
Une tunique brune serrée par une ceinture de cuir, et laissant voir par-dessous une robe blanche richement brodée à la poitrine, quelques coraux dans les cheveux et à la poitrine, forment à l’héroïne de Béthulie une toilette très-pittoresque, mais peut-être un peu trop simple, surtout si l’on songe que, d’après le texte de la Bible, Judith s’était parée de ses plus riches ornements. Peut-être trop de luxe d’étoffes et de pierreries aurait-il dérangé la gamme sobre et l’effet austère que l’artiste s’était donnés pour programme, car il excelle à peindre ces détails et à leur donner la réalité la plus surprenante, comme peut en faire foi la poignée du glaive sur lequel s’appuie la main de la Judith, et dont l’or soutient sans peine le voisinage de la dorure du cadre auquel elle touche presque.
Ce tableau, d’un aspect ferme et décidé, rappelle pour la netteté des contours, la localité rembrunie des chairs et des étoffes, le caractère violent et sombre de la composition, certains maîtres de l’école espagnole, Alonzo Cano ou Juan Valdez Leal.
Outre la Judith, M. Ziégler. a exposé une Vision de Jacob, où le rêve biblique est interprété d’une façon nouvelle. — Le jeune pasteur, étendu sur un lit de mousse et de gazon, répand ses cheveux d’or comme les flots d’une urne sur la pierre qui lui sert d’oreiller. Le sommeil a jeté sa poudre sous ses paupières baissées, mais il voit des yeux de l’âme.
Ceci, c’est la partie réelle du tableau, et tout y est peint avec une conscience minutieuse destinée à faire valoir la partie fantastique et vaporeuse: Les rayons du soleil dorent tout ce premier plan avec une intention peut-être un peu trop marquée.
A partir de là, nous faisons un voyage dans le bleu, mais dans un bleu d’un outremer encore plus foncé que celui de Ticck. Toute la vision est illuminée par une lumière de grotte d’azur dont il est très-difficile d’apprécier la vérité. Dans cette atmosphère de feux de Bengale se déroule toute une théorie de figures angéliques remontant et descendant l’échelle mystérieuse; ces esprits révèlent l’avenir au dormeur en lui présentant divers symboles. Le moment choisi est celui où passe le groupe des anges portant les emblèmes des arts; la houlette des pasteurs, la gerbe du laboureur, les grappes de la vigne, les fruits des vergers et les fleurs des jardins précèdent ceux qui portent les symboles de la musique, de l’architecture et de l’art céramique, — ô grès de Voisinlieu, que faites-vous ici? — Viennent ensuite les anges qui représentent la peinture, la sculpture, la gravure, la poésie; puis enfin, sur un plan éloigné, des figures voilées qui révéleront à Jacob les arts à venir encore ignorés de nous.
Nous empruntons à M. Ziégler lui-même cette explication d’une ingéniosité un peu laborieuse. Le songe de Jacob serait alors la révélation des destinées de l’humanité.
Il y a dans cette foule angélique de charmantes figures, des poses et des tournures d’une grâce ravissante, et qu’on apprécierait davantage, si tout cela n’était baigné de cette lueur bizarre qui ôte aux tons leur valeur relative, et donne à ce côté de la composition un aspect de camaïeu. Dans les paysages élyséens de Breughel de Paradis, il y a des lointains vaporeux d’une tendresse azurée tout à fait idéale, et dont M. Ziégler aurait pu emprunter quelques nuances pour colorer plus mollement sa vision.
Ces deux tableaux si différents l’un de l’autre montrent chez M. Ziégler un esprit inquiet, chercheur, toujours en quête de nouvelles voies. — Certes, le peintre de Giotto, du Saint Georges, du Saint Luc peignant la Vierge, etc., n’avait qu’à suivre le chemin où ses premiers pas s’étaient empreints si fortement, et n’avait pas besoin de se mettre à la poursuite d’autres théories et d’autres manières: eh bien! chaque année il se lance après un nouveau rêve, et ne garde de lui que cette précision de touche et cette maestria de pinceau à laquelle on le reconnaît toujours. La peinture même ne lui suffit pas, et jetant sa palette de côté il cherche le galbe d’un vase et le profil d’une anse. Moins spirituel et moins ingénieux, il serait peut-être un plus grand peintre. Il a trop cédé aux curiosités de son esprit et disséminé de puissantes facultés d’invention et d’exécution.
Le même sujet de la Vision de Jacob a été traité dans des dimensions colossales par un peintre bavarois récemment naturalisé français, M. Laëmlein. Il y a du mérite et de l’originalité dans cette grande toile, placée trop haut pour que l’on puisse apprécier sûrement les finesses de l’exécution: le Jacob renversé en arrière palpite bien sous la vision; les anges et les figures mystiques ont des tournures assez fières et se campent sur les marches de l’escalier avec une certaine crânerie strapassée, et un certain goût, contourné, demi-florentin, demi-rococo, saupoudré d’un peu de Cornelius, qui ne manquent pas d’effet et de ragoût.
Cette tendance à imiter le faire de l’ancienne école française ou des maîtres de la décadence italienne se retrouverait dans beaucoup d’autres tableaux. Nous ne voyons pas là grand mal. Ces peintres, beaucoup trop méprisés, possédaient des qualités nombreuses, la facilité, l’abondance, la souplesse, le mouvement, et c’était encore des hommes prodigieusement doués que Luca Jordano, Pietre de Cortone, Tiepolo, Carle Maratte, en Italie, et, en France, Jouvenet, Mignard, Subleyras, Natoire, Lemoine, et les autres flamboyants.
M. Hippolyte Flandrin, qui nous a donné cette année un Napoléon si roide, si perpendiculaire, aurait bien fait de les étudier pour s’assouplir un peu.
Quelle étrange aberration que cette figure sans vie, sans couleur, sans modelé, plaquée sur ce fond d’indigo, hissée sur cette espèce de chaise de pierre ou de bois soutenue par un terrain jaunâtre! Dans quel monde cela se passe-t-il? est-ce dans Saturne ou dans Mercure? Assurément, ce n’est pas dans notre globe sublunaire. — Voilà où les conséquences excessives d’une idée systématique peuvent conduire un homme de talent, car il y a même dans cette désastreuse toile beaucoup de science et de mérite.
Nous n’insisterons pas davantage. M. Hippolyte Flandrin a fait les belles peintures murales de Saint-Germain-des-Prés, le meilleur travail et le mieux approprié à sa destination qui, depuis longtemps, ait été exécuté dans les églises. Son Christ entrant à Jérusalem, et se traînant sur le chemin de la croix, demande grâce pour son Napoléon. Et d’ailleurs, nous ne saurions garder rancune au peintre de ces adorables portraits de femme, devant lesquels nous avons passé, aux précédents Salons, tant de douces heures de contemplation silencieuse.