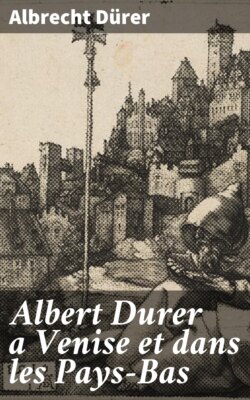Читать книгу Albert Durer a Venise et dans les Pays-Bas - Albrecht Durer - Страница 4
A
MONSIEUR LE BARON BEYENS
Ministre de Belgique en France
Hommage affectueux,
CHARLES NARREY.
ОглавлениеVIII
INTRODUCTION.
La vie des grands hommes est le flambeau qui éclaire leur œuvre.
Les souffrances et les faiblesses, les luttes et les triomphes de ces génies prédestinés expliquent et commentent leurs ouvrages, et chaque étape de leur existence correspond à une évolution de leur talent. Leur biographie est donc en quelque sorte le lien logique de leurs ouvrages; elle donne la clef de la succession de leurs pensées et démontre comment elles s'enchaînent.
Écrire l'histoire d'un grand artiste, si l'on se place à ce point de vue élevé, c'est faire en même temps l'histoire de ses idées, c'est pénétrer avec lui dans les mystères de son inspiration.
Prenez l'homme le plus profondément original, et le plus rebelle aux influences extérieures; ses relations avec ses contemporains, son commerce avec d'autres artistes, grands comme lui, mais comprenant leur art de façons différentes, ne pourront manquer d'imprimer une modification, si minime qu'elle soit, à ses propres idées.
S'il y a entre les hommes ainsi rassemblés par le caprice du hasard ou par une loi mystérieuse de la création de larges points de contact et des horizons communs, cette influence deviendra décisive et modifiera parfois d'une manière profonde le faire de l'artiste qui la subit. Y a-t-il au contraire une opposition fondamentale entre leur esprit, leur principe réciproque s'accentuera avec plus de vigueur, et leur contact servira à caractériser davantage leur tendance primitive. Grande ou petite, profonde ou superficielle, cette influence doit subsister, et la saisir jusque dans ses manifestations les moins apparentes est l'objet de la critique.
Or, c'est l'histoire de l'artiste, et son histoire de chaque jour, qui peut en fournir les éléments d'appréciation.
Quoi d'étonnant alors que les moindres particularités de la vie privée d'un grand homme acquièrent la plus haute valeur aux yeux de la postérité?
Aussi, dans ces derniers temps, ce genre d'études historiques a-t-il fait l'objet de nombreux et de consciencieux travaux. On a cherché à y introduire la précision et la sévérité de la critique moderne, et l'on a bravement fermé la porte à toutes les fables et à toutes les anecdotes de contrebande, pour y substituer définitivement la vérité dans sa froide et chaste nudité. Mais on ne croit guère que de pareils travaux présentent énormément de difficultés, et beaucoup plus même que ceux qui concernent la grande histoire.
Les faits que recherche le biographe sont presque toujours d'une apparente insignifiance, et par cela même les contemporains des grands hommes, sans prévoir la valeur que ces détails pourront acquérir un jour, ont négligé de les consigner. Aussi quelle bonne fortune extraordinaire, lorsque l'artiste lui-même, soit par une sage prévision, soit dans un but désintéressé, a pris soin de rassembler minutieusement tous les matériaux d'une autobiographie.
C'est précisément ce qui nous arrive pour l'illustre père de l'école allemande.
Albert Dürer a laissé sur sa vie privée un grand nombre de notes et de correspondances qui éclairent d'un jour nouveau sa vie et ses œuvres, et mettent hors de discussion un grand nombre de points qui, pour des artistes beaucoup plus récents même, ne sont ordinairement qu'un stérile sujet de querelles entre les historiens.
Mais avant de donner la parole au maître lui-même et de laisser découler de ses écrits les commentaires qui en dérivent, on nous permettra d'en tirer quelques conclusions générales et quelques conclusions personnelles.
Ce qui résulte d'abord de la vie de cet éminent artiste, telle qu'il l'a simplement racontée lui-même, ce qui ressort de la lecture de sa correspondance intime avec son ami Bilibald Pirkeimer, c'est une profonde estime pour le caractère de l'homme, comme une grande admiration pour l'artiste ressort de la contemplation de ses œuvres.
Albert Dürer est un aussi grand et noble caractère qu'il est un génie original et transcendant. Cette double perfection est une chose trop rare dans le cercle des grands esprits pour ne pas y insister.
On dirait, en vérité, que l'intelligence ne peut se développer qu'au détriment du caractère, et trop souvent l'épanouissement de la pensée a pour corollaire fatal l'atrophie morale du cœur. Si quelque chose, par exemple, pouvait amoindrir notre admiration pour le panthéiste Gœthe, ne serait-ce pas la sécheresse de son âme et l'égoïsme de son caractère. L'esprit humain, qui tend sans cesse à l'idéal et qui prodigue d'instinct aux élus de l'intelligence tous les dons et toutes les qualités, est péniblement déçu en voyant tant de grandeur intellectuelle à côté de tant de petitesse de sentiment. Nous n'aimons pas à apprendre que Virgile était le flatteur d'Auguste et que Horace eut peur à la bataille d'Actium.
Je ne connais que bien peu de génies qui aient été en même temps des héros du cœur. Michel Cervantes dans les lettres et Michel-Ange dans les arts sont pour moi les types de cette double grandeur; notre Albert Dürer peut aussi revendiquer ces deux auréoles. Sa vie a été une lutte continuelle, soyons plus vrai,—un long martyre causé par celle qui aurait dû précisément arracher les ronces et les épines de sa route.
Marié de bonne heure, sans qu'on eût consulté son inclination, à une femme froide et avare, il n'a pas eu la consolation de se reposer dans la douce vie du foyer des tracasseries envieuses auxquelles un homme de sa valeur devait nécessairement se trouver exposé.
Dès l'âge de 23 ans il devenait le seul soutien de sa famille. «Deux ans après la mort de mon père, je pris aussi ma mère avec moi (il s'était déjà chargé de son frère Hans), car elle n'avait plus rien. En 1513 elle tomba subitement malade. Ses souffrances durèrent une année entière, et elle fut mourante du premier au dernier jour.»
Dans ces conditions il fut obligé de se livrer à un travail assidu et pénible; en outre sa femme l'excitait sans cesse au labeur et le stimulait avec ses avaricieuses exigences. Et pourtant c'est à peine si, dans ses écrits, on entend l'écho d'une plainte contre celle qui le faisait tant souffrir; tout au plus dans sa correspondance avec Bilibald Pirkeimer, correspondance si franche et si naïve, hasarde-t-il de temps en temps quelque allusion prudente à ses affaires de ménage. Encore en parle-t-il avec tant de mansuétude et de bonne humeur, qu'on ne soupçonnerait pas la profondeur de sa blessure si ses amis n'avaient pas pris la peine de la sonder.
«Il était fort contre l'adversité, dit Schrober, mais il est vrai qu'il n'avait que trop le moyen de s'exercer à la patience, sa femme se chargeait tous les jours de lui en fournir l'occasion.»
C'est assez clair, et cependant les lettres de G. Hartmann et de Pirkeimer sont encore plus explicites.
En voici des extraits:
G. HARTMANN A M. BUCHLER.
«. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
«Elle était d'une piété et d'une honnêteté si intolérantes, qu'il aurait mieux valu pour Albert Dürer être le mari d'une coquine avec un caractère aimable, que d'avoir à ses trousses une de ces dévotes qui sont d'une humeur si féroce, qu'elles vous laissent à peine des moments suffisants pour respirer. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .»
AUTRE LETTRE DE GEORGES HARTMANN.
«Il ne faut imputer le décès de Dürer à personne qu'à sa femme. Elle lui avait si bien rongé le cœur, elle lui avait fait endurer de telles souffrances, qu'il semblait en avoir perdu la raison. Elle ne lui permettait jamais d'interrompre son travail, l'éloignait de toutes les sociétés, et par des plaintes continuelles, répétées le jour et la nuit, le tenait rigoureusement enchaîné à l'œuvre, afin qu'il amassât de l'argent pour le lui laisser après sa mort. Elle avait sans cesse la crainte de périr dans la misère, et cette crainte la torture encore maintenant, quoique Dürer lui ait légué près de 6,000 florins. Elle est insatiable: elle a donc été vraiment la cause de sa mort, etc.»
LETTRE DE PIRKEIMER A TZERTE,
Architecte de l'Empereur, à Vienne.
«J'ai positivement perdu, dans la personne d'Albert Dürer, un des meilleurs amis que j'aie eus de ma vie. Sa mort m'a fait d'autant plus de peine qu'elle s'est produite sous l'influence de causes bien pénibles. En effet, je ne puis l'attribuer, après Dieu, qu'à sa femme qui lui a causé de si vifs chagrins et l'a tourmenté d'une façon si cruelle, qu'elle l'a poussé vers la tombe, et l'a rendu sec comme de la paille. Le pauvre homme n'avait plus de courage et ne recherchait plus aucune société. Cette mégère prenait soin de ses intérêts, et poussait son mari au travail nuit et jour afin qu'il lui laissât le plus d'écus possible. . . . . . . . . . . Je lui ai souvent reproché ses procédés, et je lui ai même prédit ce qui est arrivé; mais cela ne m'a valu que de l'ingratitude. Du reste, tous ceux qui aimaient le pauvre Albert détestent sa femme, qui le leur rend bien. En somme, c'est elle qui a mis le cher homme en terre.»
Dans les premiers temps de son mariage, Albert Dürer avait fait des efforts héroïques pour se soustraire à la domination de sa femme, mais la lutte ne convenait pas à son caractère; peu à peu il avait fini par courber le front, et, aux derniers jours de sa vie, il obéissait comme un enfant à cette nouvelle Xantippe.
Poussait-il la douceur jusqu'à la pusillanimité?—Nous ne le croyons pas,—car plusieurs fois, pendant sa trop courte existence, il a prouvé qu'avec les hommes il savait parler en homme.—Ou puisait-il cette patience angélique dans la religion? En voyant le portrait d'Agnès Frey qu'il a dessiné lui-même, et que l'on trouve encore aujourd'hui à Vienne, nous croyons plutôt qu'il fut toujours amoureux de sa femme,—car elle était fort belle.—Son front était froid, mais l'intelligence s'y jouait comme un rayon de soleil sur une plaque d'acier poli; ses yeux étaient durs, mais grands, veloutés et noirs; sa bouche était hautaine, mais correcte; ses traits étaient sévères, mais remarquablement beaux; ils ne commandaient pas la sympathie cependant: on sentait que celui qui avait aimé cette femme l'aimerait toute sa vie, dût-il mourir de son amour.
Quelle personnalité attachante que celle d'Albert Dürer!
Il était beau, et la noblesse de ses traits reflétait la pureté de son âme et la lumière de son intelligence.
Qui a vu une fois un de ses portraits ne peut plus l'oublier. De beaux cheveux blonds cendrés qui flottent sur ses épaules, un front élevé et pur où le génie a imprimé sa sévère majesté, de grands yeux bleus, bien enchâssés dans leur arcade et ombragés de longs cils plus foncés que ses cheveux, une bouche rêveuse, un cou flexible qui porte une tête digne du ciseau de Phidias, comme la tige du lis porte la fleur des rois, tels sont les traits principaux de cette figure ravissante.
ALBERT-DÜRER P.
AH.-CABASSON D.
TAMISIER. SC. 1850.
Toute sa personne était sympathique et séduisante.
«Il avait de la noblesse et de l'aisance dans les mouvements, et sa haute raison et son rare bon sens perçaient naturellement dans ses discours.» «Sermonis tanta in eo suavitas et lepor erat, dit Joachim Camerarius, ut nihil esset audientibus magis contrarium quam finis.»
Et Schrober dit aussi:
«Il y avait quelque chose de si doux et de si harmonieux dans sa manière de parler, qu'on l'écoutait avec ravissement.» Du reste son instruction était fort étendue.
Peintre, dessinateur, graveur, orfévre, architecte, statuaire, ingénieur et géométrien, comme l'écrit Loys Meygret, le traducteur de son livre des Proportions humaines, il fut tout ce qu'il voulut être [1].
On l'a souvent comparé à Raphaël, mais du côté de l'universalité des connaissances, il a bien plus de points de contact avec Michel-Ange.
J'ai vu quelque part qu'on lui reconnaît aussi le talent de l'écrivain. On prétend même qu'il a contribué à fixer la langue allemande,—mais c'est là une assertion que je ne peux admettre. Pour ses traités didactiques, il est certain que Pirkeimer y mettait la main, car ils diffèrent notablement, comme style et comme orthographe, de sa correspondance intime. Dans ses lettres à Pirkeimer, le même mot est écrit parfois de quatre ou cinq façons différentes, et l'on ne peut s'empêcher de rire à la vue de ses essais de versification.
Comme artiste, Albert Dürer est un des esprits les plus originaux que je connaisse. C'est un peintre qui est avant tout de son pays et de son époque, grande qualité, si l'on y réfléchit, et à ce titre il mérite pleinement la qualification de père de l'école allemande.
Vasari, Lambert-Lombart, Mariette, et quelques autres auteurs anciens et modernes ont regretté qu'Albert Dürer ne fût pas né en Italie, et ils lui ont reproché sérieusement de n'avoir pas été à Rome étudier l'antique. Ce sont là des idées étroites et puériles que l'on est étonné de trouver chez des écrivains d'une valeur réelle. S'il fallait en croire certains critiques trop exclusifs, l'art ne serait bientôt plus qu'une formule, car pour eux le beau n'a qu'un type unique en qui réside une perfection absolue. Ce serait un moule où les esprits les plus divers viendraient prendre une empreinte fastidieusement uniforme. C'est une folie que ce nouveau lit de Procruste, car le beau est dans tout, dans l'harmonie des proportions, comme dans la profondeur du sentiment, dans l'éclat de la couleur, comme dans la correction du dessin.
Ces dernières idées étaient aussi celles d'Albert Dürer.
«L'homme qui cherche le beau, dit-il, rencontre le multiple et le divers, et il y a plusieurs voies pour atteindre à la beauté.»
Il a entrevu l'accord et l'agrément de la nature, jusque dans ses difformités, et il a deviné la beauté des diverses races. «Il y a des corps d'Éthiopiens, ajoute-t-il, où la nature a mis une telle convenance et une telle harmonie, qu'on ne peut rien concevoir de plus parfait.» On le voit, il n'a pas inventé, comme on l'a prétendu, la fameuse phrase: Le beau, c'est le laid. Quand son modèle est beau, il le fait beau, témoin le Jeune homme de la galerie de Vienne, témoin le Saint Jean, de Munich.
Du reste, mille circonstances viendraient empêcher cette fusion, si quelqu'un était assez fou pour la tenter, et pour n'en citer qu'une seule, la variété des climats maintiendra toujours une différence fondamentale entre le peintre allemand et le peintre italien. Du temps de Dürer, une autre cause encore venait accentuer cette différence entre les deux écoles. Les anciens peintres allemands procédaient des Byzantins comme les Italiens; cependant, le développement de l'art se faisait de part et d'autre dans des conditions toutes différentes.
Les Italiens, ayant sous les yeux les trésors de la statuaire antique, ont pu acquérir rapidement la pureté et la correction du dessin. Ils ont appris à donner à leurs figures cette souplesse et cette élégance de pose, et à les revêtir de draperies artistement disposées. Les Allemands, au contraire, n'avaient qu'un modèle: la nature. Aussi, si leurs poses ont quelque roideur, si leurs têtes sont presque toutes des portraits, ils ont un grand charme et une délicieuse naïveté dans l'expression. Ils sont, en quelque sorte, restés plus près de la vérité.
Albert Dürer a conservé quelques-uns des défauts de ses prédécesseurs, mais il a recueilli le riche héritage de leurs qualités; c'est non pas un réaliste, dans le sens moderne du mot, mais un naturaliste.
Du reste, en laissant de côté ces préoccupations d'école, Albert Dürer est encore un génie de premier ordre. Ce qui le prouve, c'est que les plus grands peintres, Andrea del Sarto, le Pontorme, le Guide, n'ont pas dédaigné de lui faire de larges emprunts.—Le Guide a copié plusieurs figures du char de Maximilien dans la fresque de l'Aurore qu'il a faite au palais Rospigliosi.
Raphaël l'estimait fort, il lui envoya son portrait et quelques dessins précieux; il disait aussi avec franchise et naïveté:
«En voilà un qui nous dépasserait tous, s'il avait pu contempler, comme nous, les chefs-d'œuvre de l'art.»
Et pour que cet éloge parût plus sincère, tout partisan qu'il était de l'antique, il exposa plusieurs estampes du graveur allemand dans son atelier.
Bernard Palissy connaissait et estimait les gravures d'Albert Dürer; voici ce qu'il en dit dans son livre intitulé: de l'Art de terre.
«As-tu pas veu aussi combien les imprimeurs ont endommagé les peintres pourtrayeurs sçavans? J'ay souvenance d'avoir veu les histoires de Notre-Dame imprimées de gros traits, après l'invention d'un Alemand nommé Albert, lesquelles histoires vindrent une fois à tel mepris, à cause de l'abondance qui en fut faite, qu'on donnait pour deux liards chascune desdites histoires, combien que la pourtraiture fust d'une belle invention [2].»
Albert Dürer est né à Nuremberg, le 20 mai 1471, au moment où cette ville était dans toute sa splendeur; mais cédons la parole au chef de l'école allemande et laissons-le se présenter lui-même tenant toute sa famille par la main.
Nous traduisons mot à mot les notes de famille, recueillies par Albert Dürer et laissées dans ses papiers. Elles diront mieux qu'on ne l'a fait jusqu'à ce jour l'origine et les commencements du célèbre artiste.
Nous sommes tellement sûrs que rien de ce qui a été écrit par un homme comme Albert Dürer ne peut être indifférent au public, que nous donnons ces notes sans en élaguer les passages qui pourraient peut-être paraître un peu longs, s'ils venaient d'un personnage moins sympathique.