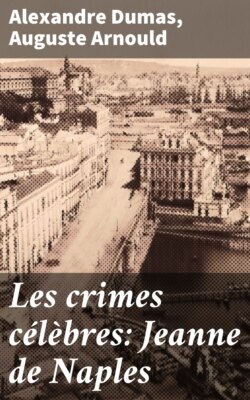Читать книгу Les crimes célèbres: Jeanne de Naples - Alexandre Dumas - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Suite
ОглавлениеTable des matières
Il existe un monument curieux du séjour de Jeanne à Avignon et de l’exercice de sa souveraine autorité. Indignée de. l’impudence des filles perdues, qui coudoyaient effrontément tout ce qu’il y avait de plus respectable dans la ville, la reine de Naples publia une ordonnance célèbre, la première de ce genre, et qui a servi depuis de modèle en pareille matière, pour obliger ces malheureuses, qui trafiquaiènt de leur honneur, à vivre enfermées dans un même asile, qui devait être ouvert tous les jours de l’année, excepté les trois derniers jours de la semaine sainte, et dont l’entrée était interdite aux juifs dans tous les temps. Une abbesse, choisie tous les ans, avait la direction suprême de ce couvent singulier. Des règles furent établies pour le maintien de l’ordre, et des peines sévères prononcées contre l’infraction de la discipline. Les jurisconsultes de l’époque menèrent grand bruit de cette institution salutaire; les belles dames avignonnaises prirent tout haut la défense de la reine contre les bruits calomnieux qui s’efforçaient de ternir sa réputation; il n’y eut qu’une voix pour exalter la sagesse de la veuve d’André : seulement çe concert de louanges fut troublé par les murmures des recluses, qui, dans leur langage brutal, accusaient Jeanne de Naples d’entraver leur commerce pour s’en réserver le monopole.
Sur ces entrefaites, Marie de Duras vint rejoindre sa sœur. Elle avait trouvé moyen, après la mort de son mari, de se réfugier dans le couvent de Sainte-Croix avec ses deux petites filles, et tandis que Louis de Hongrie était occupé à brûler ses victimes, la malheureuse, ayant échangé ses habits de femme contre le froc d’un vieux religieux, s’était échappée comme par miracle et avait réussi à gagner un navire qui faisait voile pour la Provence. Marie raconta à sa sœur les affreux détails des cruautés de Louis de Hongrie. Bientôt une nouvelle preuve de cette haine implacable vint confirmer les récits de la princesse désolée: les ambassadeurs de Louis se présentèrent à la cour d’Avignon pour requérir formellement la condamnation de la reine.
Ce fut un grand jour que celui où Jeanne de Naples plaida elle-même sa cause devant le pape, en présence de tous les cardinaux qui se trouvaient à Avignon, de tous les ambassadeurs des puissances étrangères, de tous les personnages éminents accourus de l’extrémité de l’Europe pour assister à ce débat, unique dans les annales de l’histoire. Qu’on se figure une vaste enceinte au centre de laquelle, sur un trône élevé, siégeait, comme président de l’auguste consistoire, le vicaire de Dieu, juge absolu et suprême, revêtu du pouvoir temporel et spirituel, de l’autorité humaine et divine. A droite et à gauche du souverain pontife, les cardinaux, couverts de pourpre, occupaient des fauteuils disposés circulairement, et derrière ces rois du collége sacré se déroulait majestueusement jusqu’au fond de la salle leur cour d’évêques, de vicaires, de chanoines, de diacres, d’archidiacres, et toute l’immense hiérarchie de l’Église. En face du trône pontifical on avait placé une estrade réservée à la reine, de Naples et à sa suite. Aux pieds du pape se tenaient debout les ambassadeurs du roi de Hongrie, qui devaient remplir le rôle d’accusateurs résignés et muets, les circonstances du crime et les preuves de culpabilité ayant été débattues à l’avance par une commission nommée à cet effet. Le reste de la salle était encombré par une foule brillante de hauts dignitaires, d’illustres capitaines, de nobles envoyés, rivalisant de luxe et d’orgueil. Toutes les haleines étaient suspendues, tous les yeux étaient fixés sur l’estrade où Jeanne devait prononcer sa défense. Un mouvement de curiosité inquiète faisait refluer vers le centre cette masse unie et compacte, au-dessus de laquelle s’élevaient les cardinaux, comme des pavots superbes à travers une moisson d’or agitée par le vent.
La reine parut, donnant la main à son oncle, le vieux cardinal de Périgord, et à sa tante, la comtesse Agnès. Sa démarche était à la fois si modeste et si fière, son front si mélancolique et si pur, son regard si plein d’abandon et de confiance, qu’avant de parler tous les cœurs étaient pour elle. Jeanne avait alors vingt ans, elle était dans tout le développement de sa magnifique beauté : mais une extrême pâleur voilait l’éclat de sa peau satinée et transparente, et ses joues amaigries portaient l’empreinte de l’expiation et de la souffrance. Parmi les spectateurs qui la dévoraient le plus avidement du regard, on remarquait un jeune homme à la chevelure brune, à l’œil ardent, aux traits fortement accusés, que nous rencontrerons plus tard dans notre histoire; mais pour ne pas détourner l’attention de nos lecteurs, nous nous contenterons de leur apprendre seulement que ce jeune homme s’appelait Jayme d’Aragon, qu’il était infant de Mayorque, et qu’il aurait donné tout son sang pour arrêter une seule des larmes qui tremblaient aux bords des cils de la reine. Jeanne parla d’une voix émue et tremblante, s’arrêtant de temps à autre pour essuyer ses yeux humides et brillants, ou pour exhaler un de ces soupirs qui vont droit à l’âme. Elle raconta avec une si vive douleur la mort de son mari, peignit avec une si effrayante vérité l’égarement et la terreur dont elle avait été saisie et comme foudroyée par cet affreux événement, porta les mains à son front avec une telle énergie de désespoir, comme pour en arracher un reste de folie, qu’elle fit passer dans l’assemblée un frisson de pitié et d’horreur. Et certes, dans ce moment, si son récit était faux, son angoisse était vraie et terrible. Ange flétri par le crime, elle mentait comme Satan, mais comme Satan elle était déchirée par les tortures infinies de l’orgueil et du remords. Aussi, quand, à la fin de son discours, fondant en larmes, elle implora aide et protection contre l’usurpateur de son royaume, un cri d’assentiment général couvrit ses dernières paroles, plusieurs mains se portèrent sur la garde des épées, et les ambassadeurs hongrois sortirent de l’audience le front couvert de confusion et de honte.
Le soir même, à la grande satisfaction du peuple entier, on proclama l’arrêt qui déclarait Jeanne de Naples innocente et étrangère à toute complicité dans l’assassinat de son mari. Seulement, comme on ne pouvait excuser sous aucun prétexte la conduite de la reine après l’évènement, et son insouciance à poursuivre lès auteurs du crime, le pape reconnut qu’il y avait dans cette affaire une preuve de magie évidente, et que la faute attribuée à Jeanne était la conséquence nécessaire de quelque sort maléfique jeté sur la pauvre femme, et dont il lui avait été impossible de se défendre . En même temps sa sainteté confirma le mariage de la reine avec Louis de Tarente, et accorda à ce dernier l’ordre de la Rose d’or et le titre de roi de Sicile et de Jérusalem.
Il est vrai que Jeanne, la veille de l’acquittement, avait vendu au pape la ville d’Avignon pour la somme de quatre-vingt mille florins.
Pendant que la reine plaidait son procès à la cour de Clément VI, une horrible épidémie, désignée sous le nom de peste noire, la même dont Boccace nous a laissé une si admirable description, ravageait le royaume de Naples et le restant de l’Italie. Suivant les calculs de Matteo Villani, Florence perdit les trois cinquièmes de sa population, Bologne en perdit les deux tiers, et presque toute l’Europe fut décimée dans cette effrayante proportion. Les Napolitains étaient déjà fatigués de la barbarie et de la rapacité des Hongrois, ils n’attendaient qu’une occasion pour se révolter contre l’oppresseur étranger, et rappeler leur légitime souveraine, que, malgré ses torts, ils n’avaient jamais cessé d’aimer: telle était sur ce peuple sensuel la force de la beauté et de la jeunesse. A peine la contagion eut-elle jeté le désarroi dans l’armée et le trouble dans la ville, que des imprécations éclatèrent contre le tyran et ses bourreaux. Louis de Hongrie, menacé tout à la fois de la colère du ciel et de la vengeance du peuple, tremblant de l’épidémie et de l’émeute, disparut tout à coup au milieu de la nuit, et laissant le gouvernement de Naples à Corrado Lupo, un de ses capitaines, courut s’embarquer à Barlette, et quitta le royaume à son tour comme il l’avait fait quitter quelques mois auparavant à Louis de Tarente.
Ces nouvelles arrivèrent à Avignon au moment où le pape venait de faire expédier à la reine la bulle d’absolution. Il fut décidé sur-le-champ de reprendre le royaume au vicaire de Louis de Hongrie. Nicolas Acciajuoli partit pour Naples, muni de la bulle miraculeuse qui devait constater aux yeux de tous l’innocence de la reine, dissiper les scrupules et réveiller l’enthousiasme. Le conseiller se dirigea d’abord au château de Melzi, commandé par son fils Lorenzo; c’était la seule forteresse qui avait refusé de se rendre. Le père et l’enfant s’embrassèrent avec ce sentiment de légitime orgueil qu’éprouvent en présence l’un de l’autre deux hommes de la même famille qui viennent d’accomplir héroïquement leur devoir. Le gouverneur de Melzi apprit au conseiller intime de Louis de Tarente que l’arrogance et les vexations des ennemis de la reine avaient fini par lasser tout le monde, qu’une conspiration en faveur de Jeanne et de son mari, tramée au sein de l’université de Naples, avait de vastes ramifications dans tout le royaume, et que la discorde régnait dans l’armée étrangère. L’infatigable conseiller se rendit de la Pouille à Naples, parcourant villes et campagnes, se multipliant partout, proclamant partout à haute voix l’acquittement de la reine, son mariage avec Louis de Tarente, et les indulgences que le pape promettait à tous ceux qui feraient un bon accueil à leurs souverains légitimes. Puis, quand il vit que le peuple se levait sur son passage pour crier: «Vive Jeanne et mort aux Hongrois!» il retourna vers ses maîtres, et leur annonça les dispositions dans lesquelles il avait laissé leurs sujets.
Jeanne emprunta de l’argent de tous les côtés où elle put en avoir, arma des galères, et partit de Marseille avec son mari, sa sœur et ses deux fidèles conseillers, Acciajuoli et Spinelli, le 10 septembre 1348 Le roi et la reine, ne pouvant entrer dans le port, qui était au pouvoir de l’ennemi, débarquèrent à Santa-Maria-del-Carmine, près de la rivière du Sebeto, aux applaudissements frénétiques d’une immense population, et accompagnés par toute la noblesse napolitaine, ils se dirigèrent vers le palais de messire Ajutorio, près de Porta-Capuana, les Hongrois s’étant fortifiés dans tous les châteaux de la ville; mais Nicolas Acciajuoli, à la tête des partisans de la reine, bloqua si bien ces forteresses, qu’une moitié des ennemis fut obligée de se rendre, et l’autre moitié, prenant la fuite, s’éparpilla dans l’intérieur du royaume. Nous ne suivrons pas Louis de Tarente dans sa pénible entreprise à travers la Pouille, les Calabres et les Abruzzes, où il recouvra une à une les forteresses occupées par les Hongrois. Par des efforts d’une valeur et d’une patience sans exemple, il s’était rendu maître à peu près de toutes les places considérables, lorsque les choses changèrent brusquement de face, et la fortune des armes lui tourna le dos une seconde fois. Un capitaine allemand, nommé Warner, qui avait déserté l’armée hongroise pour se vendre à la reine, s’étant revendu par une nouvelle trahison, se laissa surprendre à Corneto par Conrado Lupo, vicaire général du roi de Hongrie, et se réunit ouvertement à lui, entraînant une grande partie des aventuriers qui combattaient sous ses ordres. Cette défection imprévue força Louis de Tarente de rentrer à Naples, et bientôt le roi de Hongrie, averti que ses troupes étaient ralliées autour de son dra peau et qu’elles n’attendaient plus que son retour pour marcher sur la capitale, débarqua, avec un grand renfort de cavaliers, dans le port de Manfredonia, et, après s’être emparé de Trani, de Canosa et de Salerne, vint mettre le siège à Aversa.
Ce fut un coup de foudre pour Jeanne et pour son mari. L’armée hongroise se composait de dix mille cavaliers et au-delà de sept mille fantassins, et la place n’était défendue que par cinq cents soldats commandés par Giacomo Pignatelli. Malgré cette immense disproportion de nombre, le général napolitain repoussa vigoureusemeut l’attaque; et comme le roi de Hongrie combattait au premier rang. Il fut blessé au pied par une flèche. Alors Louis, voyant qu’il lui serait difficile d’emporter la place d’assaut, résolut de la prendre par la faim. Les assiégés firent trois mois des prodiges de valeur; mais la résistance était impossible, et on s’attendait d’un moment à l’autre à les voir capituler, à moins qu’ils ne fussent décidés de périr jusqu’au dernier. Renaud des Baux, qui devait arriver de Marseille avec une escadre de dix galères, pour défendre les ports de la capitale, et protéger la fuite de la reine, si l’armée hongroise venait à s’emparer de Naples, retardé par les vents contraires, avait dû s’arrêter en chemin. Tout paraissait conspirer en faveur de l’ennemi. Louis de Tarente, dont l’âme généreuse répugnait à verser le sang des braves dans une lutte inégale et désespérée, se dévoua noblement, et offrit au roi de Hongrie de vider leur querelle dans un combat singulier. Voici la lettre authentique du mari de Jeanne, et la ré ponse du frère d’André.
«Illustre roi de Hongrie, qui êtes venu envahir notre royaume, — nous, par la grâce de Dieù, roi de Jérusalem et de Sicile, vous invitons à un combat singulier. Nous savons que vous ne vous inquiétez de la mort de vos soldats de lance, ou des autres païens que vous avez entraînés à votre suite, pas plus que s’ils étaient des chiens; mais nous qui craignons les malheurs qui pourraient arriver à nos soldats et gens d’armes, nous voulons combattre personnellement avec vous, pour terminer la présente guerre et ramener la paix dans notre royaume. Celui de nous deux qui survivra à l’autre sera roi. Et pour que le duel se fasse en toute sûreté, nous proposons qu’il ait lieu ou à Paris, en présence du roi des Français, ou dans la ville de Pérouse, ou à Avignon, ou à Naples. Choisissez un de ces quatre lieux, et répondez-nous.»
Le roi de Hongrie, ayant d’abord entendu son conseil, lui répondit ainsi:
«Grand roi, nous avons lu et pris connaissance de votre lettre que vous nous avez envoyée par le porteur des présentes, et votre invitation au duel nous a plu souverainement; mais nous n’approuvons aucun des lieux que vous prescrivez, parce qu’ils nous sont tous suspects, et par plusieurs raisons. Le roi de France est votre aïeul maternel, et quoique nous ayons avec lui des liens de sang, il ne nous est pas aussi proche parent. La ville d’Avignon, quoiqu’elle appartienne de nom au souverain pontife, est la capitale de la Provence, et a été toujours soumise à votre domination. Nous n’avons pas plus de confiance en la ville de Pérouse, parce que cette ville vous est dévouée. Quant à la ville de Naples, il n’est pas même nécessaire d’écrire que nous la repoussons, puisque vous savez bien qu’elle est en révolte contre nous, et que vous y régnez. Mais si vous désirez de vous battre avec nous, ce sera en présence de l’empereur d’Allemagne, qui est le maître suprême, ou du roi d’Angleterre, qui est notre ami commun, ou du patriarche d’Aquilée, qui est bon catholique. Mais si vous n’aimez pas les lieux que nous vous proposons à notre tour, pour ôter tous les prétextes et abréger tous les délais, nous serons bientôt près de vous avec notre armée. Alors vous sortirez de votre côté, et nous pourrons terminer notre duel à la présence des deux camps.»
Après l’échange de ces lettres, la provocation de Louis de Tarente n’eut pas de suite. La garnison d’Aversa avait capitulé après Une résistance héroïque; et l’on savait trop bien que si le roi de Hongrie pouvait arriver sous les murs de Naples, il n’aurait pas eu besoin de mettre sa vie en danger pour s’emparer de la ville. Heureusement les galères provençales étaient enfin dans le port. La reine et son mari eurent à peine le temps de s’embarquer et de se réfugier a Gaëte. L’armée hongroise se présenta devant Naples. La ville allait se rendre et avait envoyé des orateurs au roi pour demander humblement la paix; mais telle fut l’insolence des paroles des Hongrois, que le peuple irrité prit les armes, et se prépara à défendre ses foyers avec l’acharnement du désespoir.
Tandis que les Napolitains tenaient tête à l’ennemi à la Porta-Capuana, à l’autre bout de la ville se passait un étrange épisode, dont le récit achèvera de peindre ces temps de violences barbares et de trahisons infâmes, La veuve de Charles de Duras, enfermée au château de l’Œuf, attendait dans une anxiété mortelle la galère sur laquelle elle devait rejoindre la reine. La pauvre princesse Marie, serrant dans ses bras ses petites-filles éplorées, pâle, les cheveux épârs, les yeux fixes, la bouche contractée, prêtait l’oreille à chaque bruit, partagée entre la crainte et l’espoir. Tout à coup des pas retentirent dans le corridor, une voix amie se fit entendre, Marie tomba à genoux et poussa un cri de joie: c’était son libérateur.
Renaud des Baux, amiral de l’escadre provençale, s’avança respectueusement, suivi de son fils aîné Robert et de son chapelain.
— Merci, Seigneur, s’écria Marie en se relevant, nous sommes sauvées!
— Un instant, madame, reprit Renaud en l’arrêtant du geste; vous êtes sauvées, mais à une condition.
— A une condition? murmura la princesse étonnée.
— Écoutez-moi, madame: le roi de Hongrie, le vengeur des assassins d’André, le meurtrier de votre mari, est aux portes de Naples; le peuple et les soldats napolitains vont bientôt succomber après un dernier effort de courage; bientôt le fer et le feu de l’armée victorieuse vont répandre partout la désolation et la mort. Et cette fois le bourreau hongrois n’épargnera pas ses victimes; il tuera les mères sous les yeux de leurs enfants, les enfants aux bras de leurs mères. Le pont-levis de ce château est levé, et nul ne veille à sa garde; tous les hommes capables de tenir une épée sont à l’autre bout de la ville. Malheur à vous, Marie de Duras, si le roi de Hongrie se souvient que vous lui avez préféré sop rival!
— Mais n’êtes-vous pas là pour me sauver? s’écria Marie d’une voix pleine d’angoisses. Jeanne, ma sœur, ne vous a-t-elle pas ordonné de me mener près d’elle?
— Votre sœur n’est plus dans le cas de donner des ordres, reprit Renaud avec un sourire de mépris. Elle n’avait que des remerciements à m’adresser de lui avoir sauvé la vie, ainsi qu’à son mari, qui prend lâchement la fuite à l’approche de l’homme qu’il avait osé provoquer en duel.
Marie regarda fixement l’amiral, pour s’assurer que c’était bien lui qui parlait avec tant d’arrogance de ses maîtres; mais, effrayée par l’imperturbabilité de son visage, elle continua d’une voix douce:
— Puisque c’est à votre seule générosité que je devrai ma vie et celle de mes enfants, je vous en serai mille fois reconnaissante. Mais hâtons-nous, seigneur comte, car il me semble à chaque instant entendre le cri de la vengeance, et vous ne voudrez pas me laisser en proie à mon cruel ennemi?
— A Dieu ne plaise, madame! je vous sauverai au risque de mes jours; mais je vous ai déjà dit que j’y mettais une condition.
— Laquelle? demanda Marie avec une résignation forcée,
— C’est que vous épouserez mon fils à l’instant même, en la présence de notre révérend chapelain.
— Téméraire! s’écria Marie en reculant, le visage pourpre d’indignation et de honte; c’est ainsi que tu oses parler à la sœur de ta légitime souveraine? Rends grâce à Dieu que je veuille bien pardonner cette insulte à un moment de vertige qui a troublé ta raison, et tâche par ton dévouement de me faire oublier ta conduite.
Le comte, sans répondre un seul mot, fit signe à son fils et au prêtre de le suivre, et se disposa à sortir de la chambre. Au moment de franchir le seuil, Marie s’élança vers lui, et, joignant les mains le supplia, au nom de Dieu, de ne pas l’abandonner. Renaud s’arrêta.
— J’aurais pu me venger, dit-il, de l’affront que vous me faites en refusant mon fils avec tant de hauteur; mais je laisse ce soin à Louis de Hongrie, qui s’en acquittera à merveille.
— Grâce pour mes pauvres filles! répétait la princesse; grâce au moins pour mes pauvres enfants, si mes larmes ne peuvent pas vous toucher.
— Si vous aimiez vos enfants, répondit l’amiral en fronçant le sourcil, vous auriez déjà pris votre parti.
— Mais je ne l’aime pas votre fils, s’écria Marie d’une voix fière et tremblante à la fois. Oh! mon Dieu, peut-on violer ainsi les sentiments d’une pauvre femme? Mais vous, mon père, vous, qui êtes un ministre de vérité et de justice, faites donc comprendre à cet homme qu’on ne peut pas appeler Dieu à témoin d’un serment qu’on arrache à la faiblesse et au désespoir.
Et, s’adressant au fils de l’amiral, elle ajouta en sanglotant:
— Vous êtes jeune, vous avez aimé , peut-être; vous aimerez sans doute un jour. Oh! j’en appelle à votre loyauté de jeune homme, à votre courtoisie de chevalier, à tous les nobles élans de votre âme: réunissez-vous à moi pour détourner votre père de son fatal projet. Vous ne m’avez jamais vue; vous ne savez pas si j’aime un autre homme dans le secret de mon cœur. Votre fierté doit se révolter de voir ainsi maltraiter une pauvre femme qui vient se jeter à vos pieds pour vous demander grâce et protection. Un mot de vous, Robert, et je vous bénirai dans tous les instants de ma vie, et votre souvenir restera gravé dans mon âme comme celui d’un ange tutélaire, et mes enfants apprendront votre nom pour le répéter tous les soirs, en priant Dieu de combler mes désirs. Oh! dites, voulez-vous me sauver! et qui sait, plus tard, je vous aimerai..... d’amour!
— Je dois obéir à mon père, répondit Robert sans lever les yeux sur la belle suppliante.
Le prêtre gardait le silence. Deux minutes s’écoulèrent, pendant lesquelles ces quatre personnages, absorbés chacun par ses pensées, restèrent immobiles comme des statues sculptées aux quatre coins d’un tombeau. Dans ce terrible intervalle, Marie fut tentée trois fois de se jeter à la mer. Mais une rumeur confuse et lointaine vint tout à coup frapper son oreille; peu à peu le bruit s’approcha, et, les voix devenant plus distinctes, on entendit des femmes dans la rue pousser ces cris de détresse:
— Fuyez! fuyez! fuyez! Dieu nous abandonne, les Hongrois sont dans la ville.
Les pleurs des enfants de Marie répondirent à ces cris, et la petite Marguerite, levant ses mains vers sa mère, exprimait sa terreur par des paroles au-dessus de son âge. Renaud, sans jeter un regard sur ce tableau touchant, entraînait son fils vers la porte.
— Arrêtez! dit la princesse en tendant la main avec un geste solennel: puisque Dieu n’envoie pas d’autres secours à mes enfants, sa volonté est que le sacrifice s’accomplisse.
Et elle tomba à genoux devant le prêtre, courbant la tête comme une victime qui tend le cou à la hache du bourreau. Robert des Baux se plaça à son côté, et le prêtre prononça la formule qui les liait pour toujours, et consacra cet infâme viol par une bénédiction sacrilége.
— Tout est fini, murmura la veuve de Duras en jetant sur ses deux filles un regard plein de larmes.
— Non, tout n’est pas fini encore, reprit durement l’amiral en la poussant vers une autre chambre; avant de partir, il faut que le mariage soit consommé.
— O justice de Dieu! s’écria la princesse d’une voix déchirante; et elle tomba évanouie.
Renaud des Baux dirigea ses galères sur Marseille, où il espérait faire couronner son fils comte de Provence, grâce à son étrange mariage avec Marie de Duras. Mais cette lâche trahison ne devait pas rester impunie. Le vent se leva avec fureur, et le repoussa vers Gaëte, où la reine et son mari venaient d’arriver à peine. Renaud commanda à ses matelots de se tenir au large, menaçant de jeter aux flots quiconque oserait transgresser ses ordres. L’équipage répondit d’abord par des murmures; bientôt des cris de mort s’élevèrent de toutes parts, et l’amiral, se voyant perdu, passa des menaces aux prières. Mais la princesse, qui avait recouvré ses sens au premier éclat de tonnerre, se traînant sur le pont, criait au secours.
A moi, Louis! à moi, mes barons! mort aux misérables qui m’ont lâchement outragée!
Louis de Tarente s’élança dans une chaloupe, suivi d’une dizaine de ses plus braves chevaliers, et, faisant force de rames, atteignit la galère. Alors Marie acheva son récit d’un seul trait, et se tournant vers l’amiral, comme pour le défier de se défendre, l’accabla d’un regard foudroyant.
— Misérable! s’écria le roi en se jetant sur le traître; et il le perça d’un coup d’épée.
Puis il fit charger de chaînes son fils et l’indigne ministre qui avait été complice de l’odieuse violence que l’amiral venait d’expier par sa mort, et prenant dans son bateau la princesse et ses filles, il rentra dans le port.
Cependant les Hongrois, ayant forcé une des portes de Naples, défilaient triomphalement vers le Château-Neuf; mais au moment où ils traversaient la place delle Correggie, les Napolitains s’aperçurent que les chevaux étaient si faibles et les cavaliers si exténués par les fatigues soutenues au siège d’Aversa, qu’un souffle aurait suffi pour disperser cette armée de fantômès. Alors, passant tout à coup de la terreur à l’audace, le peuple se rua sur les vainqueurs, et les refoula hors des murs qu’ils venaient de franchir. Cette brusque réaction populaire dompta l’orgueil du roi de Hongrie, et le rendit plus docile aux conseils de Clément VI, qui crut enfin devoir intervenir. Une trêve fut d’abord conclue depuis le mois de février 1350 jusqu’ au commencement d’avril 1351; et l’année suivante la trêve fut changée en paix définitive, moyennant la somme de trois cent mille florins, que Jeanne paya au roi de Hongrie pour les frais de la guerre.
Après le départ des Hongrois un légat fut envoyé par le pape pour couronner Jeanne et Louis de Tarente, et on choisit pour cette solennité le 25 mai, jour de la Pentecôte. Tous les historiens du temps parlent avec enthousiasme de cette fête magnifique, dont les détails ont été rendus éternels par le pinceau de Giotto, dans les fresques de l’église qui prit dans cette occasion le nom de l’Incoronata. On prononça une amnistie générale pour tous ceux qui, dans les guerres précédentes, avaient combattu dans l’un ou dans l’autre parti, et des cris d’allégresse accueillirent le roi et la reine, qui chevauchaient solennellement sous le dais, suivis par tous les barons du royaume.
Mais la joie de ce jour fut troublée par un accident qui parut d’un augure sinistre à la populace superstitieuse. Louis de Tarente, monté sur un cheval richement caparaçonné , venait de passer la Porta-Petruccia, lorsque des dames qui regardaient le cortége du haut de leurs fenêtres jetèrent sur le roi une si grande quantité de fleurs, que le cheval effrayé se cabra et rompit le frein. Louis, ne pouvant retenir son palefroi, sauta légèrement à terre; mais la couronne tomba en même temps de sa tête et se brisa en trois morceaux. Le jour même mourut la fille unique de Louis et de Jeanne.
Cependant le roi, ne voulant pas que cette brillante cérémonie fût attristée par des signes de deuil, fit continuer pendant trois jours les joûtes et les tournois, et, en mémoire de son couronnement, institua l’ordre des Chevaliers du Nœud. Mais, à dater de ce jour, signalé par un triste présage, sa vie ne devait plus être qu’une longue suite de déceptions. Après avoir soutenu des guerres dans la Sicile et dans la Pouille et dompté la rébellion de Louis de Duras, qui finit ses jours dans les cachots du Château de l’Œuf, Louis de Tarente, usé par les plaisirs, miné par une lente maladie, accablé de chagrins domestiques, succomba à une fièvre aiguë, le 5 juin 1362, à l’âge de quarante-deux ans; et on n’avait pas encore descendu son cadavre dans le royal tombeau de Saint-Dominique, que déjà plusieurs prétendants se disputaient la main de la reine.
Ce fut l’infant de Mayorque, ce beau jeune homme que nous avons déjà nommé, qui l’emporta sur tous ses rivaux, y compris le fils du roi de France. Jayme d’Aragon avait une de ces figures douces et mélancoliques auxquelles une femme ne sait pas résister. De grandes infortunes noblement supportées avaient jeté comme un crêpe funèbre sur sa jeunesse: il avait passé treize ans enfermé dans une cage de fer; délivré de cette affreuse prison à l’aide d’une fausse clef, il avait erré de cour en cour pour recouvrer ses états; et l’on dit même que, réduit à un extrême degré de misère, il avait dû mendier son pain. La beauté du jeune étranger, le récit de ses aventures, avaient frappé Jeanne et Marie à la cour d’Avignon. Marie surtout avait conçu pour l’infant une passion d’autant plus violente qu’elle avait fait plus d’efforts pour la concentrer dans son cœur. Dès que Jayme d’Aragon arriva à Naples, la malheureuse princesse qu’on avait mariée le poignard sur la gorge, voulut racheter sa liberté au prix d’un crime. Suivie de quatre hommes armés, elle entra dans la prison où Robert des Baux n’avait cessé d’expier une faute qui était bien plus celle de son père que la sienne. Marie s’arrêta devant le prisonnier, les bras croisés, les joues livides, les lèvres tremblantes. L’entrevue fut terrible. Cette fois c’était la princesse qui menaçait, c’était le jeune homme qui demandait grâce. Marie demeura sourde à ses prières et la tête du malheureux roula sanglante à ses pieds, tandis que les bourreaux jetaient le corps à la mer. Mais Dieu ne laissa pas ce meurtre impuni: Jayme préféra la reine à sa sœur, et la veuve de Duras ne recueillit de son crime que le mépris de l’homme qu’elle aimait, et des remords cuisants qui la menèrent, jeune encore, à la tombe.
Jeanne se maria successivement avec Jayme d’Aragon, fils du roi de Mayorque, et avec Othon de Brunswick, de l’impériale famille de Saxe. Nous traverserons rapidement ces années, pressés que nous sommes d’arriver au denouement de cette histoire de crimes et d’expiations. Jayme, éloigné de sa femme, continuant son existence orageuse, après avoir longtemps lutté en Espagne contre Pierre-le-Cruel, qui avait usurpé son royaume, mourut près de Navarre vers la fin de l’année 1375. Quant à Othon, ne pouvant pas se soustraire à la vengeance divine qui pesait sur la cour de Naples, il partagea courageusement jusqu’au bout la destinée de la reine. Se voyant privée d’héritiers légitimes, Jeanne avait adopté son neveu, Charles de la Paix, comme il fut appelé par la suite à cause de la paix de Trévise. Ce jeune homme était fils de Louis de Duras, qui, après s’être révolté contre Louis de Tarente, avait péri misérablement dans la prison du château de L’Œuf. L’enfant aurait subi également le sort de son père; mais Jeanne intercéda pour ses jours, le combla de bienfaits, et le maria à Marguerite, fille de sa sœur Marie et de son cousin Charles de Duras, égorgé par le roi de Hongrie.
De graves dissensions s’élevèrent depuis entre la reine et un de ses anciens sujets, Bartolommeo Prignani, devenu pape sous le nom d’Urbain VI. Irrité de l’opposition de la reine, le pape avait dit un jour, dans un accès de colère, qu’il l’enverrait filer dans un cloître. Jeanne, pour se ven ger de cette insulte, favorisa ouvertement l’anti-pape Clément VII, et lui offrit un asile dans son propre château, lorsque, poursuivi par les troupes d’Urbain, il s’était réfugié à Fondi. Mais le peuple s’étant soulevé contre Clément, tua l’arche vêque de Naples, qui avait contribué à son élection, brisa la croix qu’on portait processionnellement devant l’anti-pape, et lui laissa à peine le temps de monter sur une galère pour se sauver en Provence. Urbain déclara Jeanne déchue de son trône, délia ses sujets du serment de fidélité, et donna la couronne de Sicile et de Jérusalem à Charles de la Paix, qui se mit en marche pour Naples à la tête de huit mille Hongrois. La reine, ne pouvant croire à tant d’ingratitude, envoya à la rencontre de son fils adoptif sa femme Marguerite, qu’elle aurait pu garder en ôtage, et ses deux enfants, Ladislas et Jeanne, qui fut depuis la seconde reine de ce nom, Mais bientôt l’armée victorieuse arriva devant Naples, et Charles cerna la reine dans son château, oubliant, l’ingrat, que cette femme lui avait sauvé la vie et l’avait aimé comme une mère.
Jeanne supporta pendant ce siège tout ce que les soldats les plus endurcis aux fatigues de la guerre ne pourraient pas endurer. Elle vit tomber autour d’elle ses fidèles exténués par la faim ou décimés par la fièvre. Après l’avoir privée d’aliments, on lançait tous les jours dans la forteresse des cadavres en putréfaction, pour infecter l’air qu’elle respirait. Othon était retenu avec ses troupes à Aversa; Louis d’Anjou, frère du roi de France, qu’elle avait nommé son successeur en deshéritant son neveu, n’arrivait pas à son secours, et les galères provençales que Clément VII avait promis de lui envoyer ne devaient paraître dans le port que lorsque tout serait perdu. Jeanne demanda une trève de cinq jours, au bout desquels si Othon n’était pas venu la délivrer, elle promit de rendre la forteresse.
Au cinquième jour, l’armée d’Othon entra par le côté de Piedigrotta. Le combat fut acharné de part et d’autre, et Jeanne, du haut d’une tour, put suivre la nuée de poussière que soulevait le cheval de son mari à travers le plus épais de la bataille. Longtemps la victoire demeura incertaine; enfin, le prince se poussa avec tant de valeur contre l’étendard royal, pressé de rencontrer corps à corps son ennemi, il s’enfonça au centre de l’armée par un choc si violent, que serré de toutes parts, couvert de sueur et de sang, l’épée brisée dans sa main, il fut forcé de se rendre. Une heure après Charles écrivait à son oncle le roi de Hongrie que Jeanne était en son pouvoir, et qu’il attendait les ordres de Sa Majesté pour décider du sort de la prisonnière.
C’était par une belle matinée de mai; la reine était gardée à vue dans le château d’Aversa; Othon avait obtenu la liberté à la condition de quitter Naples; Louis d’Anjou, ayant enfin réuni une armée de cinquante mille hommes, marchait en toute hâte à la conquête du royaume. Aucune de ces nouvelles n’était parvenue à l’oreille de Jeanne, qui vivait depuis quelques jours dans l’isolement le plus complet. Le printemps déployait toute sa pompe dans ces plaines enchantées, qui ont mérité le nom de terre heureuse et bénie, campagna felice! Les orangers couverts de leur neige odorante, les cerisiers élancés aux fruits de rubis, les oliviers aux petites feuilles d’émeraude, le grenadier empanaché de ses rouges clochettes, le mûrier sauvage, le laurier éternel, toute cette végétation puissante et touffue, qui n’a pas besoin de la main de l’homme pour fleurir dans ces lieux privilégiés de la nature, formaient comme un vaste jardin coupé çà et là par de petits ruisseaux souterrains. On eût dit un Eden oublié dans ce délicieux coin du monde. Jeanne, accoudée sur sa fenêtre, respirait les parfums printaniers, et reposait ses yeux voilés de larmes sur un lit de verdure et de fleurs; une brise légère, embaumée d’âcres senteurs, se jouait sur son front brûlant, et répandait sur ses joues moites de fièvre une suave fraîcheur. Des voix mélodieuses et lointaines, des refrains de chansons bien connues venaient seuls troubler le silence de cette pauvre chambrette, de ce nid solitaire, où s’éteignait dans les larmes et dans le repentir l’existence la plus brillante et la plus agitée de ce siècle d’agitation et d’éclat.
La reine repassait lentement dans son esprit toute sa vie depuis l’âge de raison; cinquante ans de déceptions et de souffrances. Elle songeait d’abord à son enfance si heureuse et si douce, à l’aveugle tendresse de son aïeul, aux joies pures et naïves de ce temps d’innocence, aux jeux bruyants de sa petite sœur et de ses grands cousins. Puis elle frissonnait à la première idée de mariage, de contrainte, de liberté perdue, de regrets amers; elle se souvenait avec horreur des paroles trompeuses qu’on lui murmurait à l’oreille, pour jeter dans son jeune cœur le germe de la corruption et du vice qui devaient empoisonner sa vie entière; les brûlants souvenirs de son premier amour, le par-jupe et l’abandon de Robert de Cabane, les moments de délire passés comme un rêve dans les bras de Bertrand d’Artois, tout ce drame au tragique dénouement, se détachait en traits de feu sur le fond sombre de ses tristes pensées. Puis des cris d’angoisse retentissaient dans son âme, comme dans cette nuit terrible et fatale. C’était la voix mourante d’André qui demandait grâce à ses assassins. Un long silence de mort succédait à cette horrible agonie, et la reine voyait passer devant ses yeux des chars infâmes, où l’on torturait tous ses complices. Tout le reste n’était que persécutions, fuite, exil, remords de l’âme, châtiments du ciel, malédictions de la terre. Il se faisait autour de la reine une affreuse solitude: maris, amants, parents, amis, tout ce qui l’avait entouré était mort, tout ce qu’elle avait aimé ou haï au monde n’existait plus; ses joies, ses douleurs, ses désirs, ses espérances, tout avait disparu pour toujours. La pauvre reine, ne pouvant résister à ces images de désolation, s’arracha violemment à sa terrible rêverie, et s’agenouillant devant un prie-Dieu, pleura amèrement et pria avec ferveur. Elle était belle encore, malgré la pâleur extrême répandue sur ses traits; les nobles contours de son ovale se dessinaient dans toute leur pureté ; le feu du repentir animait ses beaux yeux noirs d’un éclat surhumain, et l’espoir du pardon faisait errer sur ses lèvres un sourire céleste.
Tout à coup la porte de la chambre où Jeanne priait avec tant de recueillement s’ouvrit avec un bruit sourd; deux barons hongrois, couverts de leurs armures, se présentèrent à la reine, et lui firent signe de les suivre. Jeanne se leva en silence et obéit à ces hommes; mais un cri de douleur s’échappa du fond de son âme lorsqu’ elle reconnut l’endroit où André et Charles de Duras étaient morts tous les deux d’une mort violente. Cependant elle recueillit ses forces, et demanda d’une voix calme pourquoi on l’avait amenée dans ce lieu. Alors un des barons lui montra pour toute réponse un cordon de soie et d’or...
— Que la justice de Dieu s’accomplisse! s’écria Jeanne en tombant à genoux.
Quelques minutes après elle avait cessé de souffrir.
C’était le troisième cadavre qu’on jetait par-dessus le balcon d’Aversa .
FIN DE JEANNE DE NAPLES.