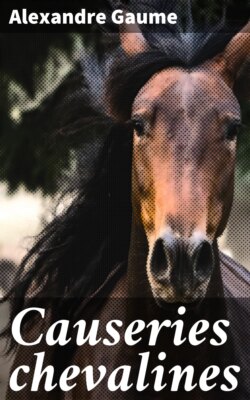Читать книгу Causeries chevalines - Alexandre Gaume - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
L’Élevage.
ОглавлениеEnfin! nous commençons à aimer les courses; nous finirons probablement par aimer les chevaux. Peut-être même le temps est-il proche où le satirique Lucien pourrait dire encore: «La manie des chevaux est
«générale, et elle s’est emparée d’un grand
«nombre d’hommes qui sont regardés comme
«de fort honnêtes gens .»
La France, grâce à une initiative aussi généreuse qu’élevée se couvre d’hippodromes, les hippodromes se remplissent de public; indépendamment du salon des courses, on parle, on parle même beaucoup, et les dames, je parle des vraies, s’en mêlent. Eh bien! tant mieux; jeu pour jeu, celui-là vaut autant que la roulette et le baccarat. Les parieurs parlent des chevaux, ils les regardent, ils cherchent à les connaître; leur coup d’oeil se forme; beaucoup d’entre eux savent à leurs dépens que l’entraînement est une science, et que l’origine paternelle et maternelle est une question de premier ordre dans l’appréciation d’un poulain; ils aiment ou haïssent le cheval, selon leurs gains ou leurs pertes, il est vrai, mais au moins, ils ne restent pas indifférents pour ce noble animal dont l’amélioration est une source de richesse et de prospérité pour le commerce et l’agriculture de notre pays.
Les boutures que nous avons détachées en Angleterre de l’arbre généalogique de la race pure, du «général Stud-Book» datant de 1791, ont trouvé notre terrain fertile. Régulièrement classées depuis 1838, elles ont donné des fruits multipliés et savoureux; Vermout, Fille de l’air, Dollar, Gladiateur, en nous procurant l’année dernière, un succès international, commencent à être connus dans les contrées les plus reculées; on en parle à Sarreguemines; l’Éclair, de Pontivy imprime leurs noms en grosses capitales, et à Brives il y a un Betting-Room. Il nous faut des triomphes, à nous Français: c’est une vieille habitude dont nous ne pouvons nous passer; des victoires, et des victoires sur les Anglais encore, mais cela seul est capable de nous donner le goût du cheval.
Nous sommes donc en bonne voie au point de vue du turf et par conséquent des chevaux de pur sang; néanmoins, il y a encore, hélas! beaucoup trop de gens qui ne savent pas ce dont il s’agit, et qui haussent les épaules de pitié en voyant tout ce monde s’ébaudir en présence de maigres haridelles incapables de galoper pendant plus de cinq minutes avec un singe de cent livres sur le dos. Aux dernières courses du printemps, M. Prudhomme, amateur placé devant moi dans les tribunes, disait à son épouse:
«Vois-tu, ma bonne, si ma faible voix pouvait se faire entendre dans les hautes régions du pouvoir, je m’exprimerais...
— Oh! ce jockey tout rose, il est charmant, il va gagner, j’en suis sûre.
— C’est un pantin...; je m’exprimerais ainsi: L’amélioration de la race chevaline, ne peut être obtenue qu’à l’aide de l’étalon percheron, à la fois fort et léger, seul modèle se rapprochant de celui des chevaux du Parthénon, chef-d’œuvre de la statuaire antique.
— Ah! le rose arrive, je te l’avais prédit, mon ami, voyons un peu le nom sur le programme: Partisan; j’en suis bien contente, je l’aurais d’ailleurs parié, combien gagne-t-il?
— Huit mille francs; c’est une ineptie, avec cette somme on achèterait à Nogent-le-Rotrou quatre reproducteurs splendides, et le Gouvernement...
— Moi, d’abord, je raffole des casaques roses.»
Néanmoins la route est tracée, elle est fréquentée, et j’espère que nous arriverons bientôt à comprendre cette phrase anglaise tirée d’un livre (The horse) qui par exception est prophète dans son pays: «En admettant
«une proportion convenable de pur sang, par
«le moyen du croisement et du métissage,
«nous sommes parvenus à rendre nos chevaux
«de chasse, nos chevaux de promenade
«et de guerre, nos chevaux de voiture, et
«même nos chevaux de trait, plus forts, plus
«actifs, plus légers et plus propres à endurer
«la fatigue, qu’ils ne l’étaient avant l’introduction
«du cheval de course ou de pur
«sang.»
J’excepterai de cette étude le cheval de pur sang, qui chez nous comme partout est généralement produit par des éleveurs qui ont du savoir et l’amour du cheval; qui souvent font courir, ou bien qui vendent leurs poulains à des turfistes ou à des entraîneurs passionnés pour leur art.
J’ai le regret de commencer ce petit travail par une citation cruellement vraie, mais dont la rude franchise honore l’homme distingué et compétent auquel je l’emprunte : «Partout le cheval est l’expression de
«l’homme qui le fait naître. En Angleterre,
«l’éleveur haut placé dans la société, forme
«le cheval pur sang, le cheval de course.
«En Arabie, en Tartarie, le cheval, élevé
«par un cavalier, devient un coursier admirable.
«Les Allemands, habiles à construire
«des voitures légères, produisent naturellement
«le carrossier léger. En France,
«hélas! pays d’horribles charrettes, pendant
«que l’on expose à Paris mille théories,
«que l’on disserte dans les états-majors,
«que l’on distribue des prix dans les
«hippodromes, le tout dans le but très-louable
«d’acclimater les meilleurs types,
«le cheval, dans sa pratique réelle, se
«trouve élevé par un charretier. Celui-ci,
«au rebours de tous les programmes de la
«civilisation hippique, et plus barbare, en
«pareille matière, qu’un Bédouin ou qu’un
«Turcoman, veut, avant tout, former un
«cheval à l’unisson de son grossier véhicule.....
«Ailleurs, par un destin bizarre,
«le cheval n’est élevé ni par un sportsman,
«ni par un cavalier, ni par un charretier;
«il l’est tout simplement par un bouvier
«qui ignore l’art de le manier et de s’en
«servir, et qui ne sait employer que le
«bœuf à ses travaux d’agriculture et de
«transporta Un tel éleveur est, on le pense
«bien, incapable d’apprécier le degré de
«coïncidence qui doit exister entre les
«formes et les qualités d’un cheval; aussi,
«ne voyant dans son élève qu’un animal à
«faire profiter, il le traite suivant cette idée
«et l’engraisse en bœuf pour le vendre à la
«foire. Du reste, pour élever des chevaux,
«je préfère un bouvier à un charretier. Celui-ci
«veut absolument faire triompher
«l’informe type attelé à sa carriole ou à sa
«charrue; l’autre a, du moins, l’avantage
«d’être, par ses mœurs, neutre dans la
«question: il reste plus de chances de s’entendre
«avec lui.»
Cela est rigoureusement vrai, sauf à l’égard des hommes intelligents qui consacrent une large part de leur temps et de leur argent à la production du cheval; si les personnalités n’étaient pas de mauvais goût, il y aurait ici beaucoup de noms à citer, en Normandie surtout et dans la plaine de Tarbes; mais, du reste, ces noms-là sont connus, ils sont à l’abri de toute attaque, ils sont la gloire de l’élevage français, et je répète une fois pour toutes qu’aucune critique contenue dans ce livre ne leur est adressée et ne les atteindra. Mais que peut, je le demande, cette honorable minorité d’agriculteurs et d’herbagers connaissant et aimant les chevaux, dans un pays qui compte dans sa population chevaline une moyenne annuelle de 2,900,000 têtes? Et dans ce chiffre, il y a environ 1,250,000 juments de 4 ans et au-dessus!
C’est donc pour le grand nombre que j’ai cité les lignes amères qu’on vient de lire; pour le grand nombre aussi je poursuis cette étude. Les généralités blessent seulement ceux qui vont au-devant de la blessure, en dirigeant contre eux-mêmes le tranchant d’une arme inoffensive; dans ce cas ils n’ont pas droit de se plaindre; ils se sont fait justice à eux-mêmes et de leur propre gré.
Le peu de popularité des goûts hippiques dans les campagnes, doit être rangé en première ligne parmi les causes qui retardent en France l’amélioration de nos espèces chevalines, de nos races, si l’on veut; quoiqu’à mes yeux, il n’y ait qu’une race, le cheval pur, le type, engendrant le demi-sang intelligemment adapté aux divers besoins de notre époque et de notre civilisation.
Il y a de plus, chez nous, disette de belles juments; foi aveugle dans l’influence à peu près exclusive de l’étalon dans les résultats de l’accouplement, et enfin désir immodéré de faire gros, comme on dit en langage technique. J’examinerai successivement ces diverses questions.
Voyons la première, l’absence de goût pour les chevaux. On parle fort du manque d’argent de nos agriculteurs, et on compare la modicité de leurs ressources à la richesse des fermiers anglais; il y a là une notable exagération, du moins au point de vue chevalin. Nos fermiers et nos propriétaires, petits et grands, gagnent beaucoup d’argent; la preuve existe dans les augmentations énormes qu’ont subies depuis vingt ans les baux des moindres fermes; néanmoins elles ne manquent jamais de locataires; lesdits locataires, au bout de quelques années passées à gémir sur leur détresse, achètent un joli bien et le payent comptant à un prix très-élevé. Les doléances sur la pauvreté de nos paysans, dans les provinces propres à l’industrie chevaline, commencent donc à devenir passablement surannées. Là, il y a plus d’aisance qu’autrefois, et aussi plus de chevaux; tous ceux qui peuvent rigoureusement en nourrir un, l’achètent immédiatement; mais quel cheval, grand Dieu!
Notre paysan est rusé, laborieux, économe, mais point spéculateur dans le sens vrai du mot; il ne veut pas exposer un capital et faire les sacrifices exigés par l’esprit même du commerce; il désire gagner, «gagner gros,» comme il dit, mais avant tout ne rien risquer. La production chevaline est embourbée dans cette ornière de la méfiance, et tous les étalons carrossiers des dépôts de l’Etat, attelés ensemble à ce malheureux chariot et tirant en même temps, ne suffiraient pas à l’en faire sortir. Il faudrait pour cela une passion hippique analogue à celle des Arabes, des Allemands et des Anglais; alors on ferait de bons chevaux, on s’apercevrait qu’ainsi faits et bien élevés, ils sont vendus cher, et on les aimerait davantage. L’intérêt serait pour la passion un aiguillon puissant, et le meilleur sans aucun doute.
Pour commencer, on mettrait quelques louis de plus à l’acquisition d’une bonne jument de travail, au lieu d’acheter pour cent écus à un maquignon forain une bête de rebut, produit informe d’un percheron mal construit et d’une bique de charbonnier, qui, une fois attelée, a les oreilles moins hautes que les bouts des brancards. De grosses limonières, également fournies dans l’avant et l’arrière-train, régulières de conformation et d’aplombs, richement membrées,avec le dos et le rein bien suivis, et le bassin développé, travailleraient avec plus de force et de célérité que les malheureuses bringues dont je viens de parler, et moyennant une nourriture substantielle et des soins, contribueraient chaque année par leur poulain à l’aisance de la maison.
Il y a deux ans, un petit cultivateur, mon voisin, ayant une ferme de deux mille francs, louée trop cher, vu la piètre qualité des terres, me disait en réponse à mes compliments sur une belle percheronne étoffée que je voyais à sa charrue, labourant seule, sans peine et en magnifique condition de santé : «— Ah!
«Monsieur, je crois bien qu’elle est bonne!
«Elle m’a coûté neuf cents francs, je ne le
«nie pas, mais je ne le regrette pas non plus;
«sans elle je ne pourrais pas payer mon
«loyer. Tous les ans, elle fait notre ouvrage,
«et nous donne par-dessus le marché un
«poulain que nous vendons en moyenne six
«cents francs à dix-huit mois. Nous en avons
«eu un de Taconnet, que nous avons vendu
«sept cents francs. Si elle venait à périr,
«notre pauvre Coquette, elle nous laisserait
«dans l’embarras. C’est la providence de
«chez nous.» Et il avait raison, le bonhomme.
Je voudrais voir les chevaux aussi bien nourris que les vaches, et quelquefois pansés, au moins le dimanche, comme leurs maîtres, qui ce jour-là se font raser. Les harnais, tout en demeurant simples, devraient être entretenus, graissés et suffisamment rembourrés; il faudrait donner aux bourreliers les colliers à ajuster, et ne pas mettre à un cheval de quatre ans, celui qu’il avait à deux ans, sous prétexte que l’animal n’a pas encore été blessé et qu’il y est habitué. Sans doute la forme du collier importe peu, mais il doit être solide, léger, approprié à la force du corps, aisé à l’encolure, sans être large, et d’une longueur telle que l’on puisse passer la main ouverte entre le poitrail et la partie inférieure. Un collier trop juste ou mal assujetti prend une direction oblique quand le cheval monte, et comprime la trachée; la traction a lieu sur le cou, et l’animal perd la plus grande partie de sa force; il respire avec peine et peut être frappé d’asphyxie ou atteint de cornage; il est dans la situation d’un homme accrochant à sa cravate le fardeau porté par ses épaules, et obligé, avec cet attirail, de monter un escalier rapide. Si le collier est trop volumineux et trop ouvert, il est jeté en avant, surtout pendant la descente, et gêne le mouvement des épaules; le frottement prolongé qu’il exerce sur l’encolure peut produire l’excoriation de cette partie en avant du garrot, et par suite un ulcère profond, lent, et difficile à guérir. S’il est mal rembourré, l’omoplate peut être atteint de tumeurs et ensuite d’ulcères d’autant plus graves que l’animal est plus maigre.
Il est des localités en France où l’on fabrique des colliers si volumineux qu’un seul homme a de la peine à les passer au cou des chevaux, comme si la solidité consistait dans le volume. La surcharge de poids et la ruine prématurée des membres antérieurs sont le résultat de cette pratique absurde.
Les Flamands, les Allemands et les Anglais ne se servent, pour leurs chevaux de labour, que de colliers fort légers, bien rembourrés de crin. Les premiers les font en bois dur, mince et presque sans oreilles; ceux des seconds sont garnis d’attelles de fer, comme pour les chevaux des voitures bourgeoises. Pourquoi ne les imitons-nous pas?
Et pour le reste du harnachement, que de choses pourrais-je ajouter! En parcourant nos routes on aperçoit rarement les chevaux des cultivateurs attelés avec goût. Souvent, au contraire les têtières trop serrées, tirent le frontal et pressent la base des oreilles; les mors placés trop haut plissent et parfois écorchent la commissure des lèvres. Les sellettes n’étant pas retenues suffisamment par la croupière, se portent en avant et blessent le garrot; ou bien elles sont mal assujetties, le harnais frotte alors sur les côtes et y détermine des durillons. Les sous-ventrières et les dossières qui soulèvent à la montée une grande partie du poids du limonier sont rarement placées sur une peau de mouton; elles manquent de largeur et de souplesse, et le sternum est excorié.
Les chevaux ayant un peu d’origine et par conséquent une plus grande finesse de peau, sont fréquemment blessés sous la queue et sur les reins par le culeron de la croupière et par sa courroie nommée fourchet, parce qu’on néglige de placer un coussinet sous le fourchet et de graisser le culeron, qui d’ailleurs n’a presque jamais un diamètre convenable.
Beaucoup d’accidents sont attribués aux vices des chevaux, et ne sont dus qu’à un mauvais harnachement. Un cheval mal harnaché est non-seulement exposé à se blesser par le frottement ou la compression des harnais, mais encore à s’abattre, à se traverser, à ruer, à pointer, à s’emporter et à faire verser cabriolets, charrettes et autres voitures. Il n’est pas rare de voir un jeune cheval trembler à la vue et au bruit du harnais qui valui être brutalement jeté sur le dos: «Voyez ce fainéant, s’écrie le charretier, il a déjà peur de travailler!» Il croit le pauvre animal mû par la paresse, tandis qu’il l’est par un souvenir de gêne et de douleur dont l’appareil qu’il a sous les yeux ne lui rappelle que trop la triste expérience.
L’élevage des chevaux, surtout des chevaux distingués, près du sang, et dont la vente est productive, exige une foule de soins et comporte les détails les plus minutieux. L’agriculteur dit avec découragement: «Oh!
«les chevaux d’espèce! nous n’en voulons pas,
«ils sont vicieux, ils travaillent mal, on ne
«peut pas les utiliser, ils sont trop casuels.» Pour être de bonne foi, convenez, au contraire, que les chevaux de demi-sang sont excellents au travail, et, pour preuve, regardez ceux de la plaine de Caen; mais avouez simplement qu’ils exigent des précautions et des ménagements que vous leur refusez, et une affection quasi paternelle que vous n’éprouvez pas. Vos vaches, avant tout, n’est-il pas vrai? Voilà le grand mot lâché ! Ah! si les juments donnaient du beurre!... On pourrait supprimer immédiatement l’administration des haras.
Deux exemples pris au hasard prouveront que l’absence de soins judicieux est souvent pour les éleveurs la cause de pertes considérables.
Il y a quatre ans, je vendis à un riche propriétaire herbager deux juments anglaises réformées de mon écurie; elles avaient chacune un poulain. L’une carrossière, baie, avait un poulain d’Impérial, étalon de demi-sang par Eylau, et l’autre, jument de selle alezane, une pouliche de Ramsay, cheval de pur sang. N’ayant pas assez d’herbe chez moi pour garder ces deux bêtes, je vendis, ou plutôt je donnai le tout, mères et produits, pour une somme insignifiante.
La jument baie âgée de neuf ans, fut mise au travail en limon, et donna l’année suivante un second poulain; elle avait un garrot remarquable par son élévation, sa longueur et sa sécheresse. On n’y prit point garde, et elle fut en peu de temps blessée par un collier qui n’était pas fait pour elle. On continua à la faire travailler avec le même instrument de torture, et comme elle était vaillante et généreuse, elle tira malgré la souffrance. Enfin, un mal gangreneux se déclara; elle devint inattelable et mourut de misère dans un enclos où on l’avait abandonnée. Cela aurait peut-être coûté deux francs pour lui faire ajuster et rembourrer convenablement un des nombreux colliers de la maison.
Quant à la jument alezane, âgée de douze ans, c’était une bête très-remarquable, accusant une haute origine; on pouvait la considérer comme un beau type de Hunter.
Nous étions à la fin de juin, l’acquéreur me dit: «Je vais mettre cette bête et sa pouliche dans un très-bon herbage. — Mais, repris-je, vous les ferez sans doute rentrer tous les soirs par votre bouvier, et elles ne coucheront pas à la belle étoile? — Oh! si; dans cette saison, cela n’offre aucun inconvénient. — Je trouve au contraire que cela en présente beaucoup pour une jument déjà vieille, habituée depuis longtemps aux écuries chaudes, aux couvertures, à l’avoine en abondance, à une hygiène tonique, et surtout pour une pouliche d’un mois très-délicate et née dans un box. — Oh! il n’y a aucun danger, je vous assure.»
Au bout de quelques jours, la pouliche était trouvée un matin, après une nuit d’orage, morte dans l’herbe détrempée. La foudre l’a tuée, me dit-on. Soit! mais la foudre n’était pas tombée cette nuit-là sur l’étable où on aurait dû la loger.
Nos charrettes sont de détestables voitures; les jeunes chevaux mis trop tôt en limon sont tarés de bonne heure; leurs épaules se brisent, leur rein se creuse, et leurs jarrets se couvrent de tumeurs osseuses ou molles. L’usage de la charrette est très-désavantageux dans les mauvais chemins qui abondent dans les exploitations rurales; car il est très-difficile que la charge soit parfaitement en équilibre sur l’essieu, et dès lors le limonier est tour à tour chargé et soulevé dans les descentes et les montées; et puis, le poids n’étant supporté que par deux roues, s’il en tombe une dans un trou, la plus grande partie de la charge se porte de ce côté, et les chevaux ont beaucoup de peine à l’en tirer. Ils en éprouvent bien moins quand cette même charge se distribue sur quatre roues. Aussi devrait-on généraliser l’emploi du charriot léger, muni d’une mécanique et traîné par un seul cheval attelé dans une limonière, comme en Alsace et en Franche-Comté, par exemple. Ce genre de voiture est excellent dans les endroits montagneux.
Les charriots des gros fermiers seraient d’une plus grande dimension, et auraient, au lieu de limonière, un timon auquel on pourrait mettre deux jeunes chevaux qui tireraient mieux ensemble et marcheraient beaucoup plus vite que l’attelage des charrettes à deux roues. Le cheval commun de gros trait, dont la vente est improductive, actuellement nécessaire comme limonier, serait beaucoup moins utile, et l’élevage des chevaux de demi-sang, qui seuls rapportent à l’éleveur, y gagnerait.
Nous pourrions aussi, sans inconvénient, supprimer ces ignobles fouets à monture droite que nos charretiers font claquer avec une gaieté stupide. On peut traverser l’Angleterre sans entendre le claquement d’un fouet, et il est difficile de parcourir quatre kilomètres sur une route française un peu fréquentée, sans être exaspéré par ce bruit qui constitue un genre de distraction brutal et inintelligent.
La plupart des écuries sont malpropres, trop étroites, trop basses et mal aérées; les chevaux ne sont même pas séparés par des barres; souvent il n’y a pas de fenêtres, et le sol n’est pas battu; les chevaux vivent sur un épais fumier; leurs poumons, leurs pieds et leurs yeux s’en ressentent, et ces pauvres animaux sont, jour et nuit, asphyxiés par des émanations fétides. L’absence de vigueur, les toux chroniques, les eaux aux jambes, crevasses, fourchettes pourries, et la fluxion périodique des yeux, sont fréquemment le résultat des écuries malsaines, et de la transition subite qu’éprouvent les chevaux en passant tous les matins, de cette température brûlante, à l’air extérieur, dans des terrains quelquefois mouillés, et à travers un brouillard humide et condensé.
Les poulains, mis au piquet dans les prairies artificielles, sont entravés de telle sorte qu’on les reconnaît plus tard sur les foires à de nombreuses traces de prises de chaîne et surtout à la déviation d’un paturon antérieur. Au service, c’est pire encore; la jambe qui a été entravée est presque toujours plus faible que l’autre et l’animal butte continuellement. Un bon entravon en cuir souple, suffisamment rembourré, ne serait pourtant pas d’un prix fabuleux, et il ne serait pas difficile d’entraver alternativement l’une et l’autre jambe. Un cheval dont les aplombs seraient ainsi conservés, aurait plus tard, sur le marché, une plus-value qui payerait bien des notes de bourrelier.
Je voudrais voir en France, comme dans les fermes allemandes et anglaises, les petits gars de quinze ans monter les jeunes chevaux sellés avec des panneaux munis d’étriers, et bridés avec un filet ou un mors doux qui ne serait pas constamment rouillé. Les poulains, quand les travaux de la culture ne les réclameraient point, iraient ainsi montés, avec des genouillères, soit à la forge, soit au marché du canton, soit aux provisions. Ils feraient, en même temps que les commissions de la ferme, de petites courses qui développeraient leur haleine et leurs allures. Leurs cavaliers finiraient par ne pas trouver ridicule ou impossible de trotter à l’anglaise, et acquerraient, avec le goût du cheval, une tournure leste et dégagée qui ne leur ferait point tort. Le paysan, l’agriculteur, voilà la base de l’amélioration chevaline; ce sont eux qui font les chevaux, et ils ne les aiment pas; c’est donc là, c’est aux champs qu’il faut exciter le goût, développer la passion et l’activité. J’en puis parler avec quelque expérience, habitant depuis plusieurs années un pays qui semble privilégié pour la production et l’élève du demi-sang, à quelques lieues du Merlerault, de la vallée d’Auge et de la plaine de Caen.
Aujourd’hui beaucoup de petits propriétaires ont des tilburys, des «bocs», comme on dit en Normandie. Ne devraient-ils pas atteler quelquefois pendant une demi-heure ou trois quarts d’heure, sur une bonne route, leurs chevaux de trois et de quatre ans, le soir, à temps libre, pour se récréer, et pour ainsi dire, en fumant leur pipe? Ils s’exerceraient ainsi à conduire proprement, et à rendre leurs élèves dociles, brillants, légers ou vites, suivant leurs moyens naturels. Ils les vendraient assurément plus cher, en les présentant sur le champ de foire, attelés, nettoyés, avec les crins faits, la queue rafraîchie, la bedaine remontée par une ou deux purgations, et après un mois d’hygiène bien entendue. Les marchands, au dire des gens de la campagne, ne veulent pas acheter les chevaux dont la toilette est faite, et qui sont apprêtés. Faites de bons chevaux, et les marchands vous les prendront aussi bien, s’ils sont présentés convenablement, que s’ils ont l’air de sortir d’une mare à fumier; seulement, ils vous les payeront davantage; voilà toute la différence.
Les poulinières des herbagers, vivant sans travail de la vie des bœufs à l’engrais, sont, pour la plupart, d’une sauvagerie notable et d’un caractère opiniâtre qu’elles transmettent à ceux de leurs produits qui naissent et sont élevés dans les pâturages jusqu’à l’âge de la vente. Il y a dans le Merlerault et dans la vallée d’Auge des juments de quinze à seize ans qui n’ont jamais porté un homme, et jamais eu un harnais sur le dos. C’est toute une affaire que de les approcher et de leur mettre un bridon pour les conduire à la saillie. Veut-on les examiner de près, ainsi que les poulains, il faut prendre autant de précautions que s’il s’agissait d’aborder des chevreuils. Habitués à voir l’homme les poursuivre en battant des mains, ou en frappant dans son chapeau avec un bâton, pour montrer à ses amis des allures prétendues brillantes, qui ne sont que les mouvements enlevés, résultat de l’effroi, même chez les rosses les plus médiocres, ils se sauvent grand train. Alors, il faut marcher lentement, ne pas lever les bras, éviter de faire du bruit, de se moucher, de cracher, et se remettre en quête; dans ce cas, on arrivera peut-être à voir ces bêtes ahuries. Si cela ne réussit pas, il faut les «encointer», mot peu gracieux désignant une manœuvre que l’on devrait réserver pour le fauve, et qui consiste en ceci: Plusieurs personnes se réunissent et poussent doucement devant elles toute la cavalerie sauvage dans un angle, un coin de l’herbage; puis elles se rapprochent et resserrent le cercle de manière à maintenir en place les chevaux, qui les regardent d’un air effaré.
Sérieusement, comprend-on que des animaux destinés à vivre en contact continuel avec l’homme, à porter des cavaliers dans les rues des grandes villes, ou peut-être à stationner avec une voiture au milieu d’une foule sortant du théâtre ou d’un bal, soient aussi négligés, aussi peu fréquentés et apprivoisés, au début de leur vie, lorsque leur caractère se forme. Témoin bien des fois de scènes semblables à celle que je viens de rapporter, j’ai souvent pensé que si les propriétaires de ces chevaux avaient le goût du cheval, s’ils aimaient à le monter et à l’atteler, ils se préoccuperaient bien davantage du caractère et de la docilité de leurs élèves. Ils verraient de leurs propres yeux, combien l’apprivoisement préalable, le maniement fréquent des poulains facilitent le dressage, et contribuent à le rendre parfait.
J’ai dressé, soit à la selle, soit à l’attelage environ cinquante chevaux augerons ou merleraultins élevés à l’herbe, et j’ai toujours été entravé et retardé au début par ces mille riens qui prennent beaucoup de temps: habituer les chevaux à rester attachés sans tirer au renard, à lever leurs pieds, à se laisser toucher sur toutes les parties du corps sans frayeur, au pansage, aux mouvements des palefreniers autour d’eux, etc. Tous ces détails, qui demandent peu ou point de précautions spéciales avec les animaux élevés dans les fermes, exigent un véritable travail avec les poulains des herbagers et plus encore avec les juments de huit à neuf ans et au-dessus, consacrées, jusqu’à cet âge, uniquement à la reproduction. Là, l’apprivoisement et le dressage doivent marcher de concert, et il faut un certain temps pour obtenir un service de ville et de route sûr, aussi bien de nuit que de jour. Toute l’énergie est dépensée dans les défenses, pendant les premières leçons, et les poumons et les membres quoique sains n’ont pas de résistance, n’ayant connu de bonne heure ni la rapidité des mouvements, ni des efforts quelconques. Si l’on n’y veille très-attentivement, les tumeurs molles ne tardent pas à paraître.
Avec cette sorte de chevaux, la moindre maladresse au début est une source d’ennuis et de retards. Le bouvier qui met pour la première fois un bridon au cheval libre jusqu’alors, et qui manque son coup, ou réussit par la violence, ne se doute pas des difficultés qu’il va créer au dresseur auquel il conduira l’animal.
Le 18 septembre 1860, M. Goupil, de Pont-fol (vallée d’Auge), me confia une belle jument baie-brune de six ans, née et élevée dans ses herbages; je la lui rendis le 8 novembre, montée et bien attelée au tilbury. Quand elle arriva chez moi, il était impossible de la brider; dès que ma main dépassait la hauteur des deux tiers de l’encolure et approchait de la nuque, la bête s’exaspérait et cherchait à grimper dans le râtelier ou à pointer en jouant de l’épinette, si j’essayais de la retourner dans la stalle. Quant au passage du collier, il n’y fallait pas songer, pour le moment du moins.
Le 17 juillet 1862 un poulain de deux ans, rouan, entra chez moi dans des conditions analogues, avec cette circonstance qu’il se campait et se refusait à tout mouvement dès que le mors du bridon était posé sur ses barres, et qu’il ne sortait de son immobilité que pour pointer à se renverser. Il appartenait à M. Sauvage, propriétaire à St-Julien-le-Faucon (vallée d’Auge), auquel je le renvoyai le 10 septembre, très-sage au tilbury, débourré à la selle, et sautant franchement.
Pour arriver à rendre ces deux chevaux calmes et faciles à débrider «comme tout le monde,» j’ai certainement perdu beaucoup d’heures; et pourtant chacun sait que rien n’est plus simple et plus facile que de mettre, du premier coup, un harnais complet sur le dos de n’importe quel poulain habitué de bonne heure à l’obéissance et aussi aux caresses et aux attouchements de l’homme. Il n’y a aucun truc à employer, et il faut plutôt de la douceur que de l’adresse; à dire vrai, l’adresse ne gâte rien.
Tous les ans, plusieurs doctes personnages voyageant aux frais de l’État, visitent les pays lointains pour remplir des missions plus ou moins scientifiques. Les sciences gagnent probablement à ces explorations, bien que quelques-uns des savants en question rapportent simplement de leur voyage, des œufs de crocodile, des flèches de sauvage empoisonnées qui donnent le frisson aux dames, et, dans un coin reculé de leur malle, l’embryon d’une dissertation somnifère sur les dynasties des premiers Pharaons, ou la théogonie des brahmines.
Ces sortes de questions brûlantes servent à réchauffer les loisirs d’un certain nombre de lettrés paisibles, qui ont des rentes, et qui consacrent leurs après-midi à des fouilles consciencieuses dans les arcanes inexplorées des bibliothèques publiques. Ne va pas dans l’Inde qui veut, et il vaut mieux étudier les mœurs des serpents rue de Richelieu qu’à Java. Ne pourrait-on pas, sans aller aussi loin, sans faire des dépenses aussi considérables, envoyer un homme ayant la pratique des chevaux, et la connaissance approfondie des habitudes peu chevalines de nos paysans, passer un mois ou deux en Allemagne, dans le Mecklembourg, le Hanovre et le Holstein, par exemple, et tout autant de temps en Angleterre et surtout en Irlande, pour y remplir consciencieusement une mission hippique essentiellement utile à notre agriculture?
Cet homme, que je suppose intelligent et observateur, serait envoyé non pour se promener dans les grandes villes et disserter dans les cercles, mais pour visiter les fermes, petites et grandes, examiner à fond toutes les habitudes d’élevage applicables en France. Il ne négligerait aucun détail: le ferrage, la forme des chariots, la confection des harnais de travail, la construction des écuries rustiques, les usages des éleveurs pour l’alimentation de leurs animaux, la façon dont les herbagers gouvernent les poulinières suitées et les produits sevrés d’après les localités et les saisons; la manière dont on les rentre, dont on les attache, dont on les emploie aux travaux de la culture. Tous ces points seraient l’objet d’un contrôle sérieux. Le bon et le mauvais seraient pesés avec les inconvénients ou les avantages qui en résultent. Au retour, notre «missionnaire» serait tenu de faire un rapport clair et circonstancié, sans mélange de grec et de latin, sur les observations qu’il aurait recueillies. Il ne lui serait pas permis de parler des quadriges, de citer Hérodote à propos de Triptolème, et de remonter aux éleveurs antédiluviens.
Il se bornerait à consigner les choses utiles et de pratique quotidienne remarquées par lui à l’étranger, et profitables pour les petits cultivateurs français aussi bien que pour les grands. Il écrirait pour être compris desdits cultivateurs «qui produisent la masse des chevaux, et qui s’en tirent assez médiocrement. » Ce rapport répandu dans les campagnes, pourrait peut-être exciter la curiosité, détourner de routines funestes, et pousser dans la voie de l’initiative, en donnant l’idée d’imiter les pratiques des pays où on élève mieux que dans le nôtre. Il ne faudrait pas qu’il fût imprimé sur un magnifique papier, et orné d’illustrations par Gustave Doré, mais qu’il coûtât deux ou trois sous; autrement on lui préférerait l’almanach liégeois. Si un travail fait dans ces conditions pouvait contribuer à accroître le goût du cheval et en faciliter l’élevage à nos paysans, ce ne serait peut-être pas pour l’État, de l’argent perdu, ni pour l’homme qui l’accomplirait, du temps stérilement employé.
En commençant ce chapitre, j’ai dit qu’il y avait en France disette de bonnes poulinières, et précisément à cause de cela, croyance exagérée à l’influence presque exclusive du gros étalon de demi-sang, au point de vue améliorateur; il faut se consoler comme on peut, ou bien s’étourdir avec un paradoxe économique. On dit bravement: «Ma jument est mal
«construite, il est vrai, mais elle ne m’a pas
«coûté cher; je vais lui donner un étalon
«ayant les qualités qui lui manquent, et j’aurai
«un bon produit; en somme, la grande
«affaire c’est de savoir accoupler, et je crois
«m’y entendre assez bien.» Ceci posé, on accouple; on mélange beaucoup d’eau avec peu de bon vin, et on obtient une boisson peu dispendieuse, assurément, mais insipide. Le résultat est nul.
Sauf les grands herbagers, qui ne sont pas les producteurs les plus nombreux de la population chevaline, les agriculteurs, propriétaires ou fermiers, ont en général des juments d’un ordre très-inférieur. Prenons pour exemple la circonscription du dépôt d’étalons du Pin. J’ai souvent visité, pendant la monte, un grand nombre des stations qui la composent; eh bien! dans toutes celles des pays de culture, j’ai vu d’horribles juments, chétives, informes et tarées pour la plupart. Et l’on croit que l’étalon va faire un chef-d’œuvre? On entend le cultivateur qui amène une poulinière de 150 francs etqui paye 15 francs pour la saillie, critiquer amèrement les reproducteurs que l’État lui fournit presque gratuitement. Celui-ci a des éparvins, celui-là des membres grêles, le dos mal fait, etc... Et votre affreuse bique, donc! l’avez-vous regardée?
Et puis on veut faire du gros, produire des mastodontes avec des bretonnes de 1 mètre 55 (et encore!) sans origine, sans régularité et sans membres! c’est une assez mauvaise plaisanterie. Du gros! avec un fort étalon et une bringue étiolée! Impossible. Vous aurez peut-être ainsi de la taille et du dégingandé ; mais le gros, avec la carrure et l’harmonie des formes, ne se trouve que dans le vaste bassin d’une mère puissante et régulière, dans lequel la charpente d’un fœtus peut s’agencer à l’aise pendant une longue gestation de onze mois. Cette mère, fortement nourrie pendant qu’elle porte et pendant qu’elle allaite, vous donnera un poulain suffisamment gros à l’âge adulte. Le produit d’un cheval de pur sang et d’une jument étoffée est plus grand et plus carré que le poulain résultant d’un fort demi-sang, avec une petite jument étroite et irrégulière. Et quant à la distinction, à l’énergie, aux qualités d’allures et de fond, à tout ce qui fait aujourd’hui la valeur sérieuse du cheval, quelle différence, à l’avantage du produit direct du pur sang!
Les herbagers, gens pour la plupart riches, et possesseurs des rares belles juments clairsemées sur le sol français, ne devraient leur donner que le cheval de race; les poulains seraient bien assez gros, bien assez étalons, puisque c’est le mot consacré pour désigner actuellement le poulain mâle, sans tares, gras et mou, destiné à alourdir nos races déjà trop lymphatiques. Ils pourraient en outre entrer pour une large part dans l’œuvre de l’amélioration, en élevant un nombre plus considérable de chevaux de pur sang. La vente annuelle de deux ou trois poulains tracés, aux écuries de course dont le développement s’étend de jour en jour, couvrirait amplement les frais généraux de l’élevage et serait un bénéfice certain. Mais il ne faudrait pas, en entrant dans cette voie, vouloir s’occuper aussi d’entraînement, sans se douter préalablement que l’entraînement est une science dont la pratique suffit à absorber tous les instants de l’homme qui s’y consacre. Quand un éleveur vend trois poulains de pur sang plus de 20,000 fr. sous la mère (et cela s’est vu plusieurs fois, l’année dernière par exemple), il fait une affaire magnifique et plus sûre que celui qui les achète. S’il ne sait pas se contenter d’un pareil bénéfice, qu’arrive-t-il? Il garde ses poulains et prend chez lui le premier ivrogne venu, pourvu qu’il soit Anglais et qu’il sorte d’une écurie de course par la porte ou par la fenêtre. Au lieu d’un entraîneur, et je le répète, un entraîneur n’est pas un homme vulgaire, il a fait l’acquisition d’un groom de mauvaise vie, ou d’un petit jockey de troisième ordre, qui sait panser les chevaux et quelquefois les monter, mais qui jamais n’amènera au poteau un cheval dans une condition supportable. Il dépensera beaucoup d’argent à l’éleveur qui a voulu faire le turfiste, il mettra le désordre dans la maison où on le considérera comme un oracle, et boira la moitié de la cave; quant aux poulains, ils arriveront, à peu d’exceptions près, les derniers sur tous les hippodromes, et ce sera chose juste; que chacun fasse son métier.
Les cultivateurs qui redoutent plus encore que les herbagers l’emploi de l’étalon de pur sang, prétendent qu’ils en ont essayé et que les résultats n’ont pas été satisfaisants; ils feraient bien de regarder leurs juments avec impartialité, et de convenir que beaucoup ne sont aptes à donner un bon poulain avec n’importe quel cheval, fût-il l’éléphant lui-même. Ils devraient convenir, bona fide, qu’ils ne les payent pas assez cher et qu’ils les nourrissent médiocrement au profit de leurs vaches; que la première pouliche à peu près bonne est vendue à l’âge adulte, au lieu de devenir une source de richesses dans la maison. Alors ils ne s’étonneraient plus de faire de mauvais chevaux, et ne s’en prendraient pas au pur sang, ou à l’administration des haras.
Par ce qui précède, je n’ai point prétendu qu’on devait livrer indistinctement toutes les juments à l’étalon de pur sang; celles qui sont chétives, de très-petite taille, ou dégingandées, haut perchées, grêles de corps et de membres (et par malheur, je le répète, le nombre en est grand), doivent être saillies par l’étalon de demi-sang largement charpenté. J’ai voulu dire que les fortes juments, les bêtes construites de manière à mériter le nom de poulinières, pourraient être ordinairement accouplées avec le cheval de pur sang, et que les produits, après un élevage bien entendu, seraient suffisamment étoffés pour être acceptés par le commerce, et de beaucoup plus élégants et plus vigoureux pour toute espèce de services.
Je ne sais pas sur quoi se fonde le désir immodéré de faire gros, qui nous pousse à l’hippopotame court, massif et mou. Les grands et gros carrossiers sont rarement bons; ils n’ont d’ailleurs d’emploi assuré que dans les écuries des souverains ou des gens de cour, le débouché n’en peut donc pas être considérable. A peu d’exceptions près, le cheval moyen, dans les différentes espèces, est le plus accessible aux divers genres de service, et le mieux adapté à nos besoins. Quant au petit cheval, c’est ordinairement le meilleur de tous, mais n’en parlons plus. Il est convenu que, sauf pour l’attelage des petites voitures dites paniers, il n’est bon à rien.
Les étalons orientaux de la plus haute lignée ne sont pas les plus grands, ni les plus charnus de la race; à peu d’exceptions près les chevaux de pur sang les plus illustres, soit au point de vue des courses, soit à celui de la reproduction, ne se comptent ni parmi les hauts, ni même parmi les étoffés. Cette vérité est encore incontestable pour les trotteurs, pour les chevaux de selle et de chasse. Quant aux chevaux d’armes, tout le monde sait que ce ne sont pas les chevaux de la grosse cavalerie que le maréchal Saint-Arnaud regrettait dans son magnifique rapport à l’empereur, après la bataille de l’Aima. Malgré la pesanteur du harnachement et des armures du temps, Guillaume le Conquérant montait un cheval arabe à la bataille d’Hastings. Les carrossiers de 1 mètre 70 c. sont bons à mener une berline au théâtre deux fois par semaine, et à ingurgiter chaque jour vingt litres d’avoine, qui ne les empêchent pas toujours de devenir poussifs ou corneurs; le temps est à la vitesse, les chemins de fer nous y ont habitués, et ils nous ont d’ailleurs débarrassés des gros transports; les routes deviennent meilleures, même les chemins vicinaux; les voitures légères se multiplient, et les hommes de six pieds, auxquels il fallait un limonier pour monture, deviennent rares. C’est peut-être un malheur, mais je n’y puis rien, ni vous non plus, qui me lisez.
Le temps où
Quatre bœufs attelés, d’un pas tranquille et lent,
Promenaient dans Paris le monarque indolent,
est passé, bien passé. Aujourd’hui l’Empereur attelle à son phaéton deux trotteurs à grandes allures, et les bœufs, n’allant même plus assez vite pour transporter leur propre personne aux abattoirs, sont conduits en wagon, comme les gens qui les mangent.
Tout le monde va vite à présent; les lambins manquent les trains directs du voyage de la vie, qui se fait à toute vapeur, et il faut dire avec les Anglais: «Time is money.»
Décidément, je ne vois pas qu’il soit plus avantageux d’être gros à un cheval qu’à un simple particulier.