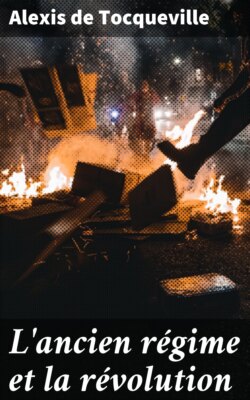Читать книгу L'ancien régime et la révolution - Alexis de Tocqueville - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE V.
ОглавлениеTable des matières
Comment la centralisation avait pu s'introduire ainsi au milieu des anciens pouvoirs et les supplanter sans les détruire.
Maintenant, récapitulons un peu ce que nous avons dit dans les trois chapitres qui précèdent: un corps unique, et placé au centre du royaume, qui règlemente l'administration publique dans tout le pays; le même ministre dirigeant presque toutes les affaires intérieures; dans chaque province, un seul agent qui en conduit tout le détail; point de corps administratifs secondaires ou des corps qui ne peuvent agir sans qu'on les autorise d'abord à se mouvoir; des tribunaux exceptionnels qui jugent les affaires où l'administration est intéressée et couvrent tous ses agents. Qu'est ceci, sinon la centralisation que nous connaissons? Ses formes sont moins marquées qu'aujourd'hui, ses démarches moins réglées, son existence plus troublée; mais c'est le même être. On n'a eu depuis à lui ajouter ni à lui ôter rien d'essentiel; il a suffi d'abattre tout ce qui s'élevait autour d'elle pour qu'elle apparût telle que nous la voyons.
La plupart des institutions que je viens de décrire ont été imitées depuis en cent endroits divers; mais elles étaient alors particulières à la France, et nous allons bientôt voir quelle grande influence elles ont eue sur la révolution française et sur ses suites.
Mais comment ces institutions de date nouvelle avaient-elles pu se fonder en France au milieu des débris de la société féodale?
Ce fut une œuvre de patience, d'adresse et de longueur de temps, plus que de force et de plein pouvoir. Au moment où la Révolution survint, on n'avait encore presque rien détruit du vieil édifice administratif de la France; on en avait, pour ainsi dire, bâti un autre en sous-œuvre.
Rien n'indique que, pour opérer ce difficile travail, le gouvernement de l'ancien régime ait suivi un plan profondément médité à l'avance; il s'était seulement abandonné à l'instinct qui porte tout gouvernement à vouloir mener seul toutes les affaires, instinct qui demeurait toujours le même à travers la diversité des agents. Il avait laissé aux anciens pouvoirs leurs noms antiques et leurs honneurs, mais il leur avait peu à peu soustrait leur autorité. Il ne les avait pas chassés, mais éconduits de leurs domaines. Profitant de l'inertie de celui-ci, de l'égoïsme de celui-là, pour prendre sa place; s'aidant de tous leurs vices, n'essayant jamais de les corriger, mais seulement de les supplanter, il avait fini par les remplacer presque tous, en effet, par un agent unique, l'intendant, dont on ne connaissait pas même le nom quand ils étaient nés.
Le pouvoir judiciaire seul l'avait gêné dans cette grande entreprise; mais là même il avait fini par saisir la substance du pouvoir, n'en laissant que l'ombre à ses adversaires. Il n'avait pas exclu les parlements de la sphère administrative; il s'y était étendu lui-même graduellement de façon à la remplir presque tout entière. Dans certains cas extraordinaires et passagers, dans les temps de disette, par exemple, où les passions du peuple offraient un point d'appui à l'ambition des magistrats, le gouvernement central laissait un moment les parlements administrer et leur permettait de faire un bruit qui souvent a retenti dans l'histoire; mais bientôt il reprenait en silence sa place, et remettait discrètement la main sur tous les hommes et sur toutes les affaires.
Si l'on veut bien faire attention à la lutte des parlements contre le pouvoir royal, on verra que c'est presque toujours sur le terrain de la politique, et non sur celui de l'administration, qu'on se rencontre. Les querelles naissent d'ordinaire à propos d'un nouvel impôt; c'est-à-dire que ce n'est pas la puissance administrative que les deux adversaires se disputent, mais le pouvoir législatif, dont ils avaient aussi peu de droits de s'emparer l'un que l'autre.
Il en est de plus en plus ainsi, en approchant de la Révolution. A mesure que les passions populaires commencent à s'enflammer, le parlement se mêle davantage à la politique, et comme, dans le même temps, le pouvoir central et ses agents deviennent plus expérimentés et plus habiles, ce même parlement s'occupe de moins en moins de l'administration proprement dite; chaque jour, moins administrateur et plus tribun.
Le temps, d'ailleurs, ouvre sans cesse au gouvernement central de nouveaux champs d'action où les tribunaux n'ont pas l'agilité de le suivre; car il s'agit d'affaires nouvelles sur lesquelles ils n'ont pas de précédents et qui sont étrangères à leur routine. La société, qui est en grand progrès, fait naître à chaque instant des besoins nouveaux, et chacun d'eux est pour lui une source nouvelle de pouvoir; car lui seul est en état de les satisfaire. Tandis que la sphère administrative des tribunaux reste fixe, la sienne est mobile et s'étend sans cesse avec la civilisation même.
La Révolution qui approche, et commence à agiter l'esprit de tous les Français, leur suggère mille idées nouvelles que lui seul peut réaliser; avant de le renverser, elle le développe. Lui-même se perfectionne comme tout le reste. Cela frappe singulièrement quand on étudie ses archives. Le contrôleur général et l'intendant de 1780 ne ressemblent plus à l'intendant et au contrôleur général de 1740; l'administration est transformée. Ses agents sont les mêmes, un autre esprit les meut. A mesure qu'elle est devenue plus détaillée, plus étendue, elle est aussi devenue plus régulière et plus savante. Elle s'est modérée en achevant de s'emparer de tout; elle opprime moins, elle conduit plus.
Les premiers efforts de la Révolution avaient détruit cette grande institution de la monarchie; elle fut restaurée en 1800. Ce ne furent pas, comme on l'a dit tant de fois, les principes de 1789 en matière d'administration publique qui ont triomphé à cette époque et depuis, mais bien au contraire ceux de l'ancien régime qui furent tous remis alors en vigueur et y demeurèrent.
Si l'on me demande comment cette portion de l'ancien régime a pu être ainsi transportée tout d'une pièce dans la société nouvelle et s'y incorporer, je répondrai que, si la centralisation n'a point péri dans la Révolution, c'est qu'elle était elle-même le commencement de cette révolution et son signe; et j'ajouterai que, quand un peuple a détruit dans son sein l'aristocratie, il court vers la centralisation comme de lui-même. Il faut alors bien moins d'efforts pour le précipiter sur cette pente que pour l'y retenir. Dans son sein tous les pouvoirs tendent naturellement vers l'unité, et ce n'est qu'avec beaucoup d'art qu'on peut parvenir à les tenir divisés.
La révolution démocratique, qui a détruit tant d'institutions de l'ancien régime, devait donc consolider celle-ci, et la centralisation trouvait si naturellement sa place dans la société que cette révolution avait formée qu'on a pu aisément la prendre pour une de ses œuvres.