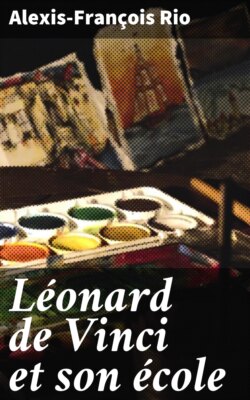Читать книгу Léonard de Vinci et son école - Alexis-François Rio - Страница 4
ÉCOLE LOMBARDE.
ОглавлениеPréliminaires historiques. — L’art milanais au moyen âge. — Patronage de la famille Visconti. — Influence de Giotto et de son école au XIVe siècle. — La cathédrale de Milan et la chartreuse de Pavie. — Mouvement de décadence au commencement du xve siècle, arrêté par une nouvelle dynastie. — François Sforza. — Artistes précurseurs de Léonard. — Averulino, Michelozzo et Bramante.
Le rôle de Milan n’a pas été moins brillant dans l’histoire de l’art chrétien que dans celle de la religion et de la liberté, et ces trois genres de gloire, qui y ont eu chacun leur point culminant à des époques assez éloignées l’une de l’autre, forment trois ères successives qui partagent presque également les annales de la Lombardie, et dont l’influence se trouve fortement marquée dans le caractère comme dans le génie national. A l’ère religieuse, la première dans l’ordre des temps et dans celui des choses, a présidé l’un des plus grands saints dont l’Église catholique ait vénéré la mémoire, saint Ambroise, le pasteur des peuples par excellence, leur modèle et leur guide dans les voies spirituelles, leur sentinelle vigilante et ferme tant contre l’hérésie que contre la tyrannie. Et comme si cette marque de la prédilection divine n’avait pas suffi, une autre lumière plus brillante encore venait, du moins pour un temps, s’ajouter à celle-là, et on vit réunis devant le même autel et dans les relations les plus touchantes deux des plus beaux génies et des plus belles âmes qui aient honoré l’histoire, non-seulement du christianisme, mais de l’humanité : saint Ambroise et saint Augustin.
Le rôle important joué par le premier, pendant son glorieux épiscopat, laissa des traces si profondes qu’on peut dire qu’elles ne s’effacèrent jamais. Aujourd’hui même elles sont encore visibles dans la saine partie de la population milanaise. Que devait-ce être au moyen âge, quand les traditions locales étaient encore dans toute leur vigueur, et quand les âmes étaient encore assez fortement trempées, non-seulement pour vénérer les vertus de saint Ambroise, mais pour comprendre son caractère tout entier?
La période la plus brillante pour la religion ne le fut pas pour l’art ni pour la liberté, de même que les beaux jours de la liberté milanaise furent précisément ceux de l’extrême décadence de l’art, qui, à son tour, ne sembla fleurir au xve siècle que pour consoler les Milanais de la perte de leurs libertés.
A travers toutes ces vicissitudes il y eut une lumière qui ne s’éteignit jamais, un nom qui ne fut jamais oublié, un grand souvenir qui resta toujours présent aux esprits, une basilique qui fut toujours préservée des ravages du temps et des Barbares, et dans laquelle sont heureusement conservés les monuments primitifs de l’art chrétien dans la Lombardie. Je veux parler de la basilique de Saint-Ambroise, avec ses vieilles mosaïques et ses vieilles sculptures, qui, bien qu’elles datent du déclin de l’Empire et de l’art, rachètent l’imperfection des formes par la grandeur imposante des caractères, et surpassent, pour le style, la plupart des ouvrages contemporains qui subsistent dans la haute et dans la basse Italie.
Entre la première invasion des Barbares, au Ve siècle, et la destruction de Milan par l’empereur Frédéric au XIIe, c’est-à-dire pendant la période la plus stérile en œuvres satisfaisantes pour le goût, on voit éclore, autour du tombeau de saint Ambroise, quelques produits plus heureux d’une inspiration toute spéciale. Ce sont d’abord les mosaïques grandioses de l’abside, et les majestueuses figures de saints qui décorent la chapelle de saint Satyrus, puis les bas-reliefs classiques de la chaire, après lesquels viennent, mais à un long intervalle, ce qu’on pourrait appeler les richesses mobilières de cette basilique, comme le bénitier d’ivoire donné par l’archevêque Godefroi, et le magnifique livre des Évangiles donné par cet archevêque Aribert, qui inventa le caroccio pour les batailles au commencement du XIe siècle; sans parler d’une quantité de diptyques depuis longtemps dispersés ou mutilés, et dont quelques précieux débris se conservent encore aujourd’hui dans le trésor de la cathédrale.
Il reste trop peu de fragments des peintures du XIIe et du XIIIe siècle pour qu’il soit possible d’en faire la matière d’une classification ou d’une appréciation vraiment satisfaisante. On peut juger de leur caractère général par celles de la vieille tour du Monastero Maggiore, l’ouvrage le plus complet et le mieux conservé de cette époque, et le plus propre à prouver qu’à Milan, comme dans le reste de l’Italie, la peinture avait besoin d’un régénérateur.
Mais quand ce régénérateur parut, au commencement du XIVe siècle, le génie des premiers Visconti avait déjà beaucoup fait pour faciliter l’œuvre de régénération. L’archevêque Othon Visconti, le premier qui eut la pensée de joindre l’image de saint Ambroise à la bannière des Milanais, avait conçu et réalisé d’autres idées dignes de celle-là, et son neveu et successeur Matthieu, qui put saluer d’assez près la lumière nouvelle qui commençait à poindre, marcha comme précurseur immédiat sur les traces de son oncle, et orna Milan de plusieurs beaux édifices, dont il ne reste plus que la Loggia degli Osi, qui suffit pour faire regretter tous les autres.
Mais leur gloire, soit comme administrateurs, soit comme stimulateurs de tous les nobles instincts qui avaient survécu à la liberté, fut bien éclipsée par celle d’Azzon Visconti, l’heureux vainqueur de Parabiago, par l’intervention miraculeuse de saint Ambroise, si l’on en croit une légende qui fut longtemps populaire et qui passa bientôt du domaine de la tradition dans celui de l’art; car la prédilection pour le héros s’étendit à la légende qui le concernait, et comme il s’agissait d’une victoire à la suite de laquelle le vainqueur avait fait grâce à son ennemi acharné, Leodrisio Visconti, on trouva tout naturel que le grand homme fût visiblement protégé par le grand saint.
Azzon Visconti, né à peu près avec le XIVe siècle, mourut très-jeune, en 1339, laissant, malgré sa courte carrière, un nom très-populaire et assez glorieux, et une quantité de monuments qui donnèrent à la ville de Milan une physionomie toute nouvelle. On peut s’en faire une idée par l’élegante tour de Saint-Gothard qui subsiste encore aujourd’hui; c’est le seul de ses ouvrages qui n’ait pas fait place à des constructions nouvelles. Il n’y a plus vestige des cent tours qui formaient l’imposante ceinture de la grande cité lombarde, ni du beau cloître qu’il fit bâtir pour les religieux chargés du service de son église de Saint-Gothard, ni enfin de ce magnifique palais longuement décrit dans la chronique contemporaine de Galvano Fiamma , et orné d’un grand nombre de peintures dont on ne saurait trop regretter la perte; car, soit qu’elles fussent de Giotto ou de ses disciples milanais, elles formaient, comme œuvre capitale et point de départ de la nouvelle école, un monument de la plus haute importance dans l’histoire de l’art en Lombardie .
Soit sympathie naturelle entre le génie toscan et le génie lombard, soit disposition heureuse de ce dernier à recevoir et à féconder dans son sein les germes venus du dehors, il est certain que les artistes florentins transplantés en Lombardie, non-seulement n’y dégénérèrent jamais, mais semblèrent plutôt y prendre un nouvel essor. On en trouve des preuves, longtemps avant Léonard de Vinci, dans le cours du XIVe et du XVe siècle; à quoi il faut ajouter l’impression profonde qu’y laissèrent le souvenir et les écrits du Dante, écrits qui ne furent peut-être nulle part mieux compris ni plus admirés, et dont l’archevêque Jean Viscônti voulut faciliter l’intelligence. Ce que Giotto y fit pour la peinture, un autre Toscan, Jean Balducci, de Pise, le fit pour la sculpture. Sorti d’une école qui avait merveilleusement régénéré cette branche de l’art d’un bout à l’autre de l’Italie , il exécuta, pour les Milanais, des monuments qui ne méritent pas la critique sévère qu’en a faite Cicognara. Le tombeau de saint Pierre-Martyr, à Saint-Eustorge, qui rappelle celui de saint Dominique, à Bologne, et dont la date (1339) coïncide avec la victoire si populaire de Parabiago, n’est pas seulement admirable sous le rapport symbolique; les formes mêmes sont traitées avec cette verve et cette franchise d’exécution qui caractérisent les beaux ouvrages du XIVe siècle. Les figures qui représentent la Charité, l’Espérance, et surtout la Foi; la Prudence avec ses trois têtes où les âges successifs sont si bien exprimés; la Force avec son air énergique et ses emblèmes de lion si heureusement incorporés à la statue; dans la partie supérieure, les belles figures de Docteurs qui sont aux angles, les miracles du saint sculptés sur les quatre côtés du tombeau, et, pour couronnement, la Vierge, si majestueuse entre deux saints qui ne le sont pas moins, tout cela forme un ensemble qui ne saurait manquer de produire son effet sur quiconque n’aura pas exclu de ses recherches la poésie et le symbolisme légitime de l’art.
En 1347, c’est-à-dire huit ans après avoir terminé ce grand ouvrage, le même artiste travaillait à la façade de l’église de Brera, ce qui était attesté par une inscription effacée depuis longtemps, mais qui a été conservée par Tiraboschi . C’est entre ces deux dates positives qu’il faut placer, en s’appuyant sur l’analogie de style, celle d’un monument précieux qui était dans l’église de Saint-Gothard, et qui, après avoir échappé par un pur hasard au marteau ou plutôt à la scie du plus grossier vandalisme, forme aujourd’hui le principal ornement du musée Trivulce. Il s’agit du tombeau d’Azzon Visconti lui-même, exécuté par un artiste qu’il avait sans doute apprécié de son vivant et auquel durent être confiés d’autres travaux restés inconnus. La figure couchée du prince est magnifique, tant pour le caractère que pour l’exécution; les villes qui lui avaient obéi sont représentées chacune par son patron spécial, et cette sorte de résumé historique ajoute encore à la majesté du monument.
Ainsi, vers le milieu du XIVe siècle, la régénération de l’art était complète dans la capitale de la Lombardie, grâce non-seulement aux artistes régénérateurs, mais surtout au héros qui avait su les attirer et les comprendre, et qui, en fondant la grandeur de sa dynastie, n’avait négligé aucun genre de gloire, bien qu’il fût mort presqu’à la fleur de l’âge. C’est à lui que remonte le grand essor imprimé au génie milanais sous l’administration de ses successeurs, et les germes déposés par lui furent assez vivaces pour croître et fleurir malgré le despotisme et le sang.
Vasari nous dit que les peintures de Giotto, éparses dans Milan, y étaient encore fort admirées de son temps; mais il supprime malheureusement les détails, et il n’est pas plus explicite en parlant de celles que le Florentin Stefano, l’un des meilleurs élèves de Giotto, y avait commencées une dizaine d’années après lui, mais que la maladie l’avait empêché d’achever . La génération de peintres qui vint immédiatement après eux ne paraît avoir marché que de très-loin sur leurs traces, si l’on en juge par les ouvrages de cet Andreino d’Edesia, le plus célèbre, ou plutôt le moins obscur d’entre eux, et dont il ne reste plus que quelques fresques à Pavie, depuis qu’on a effacé celles de la sacristie de Saint-Thomas, à Milan.
On en pourrait dire autant des sculpteurs qui succédèrent à Jean Balducci, si l’on se contentait d’étudier leurs ouvrages dans l’église de Saint-Eustorge, dont le patronage de la famille Visconti fit un véritable musée de sculpture. Celle qui représente l’Adoration des rois mages, et qui est ordinairement attribuée à un élève de Jean Balducci, ne mérite assurément pas l’éloge qu’en a fait Cicognara, qui va jusqu’à la préférer au chef-d’œuvre du maître, au tombeau de saint Pierre-Martyr, placé dans une chapelle voisine . C’est avec un peu moins d’injustice qu’il donne la même préférence aux sculptures d’une date postérieure qui décorent le grand-autel, et dans lesquelles on ne trouve plus au même degré cette force et cette pureté qui caractérisent l’époque précédente. Mais dans une autre église, dans celle de Saint-Marc, il y a un monument exécuté sous de plus heureuses inspirations: c’est celui du bienheureux André Settala; et si l’on veut chercher des objets de comparaison dans les villes environnantes, on trouvera dans celle de Pavie le magnifique tombeau de saint Augustin, orné de plus de deux cent quatre-vingt-dix figures de différentes grandeurs et d’un style d’exécution qui accuse les meilleures traditions toscanes .
Entre la mort d’Azzon Visconti et l’avénement du fameux Jean Galéas, qui forme une autre ère glorieuse dans l’histoire de l’art en Lombardie, il s’écoula un demi-siècle de vicissitudes qui furent parfois assez sanglantes pour constituer un véritable état de terreur, et pourtant on ne trouve pas que le développement du génie ou de la prospérité nationale ait été notablement interrompu. Il y avait dans cette dynastie des Visconti un si curieux assemblage de grandes qualités et de vices monstrueux! Ce débauché Luchino, qui partagea avec son frère, l’archevêque Jean, la succession immédiate de leur neveu Azzon, qui était, aussi bien que sa femme, Isabelle Fieschi, un objet de scandale et d’horreur pour toute l’Italie, qui immolait de nobles victimes à ses passions brutales, et n’échappait ensuite aux poignards des conjurés que pour périr de la main de sa propre femme à laquelle il destinait le même sort; ce même Luchino était souvent le protecteur du peuple contre les grands, des Guelfes contre les Gibelins, ses propres partisans; il abolissait les taxes arbitraires, faisait fleurir le commerce, nourrissait jusqu’à quarante mille pauvres à ses dépens durant la famine de 1340, et l’on peut dire que ce fut surtout à ses sages précautions que Milan dut d’avoir échappé au terrible fléau qui dépeupla tant de villes italiennes en 1348. Quant à son goût pour les arts, il le manifesta de deux manières: par la défense qu’il fit d’abattre, comme on l’avait fait à Bologne et ailleurs, les palais des citoyens bannis, et par la construction de deux résidences magnifiques; l’une, auprès de San-Girogio al Palazzo, ornée de peintures qui ont été détruites en même temps que l’édifice; l’autre, près San-Giovanni in Conca, laquelle surpassait encore la première en magnificence.
Son frère Jean, à la fois seigneur et archevêque de Milan, eut une administration ferme, paternelle et glorieuse, grâce à laquelle ses sujets devinrent plus riches, plus redoutés, plus industrieux qu’ils ne l’avaient jamais été. Alors furent fondées ces fabriques d’armes qui donnèrent ensuite tant de renom aux armuriers milanais, et qui, en 1427, pouvaient fournir de quoi armer complétement en peu de jours quatre mille cavaliers et deux mille fantassins. Qu’il ait favorisé aussi lui, de tout son pouvoir, la manifestation du beau sous toutes les formes, c’est ce qui est mis hors de doute par son admiration si authentique pour les deux plus beaux génies poétiques de ce siècle, admiration qui, en ce qui concerne Pétrarque, fut renforcée par une tendre prédilection et par une association intime aux sollicitudes de son gouvernement. Aussi le poëte, à qui les faveurs de ce genre tournèrent plus d’une fois la tête, appelait-il son patron le plus grand homme de toute l’Italie.
Quant à l’admiration de l’archevêque pour le Dante, il la témoigna par une mesure qui suffirait presque pour justifier la qualification que lui donnait Pétrarque. Il voulut que six commentateurs, choisis parmi les hommes les plus versés dans les diverses sciences qu’embrassait le poëme, fussent chargés d’en sonder les profondeurs, chacun dans une direction différente, afin d’en faciliter l’intelligence à ses admirateurs.
Si seulement il avait laissé ses trois neveux Matthieu, Galéas et Barnabé dans l’exil auquel les avait condamnés leur oncle Luchino! Ce rappel fut son tort irrémissible, et les Milanais eurent le droit de lui imputer toutes les horreurs dont ils furent témoins et victimes, par le monstrueux abus que firent du pouvoir Galéas et Barnabé, particulièrement ce dernier, qui pour exécuteurs de ses arrêts de mort avait cinq mille dogues dressés à dévorer ses victimes. On n’est pas tenté de s’enquérir du sort des beaux-arts sous un tel patronage; on est même fâché de trouver que son tombeau, conservé dans une salle du palais Brera, ait été épargné par les modernes vandales préférablement à tant d’autres monuments du même genre, beaucoup plus intéressants comme souvenirs historiques et même comme œuvres d’art; car ici tout se ressent de la pauvreté de l’inspiration. Le cheval est on ne peut plus lourd, la pose de la statue n’est rien moins qu’héroïque, et les bas-reliefs sont marqués, encore plus visiblement que le reste, du sceau de la décadence.
Il serait injuste de partager également entre les deux frères la responsabilité de cette époque sanglante et ténébreuse. Galéas fut rarement un tyran brutal, et sa qualité de fondateur de l’université de Pavie ainsi que celle d’ami de Pétrarque, forme un certain prestige qui, de loin, adoucit un peu la dureté de cette physionomie. Quant à sa compétence en matière d’art, elle est rendue très-problématique par la description que nous a conservée Muratori du palais qu’il fit construire sous sa direction personnelle et dans le goût le plus bizarre, à la place du vieux palais de Saint-Gothard, dont il ne laissa subsister que l’église et la belle tour qu’on voit encore aujourd’hui.
Quand il mourut en 1378, à son château de Belgioso, il laissait un fils déjà mûr pour les grandes choses dont l’exécution lui était réservée, et en faveur desquelles on lui pardonne sans peine le tour plein d’astuce qu’il joua à son oncle Barnabé pour le prévenir et s’en défaire . Ce fut son premier titre à la reconnaissance des Milanais qui, voyant en lui leur libérateur, le proclamèrent seigneur perpétuel de leur ville, comme s’ils avaient eu le pressentiment du grand rôle qu’il devait leur faire jouer dans l’histoire d’Italie. Peu s’en fallut que son génie, secondé par l’élan et l’intelligence de ses sujets, ne fit de Milan la glorieuse capitale du plus beau et du plus riche royaume qui fût alors en Europe, un royaume dans lequel se trouvaient enclavées les républiques de Pise, de Bologne, de Sienne, de Pérouse, et dans lequel, après sa grande victoire de Casalecchio, en 1402, il comptait encore enclaver Florence, où il méditait une entrée triomphale et son couronnement comme roi, quand sa mort presque subite fit écrouler tout à coup ce bel édifice.
Mais la grandeur ambitieuse des vues, dans le chef et dans le peuple, n’avait pas seulement produit des conquêtes éphémères. Au plus fort des prospérités de ce règne, quand chacun avait une conscience très-distincte de la part qui lui en revenait, l’essor imprimé aux imaginations s’était aussi fait sentir dans le domaine des arts, et de ce concours de circonstances heureuses sortirent des monuments trop magnifiques peut-être, à cause de leur disproportion avec les destinées ultérieures du pays, mais du moins qui restèrent toujours, par leur destination, en harmonie avec le caractère profondément religieux du peuple milanais. On voit que je veux surtout parler de cette fameuse cathédrale, qui est considérée, à juste titre, comme une des merveilles du monde chrétien, et qui désormais aura son histoire à part comme une république.
C’était une magnifique pensée et digne d’un conquérant plus pieux que lui, de bâtir, en guise de trophée, une église de dimensions correspondantes à ses projets de domination royale sur l’Italie. Chez un peuple dont saint Ambroise avait fait à l’avance l’éducation religieuse, un monument de ce genre devait être le plus populaire de tous: aussi fut-il toujours, alors et dans les siècles suivants, le grand intérêt du peuple autant que celui du prince, sans nuire toutefois à la basilique Ambroisienne qui conserva la popularité spéciale, que nous aurons occasion de caractériser plus tard. Pour le moment, nous remarquerons seulement que la peinture a fourni les décorations de l’église de Saint-Ambroise, tandis que la cathédrale a surtout emprunté les siennes au ciseau des sculpteurs. On peut même la considérer comme le centre d’une grande école de sculpture dont les ramifications et les vicissitudes sont intéressantes à suivre dans l’histoire de cette branche de l’art.
Quel fut l’artiste qui conçut et dressa le plan de ce monument gigantesque? Le style général semble accuser des inspirations ultramontaines, dans le genre de celles qui ont présidé à la construction des cathédrales à la fois si grandioses et si régulières de la France et de l’Allemagne. Mais les anomalies qu’on y remarque portent sur des parties tellement fondamentales et sur des conditions esthétiques si essentielles dans l’architecture gothique, telle qu’elle était comprise et pratiquée dans le Nord, qu’il est impossible d’y reconnaître le produit libre et spontané du génie français ou allemand. Évidemment, c’est ce génie qui a prédominé, mais en subissant les contradictions du génie national et les déviations imposées par lui, comme il arriva pour la construction du dôme de Florence et de plusieurs autres. C’est donc à tort que le plan primitif de la cathédrale de Milan a été exclusivement attribué par les uns, à Nicolas Bonaventure, de Paris; par les autres, et surtout par les Milanais, à leur compatriote Marco de Campione ; cependant, s’il fallait absolument se prononcer en faveur d’un des noms proposés, ce serait plutôt à ce dernier qu’il faudrait donner la préférence .
Dix ans après avoir commencé la construction de la cathédrale, Jean Galéas ordonna celle de la magnifique chartreuse de Pavie, dont vingt-cinq moines, appelés d’au-delà des Alpes, prirent possession dans la dernière année du XIVe siècle. Le temps n’était pas encore venu pour la sculpture et pour la peinture d’y déployer leurs merveilles. Il est même à remarquer que le prince favorisa beaucoup moins ces deux arts que l’architecture, qui était plus en rapport avec ses conceptions gigantesques en tous les genres. Cependant il ne faut pas passer sous silence le missel de l’église de Saint-Ambroise, qui fut donné par Jean Galéas en mémoire de son couronnement comme duc de Milan, et dont les miniatures ne sont pas moins intéressantes par la beauté du style et le mérite de l’exécution que par les sujets qu’elles représentent. C’est un ouvrage digne à la fois de la grande époque où il fut exécuté et de la basilique Ambroisienne dont il forme un des plus précieux trésors .
Quant aux ouvrages de sculpture, s’ils furent plus rares sous ce règne que sous ceux qui le précédèrent et le suivirent, ce fut moins par disette d’artistes ou d’inspirations que par l’effet des préoccupations presque exclusives du prince en matière d’art. Il paraît même que l’espèce d’académie qu’il avait fondée pour l’aider à tracer une marche régulière aux travaux entrepris sous ses auspices, ne comprenait dans ses attributions que l’architecture et la peinture . Au reste, pour prouver que cette exclusion ne fut ni symptôme ni cause de décadence, il suffit de citer, outre le magnifique candélabre de la cathédrale de Milan , le travail exquis qu’on y remarque au-dessus de la porte de la sacristie méridionale. La Vierge qui surmonte la pointe de l’ogive, et qui étend son manteau sur deux groupes agenouillés, fait regretter que l’artiste qui sculpta ce groupe n’ait pas travaillé davantage à la décoration intérieure de ce monument, et on le regrette d’autant plus que les sculpteurs qui vinrent après lui laissèrent dans leurs ouvrages l’empreinte plus ou moins marquée de la décadence où tombèrent les arts, les mœurs et les caractères sous les successeurs immédiats du grand Visconti. Cette lourde statue du pape Martin V, que fit ériger Philippe-Marie Visconti, en mémoire de la consécration du dôme par le souverain pontife en personne, est le chef-d’œuvre de Giacobino da Tradate, sculpteur tellement en vogue vers 1410, qu’on lui permettait à grand’peine d’interrompre ses travaux de la cathédrale, pour se mettre pendant quinze jours au service des dominicains de Saint-Eustorge. Que pouvait produire de grand dans le domaine de l’art, ou dans tout autre domaine de l’intelligence, le patronage d’un tyran comme ce Jean-Marie Visconti, qui dressait des chiens à dévorer ses sujets ou qui lançait sur eux des satellites armés, quand épuisés par la guerre ils le suppliaient de faire la paix; qui défendait sous peine de mort de prononcer ce mot, pour lui si odieux, sans excepter de cette brutale défense le prêtre célébrant le saint sacrifice? Sous une pareille domination, il n’y avait pas de milieu entre l’abrutissement par la terreur et l’exaspération par le désespoir, et ce n’était pas chez un peuple comme les Milanais qu’un pareil sentiment pouvait rester stérile. Une troupe de conjurés, qui avaient presque tous à venger la mort d’un frère, le massacra dans l’église de Saint-Gothard en 1412. Mais cette délivrance inespérée ne put pas faire sortir l’art de l’espèce de léthargie où il était tombé. Le peu d’ouvrages qui furent exécutés sous son successeur, et dont les plus remarquables sont dans l’église de Saint-Eustorge , y figurent assez tristement à côté du magnifique tombeau de saint Pierre, martyr, fait un demi-siècle auparavant. Mais c’était surtout dans la famille même des Visconti que la décadence était visible et rapide. Le dernier prince de cette dynastie n’attacha son nom à aucune espèce de monument, à moins qu’on ne veuille lui tenir compte du commentaire qu’il fit composer à François Philelfe sur Pétrarque, son poëte favori. Cette prédilection, et l’admiration qu’il professait pour le Dante, dont il se faisait lire et expliquer le poëme par Marziano, de Tortone, ne semblent guère compatibles avec les vices de son cœur et de son caractère, qui, joints à ses difformités physiques, offraient à ses sujets un assemblage assez repoussant pour qu’ils vissent sans regret l’extinction de cette dynastie épuisée.
Heureusement pour Milan, et plus heureusement pour l’art, le moment d’une régénération approchait et elle devait commencer sous les auspices d’un héros que son âme et son goût rendaient digne d’une pareille mission. Ce héros était François Sforza, en qui de fréquentes expéditions et des séjours prolongés dans les villes de la Toscane et surtout de l’Ombrie avaient fait naître le désir d’imiter les Montefeltro d’Urbin, les Baglionide Pérouse, et les Médicis de Florence, dans l’essor et l’encouragement qu’ils avaient su donner aux beaux-arts; et l’on peut dire qu’il les surpassa presque tous par la pureté de ses tendances et par le nombre de ses fondations à la fois magnifiques et pieuses. Le grand hôpital de Milan, dont Vasari parle avec tant d’admiration et qui fut fondé en 1456, honore la mémoire du fondateur encore plus que celle de l’architecte Averulino, que François Sforza fit venir tout exprès de Rome où il l’avait vu travailler aux portes de bronze de la basilique de Saint-Pierre . Pendant que cet artiste florentin présidait à la construction de ce monument et à celle de la grande église de Bergame, des artistes nationaux, sollicités par le réveil de la patrie et par l’émulation, reprenaient les travaux du dôme tristement suspendus pendant la terreur, et bâtissaient des églises votives promises par le duc ou par sa femme Bianca pendant la guerre. La plus intéressante est sans contredit celle de l’Incoronata, formée de la réunion de deux petites églises que chacun des deux époux avait fait construire à côté l’une de l’autre. On les voit tous deux à genoux sur un vieux tableau délabré, dont tout le mérite consiste dans le touchant souvenir historique qu’il rappelle. Un autre membre de la famille, le saint archevêque Gabriel Sforza, propre frère du duc, a son tombeau dans une des chapelles, et cette figure magnifique, couchée en habits pontificaux avec les mains croisées sur la poitrine, est là, pour prouver que la sculpture déchue, depuis près d’un demi-siècle, avait participé à la régénération générale.
L’architecte de l’Incoronata, qui fut aussi celui du Dôme et de plusieurs autres églises , s’appelait Boniforte Solari. Son talent et son activité sont attestés par le nombre et la beauté de ses travaux. Disciple d’un père moins illustre que lui dans son art, il eut deux fils dont nous aurons occasion de parler plus tard et dont la célébrité éclipsa tout à fait la sienne .
Malgré cette vogue incontestable, il ne paraît pas qu’il fut l’architecte favori du duc Sforza, ou du moins il ne le fut pas au même degré que ce Barthélemi Gazzo, de Crémone, qui fut chargé en 1450 de bâtir le château de la porte Giovienne à Milan, et qui, en 1463, donnait le dessin de la belle église de Saint-Sigismond hors de Crémone. C’est que Crémone était sa ville chérie, comme Saint-Sigismond était son église favorite . C’était là, devant les moines hiéronymites, qu’il avait épousé, en 1441, sa chère Bianca, à laquelle il avait donné pour cortège deux mille cavaliers d’élite qui, relevant la pompe nuptiale par un mélange bien assorti de pompe militaire, semblaient présager à la nouvelle épouse un genre de gloire auquel les femmes ordinaires n’aspirent pas. Sept ans après cette inauguration conjugale et militaire, on vit Bianca, surprise dans Crémone en l’absence de son mari, se précipiter sur les Vénitiens, et d’un coup de lance couper la parole à un soldat qui osait crier devant elle vive saint Marc! Et quand cette femme forte avait dans les mains ce livre d’heures qu’on voit encore à la bibliothèque Ambroisienne, les élans de piété lui venaient aussi naturellement que les élans d’audace, et elle était aussi recueillie devant les autels qu’intrépide en face du danger. C’était sur ce mélange de qualités héroïques et religieuses qu’était fondée la rare sympathie qui existait entre elle et son époux, et ce double caractère se retrouve jusque dans l’influence qu’ils exercèrent conjointement sur les arts, mais particulièrement sur la peinture à laquelle ils demandèrent successivement, suivant la convenance des lieux, des compositions héroïques et des compositions religieuses. Les premières furent exécutées dans le vieux palais de Milan, dans ce qu’on appelait la salle des Barons armés, où les portraits des fameux capitaines, modèles ou rivaux de François Sforza, avaient été tracés par les meilleurs peintres du temps. Les secondes furent principalement exécutées à Crémone, non-seulement à cause de la prédilection du duc pour cette ville, mais aussi parce que les artistes crémonais étaient les plus dignes. Là florissait alors Bonifaccio Bembo, qui paraît avoir été le peintre favori de la duchesse Bianca; ce fut lui qui, en 1468 (c’est-à-dire deux ans après la mort du duc), fut chargé par elle de perpétuer dans une chapelle de l’église des Augustins le souvenir d’une union où elle avait trouvé tant de bonheur et tant de gloire. Le tableau qu’il fit à cette occasion ne décore plus l’autel , mais les portraits des deux époux agenouillés, en face l’un de l’autre, sont encore assez bien conservés pour remplir en partie l’objet que s’était proposé la pieuse fondatrice. Au reste, cet ouvrage de Bembo avait été précédé par plusieurs autres tant dans les églises de Crémone que dans la salle des Barons armés, où il avait eu pour collaborateurs ce Vincenzo Foppa, loué outre mesure par Vasari et par Lomazzo, qui le désigne comme le fondateur de l’école milanaise , et Bertino de Lodi, dont le même Lomazzo fait une trop courte mention, vu l’importance et la pureté des produits qui sortirent plus tard de cette école trop peu connue.
L’art était donc à la mort du grand Sforza en voie de régénération dans ses États et même sur plusieurs points à la fois. La comparaison de son règne avec celui de son prédécesseur ne laisse aucun doute à cet égard, surtout en ce qui concerne la peinture. Le peu d’artistes qui s’y étaient voués sous le dernier Visconti, ou avaient été entraînés dans la décadence générale, ou avaient cherché au dehors l’aliment et l’exercice qui manquaient à leurs talents. Ce fut un de ces peintres émigrés, Leonardo de Bissuccio, qui, en 1433, peignit à Naples, derrière le chœur de l’église de San-Giovanni, à Carbonaro, ce couronnement de la Vierge qui rappelle encore un peu le style de Giotto, mais se rapproche davantage de celui de Fra Angelico de Fiesole pour le charme de l’expression, surtout dans les têtes d’anges. C’est peut-être le plus beau produit de l’école milanaise dans la première moitié du XVe siècle, si toutefois on peut attribuer à cette école un ouvrage où l’influence des artistes ombriens de cette époque se montre si manifeste.
Désormais ce ne seront plus les peintres milanais qui émigreront, ce seront les peintres du dehors qui viendront décorer les églises et les palais de Milan. Les fresques de Masolino da Panicale, qui ont été récemment découvertes dans le bourg de Castiglione, ne furent peut-être pas étrangères au mouvement qui s’opéra dans le domaine de l’art sous les auspices du premier Sforza, dont cet artiste fut le contemporain. D’un autre côté, l’école de Padoue, dont nous avons signalé ailleurs les tendances peu élevées sous Squarcione et même sous Mantegna, étendant peu à peu son influence et ses ramifications dans la Lombardie , il était difficile que le naturalisme n’y prévalût pas. Aussi trouvons-nous Vincenzo Foppa et ses disciples profondément engagés dans cette voie jusqu’à l’ère nouvelle que forme l’arrivée de Léonard de Vinci dans ce pays. L’énumération des ouvrages qui dans cet intervalle furent produits par Civerchio, auteur de fresques assez grossières qu’on voit encore dans l’église de Saint-Pierre, à Milan, par Foppa et par ses élèves Buttinone et Zenale de Treviglio, serait aussi stérile que fastidieuse. La carrière artistique de Buttinone embrasse un intervalle de trente années, de 1451 à 1481, c’est-à-dire toute la période qui s’écoula entre l’avènement du duc Sforza et l’arri vée de Léonard de Vinci. Les peintures dont Buttinone et Zenale décorèrent la chapelle de Saint-Ambroise dans l’église de San Pietro in Gessate, ne sont pas mieux conservées que celles qui furent peintes par Civerchio, en 1464, dans la chapelle de Saint-Antoine. Il y avait encore de ce même Civerchio des fresques jadis fameuses dans l’église de Saint-Eustorge. Elles ont toutes péri, ainsi que celles de Zenale, dans le couvent de Sainte-Marie-des-Grâces, dans celui des Franciscains et dans plusieurs autres. Ce fut comme une fatalité qui poursuivit les produits de cette école naturaliste, rameau fécond et assez vigoureux de celle de Padoue. Heureusement l’ouvrage qu’on peut regarder comme le chef-d’œuvre de cette première école milanaise, a été très-spécialement épargné par le temps et par les hommes. On peut le voir dans la principale église de Treviglio, où après avoir longtemps décoré le maître-autel, il a été relégué derrière le chœur dans un lieu presque inaccessible, même aux regards.
Il ne reste donc à Milan que d’assez faibles souvenirs des quatre principaux peintres de la période antérieure à celle qui commence avec Léonard. Après avoir fait le tour des églises et des musées, on ne se sent pas épris de la moindre admiration pour le vieux Foppa, ni pour Civerchio, ni pour Buttinone, ni pour Zenale, bien que Léonard ait exercé sur ce dernier une certaine influence. Mais si de l’étude des œuvres d’art on passe à celle de la théorie, on trouve que dans cette carrière alors toute nouvelle ils ont laissé des traces ineffaçables. Les écrits de Foppa sur la perspective linéaire et sur les proportions du corps humain restèrent dans l’école milanaise comme une espèce de tradition qui s’enrichit ensuite par les travaux de Zenale sur le même sujet. Comme tous deux embrassaient dans la pratique l’architecture et la peinture, les vues théoriques y gagnaient à la fois de l’étendue et de la fermeté. D’ailleurs, la tournure de l’esprit lombard semblait exiger ce complément de tous les artistes qui aspiraient à une popularité durable. Quand Léonard vint compléter ou réformer, par les ressources combinées de la science et du génie, l’œuvre de ses devanciers immédiats, le terrain se trouvait admirablement préparé, non-seulement par le travail des peintres indigènes, mais par les traces profondes qu’avaient laissées en Lombardie des artistes venus de Florence et de l’Ombrie. C’étaient d’abord cet Averulino, fondateur du grand hospice sous François Sforza, et auteur d’un savant ouvrage théorique où l’imagination domine souvent au préjudice de la science; Michelozzo, le digne élève de Donatello et l’architecte d’un magnifique palais à Milan, bâti pour Côme de Médicis, son patron, qu’il avait suivi dans son exil; enfin Bramante, qui les surpassa tous, non moins par la profondeur et l’étendue de ses connaissances, que par la grâce et l’élévation naturelle de son génie, et qui, par la construction de plusieurs coupoles gracieuses qu’on admire encore aujourd’hui, s’essayait graduellement à la grande œuvre qui a immortalisé son nom en l’associant à celui de Michel-Ange pour la construction ou du moins pour la conception de la basilique de Saint-Pierre.
Élève du moine dominicain Fra Carnovale pour la peinture, préparé par de fortes études mathématiques à l’intelligence de l’architecture dans laquelle il conserva toujours son originalité malgré l’influence que dut exercer sur lui son maître et son ami Cesariani, commentateur enthousiaste de Vitruve, Bramante ne donna à l’antiquité classique qu’une part très-restreinte dans son éducation, et au lieu d’aller en étudier les monuments à Rome comme avait fait Brunelleschi, il prenait la route opposée pour chercher des inspirations d’un autre genre, ou pour mettre son génie plus à l’aise. Nous savons qu’il alla visiter le dôme de Milan en 1476, et qu’on lui demanda ses conseils et même sa coopération pour l’achèvement de ce merveilleux édifice, objet de noble sollicitude pour la dynastie des Sforza, comme elle l’avait été pour celle des Visconti. La reconstruction de l’église de Saint-Celse, où se conservait une Madone miraculeuse glorifiée par la dévotion populaire, lui donna une grande vogue non-seulement à Milan, mais encore dans les villes voisines qui rivalisaient avec la capitale. Le cardinal Ascagne Sforza, le digne émule de son frère Louis le Maure pour tout ce qui tenait à la culture et à l’encouragement des beaux-arts, voulut que Bramante reconstruisît sur un nouveau plan sa cathédrale de Pavie , et la ville de Bergame, déjà si justement fière de la beauté de ses monuments, mit en œuvre le pinceau de Bramante pour décorer ses églises et ses palais . Malheureusement il ne reste plus le moindre vestige de ses travaux; on en peut dire à peu près autant des peintures à fresque exécutées par lui à Milan. L’église de Saint-Celse a partagé le sort de tant d’autres que le vandalisme a supprimées ou détruites; mais le petit chef-d’œuvre à forme octogone qui sert de sacristie à l’église de Saint-Satyrus, excite encore aujourd’hui l’admiration des voyageurs, et fait pressentir, malgré l’exiguïté de ses dimensions, les grandes destinées de l’architecte.
Son élève Bartolomeo Suardi, plus connu sous le nom de Bramantino, étudia non moins sérieusement que son maître les sciences qui se rattachaient à la peinture et à l’architecture, et laissa plusieurs ouvrages sur la plupart desquels le temps n’a pas exercé moins de ravages que sur ceux de Bramante lui-même. Cependant la ville de Milan conserve encore de lui, outre la fresque de Brera, deux peintures très-remarquables, dont l’une, située au-dessus de la porte de l’église du Saint-Sépulcre, a été si bien protégée contre les injures de l’air qu’elle est devenue complétement inaccessible aux regards des voyageurs. Il faut donc pour juger ses compositions se contenter de quelques fragments épars et du tableau qu’on voit au palais Borromeo, représentant le Christ en croix, avec deux portraits vigoureusement touchés, et qui signalent une grande puissance dans cette branche de l’art. Quant au sujet principal, il est traité avec cette bizarrerie d’invention qui forme un des traits caractéristiques du talent de Bramantino. Car à force de viser à l’originalité, il s’égarait quelquefois jusqu’au mauvais goût, tout en donnant à ce genre d’égarements l’apparence d’intentions symboliques. Et cependant il avait, à l’exemple de son maître, étudié et même copié les belles productions de l’art grec, et il avait écrit sur les antiquités grecques et romaines un ouvrage universellement admiré par ses contemporains.