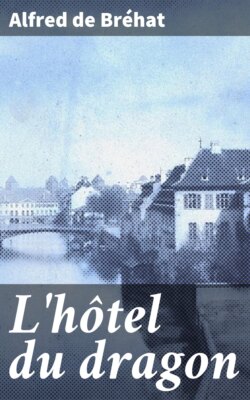Читать книгу L'hôtel du dragon - Alfred de Bréhat - Страница 5
I
ОглавлениеLe mois de mai touchait à sa fin. De nombreux voyageurs commençaient à sillonner l’Allemagne pour se rendre aux divers établissements d’eaux minérales des bords du Rhin. Les hôtels avaient fait leur toilette d’été et leurs kellners (garçons) en habit noir se tenaient prêts à recevoir les touristes. Vers quatre ou cinq heures de l’après-midi, un jeune homme se présenta à l’hôtel des Quatre-Saisons. Une malle, un carton à chapeau, un nécessaire, une boîte à couleurs, un chevalet portatif, un pliant et un de ces vastes parapluies à l’usage des peintres, tel était le bagage du nouveau débarqué. Les arts et la fortune marchant rarement de compagnie, les hôteliers n’ont qu’une fort médiocre estime des Raphaëls et des Titiens en herbe. Le moindre épicier au ventre et au gousset rebondis leur paraît bien plus respectable. Imbu de ces bons principes, le garçon qui servait de guide au jeune Anglais montait devant lui, d’un air dégagé fort différent de l’empressement obséquieux qu’il savait si bien témoigner d’habitude. Il paraissait disposé à grimper ainsi jusqu’au toit de la maison, mais le voyageur s’arrêta résolûment au second étage.
— Je ne monte pas davantage, dit-il au domestique.
— C’est que nous n’avons ici que de grandes chambres.
— Eh bien! donnez-m’en une.
Le garçon lui jeta sournoisement ce regard investigateur qui jauge un homme à deux cents francs près.
— Je vais chercher l’oberkellner, dit-il.
L’oberkellner ou premier garçon est, en Allemagne, une sorte de fondé de pouvoirs du maître d’hôtel. C’est lui qui dirige le service, commande aux autres domestiques et répond aux voyageurs. Le maître d’hôtel ne se montre que dans les grandes occasions. Quant à l’oberkellner, c’est le plus souvent le fils de quelque maître d’hôtel des environs, qui étudie ainsi son métier avant de prendre la direction de la maison paternelle. Tous parlent couramment pulsieurs langues, et la plupart ont reçu une excellente éducation.
Il ne fallut qu’un seul coup d’œil à l’oberkellner des Quatre-Saisons pour juger le voyageur. Des vêtements d’été simples, mais d’une coupe élégante, du linge fin, des gants frais, l’air distingué, la voix douce et ferme d’un homme habitué à être obéi promptement, c’était là plus qu’il n’en fallait pour donner à l’oberkellner une bonne opinion du nouvel arrivé. Il l’installa dans une jolie chambre du second étage, et descendit avec l’autre garçon, en faisant à ce dernier un cours de physiologie que Lavater n’eût pas désavoué.
Il y avait quelque chose de si aristocratique dans la figure et dans la tournure du jeune voyageur, que l’oberkellner fut presque surpris de n’avoir à inscrire sur son registre que le nom plébéien de William Mewill, esquire. Le passe-port, visé par l’Autriche, la Prusse et divers petits États allemands, portait le signalement suivant:
Age, vingt-quatre ans; taille, cinq pieds neuf pouces; nez droit; front élevé ; yeux bleus; cheveux blonds; menton rond; visage ovale; teint clair.
Le signalement aurait pu ajouter que Mewill avait une figure douce, rêveuse et très-sympathique, mais les passe-ports n’en disent pas si long.
L’hôtel des Quatre-Saisons n’avait jamais possédé un hôte plus tranquille que celui-là. Il se faisait servir dans sa chambre, ne mettait jamais le pied au kursaal (casino) et ne parlait à personne. Il allait deux fois par jour à la poste pour porter les nombreuses lettres qu’il écrivait, ou pour retirer les lettres bureau restant qu’il recevait assez fréquemment. La plupart avaient des enveloppes et des cachets qui révélaient une origine bureaucratique et provenaient de divers consuls anglais de l’Allemagne. Une partie de la: journée de William se passait à répondre à ces lettres, ou bien à compulser des papiers contenus dans un petit coffret garni de bandes d’acier.
M. Mewill attendait sans doute quelqu’un à Wiesbaden, car il ne manquait jamais d’assister à l’arrivée de chaque train. Coiffé d’un chapeau de paille à larges bords, et vêtu d’un paletot-sac qui le rendait méconnaissable, il se plaçait derrière quelque voiture et regardait attentivement chaque personne qui descendait des wagons.
Le soir, il prenait un livre et s’en allait tout seul faire de grandes promenades dans la campagne. De temps en temps il partait par le chemin de fer et faisait des absences de deux ou trois jours.
Un soir que, revenant de Mannheim, il arrivait à Mayence, il se fit conduire de la station du chemin de fer à la maison du consul anglais. Ses bureaux étaient déjà fermés. Il prit le part de coucher à Mayence. Après le dîner il alla se promener sur les bords du Rhin.
La lune qui se levait en ce moment éclairait de sa lueur argentée la campagne verdoyante et les flots rapides du grand fleuve allemand.
Absorbé dans la contemplation de ce magnifique spectacle, William marchait lentement sur la route poudreuse.
—Aufgeschaut! (gare!) lui cria la voix enrouée d’un cocher de droski (voiture de place).
Tout en se rangeant sur le côté de la route, William jeta un regard distrait vers les personnes qui se trouvaient dans la voiture. Tout à coup il tressaillit et porta la main à son front comme quelqu’un qui se réveille en sursaut; puis, prenant sa course, il se précipita sur les traces du droski, qui s’éloignait au grand trot.
La voiture ayant déjà beaucoup d’avance, William avait fort à faire, non-seulement pour la rejoindre, mais pour ne pas la perdre de vue. La sueur ruisselait à flots sur son visage, et ses tempes commençaient à battre avec violence. Lorsqu’il se sentait sur le point de tomber il s’arrêtait durant quelques secondes; puis, dès que la respiration commençait à lui revenir, il reprenait sa course.
A la fin cependant, le droski s’arrêta devant le jardin d’une de ces brasseries qu’on trouve aux environs de presque toutes les villes allemandes, et qui ressemblent un peu aux guinguettes de la banlieue parisienne. Leurs bosquets, leurs tonnelles et leurs berceaux de verdure abritent chaque dimanche une foule nombreuse de buveurs et d’amoureux.
Un jeune homme sauta lestement de la calèche. Il offrit sa main à une vieille dame que suivit une jeune femme fort jolie.
— Ainsi, Henriette, tu ne veux pas venir avec moi chez le capitaine Zufriedlen? dit un vieillard qui était resté dans la voiture.
— Non, bien certainement, mon père, répondit la jeune femme; Mme de Vesperren et moi nous vous attendrons ici.
— En buvant de la bière? demanda le vieillard en riant.
— Certainement, monsieur, repartit le jeune homme, ma mère a déjà commandé pour elle seule trois moos et trois butterbrod (petits pains fendus par la moitié et beurrés).
— Une vraie partie de cabaret enfin, dit la jeune femme en riant.
— Très-bien! Alors dans une demi-heure je viendrai vous prendre, répliqua M. de Splittern en leur faisant un geste d’adieu.
Le droski s’éloigna, tandis que Mme de Vesperren, son fils et Mlle de Splittern s’enfonçaient gaiement dans les bosquets de la brasserie.
Ils s’attablèrent sous une tonnelle qui donnait sur la route, et se firent servir des rafraîchissements.
Henriette de Splittern et Philip de Vesperren étaient fiancés. L’anneau de fiançailles, en Allemagne, est un pavillon à l’ombre duquel l’amour navigue hardiment et souvent pendant bien des années avant d’atteindre le port de l’hymen. On assure que les naufrages sont fort rares. Il est vrai qu’en cas de malheur les navires désemparés en sont quittes pour arborer un nouveau pavillon.
La conversation d’Henriette révélait une femme vive et spirituelle. Quant à son fiancé, c’était un très-bel homme, fort bien habillé. Avec la meilleure volonté du monde, on n’aurait pu trouver autre chose à dire sur son compte. Il avait l’air très-content d’être au monde et devait jouir d’un fort bon caractère, malgré la suffisance qui perçait dans ses moindres paroles.
Au bout de quelques minutes, Mme de Vesperren s’éloigna un peu des deux fiancés, sous prétexte de regarder ce qui se passait sur la route.
Tandis qu’Henriette et Philip exécutaient à demi-voix leurs variations sur ce thème inépuisable qu’on appelle l’amour, William Mewill s’était silencieusement installé dans un bosquet voisin de celui qu’ils occupaient.
Dès que la servante de la brasserie lui eut apporté la bière qu’il avait demandée et se fut retirée, il se glissa à travers les arbres jusqu’à la charmille qui abritait les amoureux. Quoiqu’il s parlassent à voix basse, il en entendait assez pour apprendre qu’ils étaient fiancés depuis un mois, et qu’ils se rendaient à Ems. Ils devaient y rester jusqu’aux premiers jours de juillet et revenir ensuite à Münschen pour s’y marier.
M. de Vesperren aurait voulu visiter, en passant, Wiesbaden, dont on n’était qu’à une demi-lieue par chemin de fer. Mais Henriette s’y opposa avec une vivacité singulière. Comme il insistait, elle lui répondit d’un ton si impatient, si contrarié, qu’il en resta tout surpris. Elle tourna la chose en plaisanterie et le tout se termina par un raccommodement à l’allemande, c’est-à-dire par un baiser rapidement échangé après un regard furtif jeté du côté de Mme de Vesperren.
Au bout de quelques minutes, la servante apporta des gâteaux et de la limonade gazeuse. Tandis que cette fille essuyait la table, Henriette remarqua qu’elle portait à la ceinture une très-jolie montre d’or d’une forme bizarre, mais assez gracieuse. Mlle de Spittern fit un geste de surprise.
— Vous avez là une bien jolie montre, dit-elle en se penchant pour examiner de plus près l’objet en question.
— On vient de me la donner à l’instant, répondit la servante.
— Un jeune homme?
— Oui, mademoiselle, un bien joli jeune homme, je vous assure, qui a l’air si doux et si triste! Quand je suis arrivée il allait la broyer sous un cruchon d’eau de seltz qu’il avait déjà levé au-dessus. Je lui ai crié bien vite:
— Ah! monsieur, donnez-la-moi plutôt que de la casser. Il s’est retourné et m’a regardée quelque temps avant de répondre, puis il me l’a donnée.
— Sans rien dire? demanda Mlle de Splittern, qui cherchait à prendre un air moqueur pour dissimuler son émotion.
— Sans rien dire, repartit la servante.
— Quelque fou! dit Vesperren en haussant les épaules.
Lorsque la servante se fut retirée, Philip essaya de renouer la conversation avec Henriette, mais il trouva celle-ci distraite et préoccupée.
— Il fait froid ici, dit-elle un instant après avec une sorte de frisson. Allons rejoindre madame votre mère et marchons un peu.
Au moment où ils arrivaient à côté de Mme de Vesperren, le droski du baron de Splittern s’arrêtait à la porte du jardin. Mme de Vesperren, son fils et Henriette remontèrent dans la voiture, qui se dirigea vers Mayence aussi vite que peut marcher un cheval allemand conduit par un cocher allemand.
Une demi-heure après, Lisette vint voir si le généreux consommateur qui lui avait donné la montre n’avait pas besoin de quelque chose. A sa grande frayeur, elle le trouva étendu par terre et complètement évanoui.
Aux cris de Lisette, toutes les autres servantes accoururent. On transporta Mewill dans l’intérieur du café. Lorsqu’il rouvrit enfin les yeux, il jeta autour de lui un regard vague et brûlant et murmura quelques mots sans suite.
— Il a le délire, dit quelqu’un.
— Et une fièvre épouvantable, ajouta la maîtresse de la brasserie, qui tenait la main du jeune homme. On chercha dans la poche de sa redingote pour voir si l’on n’y trouverait pas quelque papier qui indiquât son nom et son adresse. Une facture de gants, livrés le jour même à M. Mewill à l’Hôtel du Dragon, ayant fourni le renseignement demandé, on transporta M. Mewill dans une voiture qu’on avait envoyé chercher à Mayence.
Quelques minutes après, il arrivait à l’Hôtel du Dragon. M. Reinhold Seiffert, le maître de l’hôtel, était absent; mais l’oberkellner, un brave garçon à figure ouverte et bienveillante, fit placer un matelas sur une sorte de civière, et ce fut sur ce brancard improvisé qu’on transporta Mewill de la voiture dans sa chambre.
Pendant ce temps, un autre garçon courait chercher le médecin.
William resta plusieurs jours dans un état qui donna quelques inquiétudes. Il revint enfin à la santé, mais la secousse qu’il avait éprouvée avait été tellement violente qu’il lui fallut longtemps avant de recouvrer ses forces. Son état de faiblesse ne lui permettant pas de retourner à Wiesbaden, dont le séjour semblait d’ailleurs lui être devenu odieux, il fit venir tout son bagage à Mayence.
De profonds accès de mélancolie, provenant autant peut-être de son état de faiblesse que de tristes souvenirs, retardaient sa convalescence. Si le médecin ne l’y avait forcé, il ne serait sorti de sa chambre que pour aller à la poste porter ou réclamer ses lettres. De temps en temps, pour obéir aux prescriptions de la Faculté en prenant un peu d’exercice et de distraction, il se faisait conduire en droski à l’une des promenades publiques qui entourent Mayence. Il marchait un peu; puis, bientôt fatigué, il s’asseyait sur un banc, et y restait quelquefois des heures entières plongé dans ses tristes pensées.
Sans ami pour le consoler, sans motif impérieux pour l’arracher à ses sombres préoccupations en le forçant à travailler, William tournait tout doucement à la consomption. Il lui man quait un coup de fouet qui rendît à son organisation le ressort dont elle avait besoin pour réagir contre l’état de faiblesse et de morne indifférence qui lui était devenu habituel.