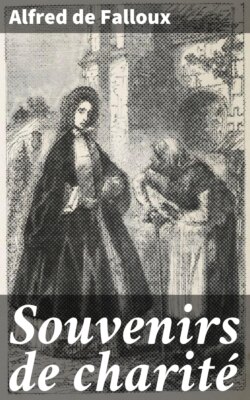Читать книгу Souvenirs de charité - Alfred de Falloux - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
DE L’EXCELLENCE DE LA CHARITÉ
ОглавлениеTable des matières
PRATIQUÉE EN COMMUN
D’autres voix que la mienne, et plus compétentes, ont déjà répondu aux différents systèmes qui n’envisagent l’humanité que dans son ensemble, et marchent à la réalisation de vœux impossibles en fermant les yeux sur les misères qui nous enveloppent. Élevons-nous de la théorie à la pratique, répète, au contraire, la charité à la philanthropie, et ne négligeons pas le pauvre qui supplie, en attendant que nous ayons découvert le secret de détruire la pauvreté.
Mais il est un autre ordre d’adversaires beaucoup moins ambitieux, et auxquels pourtant il n’importe pas moins de répondre. Ce sont les hommes qui ne croient qu’à la charité individuelle, et repoussent ou redoutent les idées de charité collective. Ceux-là sont charitables et n’ajournent pas l’effet de leur charité, mais quand on vient les solliciter au nom d’une œuvre, ils répondent: «Je ne mets pas en doute le zèle de ces hommes dont vous me présentez la requête, mais je vous demande la permission de m’en rapporter à mes propres lumières pour l’application de mes aumônes: j’ai mes pauvres; c’est à eux que je dois ma première sollicitude.»
Oui, vous connaissez, en effet, des infortunes particulières, vous êtes compatissant et généreux à leur égard; oui, vous séchez des larmes en secret, vous n’avez point recherché le vain plaisir de l’ostentation, et vous n’en goûtez point à voir votre nom figurer dans un journal. Tout cela est vrai, tout cela est beau; mais cela est-il suffisant? En ne vous dépouillant pas davantage, ne pourriez-vous pas faire plus? et ce surcroît d’action efficace, pouvez-vous l’attendre sans l’intermédiaire des œuvres?
En vous réduisant ainsi à vos propres ressources, en vous isolant, en refusant cette force propre de l’association que chaque spéculation réclame aujourd’hui, vous secourez bien un infortuné, mais vous ne secourez pas l’infortune. Vous assainirez une âme corrompue, mais vous ne combattrez pas la corruption. Vous êtes présomptueux, si vous croyez pouvoir lutter seul contre les influences de ruine et de dégradation qui enveloppent de toutes parts les classes indigentes; vous êtes faible, si vous renoncez absolu men à toute lutte; vous êtes moins charitable que vous ne le croyez, si, après avoir ramassé un naufragé sur la rive, vous regardez paisiblement couler le torrent sans vouloir travailler à la digue.
Je vais plus loin, et j’affirme que vous ne faites pas même pour vos pauvres ce que les œuvres vous enseigneraient à faire pour les pauvres de tout le monde. — Parlons des enfants; il y en a dans les familles que vous avez adoptées, et je suis sûr qu’ils obtiennent une large part dans votre sollicitude. — On vous demande de payer l’apprentissage de ce charmant petit garçon; vous souriez à l’intelligence de ce jeune regard, vous envisagez d’un seul trait son développement, son succès, les bénédictions que vous pouvez recevoir et mériter en prononçant un mot; vous êtes attendri, et ce consentement, imploré à mains jointes par quelques vieilles mères ou des parents malades, vous ne le refusez pas. Désormais ce jeune enfant est vôtre; tous les mois il viendra vous rendre compte de sa conduite, et vous lui remettrez quinze à vingt francs qu’il reportera gaiement à son maître. Vous avez été fort généreux (et de la meilleure foi du monde, je ne le conteste jamais à ceux qui refusent), mais vous avez été fort imprudent; et ce qui m’étonne, c’est votre surprise en m’entendant vous adresser cette apostrophe: Vous donnez vingt francs par mois; mais savez-vous à qui vous les donnez? Vous connaissez le maître de l’atelier peut-être, et tout au plus; mais connaissez-vous les contremaîtres, les apprentis, les voisins qui travaillent dans la même cour? La probité d’un maître d’atelier ne suffit pas; vous êtes-vous assuré de son intelligence à déjouer les mille ruses que les camarades s’enseignent entre eux, et qui tournent promptement aux plus funestes tromperies? Eh bien! une œuvre qui, pour une somme moins élevéee, se serait chargée de votre protégé, aurait su tout cela le plus naturellement du monde; elle l’aurait placé chez ces honnêtes, je dirai même chez ces admirables ouvriers, plus nombreux encore qu’on ne pense, dont elle connaît toutes les habitudes et dont elle surveille tous les engagements.
Vous n’avez pas songé à la différence qui existe entre les différents maîtres de tel ou tel atelier sous le rapport des garanties morales, qui, ne l’oublions pas, représentent les mêmes garanties sous le rapport du développement physique; mais avez-vous songé du moins à la différence des états entre eux, sous le même point de vue? Savez-vous, par exemple, que les œuvres constatent une énorme différence entre les états assis, tels que les états de tailleur ou de cordonnier, et les états actifs, tels que ceux d’ébéniste ou de serrurier: les uns torturant les membres, gênant la croissance, nourrissant le bavardage et tous les inconvénients qui en découlent; les autres entretenant les corps dans une sorte de gymnastique continuelle, et détournant par la fatigue les mauvais penchants dont il importe le plus de préserver la jeunesse? Eh bien! ces notions, qui se présentent ici pour la première fois à l’esprit de quelques-uns, sont élémentaires dans le rudiment des œuvres, et pas un enfant ne sera livré par elles au hasard, qui a dû prendre en même temps que vous sous sa protection le jeune enfant vis-à-vis duquel vous croyez avoir rempli tout à l’heure des devoirs presque paternels. Notez enfin que si je visais au tableau, au lieu de présenter quelques idées sommaires, je devrais montrer à dix ans de là le bienfaiteur, trompé dans son attente, regretter son bienfait au lieu de condamner son propre tort.
Voilà pour ce qui concerne le pauvre, et l’on conviendra que ce discernement, fruit de l’expérience et de l’étude, peut bien compter dans la balance; mais le pauvre ne trouve pas seul son bénéfice dans la fondation et les progrès des œuvres.
L’homme qui a ses pauvres et l’homme qui reçoit dans une œuvre la charge de tous les pauvres indistinctement, remplissent-ils les mêmes devoirs envers la société et envers Dieu? Je prends ici, sans hésiter, mon contradicteur pour juge.
Qu’est-ce qu’entrer dans une œuvre? C’est se réunir à jour fixe, affaire ou plaisir cessant, réciter une courte prière en commun, écouter ceux qui parlent des maux que vous ignorez, révéler ceux qui vous sont connus, rechercher le remède applicable au plus grand nombre des blessures, descendre chaque jour plus avant, par cette sérieuse discussion, dans le cœur de ceux qui souffrent et dans votre propre cœur à vous-même, prendre des résolutions réfléchies, les accomplir avec le zèle de l’émulation, et, l’on n’en doit pas rougir, avec une sorte de point d’honneur qui se mêle à toute œuvre commune, rendre compte à ses émules des résultats obtenus; puis, après avoir constaté de semaine en semaine ou de mois en mois le progrès de la charité pratique, considérer d’année en année le progrès de la pensée même de la charité, et s’émerveiller, en s’y animant chaque année davantage, des découvertes de cet éternel noviciat.
L’homme livré à lui-même, l’esprit le mieux né, parcourra-t-il à lui seul, sans secours, sans aiguillon, ce nouveau chemin de la croix?
Et vis-à-vis de la société, l’homme seul accomplit-il sa mission?
L’homme qui se présente dans la mansarde du pauvre au nom d’une œuvre y porte non-seulement le pain et la consolation, mais une impression de réhabilitation, et, si je l’osais dire, d’orgueil dont le pauvre a besoin pour ne pas maudire sa condition et toutes celles qui l’écrasent. L’homme seul va dire au pauvre: Tu m’as fait pitié ; l’homme qui représente une certaine agrégation de ses semblables, fait pénétrer un autre langage dans l’oreille du pauvre, il lui dit: La société que tu maudissais, et à l’instant où tu la maudissais, s’occupait de toi; plusieurs hommes séparés dans le monde se réunissent, sans autre but que de s’entretenir de toi et de venir à ton aide. Quand l’homme seul a quitté le pauvre, il lui laisse un sentiment affectueux, mais isolé aussi; quand l’homme d’une œuvre a refermé la porte d’une mansarde, il y a déposé des sentiments multiples; il a bouleversé toutes les idées que le pauvre, dans son désespoir, se formait sur sa propre situation et sur les relations de la société avec lui; le pauvre secouru par l’homme seul ne perdra pas la pensée de la vengeance contre l’ordre social tout entier, et, s’il rencontre son bienfaiteur un jour d’émeute, il se contentera de lui sauver la vie ou de détourner le pillage de sa maison; mais l’homme qui est secouru par une société fera monter sa reconnaissance plus loin, et si la statistique des émeutiers se pouvait faire, je maintiens qu’on y trouverait dans une proportion toujours décroissante les hommes inscrits sur les registres de la charité collective. Le sentiment de la reconnaissance et la logique ne conduisent pas d’ailleurs tout seuls à ce résultat, le sentiment religieux y entre aussi pour une part que je n’ai nullement l’intention d’affaiblir.
Quand le membre d’une œuvre entre chez le pauvre, il y introduit nécessairement un tiers qui n’existe pas entre lui et tout autre visiteur: c’est le saint sous le patronage duquel l’œuvre est placée. Cette porte, on se la fait ouvrir au nom de saint Vincent de Paul, de saint François Régis, de saint François Xavier. Qu’est-ce que c’est qu’un saint? qu’est-ce que c’est que la religion qui fait les saints? qu’est-ce que c’est que le Dieu qui a révélé au monde une telle religion? Pouvez-vous empêcher le pauvre de demander cela, quand vous vous présentez sous de tels auspices? Pouvez-vous faire qu’il se le demande, quand vous ne vous présentez, qu’en vertu de votre propre mouvement et d’une passagère émotion? L’homme du monde le plus éloquent pourra prodiguer ses paroles au pauvre, il ne trouvera jamais rien de si persuasif que l’homme ignorant ou la femme timide lui démontrant, sans le lui dire, que Dieu est charité, que ses saints ont été surtout charité, et que les disciples qui se placent tout indignes sous leur patronage sont obligés d’acquitter leur première dette à la charité.
L’époque où nous vivons n’admet plus ou n’admet pas encore les grandes institutions religieuses d’autres âges et d’autres pays. Sachons donc, sans vouloir précipiter en rien les décrets de la Providence, combler nous-mêmes cette immense lacune pour l’honneur de notre nature et pour le soulagement de l’humanité. Élevons en même temps le niveau matériel et le niveau moral du pauvre, sans laisser croire au riche qu’il est suffisamment charitable quand il est simplement généreux et compatissant. Noblesse oblige, richesse oblige, aumône oblige; tout nous oblige en ce monde, puisque nous avons tout reçu.
Janvier 1842.