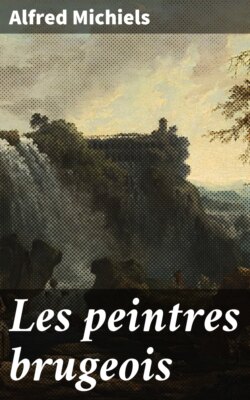Читать книгу Les peintres brugeois - Alfred Michiels - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
CHAPITRE II.
Les Van Eyck.
ОглавлениеTable des matières
Hubert et Jean Van Eyck sont distingués par Philippe le Bon. –Josse Vydt les charge de peindre le fameux tableau de Gand.–Description du tableau.–Mort d’Hubert et de Marguerite.–Jean Van Eyck se marie.–Philippe le Bon l’envoie en Espagne.–On place et inaugure l’Adoration de l’Agneau mystique.–Retour du peintre à Bruges.
L’effet produit par l’invention de la peinture à l’huile, dans le pays même, fut si grand que l’on dédaigna l’ancienne méthode et imposa aux dessinateurs l’obligation d’employer la nouvelle. Les archives de Gand contiennent une pièce de l’année1419, qui met cette circonstance hors de doute: c’est un accord fait entre le trésorier de la ville et les francs peintres (vrie schilders) Guillaume Van Axpoele et Jean Martens, pour restaurer en bonnes couleurs à l’huile, sans mélange de substances corrosives, plusieurs morceaux très-anciens, qui ornaient l’hôtel-de-ville; un acte postérieur, de l’année1434, prouve qu’un nommé Saladin de Scoenere prit l’engagement de peindre à l’huile le retable de la chapelle des frères mineurs, dans la même cité. Il ne s’agissait pas d’enluminer des statues et moulures, comme on pourrait le croire. Le premier accord mentionne, il est vrai, une opération de ce genre, mais il porte, en outre, que l’artiste reproduira sur les vieux panneaux, sans changer les formes originelles: le comte Louis, les bourgeois avec leurs armes et tous ceux qui les suivent; par ces termes se trouve bien dénotée une peinture. Le deuxième acte est plus explicite encore: Saladin y promet non-seulement de colorier la menuiserie et les sculptures en bois d’un autel, mais de tracer, sur la face intérieure des volets, la naissance et la mort de la Vierge; et à l’extérieur, deux sujets en grisaille, dont il abandonne le choix au goût du contractant. Il ajoute qu’il représentera, en bonnes couleurs à l’huile et sur toile, un Christ avec quatre figures. Peut-être Saladin employa-t-il le procédé de Van Eyck; mais Guillaume Van Axpoele et Jean Martens eurent vraisemblablement recours à la manière gothique; les frères ingénieux n’avaient pas encore, selon toute apparence, divulgué leur secret.
Tant de mérite, une gloire si éclatante ne pouvaient échapper aux yeux des princes qui tenaient alors entre leurs mains les destinées de la Belgique. Philippe le Bon surtout devait s’occuper de l’illustre groupe: il aimait les beaux-arts, les miniatures, les joyaux, les poèmes; il avait «accoutumé de journellement faire devant luy lire les anciennes histoires,» et avait fondé à Bruxelles un atelier de calligraphie. Ces pompes secondaires pâlissaient devant les tableaux somptueux de nos peintres. Il est donc probable qu’il les distingua, lorsqu’il était simple comte de Cliarolais: il leur témoigna toute son estime et son admiration, dès qu’il siégea sur le trône ducal. Il avait une préférence marquée pour Jean Van Eyck, dont la société lui plaisait beaucoup, sans doute à cause de sa vive intelligence et de ses façons agréables: aussi le nomma-t-il son conseiller privé. Une affection de la même nature avait jadis uni Alexandre et Apelle. Je ne sais qui, du prince ou de l’artiste, ces relations honorent le plus: si elles flattent le dernier, si elles augmentent sa valeur, son importance aux yeux de la multitude, elles attestent dans les puissants du monde une liberté morale et un sentiment de la vraie grandeur humaine, que leurs fausses grandeurs les empêchent souvent d’acquérir. Les mobiles, les capricieuses faveurs du sort enivrent d’orgueil la plupart des hommes: ceux qu’elles ne boursouflent point, qui gardent, au milieu de leur pompe, la rectitude de l’esprit et la simplicité du cœur, ne sont pas des intelligences vulgaires; ils se montrent dignes du rang qu’ils occupent, et l’exception est toujours assez rare pour être glorieuse.
D’autres personnages se lièrent d’amitié avec nos deux artistes. En1420, Josse Vydt, seigneur de Pamele, un des plus nobles citoyens de Gand, acheta, selon l’usage de l’époque, une chapelle dans l’église de St.-Bavon, afin d’y établir la sépulture de sa famille: les parents de sa femme Isabelle Borluut devaient y recevoir aussi l’hospitalité de la mort. Il la fit rebâtir ou du moins restaurer; on sculpta ses armoiries sur la clef de voûte et sur la porte, où on les voit de nos jours; on les déploya sur les vitraux. Une crypte fut ouverte sous la chapelle haute, pour servir d’asile aux cadavres et de funèbre oratoire. Mais l’autel supérieur avait besoin d’une décoration en harmonie avec ce luxe féodal et religieux. L’opulent seigneur alla donc trouver les frères Van Eyck, leur exposa sa demande et son projet d’éclipser tous les monuments analogues. Les peintres lui donnèrent leur parole qu’ils seconderaient ses vues autant que possible. Leur premier soin fut de quitter Bruges, de transporter leur résidence à Gand. Ils se fixèrent dans une maison située près de la place qu’on nomme le Kautre, à l’angle de la rue des Vaches et du Marché-aux-Oiseaux. Cette maison a été, depuis peu, reconstruite et ornée de deux médaillons, qui représentent les célèbres frères. Là ils conçurent le plan de leur travail, puis se mirent à l’exécuter.
Ce n’était rien moins qu’une œuvre immense, la plus colossale entreprise tentée par leur pinceau. Malheureusement ils firent choix d’un sujet symbolique et les symboles dans le vivant domaine de l’art occupent la dernière place. La forme peut en être admirable, mais on sent toujours qu’elle n’existe point pour elle-même, qu’elle sert d’enveloppe et fléchit sous le despotisme accablant de l’idée. Or l’imagination demande tout le contraire; elle ne s’intéresse point aux objets ou s’y intéresse d’une façon directe. Si on les lui présente comme des voiles, comme des leurres, comme des emblèmes arbitraires, l’ennui la frappe de sa baguette léthargique. Ce qu’elle voit n’a pas même la haute réalité de la poésie; c’est une double fiction, qui ne s’adresse vraiment point à elle, mais à une autre faculté. Dès lors que lui importe?
Les habiles frères prirent donc pour thème deux passages de l’Apocalypse: le premier nous dépeint Jésus comme un agneau, qui rachète de son sang les crimes de notre espèce; le second va nous expliquer tout le retable:
«Je vis ensuite l’agneau debout sur la montagne sainte et avec lui cent quarante-quatre mille personnes, qui portaient le nom de son père écrit sur leur front.
» J’entendis alors une voix du ciel, semblable au fracas des grandes eaux, pareille au bruit d’un grand tonnerre; et cette voix, je l’entendais comme le son de plusieurs joueurs de harpe, qui touchent de leurs instruments.
» Ils chantaient un nouveau cantique devant le trône, et devant les quatre animaux, et devant les vieillards; et nul ne pouvait le chanter que les cent quarante-quatre mille, qui avaient été rachetés de ce monde.
» Ceux-là n’ont point été souillés par les femmes, car ils sont demeurés vierges; ceux-là suivent l’agneau en tous lieux; ils ont été rachetés d’entre les hommes, pour être consacrés à Dieu et à l’agneau, ainsi que des prémices.
» Et l’on n’a jamais trouvé le mensonge dans leur bouche; ils sont purs et sans tache devant le trône de Dieu.»
Les peintres crurent pouvoir interpréter largement les versets de l’Écriture et grouper autour de l’Agneau toutes les idées chrétiennes, à l’aide des personnifications dogmatiques et historiques, sanctionnées par un long usage. Ils placèrent donc au milieu la victime expiatoire, debout sur un autel, couvert d’une nappe blanche; de sa poitrine s’échappe un filet de sang, qui tombe dans un calice. Le devant de l’autel porte en haut cette inscription: Ecce Agnus Dei, qui tollit peccata mundi, et en bas une seconde: Jesus via, veritas, vita. La colombe divine plane au-dessus de l’emblème mystique: au-dessus de la colombe trône Dieu le Père, la tête couronnée de la tiare des Papes. Un splendide manteau rouge l’enveloppe et se rattache sur la poitrine au moyen d’une agrafe éclatante: une broderie de perles en ourle magnifiquement les bords. L’artiste n’a point donné à l’Éternel les traits d’un vieillard: il l’a représenté dans la force de l’âge, comme les anciens figuraient Jupiter; il vaut mieux, en effet, le revêtir d’une jeunesse inaltérable, que de le montrer soumis au pouvoir du temps. Les siècles passent devant lui comme des jours: la décrépitude et la mort lui obéissent et ne sont que les instruments de sa volonté. Plein d’un calme profond, d’une gravité majestueuse, il a bien l’air ici du Maître suprême. Dans sa main gauche brille un sceptre de cristal, aussi diaphane que tous les vases des peintres hollandais. De la main droite, il bénit les fidèles qui se pressent au bas du tableau. La Sainte Vierge est assise de ce côté: elle tient un livre à la hauteur de sa poitrine et en médite les paroles; ses yeux, sa tête légèrement baissée expriment l’attention, la réflexion. Une candeur angélique, une sainte paix divinisent sa figure, dont le type est malheureusement un peu lourd: ses grosses lèvres, ses pommettes saillantes trahissent son origine. Des cheveux châtains flottent sur ses épaules: un manteau bleu se drape autour de ses formes; elle semble avoir pris pour costume un pan du céleste azur. A la gauche de Dieu, St. Jean-Baptiste frappe la vue par ses traits mâles et son attitude pensive: une barbe, une chevelure épaisses, d’une teinte foncée, lui impriment un caractère de sombre grandeur, en harmonie avec son histoire. C’est l’homme de la solitude, Vox damans in deserto: l’âpre vent de la Palestine, sa chaleur africaine, la réverbération d’une terre desséchée ont bruni son visage. Il a cherché le Seigneur dans les lieux incultes, sur les rives sinistres de la mer Morte, parmi les hauteurs funèbres qui l’environnent. Un manteau vert, signe d’espérance, l’habille de ses longs plis. Levant la main droite, il paraît désigner le Christ, et le livre des prophètes, ou de l’ancienne loi, étale sous ses regards ses feuilles mystérieuses.
A droite et à gauche de cette trinité, on voit des anges qui la saluent de leurs chants. Par suite d’un caprice, le peintre a omis les ailes que leur donne la Bible; peut-être encore les a-t-il négligées parce qu’elles eussent envahi les étroits volets où ils figurent: les célestes musiciens, qui auraient pu y tenir, eussent alors été trop peu nombreux pour simuler une foule. Quoi qu’il en soit, ils portent des habits magnifiques: l’imagination la plus vive n’augmenterait point l’opulence de leurs robes, de leurs chapes brodées, que maintiennent dos agrafes éblouissantes. De longs cheveux tombent sur leurs épaules, couronnés d’un bandeau garni de perles et de diamants. A droite, le premier, ange touche de l’orgue les tuyaux et la boiserie en sont d’une vérité frappante. Van Mander prend l’harmonieuse créature pour une sainte Cécile, mais il se fait illusion, car nul attribut ne légitime cette hypothèse. De l’autre côté, devant un pupitre en bois, peint avec une surprenante délicatesse et orné d’un bas-relief qui nous montre saint Michel tuant le fameux dragon, un adolescent se tient debout d’un air grave: il bat la mesure et dirige les chanteurs placés derrière lui. Le peintre a eu le soin minutieux d’indiquer par la pose, par l’ouverture de la bouche, par les plis du front, par les traits du visage, s’ils font la basse ou le dessus.
Un troisième chœur d’esprits célestes s’agenouille devant l’autel, en adorant l’Agneau; les deux premiers balancent des encensoirs, les autres chantent ses vertus, son sacrifice et portent les instruments de la passion: la croix, la lance, l’éponge amère et la sanglante colonne. Ils sont vêtus de grandes tuniques et déploient des ailes rougeâtres. Sur le premier plan ruisselle une fontaine, que désignent ces paroles de l’Apocalypse: «L’ange me montra encore un fleuve d’eau vive, clair comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l’Agneau.»–«Ils n’auront plus ni faim, ni soif, et le soleil ni aucun souffle brûlant ne les incommodera plus; parce que l’Agneau, qui est au milieu du trône, sera leur pasteur, et il les conduira aux sources d’eau vivantes, et Dieu essuiera toutes les larmes de leurs yeux. Il Jamais certes allégorie n’a été peinte d’une manière plus habile: cet accessoire est un chef-d’œuvre. Une colonne, surmontée d’un ange en bronze, s’élève au milieu; les têtes de dragons qu’elle supporte vomissent dans le bassin des filets d’eau, clairs et purs comme le diamant. Ils agitent l’onde prisonnière entre des parois de marbre; les cercles mobiles, les petites vagues qu’ils forment sont rendus avec une patience et un bonheur extrêmes; la lumière devenue liquide ne serait pas plus brillante. Ces flots en miniature ont l’air de scintiller, de trembler; le regard se joue à la surface et y plonge tout ravi: ils sont limpides comme les sources des montagnes, riches d’aspect comme les vins précieux que les monarques boivent dans l’or. S’échappant de leur réservoir, ils baignent un canal peu étendu, où la main de l’homme n’a pas laissé de traces. On en pourrait nombrer les cailloux; des perles et des diamants ornent ce lit sans souillure; d’admirables fleurs, des plantes délicates poussent sur les bords, se penchent sur le ruisseau et y projettent leurs ombres mignonnes. Le soin, la poésie du détail sont parvenus à leurs dernières limites: Gérard Dow lui-même n’a pas fait mieux.
Une pelouse éclatante, semée de violettes, de marguerites, de lys, de pensées, de primevères et de campanules, se déroule autour de l’Agneau et de la fontaine. Des buissons de roses, des palmiers, des cyprès, y grandissent; le terrain va en montant, un horizon lumineux couronne le paysage, à l’extrémité duquel on aperçoit la Jérusalem céleste. Elle offre l’aspect d’une ville ordinaire: les flèches qui l’embellissent et la dominent paraissent avoir eu pour modèles les flèches de Maestricht. Un souvenir de son enfance vint encore inspirer l’homme de génie; dans le fond de cette riante perspective, au-dessus de la ville bienheureuse, il dressa les fiers clochers, les saintes pyramides qu’il voyait durant sa jeunesse, tantôt lorsqu’il errait au milieu des bois et qu’une vaste clairière lui permettait d’en saisir le profil, tantôt lorsqu’il s’ébattait sur le gazon des pâturages ou suivait les bords de la Meuse, troublé, charmé déjà, ayant pour compagnon le noble guide qui révèle aux âmes fortes les secrètes harmonies des choses.
A travers la campagne étoilée de fleurs, s’avancent des groupes bénis: ce sont les élus qui viennent adorer l’emblème du Christ. «Ils se tenaient debout, vêtus de robes blanches, et ayant des palmes dans leurs mains. Ils s’écriaient et disaient d’une voix forte: c’est à notre Dieu, qui est assis sur le trône, et à l’Agneau qu’est due la gloire de notre salut.» Nous apercevons d’abord près de la Jérusalem céleste, dans le haut du panneau et sur la droite, la légion des douces héroïnes, qui ont souffert le martyre. Elles sont conduites par sainte Agnès, sainte Barbe et sainte Dorothée. Presque toutes portent des turbans. De longues chevelures blondes, crêpées en éventail, flottent sur leurs épaules. Une grâce extraordinaire embellit leur visage, leurs formes et leur attitude. Mais leur dimension étant très-petite, elles n’ont pas la même importance que les figures masculines, dont nous allons parler. Le sexe aimable se trouve donc sacrifié ici, comme dans toutes les peintures flamandes. Elles tiennent des palmes à la main, signes de leur triomphe et de leur joie.
Plus bas rayonne une troupe de moines, de papes et d’évêques, placés vers la droite et regardant l’autel. On distingue parmi eux saint Liévin, apôtre de la Belgique, martyrisé en633. Un sentiment de pieuse componction anime leur figure: on ne peut rien voir de plus doux et de plus noble. Il ne faudrait pas néanmoins étendre cet éloge aux cénobites vêtus de lourds manteaux et agenouillés sur le devant. Je ne sais dans quel but le peintre sagace leur a donné des visages comiques; menton saillant, nez camus, bouche difforme, les traits sont d’une complète vulgarité. La magie de la couleur ne rachète pas ce défaut, qui voile sans le moindre doute une intention. Ils ont les mains jointes et une ferveur enthousiaste répand un demi-jour idéal sur leurs têtes communes.
Derrière les prêtres marchent les saints ermites: des rochers, une épaisse forêt occupent le second plan; de nombreux orangers, couverts de fruits, déploient leur feuillage sur la lisière. Les anachorètes sortent d’un ravin obscur, symbole de leur vie paisible et retirée. Ils cheminent d’un air pensif, tenant d’une main un bâton de voyage et de l’autre un chapelet. D’où viennent-ils, sous leur froc sombre, d’un pas lourd et chancelant, qui trahit l’habitude religieuse d’une immobilité contemplative? Leurs chevelures, leurs barbes touffues, que la vieillesse a blanchies de sa première neige, ou qui ont gardé leur couleur noire, sont incultes et désordonnées comme les broussailles de leurs thébaïdes; leur peau brune, leurs traits sévères et même farouches annoncent également les privations de leur rude existence, la funèbre solitude où ils passent leurs jours. L’un d’eux, la tête inclinée, cherchant l’Agneau du regard, prie avec une ardeur sublime; l’extase est peinte sur sa figure austère. Son voisin de gauche a peut-être une expression plus frappante encore; une humilité sainte, un profond recueillement voilent ses yeux; il paraît abîmé dans les visions magiques d’un autre monde. Les sourcils relevés de quel ques ermites, leurs fronts couverts de plis, l’air étrange de leur figure dénotent aussi l’exaltation. Marie Madeleine, portant son vase de parfums, et une seconde sainte, qui pourrait être Marie l’Égyptienne, terminent ce groupe merveilleux.
Nous découvrons ensuite les pèlerins, Peregrini sancti. La forêt se prolonge, mais une vallée en sépare les derniers massifs d’une colline charmante, où verdoient quelques arbres. Une eau limpide arrose le sol inférieur: dans le lointain, on aperçoit une ville, puis des coteaux mollement ondulés qui ferment l’horizon. De ce champêtre val sort la pieuse troupe: un géant marche à leur tête et leur fait signe de le suivre; une tunique blanche lui descend jusqu’aux genoux, il porte un vaste manteau rouge, qui lui cache les deux bras et une main, et tombe en plis harmonieux sur le devant. Ses pieds maigres, comme ceux des autres voyageurs, témoignent de ses longues fatigues. Il a pour s’appuyer un bâton énorme; une chevelure épaisse et noire, une barbe pareille assombrissent ses traits, dont l’exécution n’est point d’ailleurs fort heureuse. Ce géant, on le devine, représente saint Christophe. Dix-sept pèlerins d’une taille exiguë cheminent sous ses ordres. Un d’entre eux, ayant sur la tête un chapeau garni de coquilles, se fait remarquer par une attitude grave, par un air sérieux. Un autre, plus jeune et le bourdon à la main, regarde ce voyage comme un plaisir et offre au spectateur une mine joyeuse. Un rude caractère, une physionomie pensive distinguent quelques-uns de ses compagnons.
En face de ces nobles cohortes, des groupes symétriques nous apparaissent sur la gauche. Les martyrs d’abord, vers le haut de la colline: on observe dans le nombre des papes, des évêques et des cardinaux; ils étreignent les palmes victorieuses. C’est pourtant la section du tableau la moins brillante.
Au-dessous des martyrs sont dessinés les prophètes de l’Ancien Testament, qui s’agenouillent sur l’herbe et ont les yeux tournés vers l’Agneau rédempteur: ils tiennent des livres entre leurs mains, lesquels, sans doute, renferment leurs ténébreuses prédictions. Une phalange placée derrière eux offre aussi ses hommages à la victime expiatoire; les individus qui la composent sont debout, largement drapés. L’un d’eux, ayant pour costume une robe et un manteau blancs, porte sur la tête une couronne de laurier et, dans la main droite, une branche d’oranger avec un fruit. Son voisin, en manteau bleu, en camail rouge, porte aussi un rameau vert, mais d’une autre espèce et dont le feuillage annonce un myrthe. Ils ont l’un et l’autre une grande dignité de pose, d’expression et de figure. Ce sont deux poètes indubitablement; l’on croirait même que le peintre a voulu représenter Virgile et le Dante. La branche d’oranger, avec son fruit jaune comme le soleil, indiquerait alors le rameau d’or, qui ouvre les portes de l’enfer, selon les paroles de l’Enéide; la branche de myrthe rappellerait le brûlant amour d’Alighieri pour Béatrice. La gravité un peu sombre du personnage conviendrait d’ailleurs très-bien au chantre des malédictions et des tortures célestes. Le groupe dont ils font partie se compose vraisemblablement d’auteurs, d’artistes sacrés: il serait injuste de les omettre dans le nombre des serviteurs d’Emmanuel, ceux qui revêtent sa doctrine de formes éblouissantes!
Du même côté, chevauchent les soldats du Christ, Milites Christi, et les juges équitables, Justi Judices. Un splendide paysage les environne: des masses de rochers, pleines de fissures, de ravins, et dont le sommet est couvert d’herbes et de buissons, occupent le premier plan. Derrière les broussailles montent de frais coteaux, où l’on aperçoit des tours et des forteresses qui dominent les arbres. Par delà ces hauteurs et ces châtellenies règnent des sommets plus élevés, dont un bandeau de neige ceint le front orgueilleux. Les soldats du Christ ont pour guides trois jeunes cavaliers, tenant des drapeaux sur lesquels brille le signe de la rédemption; des couronnes de laurier pressent leurs cheveux flottants, des cuirasses polies abritent leur poitrine. Le personnage du milieu, que sa situation et son cheval blanc désignent comme la figure principale, étonne le spectateur par son imposante majesté: une dévotion profonde exalte ses traits. On voit en lui un homme énergique, une forte nature, qui reconnaît cependant une puissance plus grande et s’humilie devant le Créateur. Il représente, selon Waagen, le célèbre héros Godefroi de Bouillon: le même auteur suppose que ses deux acolytes sont Tancrède et Robert de Flandres: le visage de ceux-ci annonce la valeur et la fidélité. Quatre princes portant des couronnes et deux individus portant des toques marchent sur leurs traces. Parmi les premiers, il en est un que signale le diadème des Empereurs. Malgré sa barbe blanchissante, M. Louis de Bast pense qu’il figure Baudouin de Constantinople. Un autre chevalier passe pour être saint Louis. Le reste de la phalange a les caractères du type flamand.
Les juges équitables montent aussi d’élégants coursiers. Le plus extérieur s’offre à nous sur un cheval blanc couvert d’une riche housse; une magnifique pelisse bleue l’enveloppe et un bonnet fourré orne sa tête. Il est déjà vieux, mais sa physionomie a une grande douceur, un air de tranquille bonté. C’est le portrait de Hubert Van Eyck. Plus loin, on observe un homme encore jeune et d’une heureuse figure, qui exprime la paix et la sensibilité: il porte une robe noire, une coiffure en manière de turban, que dépassent les bouts de l’étoffe: un chapelet de corail est suspendu à son cou. On l’a baptisé du nom de Jean Van Eyck. Ces têtes ont servi de modèles pour toutes les images des célèbres frères. Ils ne sont pas rassemblés, mais deux individus les séparent; un de ceux-ci devrait, selon le texte de Karel Van Mander, nous montrer Philippe le Bon; Van Mander commet une erreur, les effigies authentiques de ce prince détruisent son hypothèse. Il faudrait plutôt y chercher le comte de Flandre Charles le Bon, qui promulgua de nouvelles lois et affermit la justice. L’un et l’autre cavaliers sont du reste peu importants. Six compagnons trottent près d’eux et longent les rochers. Le soin avec lequel le peintre spécifiait et caractérisait toute chose, se trahit jusque dans la manière dont il a exécuté les chevaux: les blancs paraissent benins et dociles; un des noirs agite violemment sa tête, comme S’il était farouche et indomptable.
Des rayons lumineux, qui partent du Saint-Esprit, viennent frapper les groupes les plus rapprochés de l’Agneau: la colombe mystique semble tous les vivifier et les unir. Le trait de flamme touche le sein des Vierges, qui se gonfle sous les caresses de l’amour divin.
Au bas du retable, on voyait autrefois un panneau longitudinal qui en formait, pour ainsi dire, l’appui et représentait le lieu des supplices éternels. Les damnés, dans leur sombre asile, fléchissaient eux-mêmes le genou devant l’Agneau rédempteur, qu’ils avaient méconnu et outragé. Malheureusement cet enfer était peint à la détrempe: des restaurateurs inhabiles, voulant le nettoyer, l’effacèrent et le gâtèrent par la suite.
Telle est la scène principale exécutée sur ce fameux tableau: on dirait un vaste synode, une immense réunion de tous les peuples qui glorifient le principe chrétien et ont pour ambassadeurs, pour représentants des individus choisis dans toutes les classes de la société. D’autres personnages complètent le symbole: par leur rapport avec les traditions catholiques, ils donnent le sens intime de cette fête solennelle.
En haut du retable, à ses deux extrémités supérieures, nous voyons Adam et Ève. L’inconséquente pécheresse est toute nue, debout, dans une attitude gracieuse. Une longue chevelure sans anneaux tombe derrière ses épaules et roule autour des seins voluptueux, qui n’ont pas encore allaité les fils de l’homme. Son visage est régulier, noble et doux. La forme générale du corps étonne par la souplesse des lignes, dans ce premier essai pour exécuter l’ensemble de la figure humaine. Sa main droite, soulevée à la hauteur de la poitrine, tient un fruit du Sud, orange pâle ou ananas, qu’elle offre au guide bien-aimé de son existence. De la main gauche, elle cache imparfaitement son sexe avec des feuilles de figuier. L’artiste nous révèle ici d’une manière curieuse son amour de la nature et l’ingénuité de son cœur: il ne veut rien omettre, il ne craint pas les licences de l’esprit et retrace le voile qui entoure les organes de la passion. Au-dessus d’Ève, Caïn tue Abel: un petit encadrement isole cette image; les suites de la faute se trouvent ainsi rapprochées de la faute même. Adam a une tête grave et un peu triste; de la main droite il cache son sexe, mais aussi imparfaitement que la séductrice. Il porte la main gauche à son buste, au-dessous du sein droit et a l’air de refuser le dangereux présent de sa compagne. Le double sacrifice de Caïn et d’Abel termine ce volet. La désobéissance des premiers coupables vient de la sorte expliquer la mort volontaire du Dieu martyr.
Ces différents sujets occupent douze panneaux et toute la surface du retable ouvert: huit de ces panneaux sont mobiles et, en se fermant, couvrent les autres. Les Van Eyck les ont donc peints à l’extérieur comme à l’intérieur. Au dehors sont figurés l’Annonciation, saint Jean-Baptiste et saint Jean l’Évangéliste, la sibylle de Cumes, la sibylle d’Erythrée, le prophète Zacharie et le prophète Michée. Nous n’avons pas besoin de faire voir le rapport qui unit à la scène capitale et l’Annonciation et les deux St. Jean. Pour les sibylles, ce qui motive leur présence, c’est qu’on les regarde comme ayant annoncé la venue du Christ. La même raison légitime celle des prophètes. Les phylactères déployés au-dessus d’eux portent les phrases suivantes, tirées de leurs écrits: «Ex te egredietur qui sit dominator in Israël.»–«Exulta sutis, filia Sion jubila. Ecce rex tuus venit.» Marie, agenouillée devant une espèce d’autel, reçoit d’un air humble et pieux le message divin: sa figure exprime une douce résignation. Elle croise les mains sur sa poitrine et témoigne par ce geste de son entier dévouement. Raphaël porte dans sa gauche un lys splendide et montre les cieux de la droite: il a de grandes ailes vertes, des ailes de perroquet. Au fond de la chambre gothique, où ils se tiennent, on aperçoit une vue de Gand, prise du coin de la rue aux Vaches et du marché aux Oiseaux. Les ombres qu’y projette le soleil donnent à penser qu’elle a été peinte durant le mois de juin ou de juillet, entre les cinq et six heures du matin. La supposant faite dans l’atelier même des Van Eyck, on en a induit, avec une hardiesse trop grande peut-être, la situation de leur demeure à Gand. Saint Jean-Baptiste et saint Jean l’Évangéliste sont des grisailles, qui simulent deux statues de pierre blanche et fine: le premier nous offre une tête analogue à celle d’Esculape, le deuxième à celle d’Apollon juvénile. Le peintre connaissait-il les ouvrages des anciens? Il a du reste largement exécuté ces figures. Elles remplissent les deux panneaux inférieurs du milieu; les deux autres panneaux, ceux de droite et de gauche, contiennent deux portraits. L’un représente un homme âgé, qui étend ses mains jointes, lève son regard vers le ciel et prie à genoux. On peut donner à la tête le nom de chef-d’œuvre; le soin du détail, la profondeur, la vivacité de l’expression, le caractère de la physionomie rangent ce travail parmi les plus beaux que l’on ait dessinés en ce genre; mais contrairement à son habitude, le peintre a ébauché les accessoires. La seconde image est celle d’une femme sur le retour, qui joint les mains et prie de la même manière: elle a une face agréable où la piété répand son tranquille enthousiasme. Les nuances du visage sont graduées avec une finesse extraordinaire; on admire malgré soi l’adresse que Van Eyck a déployée en reproduisant l’ombre légère, qui tombe du bonnet sur le front. Ces deux personnages sont indubitablement les donateurs, Josse Vydt et Isabelle Boorluut, sa femme.
Nous avons décrit longuement ce retable, à cause de son extrême importance. OEuvre capitale des frères Van Eyck, il était par cela même le plus vaste morceau entrepris jusqu’alors dans les régions cisalpines. Ce fut la grande épopée homérique de la peinture néerlandaise, une fertile création étudiée pendant près de deux siècles, Sur ce tronc merveilleux, sur cet arbre de Jessé, verdoyèrent tous les rameaux, s’épanouirent toutes les fleurs que, durant une longue suite d’années, l’imagination produisit dans les campagnes flamandes.
Le haut seulement de la composition était achevé, lorsque le18septembre1426, la mort brisa la palette d’Hubert et lui arracha les pinceaux qu’il avait consacrés au Seigneur. On l’enterra dans le caveau sépulcral de la famille Vydt, sous la chapelle même qu’il décorait naguère. On lui éleva une tombe sous une arcade ouverte dans la muraille, et tailla sur la dalle qui fermait son dernier lit de repos un squelette en marbre, tenant une plaque de cuivre, où on lisait une épitaphe que nous traduisons du flamand:
Voyez en moi votre image, vous qui passez au-dessus de ma tête: j’étais jadis semblable à vous, maintenant je suis mort et couché sous la terre, comme il y paraît bien. Ni la prudence, ni l’art, ni la médecine ne m’ont servi. Honneur, habileté, sagesse, pouvoir, opulence, grandeur, la mort n’épargne aucune chose. Je m’appelais HUBERT VAN EYCK, j’étais célèbre et admiré comme un grand peintre; maintenant les vers me dévorent. J’étais quelque chose il y a peu de jours et ne suis plus que néant.
Ce fut en l’an du Seigneur mil quatre cent vingt-six, le dix-huit du mois de septembre, que je rendis avec peine mon âme à Dieu. Priez-le pour moi, vous qui aimez l’art, afin que je puisse obtenir sa grâce, et fuyez le péché, accomplissez le bien, pour qu’un jour il vous soit donné de nie suivre.
Mais on ne livra point toute sa dépouille à la terre. L’os de son bras droit, de ce bras qui soutenait une main si habile, fut détaché par ses admirateurs. On l’exposa, comme un objet de vénération publique, dans une armoire de fer, à la porte de l’église, que le cimetière environnait selon l’ancienne coutume. Il y attirait encore la vue pendant le seizième siècle, et cette relique d’une nouvelle espèce montrait quelle action pro fonde avait exercée le génie des Van Eyck sur les habitants de la Flandre.
Marguerite, qui était sans doute l’aînée de Jean, ne tarda pas à suivre Hubert en sa froide demeure. Elle alla aussi habiter le caveau funèbre de Josse Vydt. Un portrait qui se trouve près de ceux des frères Van Eyck, sur un tableau possédé par l’ambassadeur russe Tatitscheff et où l’on voit Jésus saignant sous le fer de la lance impie, est regardé comme le sien.
Jean avait alors une quarantaine d’années. Seul et triste, il voulut se donner une compagne et choisit une jeune fille, qui avait la moitié de son âge. Comme beaucoup d’artistes, de poètes, il semble avoir placé mal son affection, du moins si l’on en juge par la figure de son épouse, qu’il a retracée lui-même. Elle a, dans ce tableau, un grand front, des arcades surciliaires bombées, mais presque pas de sourcils. L’orbite de l’œil est plein, avec des renflements à l’angle intérieur, près du nez; les yeux, qui sont petits, ont des bords tant soit peu rouges et dépourvus de cils. Le nez s’amincit par le haut et s’évase par le bas. Les pommettes forment une légère saillie: la bouche est pincée, la lèvre inférieure dépasse la lèvre supérieure, signe d’un caractère méprisant. Tout ce visage a une expression froide, sèche, désagréable. Deux cornets, qui se dressent sur les tempes, renferment ses cheveux antérieurs, de sorte que le devant du crâne est totalement nu. Une sorte de faille en toile épaisse, bordée d’une ruche de même étoffe, s’avance par-dessus les cornets. La disgracieuse ménagère porte une robe pourpre, à larges manches, ornée de petit gris. La main qu’on voit posée sur l’épigastre est merveilleusement peinte, et le morceau a en général beaucoup de finesse. On y lit deux inscriptions: la première occupe le haut:
Conjux meus Johannes me complevit anno1459, mense
Junii.
La seconde longe le bord inférieur:
Ætas mea triginta tria annorum. Als ikh kan.
Lorsqu’on regarde cette tête déplaisante, on n’envie point le bonheur matrimonial de Jean Van Eyck.
Il continua seul le tableau entrepris avec son frère; mais en4428, il fut obligé de suspendre son travail. Philippe le Bon expédiait une ambassade en Portugal, pour demander au roi Jean Ier la main de sa fille Élisabeth. «L’excellent maistre en art de painture» se joignit par son ordre à la troupe; il devait reproduire les traits de l’Infante et cette image devait être aussitôt envoyée dans les Pays-Bas, afin que le duc pût connaître au moins la figure de sa nouvelle épouse. Cent soixante livres lui furent données en récompense de ce voyage et de certains voyages secrez entrepris pour les affaires de son suzerain.
Les sires de Roubais, de Lannoy et d’autres seigneurs s’embarquèrent au port de l’Écluse, le 19octobre1428, sur deux galères vénitiennes, accompagnés de notre artiste. Ils furent contraints de relâcher dans plusieurs ports de la Grande-Bretagne, nommément à Sandwich, Plymouth et Falmouth; ils restèrent captifs dans le dernier jusqu’au second jour de décembre. Le18du même mois, ils atteignaient Lisbonne. La réception faite, les clauses stipulées, Jean, varlet de chambre de Philippe le Bon, se mit à l’œuvre: son pinceau eut les prémices de cette beauté que n’avait pas encore vue son maître. Le12février 1429, la pourtraiture de madame Élisabeth, painte au vif, partit pour Bruges. Ce tableau s’est perdu depuis lors et l’on doit beaucoup en regretter la destruction. Ouvrage exécuté dans un moment solennel, le grand homme y avait sans doute employé toute son adresse et tout son génie. Au lieu d’attendre inertement la réponse de leur souverain, les ambassadeurs formèrent le projet de parcourir la Péninsule. Pour débuter, ils allèrent à St.-Jacques en Galice, puis chez le duc d’Arjonne, puis en Castille, à Grenade et en bien d’autres lieux. Les rois de ces divers pays les accueillirent honorablement. Que Van Eyck ait négligé une pareille occasion, une pareille fête, nul ne le supposera, s’il connaît un peu les artistes. Le profond observateur dut ressentir une joie continuelle, en voyant cette nature si différente de la pâle et triste nature déployée sous les regards du soleil septentrional. Une ardente lumière qui tombe par torrents sur des campagnes sèches et poudreuses, une végétation que la chaleur brûle et noircit, un air transparent comme le vide, un ciel toujours pur, d’un bleu indigo, une mer éclatante, aussi bleue que le ciel ou verte comme une émeraude, les silhouettes durement esquissées des objets, les lointains diaphanes des paysages, les hauteurs jaspées, irisées de mille nuances d’or, de nacre, d’opale et d’améthyste, l’ombre couleur d’azur, les nuits sereines où les constellations rayonnent plus grandes, plus magnifiques, voilà ce qui dut l’étonner, le ravir, le plonger dans l’extase et dans une sorte d’ivresse. Bientôt, lorsqu’il traversa l’Andalousie, les palmiers se dressèrent au bord du chemin, les aloès brandirent leurs feuilles pointues et rigides qui simulent des glaives, le laurier-rose déploya son noble feuillage, les cactus allongèrent leurs serpents de verdure. Ayant poursuivi leur route jusqu’à la fin de mai, la splendeur et les grâces d’un printemps espagnol éblouirent successivement leurs regards. Le thym, le genêt, la lavande, l’œillet de Chine et mille plantes inconnues parfumaient l’air de vives senteurs: le myrthe, l’oranger, le citronnier se couvraient de blanches toisons et versaient dans l’air d’autres arômes. Grenade était encore la ville des Abencerages; le nom d’Allah retentissait au fond des mosquées, les lampes éternelles brillaient devant le Dieu du Prophète et les sultanes erraient nonchalamment sous les voûtes sculptées de l’Alhambra. Quels objets d’étude pour notre artiste! Comme il devait examiner les sombres chevelures, les grands yeux noirs, le teint doré, les traits élégants de cette population africaine! Les jours trop rapides de ce merveilleux pèlerinage comptèrent sans doute parmi les plus beaux de sa vie.
La réponse de Philippe le Bon arriva le4du mois de juin. Elle était favorable et les ambassadeurs s’occupèrent immédiatement du traité de mariage, comme on disait alors. Le25du mois de juillet, le sire de Roubais épousa l’Infante par procuration. De grandes fêtes, des repas, des cavalcades, longuement décrits dans une relation contemporaine, ne leur permirent pas de s’éloigner avant la fin de septembre. Ces réjouissances magnifiques, sous une chaleur de trente-cinq à trente-huit degrés, fournirent encore plusieurs sujets de méditation à Van Eyck. Ils s’embarquèrent cependant, mais soit ignorance, soit inadvertance, ils choisirent, pour se confier aux vagues, la terrible saison de l’équinoxe. La Belgique fut près de perdre son glorieux enfant et le tableau de St.-Bavon courut grand risque de ne pas être achevé. Une flotte de quatorze navires portait la princesse, les ambassadeurs et les gens de leur suite. Le mauvais temps les força de relâcher à plusieurs reprises; neuf vaisseaux se perdirent; au bout de quarante jours, ils n’avaient point encore dépassé le nord de la Péninsule. Le chef de l’entreprise, le sire de Roubais, se trouva si malade, si aggrevé, qu’il fallut le descendre à Ribadeo, petit port de la Galice. Seize jours après, il fut assez remis pour continuer le voyage. Mais le pilote se trompa de chemin et ils furent poussés vers la pointe de l’Angleterre, au lieu nommé le camp de César; là, ils se virent menacés d’un naufrage. Mais ils gagnèrent le havre de Plymouth, et le jour de Noël, à midi, les bassins de l’Écluse avaient reçu l’escadre. Isabelle était en mer depuis trois mois.
Jean Van Eyck, bronzé par le soleil du Portugal, se rendit à Gand pour y continuer l’Agneau symbolique. Ce fut alors probablement qu’il peignit les volets de droite; il plaça au fond des orangers avec leurs pommes d’or, le cèdre, le cyprès, qui n’est pas un arbre septentrional, mais un arbre du midi où il atteint des proportions gigantesques, et le tronc nu, les mobiles éventails du palmier. Le fruit des Hespérides et la plante de l’amour chargèrent les mains de deux poètes. Il donna aux ermites, aux pèlerins des figures bazanées, des cheveux noirs, une expression de fanatique piété, comme il en avait vu sur le sol brûlant de l’Estramadure et des Castilles. Là prirent naissance les rapports de la Flandre avec l’Espagne. Chose étrange et bien digne de remarque! ce grand homme, dont le génie ouvrait à la nation le monde poétique des beaux-arts, subissait le premier une influence qui devait un jour déterminer pour longtemps le sort de sa patrie.
Enfin cette œuvre immense fut achevée en1432. On n’y admirait pas moins de trois cent trente figures, toutes ayant un caractère individuel et nulle ne ressemblant aux autres. Le6du mois de mai, on plaça le tableau, on consacra la chapelle; on écrivit ensuite le long du bord inférieur ces paroles latines:
Pictor Hubertus e Eyck, major quo nemo repertus,
Incepit; pondusque Johannes, arte secundus,
Suscepit lætus, Judoci Vyd prece fretus.
VersU seXta Mal Vos CoLLoCat aCta tUeri.
Ce qui veut dire: Le peintre Hubert Van Eyck, le plus grand qui ait jamais existé, a commencé ce tableau, et Jean, le second de son art, s’est chargé de le finir, à la prière de Josse Vydt. Ce vers vous annonce que le six mai on exposa aux regards du public le travail terminé.
Les lettres numériques du chronogramme donnent le chiffre1432, et achèvent de fixer la date.
Cette inscription barbare contient aussi un pieux hommage rendu par Jean à la mémoire de son frère. On y retrouve cette modestie que nous a déjà fait connaître sa devise: mettre Hubert au-dessus de lui, c’était lui accorder le plus brillant de tous les éloges. La conscience de sa propre valeur perce néanmoins sous le panégyrique; en décernant à son maître et ami la première couronne, il est persuadé qu’il l’entoure d’une gloire immense et affirme qu’il n’a jamais eu d’égal. Ce témoignage public nous intéresse d’une autre manière: il prouve que l’aîné des deux peintres commença le retable, qui fut achevé par le cadet. En l’examinant avec soin, on doit y reconnaître deux touches différentes et on peut déterminer quelle portion du tableau revient à Hubert, quelle portion à Jean. C’est dans tous les cas une étude méritoire et curieuse. Nous verrons plus loin les résultats qu’elle donne. Mais si cette notice a une grande valeur historique, on n’a pas le droit d’en exagérer l’importance: je proteste donc formellement contre les inductions que M. Louis De Bast a voulu en tirer. Il a écrit de nombreuses pages où il soutient que «l’invention et le perfectionne ment de la peinture à l’huile, ou, pour mieux dire, l’application de cette méthode aux tableaux proprement dits, avec ce succès complet qui l’a fait adopter par les artistes de toutes les écoles, doivent être attribués à l’aîné des frères. » Il prend au pied de la lettre l’affectueuse hyperbole de Jean et raisonne ainsi: Puisque Hubert était le plus grand peintre qu’on eût jamais vu, c’est donc lui qui a découvert le fameux procédé.–Or, quand même le noble élève n’aurait point amplifié le talent de son guide, quand même il lui aurait été inférieur par l’exécution, hypothèse fausse et inadmissible, cela n’autoriserait point à douter de son génie inventif; car il aurait pu avoir les qualités d’un penseur plutôt que celles d’un peintre. Pour légitimer un doute semblable, un texte positif serait nécessaire. Mais tous les textes parlent en faveur du jeune Van Eyck. Outre Vasari et Karel Van Mander qui lui prêtent leur caution, Facius arrive à son aide. Un autre contemporain, Jean Santi, père de Raphaël, passe totalement Hubert sous silence, preuve de l’éclat supérieur qui entourait son émule:
A Brugi a supra gli altri piu lodati
II gran Joannes, il discepol Rugero,
Con tanti d’alto merto dotati,
Della cui arte e sommo magistero
Di colorire furno si eccellenti
Che han superato spesse volte il vero.
L’effet produit par l’Agneau mystique fut immense. On ne le montrait qu’aux grands seigneurs, ou aux curieux dont la bourse était bien ronde et s’ouvrait aisément, hors certains jours de fête pendant lesquels tout le monde pouvait l’admirer. La foule était alors si épaisse que l’on atteignait avec difficulté la chapelle. Hommes, femmes, vieillards, jeunes gens se pressaient alentour, comme les abeilles et les mouches autour des corbeilles de fruits et de fleurs.
Van Eyck était retourné à Bruges. Il y peignit un autel qui lui valut de grandes louanges; il exécuta aussi de magnifiques portraits, avec le soin, la patience qu’on admire dans tous ses tableaux: derrière les figures, il ouvrait en mainte occasion de charmantes perspectives agrestes. Ses ébauches étaient plus éclatantes, plus fermes que les productions achevées des autres coloristes. Van Mander se rappelait en avoir examiné une chez Lucas De Heere, son maître, où ressortait agréablement une jeune personne, qui se détachait sur un beau paysage. C’est ainsi qu’il travaillait à se rendre immortel, pendant que la vieillesse, l’entourant peu à peu comme une nuit d’hiver, le glaçait déjà de ses premières bises et raréfiait sa chevelure. Mais il ne devait point emporter son secret sous la dalle funèbre: les hommes robustes ne manquent jamais de féconder les esprits, de laisser au monde un vivant souvenir et une glorieuse postérité.