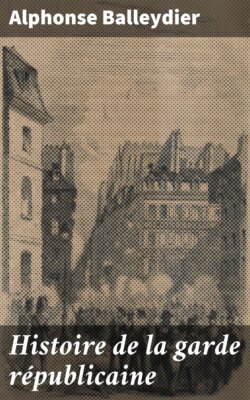Читать книгу Histoire de la garde républicaine - Alphonse 1818-1859 Balleydier - Страница 3
CHAPITRE PREMIER.
ОглавлениеLes Journées de Février. — L’Hôtel-de-Ville. — La République. — Le général Lagrange. — Origine de la Garde républicaine. — Premiers jours — Dévouement et générosité. — Démission de Lagrange. — Rey nommé colonel-gouverneur. — Premières réformes. — Election des officiers. —Armand Marrast. — Nouvel uniforme. — Incident de la manifestation du mois de mars. — Expulsion. — Journée du 15 mai. — Violation de l’Assemblée nationale. — Marche de l’émeute sur l’Hôtel-de-Ville. —Dispositions. — Coup de feu. — Panique. — Curieux dialogue. — Envahissement. — Les Montagnards. — Les Lyonnais. — Services rendus. — Château des Tuileries. — Sommation. — Conflits entre propriétaires et locataires. — 10 francs. — Revers de la médaille. — Indiscipline. —Scènes excentriques. — Attitude des Montagnards le 15 mai. — Préparatifs de siége. — Conciliation. — Licenciement de la Garde républicaine. — Réorganisation.
L’insurrection victorieuse du 24 février venait de laisser au palais Bourbon les députés de la France, étourdis encore du violent coup de tonnerre qui avait brisé en quelques heures le trône de juillet; elle se dirigeait haletante et rapide vers l’Hôtel-de-Ville, elle courait sans songer à ramasser la couronne tombée au pied des barricades, elle arrivait au milieu de son escorte sanglante et noire de poudre, lorsque tout à coup un cri s’élève sur son passage, ce cri était celui de la République. La plus incroyable des révolutions était consommée!
L’Hôtel-de-Ville devint aussitôt la capitale de Paris; le gouvernement provisoire, composé à la hâte de onze noms tombés des lèvres populaires transformées en urnes électives, s’y installe le soir même sans transition aucune, et sans qu’elle sans doutât, la France monarchique devint républicaine.
Cinq cents hommes, sentinelles avancées et soldats d’élite de l’insurrection, se partagèrent immédiatement, sous le commandement de Lagrange, nommé général-gouverneur, les postes principaux de l’Hôtel-de-Ville.
En l’absence des troupes, ces hommes affectés au service militaire de l’hôtel prirent les noms des postes qu’ils étaient chargés d’occuper et de défendre: le poste de l’aile droite, de l’orangerie, de l’escalier du centre, de l’artillerie, du gouverneur des archives, enfin le poste des morts. Celui-ci fut consacré à la garde des victimes de février déposées dans la salle Saint-Jean, embaumées ensuite par le docteur Gannal.
L’origine de la garde républicaine ressemble étrangement à celle de ces vieilles phalanges romaines qui conquirent le monde. Ce fut d’abord des hommes, la plupart sans foyers, sans asiles, sans autre vêtement qu’une blouse en lambeaux jetée sur un pantalon usé par la misère; mais sous cette blouse il y avait une poitrine de fer, et dans cette poitrine un cœur vigoureusement trempé. En quelques jours, ces hommes, qui comptaient d’anciens militaires parmi eux, subirent une transformation complète. La joyeuse insouciance du Bohémien avait fait place à la sévère discipline du soldat; ces hommes à l’épreuve de tous les sacrifices formaient déjà le noyau d’une garde d’élite.
Les commencements de leur vie militaire ont été rudes et pénibles; ils ont éprouvé dans les premiers jours de la révolution toutes les privations, toutes les fatigues qu’on peut subir en campagne. Plusieurs d’entre eux sont demeurés quatre jours et quatre nuits sans prendre une heure de repos, à la porte de la salle où délibéraient les membres du gouvernement provisoire. Jamais délibérations politiques ne furent mieux gardées et mieux protégées.
Pendant les quinze premiers jours, ces soldats improvisés au milieu des barricades couchèrent par un froid glacial et sans vêtements pour ainsi dire, dans les corridors, dans les vestibules, sur les escaliers, partout où il y avait quelqu’un à défendre, quelque chose à conserver. Ce sont eux qui, la nuit du 24 au 25 février, ont préservé du pillage, et au prix de leur vie, la bibliothèque et les archives; ce sont eux qui ont écrit avec du charbon, sur la porte de la bibliothèque, cette inscription: Respect aux arts et aux sciences; ce sont eux qui, trois jours et trois nuits, ont bravé les menaces et les imprécations des figures sinistres qui voulaient y pénétrer pour autre chose que pour l’amour de l’étude.
Ce sont eux qui, malgré le dénuement le plus complet, ont généreusement abandonné pendant quinze jours, au profit des victimes de février, la solde de 1 franc 50 centimes que le gouvernement provisoire leur avait allouée. Ce sont eux enfin qui, pendant plus de deux mois, ont partagé, avec les malheureux qui assiégeaient les grilles de l’Hôtel-de-Ville, les vivres qu’on leur distribuait.
Un des premiers soins de Lagrange, après avoir pris le gouvernement militaire de l’Hôtel-de-Ville, fut de s’entourer d’hommes énergiques, sur lesquels il pût compter, et qui contribuèrent puissamment à la formation et à l’organisation de la garde républicaine. C’étaient un ancien capitaine d’état-major au service du Portugal, M. Rey; puis MM. Guyon, Bauder, Thevenin, chargés des écritures de l’expédition des dépêches et des munitions de guerre.
L’énergie qu’avait dépensée le général-gouverneur et les fatigues de trois jours et trois nuits, le jetèrent dans une prostration telle, qu’il dut donner sa démission.
Le même jour, le gouvernement provisoire pourvut à son remplacement en nommant colonel-gouverneur de l’Hôtel-de-Ville, le citoyen Rey, chef d’état-major de Lagrange.
A partir de ce moment, le nouveau gouverneur s’occupa avec zèle de l’organisation de la garde républicaine. Il lui fit donner des chemises et des souliers, puis une espèce d’uniforme composé du pantalon rouge de l’infanterie, de la blouse bleue en coutil et du képi; il compléta cet uniforme par un équipement formé de la giberne, du fusil et du sabre-poignard.
Le service s’établit avec plus de régularité et les consignes furent plus sévèrement observées.
Quinze jours après, les six postes principaux furent organisés en un bataillon, et ce bataillon divisé en quatre compagnies, appelées un peu plus tard à se donner des officiers par la voie élective.
Cette circonstance raviva les symptômes de discorde qui déjà s’étaient fréquemment manifestés dans le sein de la garde républicaine, surtout au poste des morts, mis à l’index des autres postes pour l’exagération de ses principes démocratiques fortement entachés de communisme. Alors les ambitions se trouvant en jeu, les rivalités travaillèrent dans l’ombre à leur bénéfice et soulevèrent d’affreuses tempêtes. Enfin, malgré mille difficultés, les élections se firent assez paisiblement dans la salle Saint-Jean.
C’est à cette époque qu’un officier, évincé des rangs de la garde, passa avec armes et bagages dans ceux des mécontents pour y fonder un journal en cotillon rouge nommé la Mère Duchène.
Il y avait alors à l’Hôtel-de-Ville un homme de cœur et d’intelligence, un homme à larges vues, à fortes conceptions et d’une probité politique égale à son mérite d’écrivain; cet homme, dont les idées avancées étaient tempérées par la crainte des excès de gens qu’il savait par cœur, était le maire de Paris.
Armand Marrast, qui plus qu’un homme de haute intelligence est encore avant tout un homme de bien, dans toute l’acception du mot, Marrast ne tarda pas à entourer la garde républicaine de toute sa sollicitude; il avait compris, d’un premier coup-d’œil, les services qu’elle pouvait rendre à la patrie.
C’est lui qui remplaça la blouse bleue et le pantalon garance par l’uniforme qu’elle porte aujourd’hui et qu’elle quittera demain.
Cette nouvelle tenue fut composée de la manière suivante: la capote à revers bleus ou rouges avec passe-poil rouge, patte blanche et macaron rouge de chaque côté du collet. Épaulettes de laine rouge à torsades blanches, aiguillettes rouges, pantalon bleu avec une large bande rouge, un bicorne d’après le modèle de 93, et orné d’une flamme rouge.
La garde républicaine, il ne faut pas se le dissimuler, avait été formée dans son principe d’éléments tellement hétérogènes, que, livrés à eux-mêmes, ils auraient pu remonter au chaos.
Peu à peu, avec une grande habileté et des précautions plus grandes encore, le colonel Rey parvint à écumer ce qu’elle renfermait de moins pur. Plusieurs gardes furent congédiés. Ainsi que nous l’avons dit, le poste des morts professait généralement des idées et des principes réduits à la dernière expression du communisme; le colonel Rey surveillait sans relâche les hommes qui en faisaient partie. Parmi ceux-là, il y en avait un certain nombre qui étaient affiliés au club Blanqui. C’était eux qui, de concert avec les Montagnards, faisaient en armes la police de ce club.
Garde Républicaine, juin 1848.
L’occasion, longtemps attendue de les expulser du corps, se présenta bientôt. La grande manifestation du Champ-de-Mars en fournit le prétexte.
Au moment où la colonne des cent mille ouvriers rassemblés marchait sur l’Hôtel-de-Ville, la garde républicaine reçut l’ordre de prendre les armes pour le défendre; mais au même instant le colonel Rey fut averti que des hommes du poste des morts avaient eu le soin d’introduire de la terre dans le canon des fusils de la plupart de leurs camarades.
Le colonel n’hésita pas à changer l’ordre de ses dispositions; il assigna aux hommes du poste des morts une place spéciale pour la défense de l’Hôtel-de-Ville, et plaça en observation près d’eux une compagnie de cinquante gardes dévoués, avec ordre de les fusiller par derrière au moindre mouvement de trahison.
Le lendemain, vingt-deux hommes composant le poste mis en état de suspicion furent expulsés de la garde républicaine.
Quelques jours après, le bataillon de la garde républicaine, augmenté de deux cents hommes, compta deux bataillons de plus.
La mémorable journée du 15 mai et l’envahissement de l’Hôtel-de-Ville ont puissamment contribué au licenciement et à la réorganisation de la garde républicaine. Parcourons à vol d’oiseau les diverses phases de cette journée qui occupe une grande page de l’histoire de la révolution de 1848.
Depuis plusieurs jours, les meneurs et certains présidents de clubs avaient organisé une solennelle manifestation en faveur de la cause polonaise. Cet hommage rendu à la mémoire d’un peuple héroïque n’était qu’un prétexte. La bannière de la malheureuse Pologne, arborée par l’émeute, devait servir d’étendard aux ambitions des ennemis de l’Assemblée nationale. Le pouvoir exécutif, averti du mouvement qui devait avoir lieu dans la journée, avait pris des mesures tardives et malheureusement insuffisantes pour le prévenir ou pour l’arrêter. La colonne, partie à onze heures de la place de la Bastille, se déploya lentement sur les boulevards qu’elle parcourut aux cris de vive la Pologne! et s’avança, sans grands désordres, vers la place de la Concorde. A deux heures, elle était en vue du palais de l’Assemblée nationale. Après un moment d’hésitation de la part des chefs commis à la garde de l’Assemblée, la tête de la colonne se trouva assez forte pour se frayer un passage à travers les troupes, et s’élança dans la salle, où peu de temps après le citoyen Huber, envahissant la tribune, prononça ces fameuses paroles: «Au nom du peuple, je déclare que l’Assemblée est dissoute. »
Pendant ce temps-là, que se passait-il à l’Hôtel-de-Ville? Le colonel Rey, informé que les envahisseurs de l’Assemblée nationale se portaient sur l’Hôtel-de-Ville pour y former un nouveau gouvernement, fit battre le rappel et rassembla la garde républicaine, qu’il dispersa par divisions de trois cents hommes dans les trois cours de l’hôtel, avec ordre de se porter au premier étage en cas d’attaque. Plusieurs bataillons de la garde nationale, convoqués dès le matin, formant un effectif de huit mille hommes environ, s’étaient rangés en bataille sur la place, et en colonnes serrées, pour barrer le quai. Quelques troupes de ligne occupaient les fenêtres de l’Hôtel-de-Ville.
Vingt minutes s’étaient à peine écoulées depuis l’annonce de l’arrivée de la colonne qu’elle atteignait l’angle de la place et se trouvait face à face avec la garde nationale qui n’avait qu’une chose à faire pour l’arrêter... croiser la baïonnette. Il n’en fut rien. Un simple coup de fusil tiré par hasard, et dont la balle vint blesser un garde national à la cuisse, fut le signal d’une panique générale. Les gardes nationaux, se dispersant dans toutes les directions, livrèrent le passage à leurs adversaires qui arrivèrent aussitôt au pas de course à la grille de l’Hôtel-de-Ville.
La grille était fermée. Alors, le colonel Rey, qui se trouvait à l’intérieur de la cour, monta sur la serrure et harangua la foule.
«J’ai un devoir pénible à remplir, dit-il: celui de défendre l’Hôtel-de-Ville. Vous me connaissez, et vous devez savoir qu’il faudra passer sur mon corps pour arriver ici.
— Ouvre-nous, lui disait Barbès, qui se trouvait, ainsi que l’ouvrier Albert, à la tête de la colonne, ouvre-nous; l’Assemblée nationale est dissoute; il n’existe plus de gouvernement, et nous sommes dans la même situation qu’au 24 février. Ouvre-nous, Rey; laisse-nous sauver la France et la république... tu mériteras bien de la patrie!
— Non, Barbès, je n’ouvrirai pas, répondit Rey. Si tu as des ordres, montre-les-moi; montre-moi une ligne écrite par la main d’un des membres de la commission exécutive, sans cela je me ferai tuer ici pour défendre l’entrée du poste qui m’est confié.
— Au nom de l’amitié, Rey, ouvre-moi, ouvre-moi.
— Tu n’es plus mon ami, car tu me proposes une lâcheté ! tu n’es plus mon ami, car tu veux me déshonorer. Retire-toi!»
Mettant fin à ce colloque, qui est de la plus grande exactitude, le colonel Rey avait à peine fait quelques pas pour appeler à lui les deux cents hommes de la garde républicaine campés dans la cour du Centre, que la grille plia sous la pression d’une main inconnue, et que le peuple aussitôt roula comme une avalanche dans le grand escalier.
«Emparez-vous de Rey, s’écria Barbes, mais ne lui faites aucun mal; empêchez-le d’agir, sans cela nous sommes perdus.»
Mais le citoyen Guyon, appuyé par six gardes républicains, le dégagea dans la partie supérieure du grand escalier sous le vestibule.
Sur les trois ou quatre mille personnes qui s’introduisirent dans l’Hôtel-de-Ville, cinq cents à peu près montèrent au premier étage pour y former le nouveau gouvernement provisoire.
Il s’en trouvait parmi quelques-unes très-hostiles à Armand Marrast: «Il faut en finir avec lui, disaient-elles, il faut lui casser la tête; cherchons-le.»
Le citoyen Guyon, qui entendit ces propos, expédia immédiatement vingt gardes républicains dans la galerie et quinze à la porte des grands appartements avec la consigne de se faire tuer plutôt que d’en livrer l’accès.
Pendant ce temps, la garde républicaine faisait évacuer la cour Louis XIV encombrée par trois mille personnes écoutant de violents discours prononcés par des orateurs qui s’étaient fait une tribune du cheval du grand roi.
Cette cour était déjà évacuée lorsque, de tous les quartiers de Paris, arrivèrent en colonnes serrées les nombreux bataillons de la garde nationale, levée comme un seul homme pour défendre et venger l’inviolabilité de l’Assemblée nationale. Quelques instants après cinquante personnes différentes se disputaient l’honneur d’avoir arrêté Barbès.
La garde républicaine est la tige principale de deux autres branches qui, après avoir subi diverses modifications, ont fini par se relier entre elles et former un seul et même corps.
Désignées par le nom de Lyonnais et de Montagnards, ces compagnies, commandées par des chefs différents, relevaient cependant de la même autorité. Elles étaient composées d’anciens militaires, d’anciens détenus politiques et d’un certain nombre de militaires qui, dès le 24 février, étaient venus se mettre à la disposition de Caussidière, pour faire le service de Paris si nécessaire, si difficile. Alors tous les rouages de la police venaient d’être brisés par la violente commotion de février. Ces diverses catégories d’hommes s’organisèrent aussitôt en compagnies sous les dénominations de: Lyonnaise, 24 février, Morisset, Saint-Just, la Liberté, etc., et prirent possession, les Montagnards, de la Préfecture de police, les Lyonnais, du Temple.
Les Montagnards ainsi que les Lyonnais desservaient plusieurs casernes et occupaient divers postes célèbres dans l’histoire de la révolution de février. Les premiers gardaient la caserne Saint-Victor et le fameux hôtel de la Commune de Parts, rue de Rivoli, n° 16; les seconds étaient casernés au quartier des Célestins. Les uns et les autres avaient adopté la même tenue, blouse bleue, ceinture rouge, une énorme cravate rouge jetée autour du cou et un brassard de la même couleur noué au bras.
Ces différents corps, animés de bonnes intentions et dévoués corps et âme aux nouvelles institutions qu’ils avaient conquises sur les barricades, présentaient de graves éléments de désordre. Outre la nature plus que légère des éléments primitifs de leur création, on eut à déplorer le mode qui présida à la formation des cadres d’officiers. La voie élective produisit cela de fâcheux que quelques bons choix se trouvaient absorbés, annihilés complètement par l’ensemble des votes.
De là, sans doute, d’un côté les tendances au retour d’une époque terrible, et de l’autre les justes craintes répandues dans le sein de la population qui, traditionnellement, en avait conservé le lugubre souvenir.
Là où il fallait rassurer on intimida, là où l’unité seule devait exister, on vit régner la division; l’ordre n’était qu’à la surface, l’anarchie débordait la situation de toutes parts, malgré la main ferme et l’énergique volonté de Caussidière. Une réforme était nécessaire, mais son heure n’était pas venue. Attendons quelques jours encore, et une main habile, vigoureuse, une main bronzée au soleil de l’Afrique, viendra prendre les rênes de cette garde qui sera plus tard un corps d’élite dans l’armée française.
Cependant telle qu’elle était organisée, la garde républicaine rendit dès les premiers jours d’énormes services à la cause de l’ordre; services difficiles, dangereux même, et dont ils s’acquittèrent honorablement, nous devons le dire.
La dévastation s’était organisée sur une vaste échelle dans les environs de Paris. Des bandes nombreuses promenaient partout la torche de l’incendie. Livrés à l’anarchie, Neuilly, Rueil et bien d’autres localités se trouvaient exposés au pillage; la désolation et la peur étaient à leur comble, on se croyait déjà reporté aux plus mauvais jours de 1793; c’était la terreur moins l’échafaud. Dans cet état de choses, la garde républicaine ne faillit pas un moment à son rôle de gardienne des droits communs. Elle se mit en campagne, et après deux jours et deux nuits de battues, elle mit fin au fléau dévastateur en ramenant un très-grand nombre de prisonniers.
Plus tard, les malfaiteurs établissent leur quartier-général sous le canon de Vincennes, qu’ils bravent dans le bois qu’ils infestent; la garde républicaine demande elle-même à marcher contre eux. Vingt hommes suffiront; ils partent et ils ramènent soixante prisonniers: trois pour un.
Plus tard encore, des hommes sans nom, le pépin de la garde républicaine, dont les Montagnards sont le noyau, ne veulent pas abandonner le château des Tuileries, qu’ils habitent depuis trois semaines. La vie leur paraît douce et facile; car c’est une vie de plaisirs et de fêtes. Pour table, ils ont celle qui a servi pendant dix-huit années la corruption aux appétits ambitieux des courtisans; pour salon, ils ont la salle des maréchaux de France; pour estaminet, la salle du trône où Louis XIV et Napoléon ont passé avant eux.
Puis le sommeil de la nuit leur paraît si bon entre les rideaux de velours et de soie qui ont abrité de jeunes et belles princesses; les riches tapis des Gobelins deviennent si moelleux sous leurs pas que le sommeil et le pavé de la rue leur semblent durs, et qu’il leur est difficile de renoncer volontairement à de si gracieux loisirs.
C’est encore la garde républicaine, sous les ordres du commandant Martin, qui reçoit la mission de les congédier. On sent tout ce qu’il lui a fallu dépenser de prudence et d’énergie pour les amener à composition; et pour cela les membres du Gouvernement provisoire ont dû parlementer avec eux et subir des conditions.
Plus tard toujours, le terme du mois d’avril arrive, terme fatal pour les locataires; car le commerce est mort et l’argent est rare. Cependant il en faut aux propriétaires pour payer leurs impôts, augmentés dans une effrayante proportion. Les locataires arborent en signe de menace le sinistre drapeau noir sur les maisons des propriétaires exigeants. La garde républicaine accourt, et partout elle rétablit l’ordre par de sages et légitimes concessions, qu’elle provoque et opère de part et d’autre.
Dans la rue des Marais, un malheureux propriétaire supplie un locataire d’accepter le congé qu’il lui donne avec l’abandon absolu de deux termes échus; le locataire refuse:
«Donnez-moi 10 francs, dit-il, pour mon déménagement, sinon, comme cet appartement est à mon gré, bon gré mal gré j’y resterai.»
Le propriétaire s’irrite de ces conditions, qu’il trouve dures; la discussion s’engage, les groupes se forment, une patrouille de gardes républicains arrive, et leur commandant dissipe les attroupements en donnant de ses deniers la somme de 10 francs, cause première de la difficulté.
Cependant ces hommes si généreux, si sympathiques et si dévoués à leur consigne deviennent indomptables hors de leur service. Alors ils ne connaissent plus l’autorité des chefs qu’ils se sont donnés; ils les mettent aux arrêts, les cassent même et en nomment de nouveaux. Les scènes les plus bizarres, les plus extraordinaires se passent dans leurs divers quartiers. Le drame broche sur le comique, qui lui-même est dépassé par le burlesque.
Aux Tuileries, les Montagnards se donnent un bal, auquel ils assistent parés et couverts des habits des princes. Les plus jeunes d’entre eux, transformés en princesses, remplissent le rôle des femmes.
Aux Célestins, ils fouillent les tombeaux des moines, et découvrent des corps dont l’embaumement rendrait jaloux les clients de M. Gannal.
Une nuit, cette caserne s’illumina comme par enchantement; minuit sonna, et tout à coup des cris de mort s’élevèrent contre le commandant Morisset, condamné au supplice de la strangulation. Mais ce commandant, peu flatté de ce genre de mort, avait eu la précaution de se mettre à l’abri; ils le cherchèrent vainement partout. Furieux de voir que leur victime leur avait échappé, ils se dépouillèrent de leurs vêtements, et se mirent à exécuter autour de l’arbre de la liberté une danse des plus sauvages. Cette nuit-là, ils ont profané le magnifique chant de Rouget de Lisle.
Les Montagnards casernés à la Préfecture de police n’étaient guère mieux disciplinés. Les scènes les plus étranges se passèrent également parmi eux; la plus importante cependant est celle qui se rattache aux événements du 15 mai.
Pendant que le corps principal de la garde républicaine, chargé de la défense de l’Hôtel-de-Ville, fait acte de dévouement et repousse l’émeute bondissante qui s’était répandue dans l’intérieur de l’Hôtel, les Montagnards, retranchés à la Préfecture, oubliés à dessein peut-être et ne recevant aucun ordre, avaient cru devoir conserver une attitude expectante et passive. L’émeute, qui peut-être avait compté sur eux, ne les vit point à son avant-garde; l’ordre de choses menacé ne les compta point non plus dans les rangs de ses défenseurs. De là provint sans doute l’explosion de colère qui, depuis si longtemps, bouillonnait dans le cœur de la garde nationale, et qui le lendemain éclata contre eux comme une bombe.
Les bruits les plus contradictoires à leur endroit se répandirent dans Paris. Ils méconnaissaient, disait-on, l’autorité du vœu national en contestant le pouvoir aux députés que la France avait choisis pour ses représentants. Satellites damnés de l’idée républicaine fond rouge et des plus foncés, ils étaient barricadés dans l’intérieur de la Préfecture, et s’apprêtaient à soutenir le siége. On disait encore que, décidés à la résistance extrême qui ne s’arrête qu’à la mort, ils avaient juré de mourir jusqu’au dernier.
Aussitôt le tambour bat le rappel; enivrés par le facile succès de la veille, la garde nationale rallie ses légions, la garde mobile et la ligne préparent leurs armes; puis ligne, mobile et garde nationale s’avancent en masse vers la Préfecture. Six pièces de canon sont dressées en batterie contre la porte principale; les servants sont debout près d’elles et mèche allumée. La collision paraît imminente; elle sera terrible!
Il y a sept cents hommes armés jusqu’aux dents, et ces hommes sont prêts à la résistance. Cependant on se décide à entrer en pourparlers. Plusieurs membres du pouvoir exécutif sont introduits près d’eux, et les engagent à rendre leurs armes et à quitter la Préfecture. Ils s’y refusent.
«Nous ne sommes point des rebelles, disent-ils, nous sommes soldats, et nous laisser désarmer serait une lâcheté ; nous sommes républicains ni plus ni moins que vous; si l’ordre nous avait appelés hier à la défense du pouvoir attaqué, nous nous serions fait tués tous au besoin pour lui. Sourds à la voix de l’émeute qui nous appelait à elle, nous sommes restés fidèles à celle de l’ordre, qui cependant méconnaissait nos intentions, les injuriait même en nous oubliant à l’heure du danger.
— N’importe, leur fut-il répondu, il faut déposer vos armes et quitter la Préfecture.»
Les Montagnards persistent énergiquement dans leur refus. Ils déplorent le sang qui sera versé, mais ils préfèrent la mort du soldat au déshonneur.
«Nous voulons bien quitter la Préfecture, ajoutent-ils, mais non comme des traîtres ou des vaincus, non la nuit comme des voleurs; nous sortirons avec nos armes, pour nous rendre aux différents quartiers qui nous seront désignés.»
Enfin on tombe d’accord; les Montagnards, pleinement justifiés de leur conduite de la veille, abandonnent l’hôtel de la Préfecture, non point en vertu d’une capitulation, mais en soldats qui changent de garnison.
Quelques jours après, par un décret du 20 mai, la garde républicaine proprement dite, le bataillon de l’Hôtel-de-Ville, le bataillon dés Lyonnais casernés au Temple et les Montagnards furent licenciés.
Une commission fut immédiatement nommée par le ministre de l’intérieur pour réorganiser sur une autre base cette garde qu’elle devait porter à un effectif de deux mille hommes de pied et six cents hommes de cavalerie.
Cette commission fut ainsi formée:
Armand Marrast, maire de Paris, président; Dames-me, colonel au 11e léger; Besme, major au même régiment; Rebillot, colonel de la gendarmerie de la Seine; Hingray, représentant du peuple; Labeylonie, adjoint au maire du 5e arrondissement; les citoyens Simonet et Charpentier, délégués de la Préfecture de police, et le capitaine du génie Baillemont, secrétaire de la commission et délégué par le ministre de l’intérieur.
Dès les premières séances les membres de la commission arrêtèrent que la garde républicaine serait portée à un effectif de deux mille deux cents hommes de pied, divisés en trois bataillons, et quatre cents hommes de cavalerie, divisés en quatre escadrons; ils arrêtèrent en même temps les différents genres de services auxquels cette garde devait être affectée, à savoir:
La garde de l’Hôtel-de-Ville, de la Préfecture de police, du ministère de l’intérieur, le service intérieur des spectacles, et l’occupation des postes situés dans les communes de la banlieue les jours de bal. Elle devait être dispensée de tout service intérieur pour les bals et concerts, soit publics, soit particuliers; celui des prisons et des tribunaux était retiré de ses attributions pour passer dans celles de la gendarmerie. Enfin, il fut décidé qu’elle pourvoierait au service des fêtes publiques, concurremment avec les troupes de ligne.
Cette organisation, adoptée par le pouvoir exécutif, fut immédiatement insérée au Bulletin des lois. Le citoyen Raymond fut nommé colonel de la nouvelle garde républicaine et prit spécialement le commandement de l’infanterie.
Le colonel Raymond, condamné pour cause politique à la peine de mort par les conseils de guerre, est le modèle de la probité et du courage militaire. Chef de bataillon au 61e de ligne, il a laissé les plus vifs regrets dans ce régiment qui l’aimait comme père et l’estimait comme chef, ce régiment, brave entre les plus braves régiments, dont le chiffre est inscrit en traces indélébiles sur la pierre romaine et sur le granit de l’Atlas. Sa noble, belle et bonne figure, son sang-froid au milieu du danger, rappellent ces anciens officiers de l’empire que la gloire semblait avoir taillés exprès pour les offrir, sur le piédestal de la France, à l’admiration de la postérité.
La garde républicaine, ainsi reconstituée, comptait dans ses cadres un grand nombre d’officiers distingués: les uns avaient gagné leurs épaulettes à la pointe de l’épée dans les plaines brûlantes de l’Afrique, les autres les obtinrent en récompense, en réparation peut-être de longues souffrances subies dans les prisons politiques.
Cependant il manquait encore un chef à la garde républicaine; l’armée d’Afrique le lui donna, à regret, sans doute, puisqu’elle perdit un de ses meilleurs officiers. M. Paul-Edouard de Vernon, le plus jeune d’une famille toute militaire, arrivé à Paris le 23 avril, fut nommé, le 9 juin, lieutenant-colonel de la garde républicaine, et prit aussitôt le commandement de la cavalerie.
La garde républicaine qui compte dans ses rangs, ainsi que nous l’avons déjà dit, un grand nombre de soldats d’Afrique, la garde tout entière applaudit avec enthousiasme à l’excellence de ce choix. En effet, nul officier n’était plus digne de commander ce corps d’élite.
Né dans la Bretagne, la pépinière des forts et des vaillants, le colonel de Vernon est le type de l’honneur, la personnification de la vertu militaire; son nom est écrit à chaque page de l’histoire de l’Afrique. Il n’a pas quarante ans et il compte trente-six campagnes. Il a été cité huit fois à l’ordre du jour de l’armée, et sept fois encore pour sa valeur et les services rendus à la patrie.
Après s’être particulièrement distingué sous les murs de Bougie et de Constantine, à l’expédition du Biban et au col d’Oued-Beham,. il prend pour témoins de sa valeur les montagnes des Beni-Ourach. Plus tard il se retrouve dans le pays des Sendjess, au col de Bab-Messema, à Ibea, et, comme partout, il donne à ses amis, comme aux ennemis, l’exemple de la bravoure et de l’intrépidité.
Dès-lors la garde républicaine ainsi constituée fit espérer à la patrie un dévouement qui, quelques jours après, s’éleva à la hauteur des circonstances.