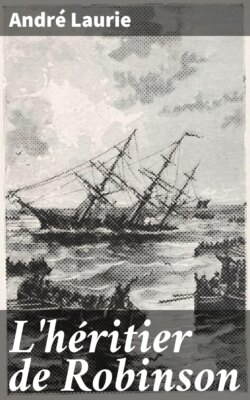Читать книгу L'héritier de Robinson - André Laurie - Страница 14
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE CODICILLE DU COLONEL ROBINSON
ОглавлениеLe personnage qui recevait un accueil si cordial et même si enthousiaste était un homme aux traits bronzés, au type hindou, à la moustache grise, dont le costume tenait le milieu entre celui d’un rifleman et celui d’un indigène des classes aisées. Les cheveux coupés ras, le port de ses épaules et de ses bras, aussi bien que sa petite veste rouge, le désignaient clairement comme un soldat ou un ancien soldat de l’armée britannique; la forme particulière de son front, la courbure de son nez, l’éclat de ses yeux, comme son large pantalon de toile blanche, ses sandales et sa ceinture de crêpe, appartenaient à un enfant du Bengale. Et, en effet, Khasji était à la fois Anglais et Indien, — Anglais par son père, Indien par sa mère. Entré de bonne heure dans l’armée de Sa Majesté la reine de Grande-Bretagne et d’Irlande, impératrice des Indes, il avait fait plusieurs campagnes aux côtés du colonel Robinson et lui avait toujours montré un dévouement dont Chandos et Florence lui témoignaient leur reconnaissance par une affection sincère et des égards marqués.
Égards et affection qu’il leur rendait bien, certes, et qui se traduisaient, au moment où il pénétra dans le salon, par un sourire fendu jusqu’aux oreilles.
Mais, soudain, il aperçut mistress O’Molloy qui le regardait, du haut de sa bay-window, et aussitôt, reprenant son air le plus sérieux et l’attitude respectueuse du soldat devant ses supérieurs légitimes, il avança d’un pas automatique, s’arrêta à la distance réglementaire, et attendit, la main au front, qu’on lui adressât la parole.
«Eh bien, Khasji? demanda mistress O’Molloy.
— Les lawyers (gens de loi) sont là,» fit-il simplement.
Ce mot de lawyers était dans la bouche de Khasji, comme on dit, tout un poème. Il résumait, en tout cas, dans une simple intonation, l’incommensurable dédain que le soldat ressentait pour les «pékins» en général, et spécialement pour cette quintessence de «pékin», un homme de loi.
Mistress O’Molloy, tout imbue qu’elle était d’esprit militaire, ne paraissait pas partager sur ce point les opinions de Khasji, car la nouvelle sembla l’intéresser vivement.
«Ce sont les solicitors du pauvre colonel, MM. Selby et Graham, expliqua-t-elle à M. Gloaguen. Je les ai fait prévenir de votre arrivée, et sans doute ils viennent se mettre à votre disposition. Voulez-vous qu’on les fasse entrer?.,.
— Je ne demande pas mieux,» répondit M. Gloaguen en s’étonnant un peu d’une visite professionnelle à pareille heure.
Mistress Major O’Molloy lui apprit alors que cette heure n’avait rien d’insolite à Calcutta, où toutes les affaires se traitent le matin et le soir, à raison de la chaleur accablante du jour. Ce qu’elle ne dit pas, c’est qu’elle était dévorée de curiosité à l’endroit des dispositions testamentaires du colonel; que l’apposition des scellés sur les papiers du défunt avait eu tout spécialement le privilège de mettre son imagination en émoi, et qu’elle avait dépêché Khasji chez les deux procureurs avec requête toute particulière de venir le plus tôt possible.
«Faites entrer ces messieurs à l’instant,» dit-elle à Khasji, qui pivota aussitôt sur ses talons, exécuta un demi-tour et sortit d’un pas cadencé, comme si tout un orchestre de fifres et de cornemuses lui avait bat u la mesure.
Les deux solicitors furent bientôt introduits et présentés par mistress O’Molloy à M. Gloaguen. Comme tous les solicitors, attorneys, notaires et avoués du monde, ils avaient le menton et les lèvres rasées de près, portaient des favoris en côtelettes, une redingote noire, un faux-col majestueux, des breloques et une serviette en veau verni. M. Selby, le senior de l’association, avait en outre une abondante chevelure d’un blond fade, un lorgnon d’écaille et une bague au petit doigt. M. Graham, le junior, était chauve et portait des lunettes. De sorte que, — comme le senior partner aimait à le constater, — c’est lui qui avait l’air d’être le junior.
A leur entrée, Florence et Chandos, par un sentiment délicat des convenances, quittèrent le salon, et Paul-Louis crut devoir faire de même. Mistress O’Molloy allait les suivre, fort à contrecœur, quand M. Gloaguen la pria de rester, ce qu’elle accepta sans difficulté.
M. Graham prit alors la parole, en assez mauvais français. Il expliqua qu’en exécution du testament de feu le colonel Robinson, son collègue et lui avaient fait fermer de panneaux de bois les portes et fenêtres du cabinet de travail, où se trouvaient tous les papiers du défunt, avaient apposé les scellés sur ces panneaux et étaient prêts maintenant, si M. Gloaguen le désirait, à lever ces scellés en sa présence.
«Ce soir même? demanda l’archéologue.
— A l’instant, Monsieur; ce sera une affaire terminée, et nous pourrons faire entre vos mains la remise de tous ces papiers.
— Mais la présence d’un magistrat de police n’est-elle pas nécessaire?» reprit M. Gloaguen.
On lui expliqua que non. Les solicitors avaient qualité pour procéder à l’opération.
Cela étant, il ne restait plus qu’à se diriger vers le cabinet de travail. C’est ce qu’on fit sans délai, sous la conduite de Khasji.
Sur la porte provisoire posée à l’entrée de la pièce réservée s’étalaient trois larges cachets de cire rouge. Les scellés ayant été reconnus intacts par MM. Selby et Graham, furent aussitôt levés; la clef grinça dans la serrure, les verrous furent tirés, et la porte s’ouvrit.
Une bouffée d’air chaud frappa le visage des visiteurs. Cette grande pièce, restée close depuis deux mois, avait quelque chose de sépulcral avec des fenêtres bouchées comme la porte par des panneaux de bois provisoires. Mais, à part ce détail, tout était dans l’état où le colonel l’avait laissé la veille de sa mort. C’est dire que tout était rangé dans un ordre parfait, les bibliothèques, les cartonniers, les grands albums à coins d’argent portés sur des pliants en X, les casiers à notes en bois d’ébène, le grand bureau cylindre placé au milieu de la salle.
M. Gloaguen fut d’abord attiré par des fragments de marbre et des bronzes antiques, disséminés sur tous les meubles. Presque tous étaient relatifs à l’archéologie indienne; quelques-uns à l’art cambodgien préhistorique. D’emblée, M. Gloaguen se sentit dans un milieu sympathique à ses goûts, sinon aux objets spéciaux de ses études personnelles; il suivit donc avec un vif intérêt les opérations des deux solicitors.
«C’est vraisemblablement dans le bureau que nous trouverons les papiers les plus importants, dit M. Graham. Si vous le voulez bien, Monsieur, nous commencerons par là notre inventaire?»
M. Gloaguen fit un signe d’assentiment, et aussitôt M. Selby, tirant de sa poche un trousseau de clefs, se mit en devoir d’ouvrir le bureau.
Les casiers intérieurs, les premiers tiroirs qu’on examina, ne semblaient contenir rien de particulièrement intéressant. Mais, en soulevant le plancher même du bureau, à l’aide d’un bouton métallique très apparent, M. Selby, mit au jour une sorte de trou carré ou de réservoir, doublé en cuivre, où l’on vit d’abord une grande enveloppe carrée, à l’adresse de M. Gloaguen, avec cette mention:
«Ceci est mon testament archéologique. G. P. C. ROBINSON.»
Le solicitor s’empressa de remettre le paquet à M. Gloaguen, qui l’ouvrit aussitôt en se rapprochant d’une lampe, tandis que la visite se poursuivait.
Il vit alors que l’enveloppe contenait:
1° Un petit portefeuille de maroquin, fait expressément pour abriter et protéger une plaque d’or très mince, d’un décimètre carré environ, sur laquelle étaient gravées des figures presque effacées par le temps.
2° Un mémoire manuscrit formant une centaine de pages de l’écriture du colonel, avec dessins à la plume.
3° Une note que M. Gloaguen s’empressa de parcourir, et qui était ainsi conçue:
«Strictement confidentielle.
A M. BENJ. GLOAGUEN.
«Calcutta, le 19 mars 1882.
«Mon cher beau-frère,
«Si je ne me suis point trompé dans mon appréciation de votre caractère, vous serez venu vous-même, comme je vous l’ai demandé, recueillir ici mon héritage archéologique. Si des obstacles insurmontables vous ont empêché de venir en personne, je ne doute pas que MM. Selby et Graham ne vous aient fait tenir ce paquet par voie sûre. Un examen même superficiel de la plaque ci-jointe suffira à vous en indiquer la valeur scientifique.
«C’est un monument unique, découvert par moi, il y a deux ans, dans le sous-sol de l’antique mosquée de Ram-Mohun, près de Candahar, et que je n’hésite pas à considérer comme l’inscription la plus antique qu’il y ait actuellement à la lumière du jour.
«Des motifs d’ordre politique m’ont obligé jusqu’à ce moment à en tenir la trouvaille secrète. Vous les trouverez développés tout au long dans le mémoire ci-joint. Il suffit de vous dire en deux mots que cette plaque, renfermée dans une sorte de coffre en pierre dure, que les mahométans du pays considèrent comme l’héritage d’un de leurs premiers marabouts, est pour eux l’objet d’un culte tout spécial. Ils l’appellent zraïmph. Si j’avais immédiatement avoué ma conquête, le gouvernement britannique aurait probablement jugé nécessaire de la restituer aux Afghans, qui la regardent comme un véritable palladium, et qui d’ailleurs ignorent encore sa disparition.
«Moi qui me la suis appropriée au nom de la science et au péril de ma vie, comme prime unique de la victoire remportée par mon régiment sur les brigands de Candahar, je ne saurais m’arrêter à de tels scrupules. D’autant que les Afghans n’ont en réalité aucun titre à la possession de cette relique.
«Elle appartient à une civilisation et à une religion fort antérieures aux leurs, et, qui plus est, elle appartient à l’histoire, à l’humanité.
«J’ai donc résolu de la garder au moins jusqu’à ce que je l’aie entièrement déchiffrée. Après quoi, je l’emporterai en Angleterre, et je la déposerai moi-même au British Museum. Nous verrons bien alors s’il peut être question, à la face de l’Europe savante, de la restituer aux mécréants qui m’ont tué tant de braves soldats!
«S’il ne m’est pas donné d’achever ce travail de traduction, c’est à vous, mon cher beau-frère, que j’en confie l’achèvement. Vous ferez ensuite de la plaque tel usage que vous dictera votre conscience.
«Comme vous le verrez dans le mémoire ci-annexé, je la considère d’ores et déjà comme un monument chaldéen relatif au déluge ou à quelque autre cataclysme des temps primitifs. Je vous lègue ce trésor, comme je vous lègue mes enfants et mes papiers, spécialement mes notes et documents sur les antiquités du Cambodge.
«Signé : G. P. C. ROBINSON.»
Le cœur de M. Gloaguen battait, en parcourant cette note, d’une émotion que les savants seuls comprendront. Avant de serrer le précieux portefeuille dans la poche intérieure de sa redingote, il voulut lui donner un second coup d’œil et le rapprocha tout ouvert de la lampe placée auprès de lui.
Tout de suite, il reconnut, avec sa grande habitude des écritures chaldéennes, que l’hypothèse du colonel devait être parfaitement fondée. Et, circonstance plus émouvante encore, certains signes gravés sur la plaque d’or semblaient être ceux du zodiaque druidique!... Quelle mine inépuisable de recherches, d’inductions et de déductions!... Le cœur de l’archéologue débordait de joie. Volontiers il aurait baisé la bienheureuse plaque, s’il avait été seul. Mais il s’aperçut qu’il était temps de sortir de son aparté, et, refermant dévotement le portefeuille, il le serra sur son cœur.
A ce moment il aperçut les yeux de Khasji fixés sur lui avec une expression singulière où il crut lire à la fois de la terreur et de la pitié.
«Eh bien! qu’est-ce donc, mon brave? lui dit-il en anglais, du mieux qu’il put. Connaissez-vous donc cette plaque, que vous la regardez ainsi?»
Khasji avait baissé la tête.
«Si je la connais! fit-il d’une voix sourde. J’étais avec le colonel quand il l’a prise. Et maudit soit ce jour! Car elle a causé sa mort, j’en suis sûr, comme elle causera celle de ses enfants et la vôtre sans doute!...
— Bon! ce sont là des superstitions indignes d’un brave soldat comme vous, répliqua M. Gloaguen. Comment pouvez-vous croire que la possession d’une petite plaque d’or mette en danger la vie de celui qui l’a dans sa poche?...
— Je ne sais pas, dit Khasji en se grattant l’oreille. Je ne suis qu’un pauvre soldat!... mais je crois ce que je crois, et on ne m’ôtera pas de la tête que c’est de cette satanée mécanique qu’est venue la mort du colonel et que viendront encore d’autres malheurs!...
— Le pauvre homme déraisonne!» se dit M. Gloaguen sans attacher plus d’importance à l’incident.
Et, se réservant de demander plus tard à Khasji quelques détails sur les circonstances de la grande découverte, il revint vers mistress O’Molloy, qui avait suivi, avec une secrète jalousie, depuis quelques minutes, l’entretien de son hôte avec le soldat.
Les deux solicitors, poursuivant leur œuvre, avaient naturellement ouvert tous les tiroirs, tous les cahiers, toutes les vitrines. Une rapide inspection suffit à montrer à M. Gloaguen qu’il y avait là, spécialement en notes sur l’architecture kmer, de véritables trésors archéologiques. Mais il ne pouvait être question de les passer en revue sur l’heure, et, d’ailleurs, le véritable but de la visite était atteint, puisque le codicille annoncé dans le testament du colonel venait d’être trouvé.
M. Gloaguen en donna donc reçu aux deux solicitors, pour dégager leur responsabilité ; puis tout le monde revint au salon, en abandonnant à Khasji le soin de refermer la porte du cabinet du colonel.
Une rapide conférence relative à la situation financière laissée par le défunt termina les opérations légales. Il fut convenu que MM. Graham et Selby transmettraient au notaire de M. Gloaguen, sous forme de délégation sur la Banque d’Angleterre, toutes les valeurs de la succession. Puis on cessa de s’occuper d’affaires pour déguster des sorbets, et les deux solicitors prirent bientôt congé.
Quand le bruit de leurs pas eut cessé de se faire entendre dans le vestibule, mistress O’Molloy se rapprocha vivement de M. Gloaguen, comme pour dire:
«Enfin, nous allons donc pouvoir causer, et vous allez me faire part de ce que contenait ce fameux codicille!»
Mais son attente fut trompée. M. Gloaguen dit simplement que l’héritage archéologique du colonel semblait être d’un grand intérêt, et qu’il faudrait assurément plusieurs mois pour dépouiller tous ces papiers. Aussi ne pouvait-il songer à se livrer à ce travail à Calcutta, et pensait-il faire emballer dès le lendemain toutes les paperasses pour les expédier à Paris.
«J’en serai ainsi débarrassé et je serai plus libre de mes mouvements, poursuivit-il. Car vous pensez bien, Madame, que mon fils et moi n’allons pas abuser de votre gracieuse hospitalité. Nous n’avons qu’un temps très restreint à donner à notre voyage et, puisque voilà les affaires réglées, le mieux sera pour nous d’utiliser ce temps à visiter l’Inde...
— N’aviez-vous pas aussi l’intention d’aller au Cambodge? demanda mistress O’Molloy.
— Ah! je crois bien qu’il faudra abandonner ce projet. La Cochinchine et Calcutta, cela semble tout près l’un de l’autre sur la carte. Mais quand on est sur les bords du Gange, on s’aperçoit qu’il s’agit d’un véritable voyage pour aller à Saïgon... Le plus sage sera, je crois, pour mon fils et moi, étant donné surtout que nous avons à ramener Florence et Chandos en Europe, de nous contenter de la plus modeste des excursions, — le voyage transpéninsulaire de Calcutta à Bombay. Nous mettrons un mois ou six semaines à le faire et nous verrons certes dans cet intervalle autant de belles et curieuses choses qu’il est possible d’en passer en revue dans si peu de temps: Bénarès, Allahabad, Luknow, Delhi, Agra, Jeypore, Barsun, Surate, Ellora...
— Une simple promenade, en effet!
— Oh! j’ai beaucoup rabattu de mes prétentions, reprit M. Gloaguen avec un sourire interne, en serrant sur son cœur la précieuse plaque d’or. Pourvu que je puisse voir au passage quelques-uns de ces monuments illustres, que je connais déjà par la gravure ou la photographie, je me tiendrai pour satisfait. Eh bien! cet itinéraire nous permettra de voir le temple de Jaghernath, l’idole de Mandar près de Bhagalgore, l’escalier cyclopéen de Sechnaga et la varaha avatar à Oudghiri, les ruines du palais de Ranakhoumbon à Chittore, les caves d’Ellora, la grotte des Lions, et cent autres merveilles classiques. Je serais vraiment difficile à contenter, si je n’étais pas satisfait de ce menu. Sans compter que notre voyage en mer sera abrégé, en allant nous embarquer à Bombay...»
Mistress O’Molloy, un peu déconcertée de voir la conversation s’écarter ainsi du codicille, essaya de la ramener à cet intéressant objet, en parlant de la mort du colonel.
«Je me demande souvent, fit-elle, si le pauvre colonel n’a jamais eu le moindre soupçon sur la nature de l’inimitié qui le poursuivait... N’en dit-il rien dans le codicille?
— Absolument rien. Il ne s’agit dans ce document que de questions scientifiques.
— C’est que, insista mistress O’Molloy, si le colonel avait laissé quelque fil pouvant conduire à la découverte de ses meurtriers, ce serait un véritable devoir de le communiquer à la justice!... Il est bien évident qu’il a été assassiné ! Toutes ces tentatives accumulées ne peuvent pas laisser place au moindre doute... Et à ce propos, Monsieur, si je ne suis pas trop curieuse, que vous disait donc Khasji, tout à l’heure? Je gage qu’il vous parlait de ses folles craintes pour Chandos?...
— Pour Chandos?... Non, pas spécialement. Il paraissait croire à l’existence de je ne sais quel danger occulte, qui a déjà frappé le colonel, et qui peut se porter sur ses enfants, sur moi-même...
— Oh! c’est surtout pour Chandos qu’il a des craintes. Figurez-vous qu’il est toujours sur ses talons, autant qu’il peut, et que la nuit il couche en travers de sa porte, comme il faisait autrefois pour le colonel!... On ne peut pas lui ôter de la tête que Chandos est en danger, parce qu’il lui est arrivé deux ou trois petits accidents sans importance, — une barre de trapèze qui a cassé, une chute de cheval, — de ces choses enfin qui arrivent tous les jours aux jeunes garçons.»
Un frisson courut tout à coup sur l’épiderme de M. Gloaguen, le souvenir de l’accident du matin venait de le frapper comme une coïncidence au moins étrange.
«Vraiment? fit-il. Chandos a eu plusieurs aventures de ce genre, récemment?... Depuis la mort de son père?...
— Oui, mais, je le répète, de ces petites aventures auxquelles les garçons sont habitués et qui ne les arrêtent même pas cinq minutes.
— Celle de ce matin, maintenant que j’y pense, avait un caractère particulier! reprit M. Gloaguen tout pensif et se parlant à lui-même.
— Comment, celle de ce matin? demanda mistress O’Molloy. Il y a encore eu un accident, ce matin, et je n’en ai rien su?...»
M. Gloaguen conta l’épisode du canot chaviré. Il dit comme il avait été frappé de la brutalité du coupable, qui ne s’était pas détourné de sa route après avoir heurté le bateau de Chandos, et même semblait l’avoir fait avec préméditation...
— C’est étrange, en vérité, dit à son tour mistress O’Molloy, subitement prise d’inquiétude. Comment se fait-il qu’on ne m’ait pas encore parlé de tout cela?... Et où sont donc ces enfants?... Voilà un siècle qu’on ne les a vus...»
Elle se leva brusquement, toucha un timbre, s’informa. Miss Florence, Paul-Louis et Chandos étaient dans le petit salon voisin, causant gaiement et se contant des souvenirs de collège. On les fit appeler à l’instant: ils rentrèrent avec des physionomies si fraîches et de bonnes figures si bien vivantes et épanouies qu’il était impossible d’associer leur présence à des idées sinistres.
Mistress O’Molloy et M. Gloaguen eurent la même pensée qu’ils échangèrent dans un sourire.
«Voilà pourtant la peur! se disaient-ils. Il suffit d’un poltron pour vous mettre martel en tête et vous faire voir des monstres partout...»
Il était déjà tard et les voyageurs devaient avoir besoin de repos. On se dit bonsoir et l’on se sépara sur le palier de l’escalier de marbre: les dames pour se rendre à leurs chambres à coucher, qui s’ouvraient sur le parc ou du moins sur la véranda du premier étage; M. Gloaguen, Paul-Louis et Chandos, pour gagner l’appartement opposé, ouvert sur la cour d’honneur.
«Ah! voilà Khasji qui a déjà apporté son matelas! dit Chandos en montrant une natte roulée près de sa porte. Croiriez-vous qu’il a pris ainsi en campagne l’habitude de coucher à terre et ne peut pas s’en défaire?...
«Bonsoir, mon oncle!... Bonne nuit, mon cousin!...»