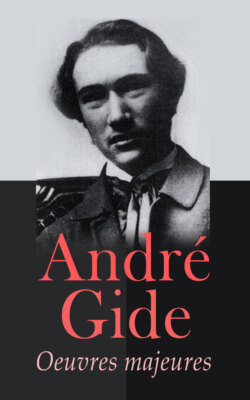Читать книгу André Gide: Oeuvres majeures - Андре Жид - Страница 5
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LE CAHIER BLANC
ОглавлениеTable des matières
Attends,
Que ta tristesse soit un peu plus reposée, – pauvre âme, que la lutte d'hier a faite si lasse.
Attends.
Quand les larmes seront pleurées, les chers espoirs refleuriront.
Maintenant tu sommeilles.
Berceuses, escarpolettes, barcarolles,
Le chant des pleureuses alanguit les chutes.
Il te faudra prier bien sagement ce soir, et que tu croies. Cela te reste, qui ne te sera pas ôté. Tu diras : Le Seigneur est ma part et mon héritage ; quand tous m'abandonneraient, tu ne me laisseras pas orphelin.
Et puis tu dormiras, – car ne réfléchis pas encore : les jours amers ne sont pas assez loin.
Endors le souvenir au gré des rêves.
Repose.
Jeudi.
Écrit des lettres...
J'ai tâché de lire, de penser... La fatigue assoupit ma tristesse ; il me semble l'avoir rêvée.
Maintenant, sous les arbres ;
L'ombre est pacifiante.
*
Que la nuit est silencieuse. J'ai presque peur à m'endormir. On est seul. La pensée se projette comme sur un fond noir ; le temps à venir apparaît sur le sombre comme une bande d'espace. Rien ne distrait de la vision commencée. On n'est plus qu'elle.
Il ne faut pas que l'âme s'alanguisse en ses rêveries mélancoliques, – mais qu'elle se réveille enfin et recommence à vivre.
⁂ Quelque soir, revenant en arrière, je redirai ces mots de deuil ; maintenant cela m'écœure d'écrire : la phrase n'est pas pour ces choses, émotions trop pures pour être parlées ; – j'ai peur qu'une rhétorique, d'ailleurs impuissante, ne profane ; par haine des mots que j'ai trop aimés, je voudrais mal écrire exprès. Je romprai les harmonies, fussent-elles fortuites :
Que tu reposes en paix, ma mère. Tu as été obéie.
Certes, l'amertume de cette double épreuve étonne encore mon âme ; pourtant, pas trop de tristesse ; ce qui domine, c'est l'orgueil d'avoir vaincu. Tu me connaissais bien si tu pensais que l'excès même de cette vertu m'exciterait à la suivre. Tu savais que les routes ardues et téméraires m'attirent, que ma volonté aime les poursuites insensées, à cause du rêve, et qu'il faut un peu de folie pour rassasier mon orgueil.
Tu les as fait tous sortir pour me parler à moi seul, – c'était quelques heures seulement avant la fin : « André », m'as-tu dit, – « mon enfant, je voudrais mourir reposée. » Je savais déjà ce que tu me dirais et j'avais rassemblé mes forces. Tu te hâtais de parler, car ta fatigue était grande : « Il serait bon que tu quittes Emmanuèle... Votre affection est fraternelle, – ne vous y trompez pas... L'habitude d'une vie commune l'a fait naître. Bien qu'elle soit ma nièce, ne me fais pas regretter de l'avoir comme adoptée depuis qu'elle est orpheline. – Je craindrais en vous laissant libres, que ton sentiment ne t'entraîne et que vous ne vous rendiez malheureux tous les deux, – tu comprendras pourquoi. Emmanuèle a déjà bien souffert : je voudrais tant qu'elle puisse être heureuse. L'aimes-tu assez pour préférer son bonheur au tien ? »
Alors tu parlas de T*** qui venait d'accourir, appelé par les tristes nouvelles. – « Emmanuèle l'estime », dis-tu. – Je savais bien. Et, comme je ne répondais rien encore : « Ai-je trop compté sur toi, mon enfant, – ou pourrai-je mourir tranquille ? »
J'étais épuisé des épreuves récentes ; j'ai dit : – « Oui, mère », sans comprendre et parce que je voulais aller jusqu'au bout – avec seulement le sentiment de me jeter dans une nuit obscure.
Je suis sorti ; quand on m'a rappelé, j'ai vu près de ton lit Emmanuèle, la main dans celle de T***. Tous nous nous sommes agenouillés ; nous avons prié. Ma pensée était inerte, – puis tu t'es endormie.
Après les ennuis cérémonieux qui distraient, nous avons communié ensemble. Emmanuèle était devant moi ; je ne l'ai pas regardée, et pour ne pas penser à elle et m'empêcher de rêver, je répétais : « Puisqu'il faut que je la perde, que je te retrouve au moins, mon Dieu, – et que tu me bénisses d'avoir suivi la route étroite. »
Puis je suis parti ; je viens ici, parce que je ne pouvais pas rester.
Jeudi.
J'ai travaillé pour que l'esprit s'occupe ; c'est dans l'effort qu'il se sent vivre. – Sorti toutes les pages écrites qui me rappellent autrefois. Je les veux toutes relire, les ranger, copier, les revivre. J'en écrirai de nouvelles sur des souvenirs anciens.
Je délivrerai ma pensée de ses rêveries antérieures, pour vivre d'une nouvelle vie ; quand les souvenirs seront dits, mon âme en sera plus légère ; je les arrêterai dans leur fuite : une chose n'est pas tout à fait morte qui n'est pas encore oubliée. Enfin je ne veux pas m'en aller, sans même détourner la tête, de ce qui m'aura tant charmé durant toute ma jeunesse. – Puis pourquoi chercher après coup les raisons d'une volonté prise, comme pour s'excuser de l'avoir ? J'écris parce que j'ai besoin d'écrire – et voilà tout. La volonté qu'on raisonne en devient plus débile : que l'action soit spontanée.
Et c'est bien plutôt, avec l'ambition ravivée, l'idée du livre si longtemps rêvé, d'ALLAIN, qui de nouveau maintenant se réveille.
20 avril.
L'air est si radieux ce matin que malgré moi mon âme espère – et qu'elle chante, et qu'elle adore avec un désir de prières.
E pero leva su ! Vinci l'ambascia Con l'animo che vince ogni battaglia Se col suo grave corpo non s'accascia... E dissi : « Va, ch'io son forte ed ardito »...
21 avril.
Pas un événement : la vie toujours intime – et pourtant la vie si violente. Tout s'est joué dans l'âme ; il n'en a rien paru. Comment écrire cela ? Rien où la pensée se raccroche et les passions, à la fin si profondes, nées je ne sais plus d'où – de toujours – insensiblement accrues.
⁂ L'éducation d'une âme ; la former à soi – une âme aimante, aimée, semblable à soi pour qu'elle vous comprenne, et de si loin que rien ne puisse entre les deux qui les sépare ; tisser et lentement des nœuds si compliqués, un tel réseau de sympathies, qu'elles ne puissent plus se détacher mais s'en cheminent parallèles par la force de l'habitude entretenue.
Lundi.
Nous apprenions tout ensemble ; je n'imaginais de joies qu'avec toi partagées ; et toi tu te plaisais à me suivre : ton esprit vagabond voulait aussi connaître.
Ce furent les Grecs d'abord, et, depuis, toujours préférés : l'Iliade, Prométhée, Agamemnon, Hippolyte, – et quand, après en avoir eu le sens, tu voulais entendre l'harmonie des vers, je lisais :
· · · · · · · · · · · · · · · Τενέδοιό τι ἰφι ἀνάσεις
Σμινθεῦ........
Τέκνον, τί κλαίεις ; τιδέ σε φρένας ἵκετο πένθος ;22 Αἵρετέ μου δέμας, ὀρθοῦτε κάρα λέλυμαι μελέων σύνδεσμα, φίλαι. Αῖ, Αῖ, πῶς ἄν δροσερᾶς ἀπὸ κρηνῖδος καθαρῶν, ὑδάτων πώμ᾽ ἀρυσαίμην......
Puis ce fut le Roi Lear ;
Le vent de la mer souffle à travers l'aubépine...
L'âpreté violente de Shakespeare nous laissait brisés d'enthousiasme : la vraie vie n'avait pas de ces enlèvements.
Les Paroles d'un croyant nous secouaient à leur souffle prophétique. Depuis, il est vrai, tu trouvais l'éloquence de Lamennais un peu bien populacière. Je t'en ai voulu de cela que je sentais pourtant juste, – parce que l'émotion déborde de ces pages, et qu'elle est toujours belle.
Puis nous reprenions les lectures de l'enfance, faites d'abord classiquement avec des admirations déflorantes : Pascal, Bossuet, Massillon... mais au charme spécieux du Carême, nous préférions la rhétorique nombreuse des oraisons funèbres, ou la sévérité janséniste...
Et tant d'autres encore – et tous les autres.
⁂ Puis, avec les ambitions révélées, ce fut Vigny, Baudelaire, – Flaubert, l'ami toujours souhaité ! Nous nous étonnions à sa rythmique savante. Les subtilités rhétoriques des Goncourt affilaient notre esprit ; Stendhal le faisait plus alerte, et plus ergoteur... (?)
ΣΥΜΠΑθΕΙΝ : souffrir ensemble, – se passionner ensemble.
« J'ai vu le Sphinx qui s'enfuyait du côté de la Libye ; il galopait comme un chacal. »
Je le déclamais à très haute voix en en développant tout d'abord l'étendue, puis en faisant saillir, sitôt après, le dactyle ; et nous frémissions tous les deux aux bondissements superbes de la phrase.
T*** nous a relu l'autre soir, m'écrivais-tu, le Voyage en Orient de du Camp et de Flaubert ; il nous a redit la chère apostrophe scandée ; mais, que T*** nous la lise ou que je la lise moi-même, c'est par ta voix toujours que je l'entends.
⁂ C'était dans la Tentation encore : « O Fantaisie, emporte-moi sur tes ailes pour désennuyer ma tristesse. » – « Égypte ! Égypte ! tes grands Dieux immobiles ont les épaules blanchies par la fiente des oiseaux, et le vent qui passe sur le désert roule la cendre de tes morts ! » – « Le printemps ne reviendra plus, ô Mère éternelle ! » – « Tu n'imagines pas la longue route que nous avons faite. Voilà les onagres des courriers verts qui sont morts de fatigue... »
.....
Et tant d'autres... ; après que nous étions lassés de les redire, d'en faire résonner toutes les harmoniques, dont le souvenir vibrant nous poursuivait longtemps encore, de sorte que nous en lisions le refrain obsédant l'un sur les lèvres de l'autre, – sans parler.
⁂ Je te racontais mes ambitions ; tu souriais, t'efforçant de paraître incrédule ; et le livre que je rêvais d'écrire, je l'appellerai ALLAIN, te disais-je...
.....
Allain ! l'œuvre rêvée ; – d'abord je la voyais mélancolique et romantique, lorsqu'à l'éveil des sens, j'errais dans les bois, cherchant les solitudes, plein d'inquiétudes inconnues ; lorsqu'un chant de vent dans les pins balancés me semblait chanter mes langueurs au gré des strophes récitées ; que je pleurais aux feuilles tombantes, aux soleils couchants, à l'eau fuyante des ruisseaux, et qu'au bruit de la mer je restais songeur tout le jour.
Puis métaphysique et profonde, quand l'esprit commença de s'éveiller aux doutes... enfantins peut-être, mais qui déjà me troublaient si fort. Il n'est pas deux façons de douter.
D'abord, je n'y voyais, dans ce livre, qu'un caractère exposé, sans suite, sans intrigue.
Puis, l'idée m'est venue, à contempler notre amour, au lieu d'un vain personnage qui déclamerait sur ces choses, de les faire vivre et s'agiter immédiatement, avec la passion de ce qu'on a vécu.
25 avril.
Ils ne comprendront pas ce livre, ceux qui recherchent le bonheur. L'âme n'en est pas satisfaite ; elle s'endort dans les félicités ; c'est le repos, non point la veille : il faut veiller. L'âme agissante, voilà le désirable – et qu'elle trouve son bonheur, non point dans le BONHEUR, mais dans le sentiment de son activité violente. – Donc la douleur plutôt que la joie, car elle fait l'âme plus vivace ; quand elle ne prosterne pas, les volontés s'y exaspèrent : on souffre, mais l'orgueil de vivre puissamment sauve des défaillances. La vie intense, voilà le superbe : je ne changerais la mienne contre aucune, j'y ai vécu plusieurs vies, et la réelle a été la moindre.
Intensifier la vie et garder l'âme vigilante : elle ne se plaindra plus alors, nonchalante, mais s'amusera de sa noblesse.
§ Le grand frisson, à la fois moral et physique, qui vous secoue au spectacle des choses sublimes, et que chacun de nous croyait seul avoir, de sorte qu'il n'en parlait pas à l'autre, – quelle joie quand nous le découvrîmes l'un chez l'autre pareil : ce fut une grande émotion. Quelle source de joies, après, en lisant, de l'éprouver ensemble ; il nous semblait nous unir dans un même enthousiasme. Et ce frisson, bientôt, nous le sentîmes l'un par l'autre ; la main dans la main et très proches, nous nous y confondions éperdument.
Et, quand nous lisions, par ma voix, tantôt déclamante ou grisée, je savais les accents, aux passages aimés qui nous feraient frissonner ensemble.
Insensés ! vous aussi, vous ne m'aurez point crue.
.....
Skamandros, Simoïs, aimés des Priamides.
– Les noms seuls, ces noms grecs aux terminaisons larges, éveillaient en nous des souvenirs si splendides, que d'avance ils soulevaient les enthousiasmes latents, aux éclats de leurs sonorités.
C'était un soir d'été que nous revenions de H***. On nous avait laissés tous deux assis au haut de la voiture ; les autres s'étaient enfermés. La route était longue et la nuit tombait vite. Un même châle nous enveloppait tous deux, qui faisait nos fronts proches.
« Sœurette, lui dis-je, j'ai sur moi l'Évangile ; si tu veux nous en lirions ensemble, pendant qu'il fait encore un peu de jour. – Lisons », me dit Emmanuèle. Et, quand j'eus fini de lui dire : – « Si tu voulais, ma sœur, nous prierions ensemble ? – Non, dit-elle, prions à voix basse, sinon nous penserions à nous plus qu'à Dieu. » Et nous nous tûmes ; mais je pensais encore à toi.
La nuit était venue. – « Que songes-tu ? » me dit-elle. Et moi je récitai :
« Le crépuscule ami s'endort dans la vallée. » Alors elle : « Adieu, voyages lents, bruits lointains qu'on écoute. Le rire du passant, les retards de l'essieu : Les détours imprévus des pentes variées, Un ami rencontré, les heures oubliées, L'espoir d'arriver tard dans un sauvage lieu... »
Et je repris :
« Mais toi, ne veux-tu pas, voyageuse indolente, Rêver sur mon épaule en y posant ton front ? »
Et tous deux, comme il se faisait tard, nous sommes endormis, songeurs, pressés l'un contre l'autre, les mains jointes...
... Puis soudain un brutal réveil, comme d'un rêve : c'est un chariot indistinct sur la route et qu'on heurte, – des bruits de voix, des bruits de chaîne, sans rien voir, – des aboiements – une faible lumière qui dessine les vitres d'une ferme voisine, soupçonnée. Tous deux un peu tremblants, nous serrions plus près encore, confiés l'un dans l'autre.
Songeant aux chariots lourds et noirs qui, la nuit Passant devant le seuil des fermes avec bruit, Font aboyer les chiens dans l'ombre...
Pendant notre sommeil, on avait allumé les lanternes. Nous regardions, amusés, la masse obscure des buissons dépassés surgir de l'ombre : nous cherchions des formes connues qui nous disent si la route était encore longue. – Puis des bruits de pas : un passant attardé, brusquement éclairé dans une saccade de lumière ; – et dans les raies de la lumière projetée, fuyantes en avant de nous sur la route, l'ombre des papillons de nuit qui s'en venaient heurter aux vitres des lanternes. – Je me souviens, quand nous traversions les champs vides, de l'air plus tiède qui soufflait sur nos fronts comme une douce caresse, avec le parfum des terres humides labourées. Nous écoutions chanter les grenouilles...
– Puis enfin l'arrivée, les rires de nouveau, le foyer, la lampe et le thé qui réchauffe ; – mais tous deux nous gardions dans l'âme le souvenir d'une intimité plus secrète.
Pas le paysage lui-même : l'émotion par lui causée. – Le coucher des soleils disparus ; l'apaisement des soirs emplit encore mon âme. O la paix des rayons sur la plaine !
Sitôt après le repas, nous courions vers l'étang ; il s'irisait au reflet des nuages.
(Juin 86.
« C'est une poésie exquise. Tout s'apaise ; le vent se calme, et l'étang assoupi n'a bientôt presque plus de rides. C'est l'heure où les bœufs viennent boire ; leurs pieds agitent l'eau qui se moire autour d'eux ; un enfant les conduit. – Le soleil s'est couché ; plus de couleurs, rien que des teintes, des reflets d'or que l'eau renvoie aux choses et qui les enveloppent toutes. Déjà une rive est dans l'ombre, incertaine, mystérieuse. La nuit monte dans la vallée. – et bientôt tout s'endort au chant nocturne des grenouilles. »
A L* M***, te souviens-tu, à la nuit tombante, nous allions jusqu'aux menhirs. Les moissonneurs attardés s'en revenaient sur leurs charrettes pleines, et leurs chants alternés se répondaient puis se perdaient en s'éloignant. Les grillons bruissaient dans les blés. – Nous regardions longtemps l'ombre s'étendre sur la mer violette et du fond des vallées monter comme une autre marée peu à peu noyant toutes formes. Un à un dans le lointain des côtes, les phares s'allumaient, et dans le ciel, plus claires, une à une, les lointaines étoiles. Vénus luisait étincelante ; nous rentrions doucement, les yeux caressés de sa lumière amie...
... Et la nuit descendait sur notre âme ravie.
Le matin tu vaquais aux soins du ménage ; je voyais ton tablier clair circuler dans les longs couloirs ; je t'attendais sur l'escalier, aux portes de la cuisine ; j'aimais t'aider et te voir diligente ; nous montions dans la lingerie si grande – et parfois, tandis que tu rangeais le linge, je t'y poursuivais d'une lecture commencée.
Je t'appelais alors « Marthe », parce que tu t'agitais pour bien des choses.
Mais, le soir, c'était « Marie » de nouveau ; ton âme après les soins du jour redevenait contemplative.
... On t'avait fait habiter la chambre de Lucie. Il semblait que la chère morte ne l'eût pas quittée tout entière. Quand tu vins, les choses d'elle autrefois parurent la reconnaître et revivre. Je revoyais tout : et la table et les livres, – l'obscur des grands rideaux sur le lit et la chaise où je venais lire, – le vase avec les fleurs que je t'avais cueillies... Au milieu de tout cela, tu vivais d'une vie comme passée déjà et ancienne : sa mémoire partout éparse autour de toi te faisait plus pensive. Le soir, je retrouvais son profil disparu dans l'ombre de ta tête penchée, – ta voix, quand tu parlais, me faisait souvenir. Et bientôt votre mémoire à toutes deux se confondait indécise.
Ils étaient confiants en nous et nous l'étions l'un dans l'autre ; nos chambres étaient voisines. – Te souviens-tu de ce beau soir où je suis venu te retrouver après que nous les avions quittés pour dormir ?
(Août 87.)
« Tout dort autour de nous et par la fenêtre grande ouverte aux étoiles, dans le repos de cette nuit d'été, nous viennent bien parfois quelques chants tristes d'oiseau nocturne ou le frémissement des feuilles mouillées quand un souffle les agite, si doucement qu'on croit un murmure d'amour.
Nous sommes seuls tous deux dans ta chambre, éperdus de tendresse et de fièvre. Dans la caresse de l'air, l'odeur des foins, des tilleuls, des roses ; dans le mystère de l'heure, dans le calme de la nuit, quelque chose d'ineffable fait que les larmes coulent et que l'âme veut s'échapper du corps, s'évanouir dans un baiser.
L'un contre l'autre, si près qu'un même frisson nous enveloppe, chanter la nuit de mai avec des mots extraordinaires, puis, quand toute parole s'est tue, rester longtemps, croyant cette nuit infinie, les yeux fixés sur une même étoile, laissant sur nos joues approchées nos larmes se mêler, et se confondre nos âmes en un immatériel baiser. »
Plus tôt levés que les autres, nous courions vite au bois, quand le temps était clair. Il frissonnait sous la rosée fraîche. L'herbe étincelait aux rayons obliques ; dans la vallée que des brumes encore faisaient plus profonde et comme irréelle, c'était un ravissement. Tout s'éveillait, chantait aux heures nouvelles : l'âme adorait confusément.
Excités peu à peu par l'ivresse de ces choses, nous voulûmes voir le lever des soleils ; c'était folie, car les jours étaient longs. Je venais le matin, dès l'aube, frapper doucement à ta porte ; ton sommeil était léger ; tu te levais, t'apprêtais hâtive. Mais la maison dormait encore, toutes les portes étaient closes ; nous ne pouvions sortir. – Alors, dans ta chambre, la fenêtre ouverte à la fraîcheur limpide, transis un peu quoique l'un près de l'autre serrés, nous regardions longuement pâlir les dernières étoiles et se colorer les brumes. Puis, quand les teintes s'étaient faites lumières, leur empourprement accompli, aux premiers rayons, nous retournions dormir, étourdis d'un vertige de joie, la tête un peu lassée, vide et comme sonore des chansons matinales.
Mardi.
Multiplier les émotions. Ne pas s'enfermer en sa seule vie, en son seul corps ; faire son âme hôtesse de plusieurs. Savoir qu'elle frémisse aux émotions d'autrui comme aux siennes ; elle oubliera ses douleurs propres en cessant de se contempler seule. La vie du dehors n'est pas assez violente ; de plus âpres frémissements sont dans les enthousiasmes intimes. Que l'admiration la soulève ; plus altière elle sera et plus les vibrations larges. Les chimères plutôt que les réalités ; les imaginations des poètes font mieux saillir la vérité idéale, cachée derrière l'apparence des choses.
Que jamais l'âme ne retombe inactive ; il la faut repaître d'enthousiasmes.
(1887.)
« Plan de conduite.
Liberté : la raison la nie. – Quand même elle ne serait pas, encore faudrait-il y croire.
Les influences certes nous modèlent : il les faut donc discerner.
Que la volonté partout domine : se faire tel que l'on se veut. Choisissons les influences.
Que tout me soit une éducation. »
(3 juin 87.)
« Je voudrais parler de bien des choses ; mais toutes se pressent ensemble. Je voulais fixer un peu ma symbolique qui se dessine ;... puis cette vision dans Notre-Dame, à travers les grilles du maître-autel, d'enfants de chœur en surplis blancs, à la lueur des lampes : tous chantaient, des chants clairs ; l'impression de chœur d'anges ; – une chute en mineur obstinément répétée, inattendue toujours, montait jusqu'à la voûte... – et je voulais parler aussi, ... mais ma pensée ondule incertaine, bercée sur les sonorités récentes d'un quatuor entendu. – J'écris parce que la poésie déborde de mon âme, – et les mots n'en sauraient rien dire : l'émotion plane sur la pensée ; – l'harmonie seule...
alors des mots, des mots sans suite, des phrases frémissantes, quelque chose comme de la musique.
Il est minuit ; j'ai sommeil, mais je ne pourrai pas dormir : je me consume d'amour. Tout dort autour de moi ; – je suis seul et je pleure. L'air est tiède ; dehors il pleut, une pluie de printemps qui féconde toute la nature. Et ce chant de violoncelle, dont je me souviens dans la nuit, alanguit mon délire, berce, apaise et console ; la pensée s'endort reposée : douleur, folie, amour, extase !...
... Résigne-toi, mon âme ; pleure et prie très longtemps par cette douce nuit qui t'enivre.
Pleure et résigne-toi, mon âme, prie ! »
.....
(1887,)
« ... Ou de la chair qui se déguise. On la trouve partout, l'impure ! elle se revêt spécieusement.
Certes, quand on songe à ce qui fait la poésie..., quelle poussée de désirs ! et les nerfs si vibrants au charme des couleurs à cause d'un peu de fluide épars dans l'être ;... ah ! quelle prose ! quelle sale prose au fond de tout cela.
Pourtant, c'est ce qui fait la fleur, suprême poésie de la plante... et les pétales diaprés se déploient sous les étamines dressées, comme un lit somptueux des amours inconscientes. O l'inconscience du poète ! – aveuglement ! croire à la muse inspiratrice quand c'est la puberté qui l'inquiète ; puis se promener par les nuits claires avec l'illusion qu'on chante à l'idéal... et, quand le vers ne vient pas, donner cours au flot de poésie qui l'oppresse dans d'amoureux ébats entre les bras d'une courtisane. – Certes, le dérivatif est sublime ! – O pourtant ! ce qui fait que l'homme se croit Dieu ! – Les belles nuits claires alors... une action réflexe que les vers (Musset)... Les chiens aussi aboient après les clairs de lune !
§ Ce qui est pur et ce qui souille – nous ne le pouvons savoir ; la connexion des deux essences, si subtile ; leurs causes, si mutuellement mélangées ; – tant l'ébranlement de l'une retentit en l'autre. L'abondance du sang fait le cœur généreux : si Swift avait connu l'amour, peut-être il aurait écrit des cantiques... Et tu me dis, ami. qu'il ne faut pas se soucier du corps, mais bien le laisser paître aux lieux qu'il convoite ; – mais la chair corrompt l'âme, une fois corrompue ! on ne peut mettre du vin pur en des vaisseaux qui se pourrissent ! La chair fait l'âme à soi, si l'âme ne la domine d'abord ; – il faut qu'elle se l'asservisse.
– Alors romantique parce que mon sang bouillonne... Tant pis ! l'illusion de l'idéal est bonne et je la veux garder. »
(Poubazlanec, sept. 87.)
« Ton conseil est admirable, ô Ar***. – Et ta doctrine ! « Dégager l'âme en donnant au corps ce qu'il demande ! » dis-tu ; – et tu m'estimerais plus lorsque je l'aurais fait... Mais, ami, il faudrait que le corps demande des choses possibles ; si je lui donnais ce qu'il demande, tu crierais le premier au scandale ; – et pourrais-je le satisfaire ?
Admirable, ta quiétude ! tu t'es dit : à quoi bon la lutte ? il ne faut pas que l'âme s'épuise en des combats indignes d'elle, – et, te soumettant d'avance, tu t'es épargné le combat. – Mais ne sais-tu donc pas que la gangrène de la chair attaque l'âme ? – Pour moi, je n'ai pas un désir que toute mon âme n'en soit ébranlée.
§ Et tu te donnes en exemple. – Certes, je t'admire : ta philosophie est grande, et tu prends la vie comme elle finira peut-être par me prendre ; – mais ce que je ne t'ai pas dit, ce que tu ne sauras pas. de peur que ton aimable calme ne s'en trouble, c'est le grand effondrement de mes rêves, quand tu m'as conté tout cela, la désillusion sur toi-même ; – ah ! je te croyais plus altier... Et des larmes sur mon orgueil blessé, dont, pour la première fois, je soupçonnais la vanité ; un écœurement, oui jusqu'à la nausée, en regardant la vie, la vie qu'il fallait vivre. – J'aime mieux mon rêve, – mon rêve !...
Tu souriais en disant ces choses, je souriais en les écoutant, mais je ne comprenais plus tes paroles ; une seule pensée grisait mon cœur de larmes : il est retourné près de cette fille, et elle ne l'a pas reconnu ! – Pas reconnu, Seigneur, est-ce possible ?... mon âme en a pleuré toute la nuit. – A quoi bon cette tristesse ? Ces choses-là devaient être. Pourquoi l'aurait-elle reconnu ? Elle en avait tant vu depuis, – puis, malgré soi, le souvenir des traits s'efface. – Il t'avait tout donné pourtant ! Le savais-tu seulement ? Avait-il osé te le dire ? – Que cela est lugubre, lugubre ! Ah fi ! si c'est là la vie qu'il faut vivre...
J'aime mieux mon rêve, Seigneur ! j'aime mieux mon rêve. »
(Juillet 87.)
« J'en hais jusqu'à l'approche, et ces mots sifflés à l'oreille, intonations triviales ou subtiles, voix de goules et ou de sirènes ; je les hais ! je les hais tout entières. – Et, quand je marche dans la rue, je quitte les trottoirs, je cours hâtif sur les pavés ; je les vois de loin qui se retournent, vont et viennent... et leurs gestes, leurs propos soupçonnés m'intriguent malgré tout ; – j'aimerais savoir...
C'était il y a deux ans. pour la première fois et l'unique d'ailleurs, car maintenant je suis attentif et je marche loin d'elles, – une chantait un refrain triste ; un peu moqueur, mais tendrement, et d'une voix si frêle, alanguie... Comme je passais auprès d'elle, elle s'est retournée. avec un geste, sans cesser de chanter. – C'était la première fois, une première nuit de printemps ; l'air était si tiède et la mélodie énervante... les larmes me sont jaillies des yeux ; malgré moi. je me suis écarté, j'ai pris le large. Elle a ri très haut ; une autre qui rôdait auprès s'est écriée : « Faut pas avoir peur comme ça, mon joli garçon !... » L'émotion était si violente que j'ai pensé m'évanouir ; le sang m'est monté au visage ; une rougeur de honte, de honte pour elles ; – l'impression d'une souillure, rien que d'avoir entendu leurs paroles. Mes tempes battaient, mes yeux se brouillaient pleins de larmes : je me suis enfui.
Mais je me souviendrai, par cette nuit de printemps affolante et si tiède, de cette ombre chantante aux reflets du gaz et sous les marronniers fleuris ; puis cet éclat de rire, aigu comme une chose qui se brise ; – et les larmes que j'ai pleurées. Oui, je m'en souviendrai toujours ; c'était une extraordinaire poésie !
J'écris ces choses ce soir parce que la saison est la même, que l'air est aussi tiède et que tout m'aide à me souvenir. J'avais joué le scherzo de Chopin que je me rappelle encore, puis j'ai couru dans la campagne, grisé de sonorités, d'harmonies. Le ciel était sans lune, mais clair d'étoiles ; quoiqu'il n'y eût pas de nuages, la pluie s'est mise à tomber, une pluie tiède, presque une rosée ; –
Et le parfum est monté dans l'air, de la poussière d'été qui se mouille. »
Vendredi.
Comme j'y pensais encore, obsédé, malgré moi, j'ai rêvé cette nuit que je suivais un chemin bordé d'ombres, où des deux côtés se tordaient des couples nus, embrassés ; je ne voyais pas les corps mêmes, mais je soupçonnais les étreintes. Un grand vertige m'a pris, et, pour ne pas chanceler, je marchais au milieu du chemin, seul et très droit, les yeux levés pour ne rien voir, les bras dressés au-dessus de ma tête. Au ciel luisaient quelques étoiles. J'entendais les baisers dans l'ombre.
Je lisais dans L'APOCALYPSE les paroles aux mystérieuses promesses :
Tu as près de toi quelques hommes qui n'ont pas sali leurs vêtements ; ils marcheront en vêtements blancs parce qu'ils en ont été jugés dignes. Celui qui vaincra, je le vêtirai de vêtements blancs. A celui qui vaincra, je donnerai de la manne cachée, – un caillou blanc sur lequel est inscrit un nom qu'aucun autre n'aura pu connaître...
Alors je méditais et je faisais des résolutions vertueuses.
Mes rêves étaient superbes ; j'écrivais :
(Mars. 1886,)
« Je voudrais à vingt et un ans, à l'âge où la passion se déchaîne, la dompter par un labeur forcené et grisant. Je voudrais, tandis que les autres courent les plaisirs, les fêtes et les débauches faciles, goûter les voluptés farouches de la vie monastique. Seul, absolument seul, ou peut-être entouré de quelques blancs chartreux, de quelques ascètes ; retiré dans une agreste chartreuse, en pleine campagne, dans un pays sublime et sévère. Je voudrais une cellule nue : coucher sur une planche, un oreiller de crin sous la tête ; auprès, un prie-Dieu, simple. énorme ; sur le support, la Bible toujours ouverte ; au-dessus, une lampe toujours allumée ; – et dans l'insomnie, trouver des extases violentes, éperdument penché sur un verset, dans la nuit enveloppante, effrayante. – Aucun bruit. que peut-être parfois les grandes clameurs des montagnes, les voix lugubres des glaciers, ou les cantiques de minuit chantés sur une seule note par les chartreux qui veillent.
Vivre profondément sans plus que le temps vous poursuive. Manger quand j'aurais faim ; dormir n'importe quand, – alors que j'aurais fait ma tâche. Je porterais le manteau blanc, la cuculle et les sandales. Dans ma cellule, une table de chêne, immense, et dessus, tout ouverts, des livres. Un grand lutrin pour travailler debout ; dessus, un livre ouvert, Au-dessus du lit, des livres rangés. Je lirais la Bible, les Védas, Dante, Spinoza, Rabelais, les Stoïques ; j'apprendrais le grec, l'hébreu, l'italien ; – et ma pensée se sentirait orgueilleusement vivre. Des débauches de science, d'où l'esprit sortirait stupéfié, brisé, comme Jacob de sa lutte avec l'Ange, mais comme lui vainqueur. Et, quand la chair exaspérée regimberait à cette gêne dans un sursaut de désirs, – alors, la discipline fouaillant le corps et qui se taira bien sous la douleur ! – Ou bien, dans la montagne, une course insensée, par-delà les rochers jusqu'aux neiges, et que la chair haletante en eût crié merci : épuisée, vaincue..., ou peut-être dans la neige profonde se plonger, – et trouver dans ce contact glacé comme un frisson extraordinaire. »
§ Quand j'étais enfant, très jeune, dans l'ignorance des choses pourtant entrevues : – « Plus tard, pensais-je, plus tard je n'aurai pas de maîtresses ; mes amours tout entières iront vers l'harmonie. » Je rêvais des nuits d'amour devant l'orgue ; la mélodie m'apparaissait, presque palpable fiction, comme une Béatrice nuageuse
« fior gittando sopra e d'interno »
comme une Dame élue, immatériellement pure, à la robe traînante aux reflets de saphir, aux replis profonds azurés, aux lueurs pâles, aux formes lentes, musicales. J'espérais qu'elle prendrait toutes mes tendresses. J'étais enfant, je ne pensais qu'à l'âme ; déjà je vivais dans le rêve ; mon âme se libérait du corps ; et c'était exquis, ce rêve des choses meilleures. Puis je les ai tant séparés que maintenant je n'en suis plus le maître ; ils vont chacun de leur côté, le corps et l'âme ; elle, rêve des caresses toujours plus chastes ; lui, s'abandonne à la dérive.
La sagesse voudrait qu'on les mène ensemble, qu'on fasse converger leurs poursuites, et que l'âme ne cherche pas de trop lointaines amours où le corps ne participe.
« Ils ne plaignent pas : ils accusent. Ils n'expliquent pas : ils condamnent. Ce qu'ils ne comprendront jamais, ce sont les luttes pour CROIRE, ces impossibilités parfois, quand pourtant quelque peu de raison proteste encore. Ils s'imaginent qu'il suffit de vouloir !, .. et le plus admirable, c'est qu'ils pensent croire avec leur raison. Ce qui surtout m'égare, c'est la fausse religion ; la bigoterie et le mysticisme factice me font parfois douter qu'il y en ait une vraie. Ils ne se doutent pas, les bigots, de tout le mal que leur exemple peut faire à ceux qui sont vraiment altérés du vrai Dieu ; ils ne se doutent pas, dans leur quiétude, qu'ils sont souvent eux-mêmes un objet de scandale... »
(Minuit, 30 déc. 87.)
« Écrire... quoi ? – Je suis heureux.
J'ai peur d'oublier. – J'aimerais qu'au-delà des temps, le souvenir de mon bonheur demeure.
Si l'on pouvait, dans l'ennui de la tombe, revivre incessamment sa vie et sentir doucement, comme dans un songe de la nuit, les amertumes et les joies, mais lointaines, de sorte qu'on n'en souffre pas plus que du souvenir des douleurs. – J'ai peur d'oublier.
Sur ces feuilles je veux fixer, comme on garde des fleurs séchées dont le parfum effacé vous rappelle, je veux fixer les souvenirs de ma jeunesse fuyante, pour que plus tard je me souvienne.
Aujourd'hui je lui ai parlé : je lui ai dit mes rêves radieux et mes superbes espérances. Aujourd'hui j'ai compris qu'elle m'aimait encore. Je suis heureux !... qu'écrirais-je ?
J'écris, car j'ai peur d'oublier.
Et tout cela n'est déjà plus que dans mon souvenir...
Mais peut-être que le souvenir des choses anciennes, au-delà du tombeau, subsiste encore. »
C'était dans une misérable chambre ; de pauvres gens pleuraient leur enfant mort (7 février 87). J'étais venu sans le lui dire – pour qu'elle ne le sache qu'après. Je leur apportais quelque argent ; j'aurais voulu les consoler. Je m'efforçais de leur parler, mais je m'embarrassais d'idées trop hautes ; ma tristesse à les voir certes était sincère, mais je la sentais si différente ; je ne sais pas me faire humble. Je n'osais leur parler du ciel, n'y croyant pas assez moi-même ; je restais indécis, gêné, bien que mon cœur débordât. – Mais voilà que la porte s'ouvre : Emmanuèle entre. – « Toi ? Emmanuèle ! » – Elle passe devant moi sans s'étonner, comme sans me voir. La voici près du lit où l'enfant repose ; elle regarde sa figure pâlie et je vois ses yeux s'emplir de larmes. – Je m'approche alors, et de ma main je cherche à saisir la sienne. – « Laisse », fait-elle, en me repoussant. Puis, s'étant mise à genoux, elle prie à voix haute une prière très triste ; moi, reculé dans l'ombre, je me sentais si humble !... Puis elle s'en va : je l'accompagne. Et, tout en marchant, j'attendais toujours quelques mots sur notre rencontre surprise, mais son émotion trop forte ne la laissait pas s'étonner ; – seulement, et comme pour expliquer la brusquerie de son départ, ou plutôt gênée du silence : – « Laissons-les, me dit-elle ; il est bon qu'ils s'affligent. Ne les consolons pas encore ; les consolations ne seraient pas sincères. L'espérance leur sera meilleure quand ils auront pleuré. – Il faudra revenir ; – on ne se dégage pas d'un bienfait commencé ; c'est une obligation : il faut aller jusqu'au bout... » – Mais, sitôt rentrés, posant son front sur ma joue, elle me dit tout bas : « Mon frère ». Son émotion maintenant débordait : comme elle relevait les yeux je la vis toute pleurante ; – pour moi, je défaillais de tendresse, mais l'aveu de sa frêle faiblesse voulait que je sois fort.
Je lui demandai, l'osant à peine, car nous avions tous deux une pudeur exagérée pour ces sortes de choses, je lui demandai de retourner là-bas ensemble. – Elle y fut admirable de douceur, de patience et de zèle, – et ne s'occupait pas de moi ; je ne m'occupais guère que d'elle, m'évertuant à l'action pour qu'un sourire me récompense... Pourtant cela ne dura pas ; elle me dit une fois : « Prends garde ! c'est pour moi, plus que pour eux, que tu t'agites. » D'ailleurs, pour un nouveau temps, je fus séparé d'elle.
§ Providence : toute leur vie est basée sur une hypothèse ; s'il leur était prouvé qu'ils s'abusent, ils n'auraient plus leur raison d'être. Mais qui le leur prouverait ? Ils ne sauront jamais s'ils ont eu tort de croire. S'il n'y a rien, ils ne s'apercevront de rien. – En attendant, ils croient ; ils sont heureux ou se consolent d'espérances. L'âme qui doute est éperdue.
§ « Philosopher ? – Quelle arrogance ! Mais avec quoi philosopher ? la raison ? Mais qui nous en garantit la justesse ? d'où vient l'autorité qu'on lui accorde ? Notre seule assurance serait de la croire donnée par un Dieu providentiel, – mais, ce Dieu, cette raison le nie.
Si nous la prétendons née seule, par une lente tranformation, une successive adaptation aux phénomènes, elle pourra bien discuter les phénomènes, mais au-delà ?...
Si même nous la reconnaissons venue de Dieu, rien encore n'en garantit la justesse.
Nous ne pouvons qu'opiner. L'affirmation est coupable : elle veut s'imposer et saccage autour d'elle. – Étroits esprits de croire que leur vérité est la seule ! La vérité est multiple, infinie, nombreuse autant que les esprits pour y croire ; – et aucunes ne se nient que dans l'esprit de l'homme. »
§ « Tous ont raison. Les choses DEVIENNENT vraies ; il suffit qu'on les pense. – C'est en nous qu'est la réalité ; notre esprit crée ses Vérités. Et la meilleure ne sera pas celle que la raison surtout approuve : les sentiments mènent l'homme et non pas les idées. On reconnaît l'arbre à ses fruits ; – la doctrine à ce qu'elle suggère.
La meilleure sera celle qui dira les mots d'amour pour que l'homme avec joie se dévoue ; qui soutiendra dans l'amertume par la vision des félicités promises à ceux qui pleurent ; qui nommera la douleur épreuve, et fera que l'âme malgré tout espère ; la meilleure sera celle qui le plus console : Seigneur ! à qui irions-nous ? tu as les paroles de la vie éternelle !
Et la raison se moquera ; mais, malgré que la philosophie proteste, le cœur aura toujours besoin de croire. »
« ΣΥΜΠΑθΕΙΝ – souffrir ensemble ; vibrer ensemble. L'imagination, c'est la toute puissante ; même pour l'émotion du cœur : car ce qui fait le cœur charitable, c'est la puissance d'imaginer les douleurs d'autrui en soi, de les faire siennes. La vie de l'âme en est ainsi multipliée. Puis la douleur s'allège à se sentir compatie.
Le cœur frémissant aux émotions de tous, et malgré l'espace ou le temps ; cela, volontairement quoique spontanément ; Voilà ce qu'il faut. »
Lire à haute voix, les soirs d'automne ; eux rassemblés entre le foyer et la lampe. Ainsi ce fut Hoffmann et Tourgueneff.
Tous écoutaient, mais ma voix avait des inflexions pour toi seule : je te lisais par-dessus eux.
Nous apprenions ensemble l'allemand, bien que le sachant déjà ; mais les leçons nous étaient un prétexte de lire, et penchés sur le même livre, pour traduire, nous amusions nos esprits aux subtilités rhétoriques des équivalences.
Ainsi nous connûmes die Braut von Messina, die Heimkehr, die Nordsee.
L'allemand a des allitérations chuchotées qui mieux que les français disaient les songeries embrumées.
Un soir qu'il pleuvait et que tous rassemblés avions déjà longtemps causé – « André, si tu lisais un peu », me dit V***. Je commençai l'Expiation qu'Elle ne connaissait pas.
C'est bien une des choses les plus douces : par l'inflexion subtile des paroles lues, fait affluer dans l'âme amie les enthousiasmes dont déborde la sienne. ΣΥΜΠΑθΕΙΝ : se passionner ensemble.
Je ne te voyais pas ; tu t'étais assise dans l'ombre ; pourtant j'ai senti ton regard lorsque je lus :
« Et leur âme chantait dans les clairons d'airain. »
Le sommeil se couchait ; l'ombre du crépuscule envahissait la salle. N'y voyant plus assez pour lire, je fermai le livre et récitai :
« Pas un ne recula. Dormez, morts héroïques !... »
Quand on nous apporta la lampe, il nous sembla nous éveiller d'un rêve. –
« Écoute, suis-moi bien, te disais-je...
C'était quelque problème ardu de métaphysique allemande qui m'avait inquiété longtemps et que je voulais t'exposer. – Sous l'effort de la pensée pourchassée, je voyais sur ton front se plisser des rides ; mais les obstacles déjà franchis m'excitaient à poursuivre et je continuais de parler quand même. J'aurais voulu que dans tous les sentiers nos esprits cheminassent ensemble ; je souffrais de connaître sans toi ; il me fallait te sentir là ; je tressaillais de tes admirations plus que des miennes. Pourtant c'étaient des sphères trop raréfiées ; ton esprit y battait de l'aile et se lassait.
Je souffrais beaucoup de ces choses : quand tu n'étais pas là et que l'émotion trop grande me forçait de parler, ma mère qui n'avait pas ta bénévole patience s'ennuyait vite de mes discours ; bientôt je la sentais distraite, alors je me taisais et mon âme reployée frissonnait de sa solitude.
J'étais enfant alors ; je ne comprenais pas que l'esprit, ce n'est rien, et qu'il passe, – et que l'âme demeure encore qu'il a passé.
L'esprit change, il s'affaiblit ; il passe, l'âme demeure.
Ils demanderont ce que c'est l'âme ?
L'ÂME, c'est en nous LA VOLONTÉ AIMANTE.
Nous disions encore « frère » et « sœur », mais c'était avec un sourire ; notre cœur ne s'y trompait plus. Pourtant tu voulais t'abuser toi-même ; craignant qu'elle n'allât trop loin, tu pensais distraire ton inquiétude commençante en la leurrant d'un mot reconnu ; tu pensais peut-être que le mot entraînerait la chose et qu'en nous appelant toujours frères, la fraternité seule serait. Mais, malgré toi, malgré nous, aux noms fraternels s'immisçaient des inflexions étrangères ; leur intimité devenait plus douce et plus secrète, dits tout bas l'un à l'autre. Lorsque tu me disais « mon frère » et que je répondais « sœurette » notre cœur tressaillait aux involontaires tendresses de la voix amicale.
Les longues journées d'automne, – la pluie dehors, rassemblés près du feu ; – la lecture absorbée durant de longues heures...
et toi, par dessus mon épaule penchée, parfois tu venais lire.
Je lisais L'Âne d'or, lorsque tu vins comme si souvent lire par dessus mon épaule. – « Ceci n'est pas pour toi, sœurette », te dis-je en t'écartant. – « Alors pourquoi le lis-tu ? »
Tu souriais un peu moqueuse, – et je fermai mon livre.
... les jeux en commun des premières années, les paysages vus, les longs entretiens, les lectures, quand tout est inconnu et qu'on découvre ensemble...
qui ne sont rien pour d'autres, mais nous ont formés peu à peu, c'est pourquoi si pareils... –
un étranger, Emmanuèle ?
Le souvenir des morts aimés, l'aurait-il ?
O qu'il ne les ait pas connus ! ô qu'il n'ait pas vu leur sourire ! Quand tu voudras parler d'eux, il ne comprendra pas ; – alors tu te tairas, te sentant seule. –
(à faire).
Je ne sais plus ni où, ni quand : c'était en rêve.
Une nuit que je pleurais sur nous deux, voici, – ton ombre amie est venue près de moi, et ta main sur mon front posée, au reflet de ton doux sourire.
Mais comme encore je pleurais : « Pourtant !... si tu voulais, André ?... » dis-tu sans que tes lèvres remuent ; et ton sourire illuminait mon âme.
En mon âme j'ai gardé la musique de tes paroles, et, sur mon front, le souvenir de ta fraîche caresse.
28 mai.
Ces trois derniers jours, j'ai relu tes lettres ; je les ai toutes gardées. – Elles te feraient bien mal connaître ; si elles étaient le seul souvenir que j'aie gardé de toi, je te verrais moqueuse, un peu perfide, sans cesse te dérobant, tentant de t'écarter de moi. Ton esprit en chassait ton âme.
Parfois pourtant, tout à coup, elle clamait à moi, et c'était alors si plaintive, comme une emprisonnée : – « Ne me retire pas, je t'en prie, disait-elle, ton affection, mon frère ; je la préfère à tout le reste. » – Et plus tard, après une séparation : « Je ne puis me faire à l'idée de la vie sans toi » – d'autres encore. – C'étaient de fugitives tendresses ; l'esprit les rudoyait bien vite, et, dans la lettre suivante, avec toute ton ironie tu te moquais de toi-même, et de moi, si je t'avais crue.
– C'est que, loin de moi, de nouveau ton esprit dominait ton âme.
§ Oui, parfois elle s'échappait, ton âme ; et, lorsqu'elle parlait alors, son ardeur m'étonnait moi-même. Je doutais parfois de ta tendresse, car tu t'en refusais à toi-même l'aveu ; je pensais t'aimer beaucoup plus.
Une veille de départ, où nous devions nous quitter pour longtemps, je te dis ces choses en me lamentant, autant sincèrement que pour savoir, – car rien ne m'assurait de toi qu'une bien fragile espérance et, dans le doute, je craignais tout de cette absence ; – mais toi, lasse enfin du silence : « Ah ! t'écrias-tu, tout en larmes, – jamais, André, tu ne sauras combien je t'aimais ! »
§ Ton esprit despote et rétif. – Il te voulait dominatrice. Tu regimbais aux moqueries : ô la moue de tes lèvres levées ! il me fallait vite obéir, ou bien tu t'écartais de moi : c'était le silence jusqu'à ma soumission. Tu savais que je te reviendrais toujours : Voilà ce qui te faisait forte ; je n'étais pas si sûr de toi ; je cédais vite. – Puis, se réconcilier après était si doux ; l'on se retrouvait davantage ; et l'âme aimait plus loin encore, après que nous l'avions retenue.
Ton esprit ! Je l'accuserai, car il m'irrite ; c'est ton esprit que je connais le mieux, et pourtant, si peu que ce soit, il n'est pas en nous deux semblable. Tu crains d'admirer sans juger ; tu voudrais garder ta raison droite ; l'excessif t'effraie, – il m'attire. Je t'en veux de n'avoir pas frémi devant l'immensité de Luther ; alors je t'ai sentie femme et j'en ai souffert. Tu comprends trop les choses et ne les aimes pas assez. – Et nos âmes, au contraire, que je pressens tant semblables, elles ne peuvent pas se connaître !...
J'écrivais à Pierre :
... « Mais laissez-les donc croire : de quel droit leur arracher les félicités de la foi ? Que leur donnerez-vous en échange ? Ils ont cent fois raison, même encore s'ils se trompent. Croire que l'on possède est aussi doux que posséder... et toutes les possessions ne sont-elles pas chimériques ? Un mirage d'éternité les hallucine, et l'espérance les soulève. S'il n'y a rien après la vie, qui reviendrait pour le leur dire ? eux-mêmes, sitôt morts, ne s'apercevront pas du néant ; ils ne sauront jamais s'ils n'ont pas eu la vie éternelle. Mais il faut que maintenant rien ne trouble leur certitude : c'est leur condition de bonheur. »
Je me souviens que je lui montrai ces lignes : – « O André ! s'écria-t-elle, mais si cela était comme tu dis, la foi serait une duperie ; la vérité seule est digne qu'on la croie, même lorsqu'elle serait désespérante. J'aime mieux souffrir de ne pas croire que de croire à un mensonge. » – Ah ! protestante !
Ta pensée haute et calme a des sérénités trop pacifiques. Le reposement de ta foi me tourmente : je voudrais qu'elle eût chancelé. O que ton âme eût crié dans le vide ! la mienne aurait été moins égarée, te sachant encore sa compagne ; elle se fût sentie compatie. Peut-être en serais-tu moins hautaine. Mais tu m'apparais toute droite, et, pour me regarder, tes yeux s'abaissent.
Puis, un jour, nous lisions Spinoza, – ah ! ces souvenirs me fatiguent, – et nous admirions sa divine ordonnance. Je te dis : « Cela ne te trouble pas, Emmanuèle, cette lecture inorthodoxe ? » – « O ! dis-tu, tous les doutes sont dans l'esprit ; ce n'est pas une lecture qui pourrait les faire naître ! »
– Ta petite âme ! qui la pourrait connaître ?
Nos esprits se connaissaient tout entiers, n'avaient plus l'un pour l'autre de mystère. Nous savions toutes nos pensées avant de les avoir parlées et comment l'autre allait les dire. J'en jouais : quand nous causions, je surprenais le mot à venir sur tes lèvres, et je te le dérobais avant qu'elles ne se fussent ouvertes. Au delà, l'âme était tout autant inconnue... Elle s'élançait après l'autre, mais se leurrait sans cesse, détournée par la poursuite des pensées qui se succédaient chez tous les deux pareilles, prise au charme de l'illusoire similitude : l'âme n'était pas là ; c'était l'esprit frivole. – Comme celui de la légende, amoureux de l'Ondine, qui, la pourchassant quelque soir, a cru voir son image changeante en la folle flamme qui flotte au-dessus des étangs, séduit par le prestige mobile, s'élance et pleure que le fantôme s'effrite en ses doigts désillusionnés.
(L'âme se retirait derrière les pensées ; et, quand l'amie s'élançait, elle glissait sur des surfaces lisses. La pente des pensées était si attirante et leur enchaînement si facile : sans cesse elle était attirée à la poursuite plus aisée des pensées qui se succédaient chez tous les deux pareilles.)
§ Nous aimions à nous perdre ensemble en les plus lointains souvenirs ; par des associations ténues, par-dessus le temps et l'espace, par des rapports inattendus, un mot suffisait à lever tant de rêves. Car ce n'était pas le mot seul ; pour nous, il avait sa légende et la même ; il évoquait bien des émois passés, des lectures, et quand nous l'avions dit, et quand nous l'avions lu : – ce n'était jamais le mot seul, c'était un rappel d'autrefois. C'est pour cela que nous nous plaisions tant à citer les poètes, non point que nous sentions au travers d'eux, mais eux surtout rappelaient tant de choses !
Puis un mot bien souvent voulait dire une phrase, connue de nous seuls, entendue par nous seuls, – ce n'était qu'un mot pour les autres. Un mot c'était un commencement de vers, ou de pensée : l'autre achevait. Ainsi quand nous sortions le soir autour de la maison, je commençais :
« Entends ! ma chère...
Et toi tu comprenais :
Entends la douce nuit qui marche. »
§ Puis cela devenait une fatigue, une obsession enfin, de toujours épier cette pensée amie et de la découvrir, malgré pourtant qu'on la sache la même... d'avance. Nous ne pensions plus, nous regardions penser l'autre, et c'était même chose. Mais, malgré soi, le besoin tourmentait de se prouver cette similitude, de sorte que l'un disait à l'autre sa pensée quoiqu'il eût aussi bien pu se taire et la dire muettement.
Nous prévoyions venir les phrases ; nous nous les dérobions avant qu'elles ne fussent dites, sur nos lèvres prêtes à parler, – et l'attente seule d'une pensée chez l'autre, la faisait parfois naître chez tous les deux la même.
Les soirs d'été, c'était avec Chopin, Baudelaire...
« Ce soir, la lune rêve avec plus de paresse. »... « Comme tu me plairais, ô nuit ! sans tes étoiles »...
Mais le vers inachevé retombait de nos lèvres lassées, pour laisser chanter le regard qui mieux disait nos tendresses vivaces et toujours désireuses.
Certains autour de nous s'inquiétaient enfin d'une similitude si grande et sans cesse flagrante. Alors on se mettait entre nous deux ; on imaginait des barrières ; mais il était trop tard déjà : nous nous comprenions par d'impalpables signes, inaperçus des autres. Ils nous excitaient au contraire au mystère des langages muets, et nous créaient au milieu d'eux une sorte de solitude. En les entravant, ils nous révélaient nos désirs.
« Les phénomènes sont des signes, un langage des volontés derrière eux. Elles seules importent, il faudrait les comprendre.
Comprendre, cela n'est rien. – mais se faire comprendre ! Voilà la gêne et l'angoisse ; l'âme qui palpite et voudrait que l'autre le sache, – et qui ne peut pas. qui se sent enfermée. Alors les gestes, les paroles, truchements malhabiles, symboles matériels des impondérables transports ; – et l'âme qui s'y désespère.
Cela n'est rien encore : la pire souffrance est celle de deux âmes qui ne peuvent pas s'approcher. « Tu m'as entouré d'un mur pour que je ne sorte pas » (Jérémie).
Elles côtoient ce mur qui les maintient parallèles, et s'y heurtent et s'y meurtrissent. »
§ « Ni la parole, ni le geste qui modèle la pensée. – tout cela procède de l'esprit frivole ; – mais l'inflexion plutôt de la voix émue, la ligne du visage, le regard surtout : voilà l'éloquence de l'âme ; elle s'y livre. Il faut les étudier, assouplir, et les faire interprètes dociles.
Leur étude devant la glace. Ils en riraient, s'ils avaient vu ; le regard fouillant le regard. et, la nuit, presque hypnotisé par le jeu changeant des prunelles profondes, cherchant ce qui des émois se révèle au dehors dans le regard qui brille ou qui pleure ; quels alignements de paupières, quels rapprochements des sourcils, quels plissements du front devaient accompagner les mots de passion, d'enthousiasme ou de tristesse...
Comédien ? peut-être... ; mais c'est moi-même que je joue. Les plus habiles sont les mieux compris. »
§ « Puis cela devient une souffrance : ne pas se perdre de vue, cherchant anxieusement le mot. le geste, le regard surtout. et cette inflexion de la voix qui révélera mieux les émois secrets de mon âme. – Et souvent alors la préoccupation de paraître ému supplante l'émotion sincère. Que de fois j'ai senti près de toi, Emmanuèle, l'émotion réelle et spontanée fuir sous l'effort trop grand de la faire saillir au dehors. – C'est là qu'est la souffrance : ne pas pouvoir se révéler et, lorsqu'on y parvient peut-être, n'avoir plus rien à dire. »
Se comprendre, cela n'est rien : ce qu'il faudrait, c'est l'embrassement des âmes.
J'ai le besoin de caresser : mes caresses inépanchées ne se sont reposées encore sur personne ; elles restent éparses sur tous. Ma caresse est un enlacement ; j'ai le geste instinctif d'embrasser.
La triste chose et dont j'ai bien souffert, que l'âme n'ait, pour révéler ses tendresses, d'autres signes que les caresses des désirs impudiques aussi ; elle s'y méprend, elle s'y leurre ;... puis en moi tout à coup le geste éveillait la pensée...
Alors rester froid pour qu'il n'y ait plus de méprise, même de mon âme, – car parfois... ; la main qu'on serre seulement et puis qu'on laisse, l'adieu du soir sans le baiser de paix ; – et que le cœur se pâme s'il veut, mais tout bas et sans qu'on le sache.
Amoureuse, adoratrice ou passionnée, j'ai l'obsession de la caresse : je voudrais l'étreinte absorbante, l'enveloppement, ou bien l'oubli de soi, ce qui fait l'extase éperdue. – Et c'est pourquoi je souffre tant devant la beauté des statues ; parce que le moi ne s'y fond pas, mais qu'il s'oppose.
... « Quoniam nihil inde abradere possunt, Nec penetrare et abire in corpus corpore toto. »
Un peu de chair s'y mêle encore, tant ce marbre est si diaphane. Le désir de posséder me tourmente et je souffre affreusement, dans le corps et dans l'âme, du sentiment de cet impossible ; – le Tireur d'épine, l'Apollon Saurochtone, le torse mutilé de la Diane au repos – le regard ne me soûle pas – il m'altère ;
« Nec satiare queunt spectando corpora coram : »
Et puis encore je souffre à penser qu'ils ne sentiraient pas mes caresses.
« Splendeur excessive, implacable, O beauté ! que tu me fais mal.
L'impossible union des âmes par le corps, · · · · · · · · · · · · · · que le baiser tourmente. »
Voilà qui est admirable. Oh ! j'ai bien souffert de ces choses ! – Et l'âme y est si fort mêlée, qu'on ne sait plus si ce n'est pas elle qui désire ou bien la chair qui se déguise comme en une adoration.
« Tant l'âme est vers ce lit mystérieux poussée... »
La caresse effleure, elle est passagère.
Mon âme s'émeut au bruit des baisers...
Et non erat qui cognosceret me... et pas plus moi que les autres – les âmes ne se peuvent connaître, et les plus semblables encore demeureront PARALLÈLES.
« Aussi bien je ne te désire pas. Ton corps me gêne et les possessions chamelles m'épouvantent. Nous ne nous aimons pas comme il faudrait qu'on s'aime avec raison. Tu ne pourrais m'appartenir : les choses que nous voulons ne s'appartiennent pas. »
12 juin.
Une lettre de Pierre avec un envoi de livres. Il me parle de Paris, de la lutte et des premiers triomphes... Adieu le calme et la philosophie quiète ; ce souffle d'air enfiévré me grise ; j'y sens tant de gloires latentes. Mes ambitions sommeillaient dans la solitude : les voilà toutes réveillées. Et c'est une fureur contre ma claustration : là-bas ils s'excitent, ils s'entraînent – c'est une ruée. J'arriverai trop tard et je n'en serai plus.
Cette lettre d'ailleurs m'est bonne ; mon orgueil en hurle de rage, mais je n'en suis pas abattu ; cela fouette à sang les énergies ; – j'en courrai maintenant plus vite. Oh ! je me sens de grandes forces.
Arriver tout à coup, et, sans qu'on vous ait prévu, sonner haut son cri de trompette ; – ou plutôt rester inconnu, mais entendre l'œuvre acclamée – car je ne me nommerai pas.
Il faut travailler frénétiquement, improbe. – Je ne sortirai d'ici que l'œuvre faite. Et, pour que plus rien ne me trouble, je fais envoyer désormais les lettres qu'on m'adresse en un endroit imaginaire.
Son écriture est d'une perfection impassible, impeccable, figée, – décourageante, car je sentais auprès ma langue si fluide encore et comme illimitée. Je voudrais l'enserrer dans des formes rythmiques, – mais l'émotion toujours fait éclater ma phrase ; je n'en écris que les débris.
Les livres, c'est Verlaine ; et je ne le connaissais pas !
Ce soir, quelque avancée que fût l'heure, j'ai coupé, rangé le papier que Pierre m'envoie avec les livres. La vue du papier blanc m'enivre ; – les petits signes noirs dont je vais tantôt le couvrir, qui révéleront mes pensées et qui plus tard, relus, me rediront les émois d'aujourd'hui...
Je ne pouvais dormir ; la pensée bouillonnait trop tumultueuse : cette force latente de production, j'en sentais la pression ; – l'inspiration me devenait comme palpable ; la vision de l'œuvre m'éblouissait comme déjà faite. Quelles splendeurs d'auréoles ; quelles lueurs d'aurore... Puis mon front qui me brûle, ma grandeur m'étourdit la pensée qui se désordonne – le sentiment de chanceler, une chute – quelque chose qui va se briser... Ah ! devenir fou ! – et brusquement, très pieux, dans un effort violent, par une indicible terreur que la pensée ne m'échappe et que toute cette promesse ne crève d'un seul coup :
– « Pardonnez-moi, Seigneur, je ne suis qu'un enfant, un petit enfant, qui s'égare dans des sentiers perfides : ô Seigneur ! que je ne devienne pas fou ! »
Pour le style, que la saveur s'en précise – et, puisque ce n'est pas la plastique, que la musique alors s'affirme ; – la strophe même – pourquoi pas ?
Mets ta main dans ma main, que nos doigts s'enlacent.
Ton cou sur mon épaule, et que nos cœurs se sentent battre.
Laisse peser ton front et que nos regards se confondent.
Mais n'allons pas jusqu'au baiser.
De peur que l'amour nous distraie.
Ne parlons pas, restons ainsi, que j'entende chanter ton âme
Et que la mienne y réponde au travers des doigts confondus.
Des cœurs approchés, des regards qui s'appellent...
Ne parlons pas – silence.
*
Ton âme chante dans tes yeux sombres.
Fais-les plus proches, mon amie.
Je la sens toujours trop lointaine.
Plus proches, ah ! plus proches encor –
Que tes regards me troublent !
On croirait qu'ils sourient et que ton âme pleure.
Qu'elle est donc loin encor derrière tes prunelles.
Dans l'ombre humide de tes yeux
Plonge mon âme désireuse. –
Mais toujours plus avant se recule ton âme
Derrière tes prunelles.
« Bien aimée, ah ! détourne, ah ! détourne de moi Tes yeux, car ils me troublent. »
(Alternative : SCHUMANN.)
Ne me regarde pas – parle plutôt – j'écoute.
Oh ! parle et je te rêverai
Semblable à l'inflexion de ta voix douce.
Qu'importent les mots – parle sans suite,
Parle lentement, songe à l'harmonie
Qui me révélera ton âme.
*
Je m'endormirais au bercement de tes paroles.
Penser parfois que c'est une duperie, cette poursuite de l'âme insaisissable, et qu'elle n'est rien autre chose qu'une manifestation plus déliée de l'esprit, d'où la raison conseille de se réjouir. – (Puis, après, viennent des subtilités précieuses) :
... « Cet effort que tente l'âme pour arriver jusqu'à la tienne, il le faudrait instinctif, spontané, – qu'il s'ignore et que l'âme s'oublie, car sinon..., en se regardant elle-même. »
Subtilités encore.
§ « A s'appeler et se contempler, elles ne se mêleront pas : en admettant que du corps elles s'échappent et bondissent l'une vers l'autre dans un mutuel élan de désir, elles se heurtent ou se croisent, mais n'ont pas de lieu où se reposer. »
§ Donc, qu'elles se rencontrent en une adoration pareille et se mêlent sur la chose admirée : elles s'oublieront elles-mêmes ainsi et ne s'inquiéteront dans le regard qui leurre, et ne s'épuiseront dans leur effort pour s'appeler.
Ainsi j'ai senti parfois leur fusion quand nous lisions et que nous admirions ensemble – quand nous avons tous deux l'un pour l'autre prié dans la chambre en deuil de Lucie, quand enfin, dans la nuit de mai si fleurie, nous regardions la même étoile, laissant sur nos joues approchées nos larmes se mêler et nous abandonnant notre âme l'une à l'autre.
Subtilités encore – pièges de l'esprit moqueur.
§ « La communion n'est pas encore parfaite.
Je sens la confusion de nos âmes ; je ne sens pas nos âmes se confondre.
Pour que la mienne se mêle à la tienne, il faut que je perde la notion de sa vie résistante, la conscience d'elle-même : L'âme devient passive alors.
Ainsi le Nirvâna n'est un bien qu'avec la saveur du néant goûtée dans le non vivre même. Il y a négation.
La communion ne sera jamais parfaite ; ou. parfaite, elle ne se sentira pas. »
L'harmonie plutôt – la musique ! La musique propage l'ondulation de l'âme jusqu'à l'autre âme.
Les corps me gênaient : ils me cachaient les âmes. La chair ne sert de rien : ce serait l'immatérielle étreinte.
La possession ; – alternative pour Allain, – et pour moi ; il faudrait s'en convaincre.
*
La nuit, bis quand le corps s'abandonne, l'âme s'échappe. C'est le sommeil. – Elle s'envole hâtive vers ses lointaines amours et les possède immatériellement : le corps rêve.
Le matin vient ; c'est le réveil ; le corps se lève : – il ressaisit la petite âme encagée de nouveau. L'on se souvient lointainement et l'on regrette – les chères amours qu'on croit seulement rêvées... car ils sont habitués à ce que le corps t'accompagne, petite âme ! – Ils n'imaginent pas sans lui de caresses... – Ah ! s'ils savaient ! mais ils sont tous aveugles !
Et chaque soir mon âme vite s'envole pres de toi, près de toi qu'aime mon âme Comme un oiseau leger. mon âme s'est posée sur tes lèvres, et. dans un doux frémissement, tes lèvres se sont mises a sourire
Avec un cri plein de désir sehnsuchtsvoll . mon âme a appelé la tienne. Comme deux flammes se mêlent, nos deux âmes ainsi se sont confondues, puis profondément elancees dans l'espace qui s'enharmonise au palpitement de leurs ailes
Elles ont pris leur essor dans l'espace. – c'est la nuit, et la lune est belle. Des grands bois endormis, les brumes montent. L'un dans l'autre enlacés, nous fuyons vers les cieux plus doux, vers les brises plus tièdes dont notre âme souhaitait les caresses – Par les sapins où le vent chante, – dans la forêt transie aux rosées ruisselantes, sous les rameaux penchés qui sur nous pleurent, – sur les blés à perte de vue qui s'étendent dans l'horizon vide et s'inclinent à notre passage comme les houles des flots sous les souffles, – au penchant des humides prairies, où les corolles des fleurs pensives, enfin désaltérées, répandent en parfums, vers les étoiles lointaines, leurs rêveries extasiées. – Dans le silence de la nuit, nos âmes fuient – d'un vol doux et rapide.
La mort viendra qui ne séparera pas nos âmes.
Par-delà le tombeau, elles s'élanceront pour s'unir encore.
Car les corps séparés ne font pas les âmes solitaires.
Le monde ne peut séparer que les corps.
L'âme aimante n'a rien qui l'arrête ; car l'amour a vaincu toutes choses.
L'amour est plus fort que la mort.
La Raison ! disent-ils, – je les trouve superbes ! Mais qu'a-t-elle fait, leur Raison ?
Elle s'oppose toujours à l'âme ; quand le cœur s'élance, elle l'enfrène.
Aussi tous les dévouements la repoussent ; le sublime est insensé toujours : folles, les hardiesses, les poésies, ce qui vaut la peine qu'on vive. La raison voudrait qu'on se conserve ; elle est utilitaire, mais elle fait la vie insupportable à l'âme.
Aussi les grands amours la méprisent, car celui qui aime ne vit plus pour soi-même : sa vie n'est qu'un moyen d'aimer ; s'il en trouve un meilleur et qui fasse l'union plus intime, il négligera pour celui-là sa vie même, il la rejette peut-être, il l'oublie.
Je n'ai jamais eu de bonheur que ma raison ne désapprouve.
(Août 88.)
« Il était tard déjà ; les autres, fatigués, s'assirent pour nous attendre.
L'autre versant de la colline, péniblement gravie, dévalait en pentes douces. Le soleil inondait la plaine de rayons dorés, pacifiques. Dans un repli de rivière, un château couvert d'ardoises ; autour, les toits plus bas des fermes blanches ; sous des impondérables brumes, la lande rose, et. surplombant, une crête de roches grises.
Les feuillages de deux châtaigniers se mêlaient au-dessus de nos têtes. Sur les pentes de la prairie, des femmes élevaient en meules les foins séchés ; l'air frissonnait d'un bruissement d'amour ; et. planant, enveloppant tout, une sérénité radieuse, une tendresse pénétrante, semblait émaner des choses avec l'odeur des foins qui s'élève quand vient le soir. Notre âme en était altérée.
« Seigneur, m'écriai-je, – il est bon que nous restions ici ! si tu voulais ? – faisons-y notre tente ! » Alors toi tu souris, mais ton sourire avait tant de tristesse que j'y sentais ton âme abandonnée ; la mienne un instant en frémit... ; tu le compris trop, et craintive, vite te détournant, tu t'arrachas douloureusement au charme. Ta main repoussa ma main qui la serrait. – « Allons ! dis-tu. ils nous attendent. Il faut quitter tout cela... »
Emmanuèle et moi la priâmes de chanter. Nous étions seuls ; V*** se mit au piano et commença la Sorcière de Schumann, en s'accompagnant elle-même. Sa voix n'était plus qu'un souffle, vase fragile de l'émotion – c'était l'émotion pure, – sans même rien qui la contienne, et qui s'échappait immatérielle : l'âme y transparaissait : il semblait que l'âme même chantât, et fît la voix inutile. – Dans la plaine ensorceleuse, sur les notes frêles suraiguës : « Es ist schon spät ; es ist schon kalt », elle tremblait, frémissant comme une chose brisée.
Ton émotion fut trop forte ; les larmes jaillirent de tes yeux ; puis, honteuse de ce trouble, inquiète de te sentir l'âme aussi vibrante malgré toi, tu t'enfuis brusquement. Je te suivis ; tu courais à ta chambre. – « Ah ! dis-tu, laisse-moi, je te prie ! »
Je m'en allai ; dans la campagne j'errai jusqu'au soir, l'esprit balancé sur des exaltations infinies ondulant au gré des harmonies ressouvenues.
Que l'âme se sente vivre, et par l'effort pour vaincre dans la lutte recherchée ; – de là les rêves d'impossible, la chasteté, la foi ; puis, avec les énergies acquises, elle sera plus vaillante pour s'emparer de ton âme, malgré ton esprit batailleur.
Ton esprit ! Ah ! que je lui voulais donc de mal autrefois ; ton pauvre esprit qui s'effrayait des troubles de ton âme et s'évertuait de calmer ses transports. Quelles luttes, et sans cesse, pour te résister à toi-même ! tu voulais ta volonté dominatrice et l'opposais à la tendresse envahissante. – « Je ne me laisserai dominer par quoi que ce soit ! » pensais-tu.
Je méconnaissais tout cela. Je comprenais seulement que ton esprit me dérobait ton âme et que ton âme me souhaitait.
J'entends bien parfois gémir tout bas ton âme, mais ton esprit dominateur la mate. Va ! je la forcerai bien de crier sans que ton esprit étouffe ses plaintes.
Va ! je la forcerai bien de parler, ta pauvre âme...
De la musique, – de la musique : en les plaintes de l'harmonie, ton âme étonnée reconnaîtra les siennes et les sanglots jailliront, si longtemps contenus. Mais, quand je commence à jouer, aussitôt tu t'enfuis, craintive.
⁂ Une nuit d'été, nuit brûlante d'orage, après un jour splendide, – tout se taisait, dehors, pas un souffle. – L'âme attendait.
Tu sortis sur la terrasse ; les autres restaient dans le salon. Quand je vis que tu ne pouvais plus fuir, j'ouvris la fenêtre toute grande et me mis au piano. Les sons t'arrivaient ainsi que des ondes. – Je commençai le premier Scherzo de Chopin ; brutalement, bruyamment, comme pour préluder, ne voulant pas d'abord effaroucher ton âme. Au piu lento, je mis la sourdine, et la mélodie pleura, morbidement douce : comme les perles d'un jet d'eau s'égrènent, les notes d'en haut tombaient, obstinément les mêmes, mais différemment éloquentes, tandis qu'alternait l'harmonie. – Je repris l'agitato, mais avec toute la passion de mon cœur, faisant tressaillir l'inquiétude des dissonances. – Je m'arrêtai brusquement avant que tu n'aies pu te dégager du charme. Et je vins près de toi ; je te trouvai tremblante ; pas de larmes, les yeux brillants. – « André, pourquoi jouais-tu cela ? » dis-tu, et ta voix était altérée, tellement que j'en fus effrayé et que je n'osai plus rien dire. – Nous nous taisions ; – alors toi, comme distraite : – « Regarde cette nuit ! N'est-ce pas qu'elle est surnaturelle ? » Des éclairs palpitaient sans bruit à l'horizon. L'air était embaumé du pollen des tilleuls, du parfum des acacias en fleur. Je voulus prendre ta main ; elle était brûlante ; mais tu me repoussas. – Nous nous taisions. – Alors toi, de nouveau, mais très bas et la tête inclinée : – « O André ! tu as agi lâchement ce soir. » Des gouttes d'eau commençaient à tomber ; nous rentrâmes.
L'orage éclata dans la nuit. Tu fus souffrante ; la fièvre et presque le délire.
Le lendemain, tu restas couchée ; tu refusas de me voir : « Un rien m'agite », disais-tu.
(Jeudi.)
« Réfléchi presque toute la nuit : je ne pouvais dormir. « O André ! tu as agi lâchement ce soir. »... et je te sentais tout à coup si frêle et délicate auprès de moi... si fragile et comme implorante. »
« Ce que j'ai fait était coupable ; t'inquiéter, – vouloir troubler ton âme... et pourrais-je la satisfaire, après que je l'aurais altérée ?
... Tu as agi lâchement ! –
Son mépris ! – Ah ! que tu ne me méprises pas ! – mais maintenant ? »
(5 octobre.)
« J'ai vécu tout ce jour dans une tristesse infinie, au milieu de choses grises.
Je recueillais une à une mes espérances flétries, et je les pleurais chacune.
Mes forces s'en étaient fuies toutes avec moi ! je n'osais même plus te souhaiter lointaine. »
« Je cesserai de poursuivre ton âme.
J'attendrai. – Je serai là – je resterai le même. A ton moindre désir, j'accourrai vers toi – mais pas avant que tu ne m'appelles. J'attendrai. »
(Dimanche.)
« Aujourd'hui j'ai vécu près d'elle, mais nos regards ne se sont pas cherchés ; je ne me suis pas rapproché de toi. J'ai pensé presque tout le jour.
L'attente.
Nous cheminerons PARALLÈLES : cela me désespérait autrefois. »
« J'ai recommencé de lire ma Bible. Il faut remonter la pente, descendue sans que l'on s'en doute.
Oh ! qu'il est difficile. »
.....
Je saute des pages – la transition sera trop brusque, mais je suis las de tout redire.
Je voudrais des choses nouvelles – et j'en vois de si radieuses...
J'étais triste alors... que cet « alors » est loin ! Dehors, c'est le printemps qui va naître – et je voudrais chanter :
Puisque l'aube grandit, puisque voici l'aurore.
(18 oct.)
« L'estime de soi-même ; le contentement dans l'âme ! la splendeur de la vertu, que d'abord je cherchais pour toi, m'éblouit peu à peu et m'attire elle-même.
Il est des émotions plus hautes, des ferveurs plus nobles, des enthousiasmes plus sublimes.
L'âme évolue. »
(22 oct.)
« Pour moi seul ! pour moi seul !
Ils ne comprendront pas – que m'importe ?
Mon cœur déborde : il faut chanter.
Un peu d'harmonie plutôt que des mots – pas de phrases – ô les phrases pour qu'ils comprennent.
« Des paroles pleines de charme bouillonnent dans mon cœur. » Mon âme se balance sur les ondulations moduleuses, les arpèges rompus, soulevés comme un vol inquiet d'ailes furtives, sans cesse retombant sans jamais se résoudre.
La passion se rythme, se scande et s'apaise... la passion s'endort, l'âme médite. »
« ALLAIN.
Pour ne pas troubler sa pureté, je m'abstiendrai de toute caresse – pour ne pas inquiéter son âme – et même des plus chastes, des enlacements de main... de peur qu'après elle ne désire davantage, que je ne pourrais pas lui donner ;... et je détournerai de ses yeux mes regards, de peur qu'elle ne les désire plus proches, et qu'alors. malgré moi, je n'aille jusqu'au baiser.
Notre âme ainsi restera craintive, malgré que l'appelle l'autre âme... »
(25 oct.)
« L'âme médite :
Pas de vertu sans effort : – ma charité n'est pas vertueuse ; j'aime aimer parce qu'il m'est doux d'aimer et parce que je voudrais qu'on m'aime autant que j'aime... mais il n'y a pas d'effort.
– Ou bien l'effort tenté attend l'estime d'autrui, son estime ; il n'est pas encore méritoire. Il faudrait l'effort sans l'espoir de la récompense.
Je cherche où est la vertu ?
La vertu serait le bien sans qu'elle le sache... oui, sans qu'après, auprès d'elle, je revendique des droits à une estime plus grande...
Sans qu'elle le sache, .. et volontairement, est-ce possible ? Il faudrait que d'abord, avant de faire l'action, je me promette de ne rien lui en dire, ni à personne qui le lui redirait – d'ensevelir l'acte en mon cœur – c'est là que l'idée de Dieu est nécessaire. il faudrait que je me paraisse le lui offrir comme un intime sacrifice dont la fumée monterait jusqu'à lui sans être vue des hommes – que je me promette de te le cacher toujours !...
Mais cette pensée m'effleure : « A quoi bon alors ? – puisqu'elle ne le saura pas. »
Mercenaire ! Il faut trouver la récompense du bien en le bien lui-même, – ne pas attendre sa récompense des hommes ; – puis cependant, la récompense de mériter son estime, quand je l'approche, sentir que je suis digne (un peu plus, tout au moins). Oh ! sans que je lui dise rien, elle le lira bien dans mes yeux, à travers mes yeux jusqu'à mon âme... « Va ! je le sentirai bien sans que tu parles », disait-elle.
... Mais alors c'est de nouveau son estime cherchée. C'est un pas de fait ; ce n'est pas tout ; quoi encore ?
– Me laisser calomnier, fût-ce par elle, et vaincre la révolte de l'orgueil ; accepter l'accusation injuste, sans chercher à s'en défendre, de sorte qu'elle me croie pire que je ne suis. Cela serait superbe ! Là, il y aurait lutte, déchirement, triomphe !
Mais si elle m'en aimait moins ?, ..
Eh bien ! c'est là précisément qu'est l'épreuve, c'est là qu'est la vertu : sentir que je suis au-dessus de son estime, que je vaux plus qu'elle ne croit. Elle m'en aimerait moins – qu'importe ! moi je l'en aimerais davantage, et ce serait ma récompense. Et je ne m'abuserais point ; je saurais que le besoin d'estime pour moi-même, que l'orgueil me fait agir ; mais j'en prendrais mon parti, loyalement, simplement, sans me jouer à moi-même des luttes morales gratuites.
Oui, c'est cela ! mésestimé par elle ! là est la vertu. C'est ce qu'il faut faire – mais comment encore ? – Un mensonge où moi-même je me calomnierais ? – Non ! je veux que l'action soit pure tout entière. Le mieux est de laisser faire les choses, simplement, banalement ; c'est ce dont je souffrirai le plus, car j'ai peur de trouver de l'encouragement au milieu de l'épreuve, dans le quelque chose d'un peu théâtral que j'y mettrais. –
Alors, simplement, banalement, je me laisserai accuser par les choses, par tous ceux qui m'entourent, de cette infinité de petites accusations mesquines, hasardées, dont mon orgueil bondira de souffrance irritée ; mais je le maintiendrai ; et, le soir, je prierai, très seul et très calme, et je tuerai mon moi despote et superbe, lentement, sous ces infimes blessures.
Et je t'en aimerai plus encore, je te bénirai plus encore, ma sœur, parce que je me dirai tout bas (mais il ne faudra pas te le dire) que c'est à toi que je dois de devenir meilleur. Te mériter plus en m'éloignant de toi – (oh ! sans style). « Dussé-je en vous aimant davantage, être moins aimé de vous. » (II Cor., XII, 15.)
(28.)
« Pour moi seul ! pour moi seul !
Ils ne comprendront pas... que m'importe ?
Je vous reconnaîtrai bien toujours, chères larmes d'amour, sous le mystère, pour les autres, de ces sanglots, de ces cris et de ces murmures...
Des larmes ? pourquoi des larmes ?
Je suis heureux pourtant... elle m'aime –... mais mon âme frissonne à la tombée du soir.
Dans la rue ils riaient en passant ; je ne sais qui chantait, mais des sonorités excessives. – Puis le soir est venu : tout s'apaise. L'eau reflétait le ciel tout rose, et déjà, sous les ponts, très sombre.
Et je ne savais plus – je marchais comme un fou ; j'avais des chansons plein la tête.
Puis le soir est venu ; tout s'apaise... l'ombre envahit – et c'est, dans le ciel pâle, la nuit...
la grande nuit qui monte.
Des larmes ! Pourquoi des larmes ? larmes d'amour, larmes d'extase !
Je pleure parce que la nuit est belle et que l'espoir emplit mon âme. »
(Minuit, Antibes, 5 nov.)
« C'est la nuit. Je ne peux pas dormir. – Que fais-tu. Emmanuèle ? Je sais que tu veilles : sur le balcon les lumières de ta chambre dessinent, en fleurs d'ombre, les broderies de tes rideaux. – Que fais-tu ? Il est tard. Les autres sont couchés.
Et qu'avais-tu ce soir ? tu paraissais pensive, – pensive de quoi, ma sœur ? – Oh ! si j'osais lire en ton âme... Emmanuèle. serait-il vrai ?... Mais j'ai peur de savoir, – j'attends encore.
Ah ! je vous en conjure, filles de Jérusalem, N'éveillez pas, n'éveillez pas l'amour – Avant qu'elle le veuille.
⁂ Je m'étais assis au piano ; je n'avais plus tenté de jouer devant toi depuis l'autre soir... craignant tout, dans le doute ; – je jouais au hasard des Novelettes de Schumann. Vous étiez sur le balcon : il faisait très chaud encore malgré la nuit montante. Je jouais au hasard – et voici, – tu vins m'écouter. Je n'avais pas vu ta venue ; je te sens tout à coup près de moi. au fin frôlement de ta robe. L'étonnement me trouble si fort, que, tout tremblant, je ne peux plus rien faire, et je te dis : « Vois ! que tu viennes ainsi m'écouter, cela m'émeut tant... je tremble. » – « Oh ! pourquoi donc. André ? » – tu souriais interrogeante. – Tu ne partais pas ; tu restais toute proche. – et tu me regardais ; – je sentais ton regard sans le voir.
Détourne de moi tes yeux, car ils me troublent. –
Tu restais si pensive. Pensive de quoi, Emmanuèle ?
Que fais-tu maintenant qu'il est si tard ? – L'heure est venue qu'on doit dormir. –
Puis nous étions assis, – c'était un peu après, – tous autour de la lampe. Tu t'étais levée pour chercher quelque ouvrage, et voici qu'avant de te rasseoir, tu t'approches, et, sur mon front, je sens ta main, ta main frêle posée qui doucement caresse. – Alors je t'ai regardée ; au-dessus de moi penchée, tendrement, tu souriais, mais si triste et comme pensive... Pensive de quoi, Emmanuèle ?
– Que fais-tu, maintenant, si tard dans la nuit ?
Peut-être que ton âme attend de même et que tu pries. »
(6 nov.)
« Pour la première fois, j'ai vu ton regard en songe : – Il souriait, mais moqueur ; et comme pour ne plus le voir je mettais ma main sur mes yeux, – au travers de ma main je le voyais encore. »
« Tu m'as dit, avec le baiser du matin : « J'ai prié pour nous deux, André, cette nuit » – mais moi : « Crois-tu que je ne le savais pas, sœurette ? »
Alors ton regard s'est troublé ; tu voulais parler, tu t'es tue. – Que voulais-tu me dire ? »
(26 nov.)
« Ils nous surveillent : je le sens bien. Ma mère surtout observe. Elle n'ose croire ; elle ne sait pas – et craint de savoir ; cela surtout la désoriente que, tous ces jours derniers, pour des raisons qu'elle ne peut saisir, je me suis écarté de toi. Mais hier, au piano, quand tu t'es approchée, j'ai bien vu son inquiétude.
Alors je rêvais cette nuit : un étrange et doux rêve. Nous étions rassemblés près de la lampe, au soir ; – on causait, on lisait comme les autres soirs – mais je sentais de toutes parts le muet espionnage de nos gestes, comme on sent ces choses en rêve, intuitivement.
Craintivement, je veillais sur mes actes ; et, de peur que tu ne m'approches, je m'étais mis très loin de toi.
Toi. distraite, semblant ignorer les regards, voici que tu t'approches pourtant, et que je ne puis pas fuir, et ta main prend ma main, inutilement se dérobante, puis lentement, tendrement, la caresse.
Autour de nous, leurs regards qui s'allument, les têtes qu'ils hochent, l'expression de leur sourire : « Ah ! ah ! faisaient-ils. nous le disions bien, nous le disions bien ! » C'était un ricanement très pénible.
Toi. tu restais les yeux baissés ; moi, je tentais de repousser, mais vainement, ta main obstinément caressante.
Et cela était si étrangement doux que je m'en suis éveillé, comme d'un cauchemar. »
Ici s'arrêtent les pages écrites. – Puis c'est ma mère malade. Tous deux au chevet de son lit nous la bercions de tendresse. Je lui mouillais le front, et toi. tu lui donnais à boire. Tous deux nous nous perdions en une commune prière ; tout le reste était oublié. Nos âmes, sans plus rien en elles que de la pitié, sans plus de désirs que celui du devoir, se rejoignaient au-dessus de la mort approchante, sans une joie profane, sans même s'étonner qu'il soit donc enfin là ce bonheur de l'étreinte qu'elles avaient tant souhaité ; – et comme sans se voir, éblouies toutes deux par les clartés de la vertu contemplée, nos âmes y tendaient d'un radieux essor. – Tout le reste était oublié, tant notre pensée était haute. – Le soir, tu mis ta main dans la mienne, pour prier ; puis, comme ma mère s'endormait doucement, tu laissas ta main, l'oubliant, à regarder la chère morte s'endormir. Nous sommes restés longtemps ainsi.
Cette nuit de veille ; tous deux dans cette chambre, où la mourante sommeillait ; proches mais sans nous voir ; – c'est le suprême période ; l'âme évolue. Sans parler, comme assoupis, nous pensions ; – quelles pensées !
La vertu, que d'abord je cherchais pour toi, m'éblouissait maintenant et m'attirait pour elle-même...
Les limites du réel se perdaient ; – je vivais un rêve.
Le lendemain, ma mère m'a parlé ; j'ai déjà raconté ces paroles... mais le sacrifice était déjà fait dans mon cœur...
... Puis ma mère les a fiancés ; je sais que je les ai vus tous les deux, Emmanuèle et T*** au pied du lit, les mains jointes, et que ma mère les bénissait ; – mais de tout le reste je ne me souviens plus ; – la douleur, trop forte, m'apparaissait irréelle ; je croyais la rêver ; – elle n'avait même plus d'amertume.
– Et ce qui reste maintenant, c'est de la joie.
28 juin.
Quelque soir, revenant en arrière, je redirai les mots de deuil... – mais aujourd'hui le ciel luit trop gaiement, trop d'oiseaux chantent. J'ai du printemps plein la tête, et de fraîches chansons où ton nom tout tendrement vient à la rime et s'allitère avec des noms de fleurs ; c'est une douce mélodie : un chant de flûte – on croirait des oiseaux qui gazouillent – et des bruits d'ailes sous les feuilles, dans l'ombre claire – ô les flûtes ! – les hautbois qui s'envolent. –
Par dessus le deuil et la mort, l'amour plane.
– Et les alléluias de victoire couvriront le chant des pleureuses.
Mère chérie, bénie sois-tu ! par dessus ton lit d'agonie, nos âmes se sont retrouvées.
Tu n'as pu séparer que nos corps, puis tous trois nous sommes reposés en la sérénité de la vertu suivie ; mais, par une volonté plus haute et cachée, l'âpre vertu d'abord et qui semblait séparatrice, s'est faite toute glorieuse pour consommer le chaste désir de nos âmes.
C'est en obéissant que je l'ai rencontrée, – malgré nous, et parce que cela devait être.
Puis je suis parti. – Sitôt le temps de deuil fini, on célébrait leur mariage... leur mariage ? ., . et moi je suis parti...
Je suis parti, je me suis enfermé dans cette solitude, car je ne connais plus personne... selon la chair, comme dit l'apôtre.
Et je vais écrire mon livre.
Te voilà si changée, mon âme !
Tu pleurais tantôt ; tu souris maintenant.
Ne te regarde pas – n'explique rien – laisse que le sentiment domine ; – et puis – va de l'avant. Toutes choses sont faites nouvelles...
J'ai dit à mon âme :
Qu'as-tu donc à sourire ? Ta solitude est désespérée. Voici, l'ancienne amie est maintenant pour toi comme si elle n'était plus. Il te faudrait même quitter ces songeries adultères.
Pleure plutôt ; ils sont partis, tous les aimés, et t'ont laissée seule ; pleure ; tes amours sont passées. Il est fini le temps d'aimer...
– « Crois-tu ? » m'a répondu mon âme, et souriait toujours, se redisant :
Par dessus le deuil et la mort, l'amour plane. Les grands chagrins sont assoupis et les pleureuses se sont tues. – Chante, mon âme, aux nouvelles aurores.
Tous les espoirs ont refleuri.