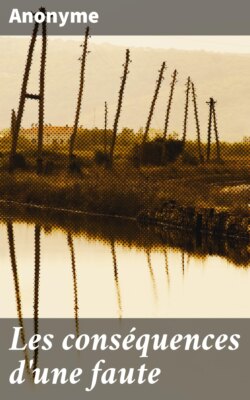Читать книгу Les conséquences d'une faute - Anonyme - Страница 3
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE
ОглавлениеTable des matières
Il y a quelques années, je reçus, de l’Ambassade de Russie, un paquet fermé et soigneusement cacheté, avec adresse portant mon nom. Je l’ouvris, sans en savoir le oontenu et sans deviner l’origine de cet envoi. C’était un cahier de papier très fin, à tranche dorée, écrit en russe, d’une jolie écriture anglaise, sans une seule note qui m’indiquât la nature de ce manuscrit, mais je trouvai, dans l’intérieur des feuillets, une petite lettre à mon adresse, ne renfermant que ces mots sans signature:
«Monsieur, je m’autorise du nom de la princesse D..., votre amie, pour vous proposer un traité secret de Sainte-Alliance littéraire. J’emploie mes loisirs à composer des nouvelles, que je serais bien aise de voir publiées en français. Je vous demande de les traduire et de les faire paraître dans quelque journal ou revue de votre pays. En échange, je traduirai en russe un ou deux de vos romans et je me charge de les faire imprimer ici ou à Kiev. Vous devez posséder à fond la langue russe, puisque vous avez écrit votre grande Histoire de la vie et du règne de S.M. l’empereur Nicolas, qui malheureusement n’est pas achevée. Quand donc l’achèverez-vous?
» Répondez-moi à Simbirsk, poste restante.
» K.»
J’examinai l’enveloppe du paquet, qui m’avait étéenvoyéde Simbirsk par l’entremise del Ambassade de Russie, et je n’y trouvai pas d’autre indice que le cachet en cire rouge, appliqué cinq fois sur le paquet, et offrant des armoiries très compliquées avec couronne de prince. Je n’avais pas d’Armorial russe, et je n’aurais pas été plus avancé, si j’en avais eu un, puisque je ne sais pas le russe, et que j’ en connais à peine l’alphabet. J’allai à l’Ambassade de Russie, demander une information qu’on ne put me fournir: le paquet à mon adresse venait directement du ministère des affaires étrangères, à Saint-Pétershourg.
J’écrivis donc à la princesse D..., pour avoir des renseignements sur le prince K..., de Simbirsk, et je lui transmis une copie de la lettre que ce prince (car je croyais bien avoir affaire à un prince) m’avait adressée. La princesse D... me répondit qu’elle ne connaissait, à Simbirsk, que la princesse K..., qui devait être âgée de près de quatre-vingts ans et qui, à coup sûr, n’écrivait pas de nouvelles ni de romans. J’aurais pu, pour être mieux instruit, communiquer à la princesse D... le cachet aux armes du prince K..., mais je n’en eus même pas l’idée. J’ignorais même où pouvait être située en Russie la ville de Simbirsk, et j’appris, dans un dictionnaire de géographie, que cette ville, chef-lieu du gouvernement de même nom, était à1,458kil. de Saint-Pétersbourg et à749kil. de Moscou, sur les bords du Volga, et à l’emboùchure de la Sviaga, dans ce grand fleuve. La lettre qui me venait de Simbirsk, en passant par Saint-Pétersbourg, avait donc parcouru plus de658 lieues de poste, avant de m’arriver!
J’écrivis au prince K..., poste restante à Simbirsk. Je m’excusais d’être incapable d’accepter l’échange de bons procédés littéraires, qu’il me faisait l’honneur de m’offrir, car je ne savais pas le russe et j’avais même oublié le peu que j’en avais appris pendant mon séjour en Russie. Je lui proposai de faire une démarche auprès de M. Tourgueneff, l’excellent romancier russe, qui habitait la France et qui écrivait lui-même en français de beaux romans de mœurs. Je déclarai impossible de trouver à Paris un traducteur, depuis la mort de Mérimée, qui avait possédé si parfaitement la langue russe et qui se plaisait tant à la traduire dans son admirable style français. Je priai donc le prince K... de m’indiquer le moyen le plus sûr de lui renvoyer son manuscrit, en lui exprimant le regret de ne pouvoir en faire usage, suivant son désir.
Je n’eus la réponse du prince ou plutôt de la princesse, car c’était une princesse, que trois ou quatre mois plus tard, par un nouveau paquet à mon adresse, quo l’Ambassade de Russie me fit remettre. Sur ce paquet, le cachet offrait des armes tout à fait différentes de celles qui se trouvaient sur le cachet du premier paquet, mais encore avec couronne de prince. Le nouveau paquet contenait un manuscrit de la même écriture que celle du premier paquet; la lettre qui l’accompagnait était aussi de la même main, que la première lettre:
« Monsieur, ce n’est pas le prince, c’est la princesse, qui vous écrit et qui vous envoie non plus un recueil de nouvelles, mais un roman, non pas écrit en russe, mais en allemand. Tout le monde aujourd’hui, en Europe, sait l’allemand, et j’ai lu plusieurs de vos ouvrages traduits dans cette langue et très bien traduits. Je traduirai donc, de mon mieux, en allemand, ceux de vos romans qui n’ont pas encore été traduits et je les publierai, avec plaisir, à Berlin. Je compte toujours sur l’échange que je vous ai proposé: vous allez traduire en français mon roman, et vous le publierez, s’il est possible, dans la Revue des Deux-Mondes, en le signant Une dame russe. Je vous donne plein pouvoir sur votre traduction; vous couperez, vous changerez tout ce que vous voudrez, dans mon roman, qui, s’il réussit, ne devra qu’à vous son succès. Répondez-moi à Berlin, poste restante.
» Votre très humble traductrice, K...»
–Ah! madame, m’écriai-je en monologue, moi, traduire de l’allemand, que je ne sais pas même lire! Votre ouvrage, je n’en doute, mérite les honneurs d’une bonne traduction française! En vérité, je suis honteux de n’avoir pas appris l’allemand!
J’allai, sur l’heure, chez un ami, qui lisait l’allemand à livre ouvert, et je le priai de parcourir devant moi quelques pages du manuscrit de la princesse et de m’en dire son avis. Le titre da ce roman pouvait être traduit: Le malheur d’être belle. Mon ami lut rapidement les premières pages et feuilleta le manuscrit, en portant çà et là sa lecture errante, qui lui permît de formuler un jugement sommaire sur tout l’ouvrage. Ce roman, dont le sujet paraissait emprunté à la vie du graand monde, était écrit avec beaucoup d’élégance et de charme. On y reconnaissait l’esprit et la plume d’une femme de haute distinction. Je remerciai mon ami, et remportai mon manuscrit.
Je ne lis pas atttendre la réponse à la princesse K..., et je ne lui ménageai pas les élogas que mon ami avait faits du roman qu’elle m’invitait à traduire. Je lui avouai, sans rougir, que je ne savais pas un traître mot d’allemand, et quue, d’ailleurs, je n’avais pas l’avantage de connaître les hauts et puissants seigneurs de la Revue des Deux-Mondes. Ce me fut une occasion de faire l’oraison funèbre de Buloz, qui m’aurait certainement fourni un traducteur d’allemaud pour le roman d’une princesse russe, quoique la galanterie ne fût pas une de ses qualités professionnelles. Je pris la liberté de m’étonner de ce que la princesse, écrivant en allemand aussi bien qu’en russe, ne publiât point elle-même son roman à Berlin.
Quoique Berlin ne fût pas à658lieues de Paris, ainsi que Simbirsk, j’attendis trois mois une lettre de la princesse K... La lettre m’arriva enfin, avec le manuscrit d’un nouveau roman, écrit cette fois en polonais, et la lettre était datée de Varsovie. L’envoi du manuscrit n’avait pas été fait, cette fois, par l’Ambassade de Russie, mais tout simplement par la poste, et la lettre qu’il eût été impossible de joindre à ce manuscrit, envoyé comme papiers d’affaires, était affranchie et recommandée. En voici le texte:
«Cher monsieur, vous allez encore me maudire. Je vous adresse un nouveau roman, écrit en polonais, et dont le titre serait en français: «Qu’en pensez-vous? Vous me demanderez pourquoi cet ouvrage est écrit en polonais plutôt qu’en russe ou en allemand? Je viens de passer trois mois dans le château d’une amie, en Ukraine, au milieu d’une charmante société polonaise. Je me suis remis à parler polonais, comme tout le monde qui m’entourait, à ce point que j’avais presque oublié ce que je sais de votre belle langue française. Voilà comment j’ai fait un roman français, en langue polonaise. C’est à vous de le faire traduire et de lepublieràmesfrais, car les Polonaisne manquent pas en France pour faire cette traduction. Je vous promets, en échange de traduire en polonais et de faire imprimer à Varsovie un de vos meilleurs romans historiques: Les deux Fous ou la Danse macabre.
» Je vais aller passer cinq ou six mois, dans mes terres, en Silésie. Voulez-vous, je vous prie, me faire passer tout co que vous auriez à m’adresser, sous le couvert du révérend docteur Mayr, ministre évangélique à Oppeln. La poste est moins curieuse et plus exacte que les ambassades.
» Château de Z..., près de Kiev. K.»
Je prenais un vif intérêt aux essais littéraires de la princesse, sans les connaître encore, et cette fois je ne fus pas en peine de trouver, dans mes relations de monde, une dame polonaise qui eut l’obligeance, non pas de traduire, la plume à la main, le roman qu’on m’envoyait écrit en polonais, mais de m’en donner lecture en français. Je fus émerveille, ravi, ému de cette lecture, et je demandai le secret à la lectrice, en lui disant (Dieu me pardonne ce mensonge obligatoire!) que ce roman, si vrai, si touchant, si intéressant, était ou devait être la traduction d’un ouvrage composé en Pologne par Balzac, peu de temps avant son mariage avec Mme la comtesse Hanska, mais que l’original s’ etait égraré ou perdu, lorsque l’auteur était revenu à Paris pour y mourir. J’avais mis à une rude épreuve la discrétion do mon aimable lectrice, et deux jours après sa lecture, le bruit courut, dans la société parisienne, qu’on allait publier un roman de Balzac, inédit, intitulé:
Qu’en pensez-vous?
Il n’en fallut pas davantage pour m’empêcher de faire traduire le roman, comme m’en avait prié la princesse K..., à qui j’adressai mes excuses, en lui racontant le beau résultat de mon mensonge. «Il faut, lui disais-je, laisser tomber le bruit que j’ai eu la maladresse de faire naître, en croyant mettre obstacle à une indiscrétion, qui aurait pu aller jusqu’à vous. Quand on ne songera plus au roman de Balzac, qu’on attend à présent avec impatience, et qu’on me demande de tous côtés, je ferai traduire votre ouvrage, par une personne discrète et nous n’aurons plus qu’à changer le titre du livre, pour le publier sous le nom d’Une grande dame, qui veut garder l’anonyme.»
Ma lettre était partie depuis deux jours, à l’adresse et aux soins du révérend docteur Mayr, ministre évangélique à Oppeln, en Silésie (Prusse), pour être remise à Mme la princesse K..., au château de Z..., près de Kiev (Russie), lorsqu’un gros paquet, duement cacheté aux armes d’Autriche, me fut apporté en mains propres par le comte Z..., attaché à l’Ambassade autrichienne, à Paris. Je reconnus l’écriture, sur l’adresse de ce paquet: c’était encore un envoi de la princesse, que je croyais alors en Silésie, et qui m’écrivait de Vienne.
«Cher monsieur, c’est une traduction faite par vous-même, sinon signée par vous, que je désire et que j’espère. Puisque vous vous récusez, en prétendant ne savoir ni le russe, ni l’allemand, ni sans doute le polonais, je vous mets en demeure de me rendre un service, dont je vous saurai un gré inlini, et je vous envoie la première partie d’un roman, écrit en anglais, dont le titre doit être traduit ainsi:Aqui la faute? Tout le monde sait l’anglais, et vous ne pourrez plus me reefuser de faire la traduction de cet ouvrage, que j’avais commencé il y a deux ans dans un voyage à Londres et que je vais achever, à la hâte, pour vous en faire parvenir la fin. Je veux que vous soyez non seulement mon traducteur en France, mais mon éditeur; je veux que mon premier livre paraisse en français, sous vos auspices: c’est plus qu’un désir, c’est une volonté, c’est un caprice, si vous voulez. Volonté et caprice, n’est-ce pas la même chose pour une femme? Il y a promesse do vous à moi. Il y a un traité entre nous. Je vous dirai en confidence, que c’est en lisant vos livres et en les traduisant dans les différentes langues qui me sont plus ou moins familières, que je me suis essayée à écrire aussi en français. Je vous envoie deux échantillons de ces essais, qui sont encore loin de me satisfaire, deux nouvelles: Une simple histoire et la Princesse Blanche. Voyez ce qu’on en peut faire. Publiez-lez ou brûlez-les.
» K...
» Vienne, Château d’été duprince Liechtenstein.»
Je ne perdis pas de temps après avoir lu ou plutôt parcouru les deux nouvelles, écrites en français, qui m’arrivaient de Vienne, avec200 pages d’un roman écrit en anglais. Je m’empressai de répondre à l’auteur:
«Madame la Princesse, vous avez renouvelé, sans le savoir, un des épisodes de la vie de Rapelais. Excusez-moi de rapprocher, d’une grande dame telle que vous, ce vieux savant de Rabelais, qui faisait aussi des romans que vous ne lirez jamais. Rabelais, envoyé de Montpellier à Paris pour traiter une affaire secrète avec le cardinal Duprat, chancelier du roi François Ier, ne réussit pas à se faire ouvrir la porte de ce ministre. Il imagina de se déguiser en Arménien, et il se présenta, sous ce costume, à l’hôtel du cardinal: il parla d’abord arménien, et le portier, qui ne le comprenait pas, alla chercher un domestique, à qui Rabelais parla arabe; le domestique fit venir un secrétaire, à qui Rabelais parla turc; le sccrétaire appela un protonotaire, à qui Rabelais parla bas-breton; le protonotaire, dont la science était en défaut, vint trouver le cardinal et lui annonça qu’un asiatique, qui savait toutes les langues, restait à la porte de l’hôtel, sans pouvoir se faire entendre. «Qu’on le fasse monter! dit le chancelier Duprat. Nous verrons bien s’il sait parier français.» Rabelais fut introduit: «Monseigneur, dit-il, en s’inclinant jusqu’à terre, que le bon Dieu vous ait en sa sainte garder!» Le cardinal, qui reconnaissait le docte Rabelais, se mit à rire et dit à ses serviteurs étonnes: «Vous voyez bien que cet habile homme parle français aussi bien que vous et moi.
Vous m’avez montré le peu que je vaux, madame, en me faisant confesser que je ne sais ni le russe, ni l’allemand, ni le polonais, ni même l’anglais, mais ce que je sais bien, c’est que je suis et serai entièrement à vos ordres. De toutes les langues que vous savez, le français suffit, et je vais m’occuper de publier vos deux nouvelles dans une Revvue française.»
J’aurais pu me permettre une facétie, dans le gout de Rabelais, en adressant ma lettre à la princesse K..., à Simbirsk, en Russie, ou à Berlin, en Prusse, on au château de Z..., près de Kiev, ou à Vienne, en Autriche, au palais d’été du prince de Liechtensten, etc. Mais je craignais que cette lettre ne s’égarât au milieu de tant d’adresses différentes, et je me contentai de la recommander aux soins du révérend docteur Mayr, ministre évangélique à Oppeln, en Silésie prussienne. Je pouvais bien supposer que la lettre mettrait deux semaines au moins à parvenir à sa destination.
Je portai le manuscrit Une simple histoire, à mon ami, Arsène Houssaye, directeur de l’Artiste, et je le priai de faire paraître dans sa revue cette nouvelle, en la signant: Une grande dame russe. Arsène Houssaye me demanda quelle était cette grande dame; je lui répondis que je ne la connaissais pas même de nom et que son manuscrit m’avait été envoyé de Russie, par un grand personnage de la cour de l’empereur. Arsène Houssaye, qui recevait souvent des communications du même genre pour sa Revue, ne m’en demanda pas davantage; il lut la nouvelle, que je lui avais remise; il y trouva des qualités réelles d’observation et d’exécution. Il se réserva seulement le droit de faire quelques changements dans le style, et la nouvelle parut dans l’Artiste. Elle eut tout le succès, que peut avoir une nouvelle empruntée à la mondaine.
–Si votre grande dame russe veut devenir une des correspondantes ordinaires de l’Artiste, me dit Arsène Houssaye, mettez-moi à ses ordres et à ses pieds; car j’ai reconnu, dans sa nouvelle, non seulement une femme d’esprit qui sait son monde, mais encore une charmante femme, qui veut devenir une véritable femme de lettres, dans le milieu aristocratique où elle étudie des caractères et dessine des portraits d’après nature.
Une lettre que M. le baron de K... m’adressa de Saint-Pétersbourg, m’apprit que la nouvelle, publiée par l’ Artiste, avait eu dans la société russe un grand succès de curiosité et qu’on avait cru reconnaître, dans l’auteur féminin qui signait Une grande dame russe, une des plus grandes dames de la cour de S.M. Alexandre II. J’attendais, de la part de l’auteur-pseudonyme, une lettre d’approbation, au sujet de sa nouvelle, que j’avais publiée dans deux livraisons de l’Artiste, et qui n’avait pu échapper à l’attention de la personne la plus intéressée à juger de l’effet produit dans son monde, par cette publication assez mystérieuse. Je ne reçus pas de lettre à ce sujet, et j’en fus d’autant plus étonné que l’Artiste conservait son ancienne clientèle d’abonnés dans toutes les cours de l’Europe. Le temps me manquait pour continuer, comme il l’eût fallu, le métier de prôneur et d’éditeur des œuvres d’une princesse inconnue, qui semblait vouloir établir en France un bureau de traduction pour ses ouvrages écrits en langues étrangères. L’idée me vint que cette aimable princesse anonyme n’était peut-être, en réalité, qu’une association littéraire de romanciers russes, allemands, polonais et autres, qui se proposaient de faire concurrence, avec des ouvrages inédits, à la Bibliothèque des meilleurs romans étrangers, que la maison Hachette et Cie, a entreprise depuis plus de vingt-cinq ans et qui compte aujourd’hui plus de500volumes, sans cesse réimprimés et répandus dans les familles.
La princesse K..., en effet, garda le silence, pendant plus de deux ans, et j’étais en peine de lui restituer les manuscrits qui restaient entre mes mains. C’était un dépôt dont j’aurais désiré me voir déchargé, et je songeais déjà, en cas de mort, à confier ce dépôt à la Bibliothèque de l’Arsenal, en assignant à l’auteur un délai de trente ans pour réclamer ses manuscrits. C’est alors qu’une lettre de la princesse m’annonça l’envoi, non plus d’un roman écrit dans une langue étrangère, mais des traductions françaises de tous les romans en différentes langues, que j’avais reçus à diverses –époques, sans pouvoir leur donner la destination que l’auteur en attendait. Voici la lettre:
«Cher monsieur, depuis deux années et plus, j’ai cru vingt fois toucher à ma dernière heure. J’étais vraiment malade, et les médecins m’avaient condamnée sans rémission. Je me suis rétablie, par la grâce de Dieu, et aussi par un effort de jeunesse et un ardent désir de vivre. Je viens donc vous remercier bien tardivement d’avoir fait paraître Une simple histoire, dans l’Artiste. Je l’ai vu lire. je l’ai entendu louer, autour de moi, et cela m’a encouragée à reprendre, à continuer mon œuvre. J’ai traduit moi-même en français les romans que j’avais écrits en russe, en allemand, en ppolonais, en anglais et même en suédois. Je vous envvoie donc ces traductions, en vous priant d’en faire ce que vous voudrez et ce que vous pourrez. Vous avez trop bien commencé, pour mal finir. Je m’en rapporte à vous et j’approuve d’avance tout ce que vous ferez. Dans le cas où vous jugeriez que ces traductions soient dignes d’être imprimées, vous enverrez les factures d’impression au révérend docteur Mayr, que je charge de vous faire passer, en mon nom, toutes les sommes nécessaires. Gardez-moi bien le secret, car j’écris, je compose, malgré tout, malgré mon entourage, malgré mes parents et mes amis. J’aime mieux écrire et composer que de faire de la tapisserie ou de tapoter du piano. Je pars demain pour le Caucase. En mon absence, le révérend docteur Mayr sera toujours là pour recevoir vos lettres et me les faire passer.
» K.
» Aux Eaux de Carsbald.»
Le colis que m’annonçait la lettre de la princesse me fut remis, le même jour, par le camionnage du chemin de fer, qui l’avait apporté d’Allemagne. Ce colis contenait quatre ou cinq manuscrits, entre autres les romans intitulés: Qu’en pensez-vous?–A qui la faute?–Les Conséquences d’une faute. Je me mis aussitôt en devoir de publier un de ces romans, même avant de l’avoir lu, mais en n’hésitant pas à me faire garant du talent de l’auteur. Il y avait alors une excellente Revue, rédigée par l’élite de la littérature, la Revue de France, qui paraissait sous l’habile et puissante direction de M. Paul Dalloz. Ce fut à la Revue de France que je destinai le roman que j’avais pris au hasard: Les Conséquences d’une faute, et je puis dire que j’eus la main heureuse, car le frère même de M. Paul Dalloz, un homme de savoir et de goût, fut séduit et charmé par la lecture de ce roman. Il me demanda quel en était l’auteur; je lui dis, sans entrer dans aucun autre détail, que c’était une grande dame russe et que je n’en savais pas davantage. Il ne me cacha pas que l’ouvrage avait besoin de quelques retouches de style, et il eut la bonne grâce de vouloir bien s’en occuper. Je m’empressai do faire savoir à la princesse, par l’intermédiaire du révérend docteur Mayr, que le roman: les Conséquences d’une faute, serait bientôt publié dans la Revue de France.
En même temps, je me rendis à la rédaction de l’Artiste, et Arsène Houssayc étant absent, je remis à M. Baluffe, qui le remplaçait, le manuscrit de la nouvelle, intitulée la Princess Blanche, dont je fis l’éloge le mieux motivé. M. Baluffe partagea mon opinion, après avoir lu cet ouvrage, qu’il s’empressa de faire paraître dans l’Artiste. Les lettrés s’ émurent de cette publication, qui révélait un nouveau romancier de l’écolo de Balzac: ce qui avait été dit fut répété, et donna lieu à un singulier quiproquo et à une étrange légende; on raconta que La princesse Blanche n’était autre qu’ un canevas de roman, que lialzac, pendant son séjour en Pologne, avait écrit à la demande d’une grande dame russe. Malheureusement, pour le roman qui devait être imprimé dans la Revue de France, la publication de cette Revue cessa tout-à-coup, et le manuscrit des Conséquences d’une faute, soigneusement corrigé pour l’ impression, me fut rendu au moment même où il allait paraître. Un des rédacteurs de la Revue de France, que je rencontrai sur ces entrefaites, m’apprit qu’on avait beaucoup parlé du roman, qui devait être publié sous le nom d’une grande dame russe, et que ce roman, d’après le témoignage d’une personne bien informée, était certainement l’œuvre de la reine de Roumanie, qui venait de faire brillamment son entrée dans les lettres françaises. J’aurais trouvé plus de probabilité à cette attribution, si la grande dame russe m’avait écrit de Bucharest ou de Kraova plutôt que de Simbirsk, de Kiev et de Carsl-pad.
Je ne balançai plus à envoyer à l’imprimerie le manuscrit des Conséquences d’une faute, et j’assurai le succès de ce roman, que j’avais lu enfin avec le plus vif intérêt, en obtenant de l’obligeance de M. Oalmann Lévy, le grand éditeur de nos meilleurs romans français, que les romans d’Une grande dame russe seraient toujours les bienvenus dans sa librairie cosmopolite.
Je me suis hâté de faire savoir cet état de choses à qui de droit, par l’intermédiaire du révérend docteur Mayr, et cette fois, la réponse ne s’est pas fait attendre. A la plus aimable lettre de remerciement était jointe la photographie de la princesse, la photographie d’une femme jeune, belle, gracieuse, élégante, et supérieure môme au portrait idéal, que je m’étais fait d’elle, en appelant à mon aide, pour la peindre, d’imagination, les traits les plus fins et les plus délicats, les couleurs les plus vives et les plus enchanteresses. J’ai regretté, je regrette qu’il ne me soit pas permis de placer ce portrait, en tête de l’ouvrage que je mets au jour, comme fondé de pouvoirs d’une grande dame russe, pour lui gagner tout d’abord un public d’admirateurs sympathiques. J’aurai donc désormais sous les yeux la charmante image de la princesse K....., mais je n’ai pas encore obtenu la fafaveur de connaître son nom.
P L. JACOB, bibliophile.