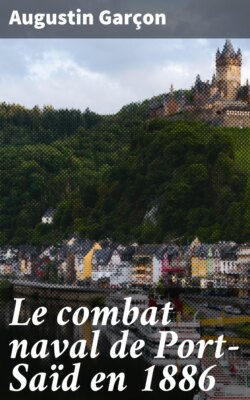Читать книгу Le combat naval de Port-Saïd en 1886 - Augustin Garçon - Страница 6
L’escadre de la Manche
ОглавлениеLe 2 juin 1886. — C’est le jour ou fut livrée la bataille de Port-Saïd. Vous vous souvenez que dans le courant de l’été de 1882, les affaires d’Egypte occupaient beaucoup les esprits; on pensa généralement que notre gouvernement s’y était mal engagé, et en sortirait difficilement. Cependant les affaires furent raccommodées, arrangées à peu près, mais on pressentait que cet arrangement ne durerait pas longtemps. Vous vous souvenez aussi comment l’orage, qui couvait depuis si longtemps, éclata à la fin, et comment peu de temps avant la date de mon récit, nous nous trouvâmes soudainement engagés dans la guerre européenne actuelle. Voici, aussi brièvement que possible, l’exposé des causes de cette guerre.
Par suite des événements de 1882, l’Egypte se trouvait sous notre protectorat et contrôle; les Turcs n’attendaient qu’une occasion pour y rétablir leur ancienne influence et leur première situation. La France, jalouse de la suprématie de l’Angleterre en Egypte, se trouvait dégagée de toute complication extérieure, cela lui permettait de donner plus de temps aux affaires étrangères et de ne pas faire comme en 1882, où elle nous laissa arranger seuls les affaires d’Egypte. La France, dis-je, se joignit aux Turcs.
Mais l’Allemagne, saisissant l’occasion avec plaisir, fit alliance avec nous. D’un autre côté, les Russes, voyant une chance de s’ouvrir les ports de la mer Noire, s’allièrent aux Français et aux Turcs.
Ainsi, au moment dont je parle, nous nous trouvâmes avec les Allemands et les Egyptiens de notre côté, engagés dans une guerre contre les Français, les Russes et les Turcs. Je n’ai pas l’intention d’entrer dans les détails politiques du moment. Vous les connaissez bien, et d’autres les ont mieux expliqués que je ne le pourrais faire.
Je veux seulement vous rappeler ce qui est absolument nécessaire pour vous faire connaître les causes premières de la bataille navale de Port-Saïd.
Quand la guerre fut déclarée en mai 1886, le principal objectif des belligérants fut de s’assurer la possession du canal de Suez.
Nos alliés les Egyptiens, comme de raison, s’y étaient préparés déjà depuis quelque temps et avaient réuni assez de troupes pour garder les bords du canal et empêcher le débarquement des forces ennemies, à condition toutefois qu’elles ne fussent pas trop importantes. Comme l’avaient fait lord Beaconsfield en 1878, et M. Gladstone en 1882, on prépara l’envoi en Egypte de 20,000 hommes de l’armée des Indes.
L’escadre des Indes orientales avait été renforcée, de sorte que la partie du canal donnant sur la mer Rouge était comparativement en sûreté.
Il restait à garder l’entrée du canal à Port-Saïd et la route qui y conduit.
La flotte de la Méditerranée était d’une force imposante; mais, eu égard à la puissante coalition formée contre nous, on jugea utile de la renforcer par l’escadre du canal, d’autant plus que l’on pensait bien que les flottes alliées de France et de Turquie tenteraient un coup de main sur Port-Saïd et l’entrée du canal, aussitôt qu’elles auraient réuni assez de vaisseaux pour réussir dans leur entreprise.
L’escadre de réserve fut jugée suffisante pour. la défense de la Manche. On doit supposer que cette décision fut adoptée après la discussion la plus approfondie, et que l’on prit l’avis des hommes les plus compétents qui pesèrent le pour et le contre. Toujours est-il qu’on ne se décida qu’au dernier moment après la déclaration de guerre et, en fait, on découvrit que, pour être de quelque utilité, les vaisseaux devraient se rendre à destination aussi rapidement que possible.
Des ordres furent donnés en conséquence. Ce départ précipité de l’escadre du canal, rendu nécessaire par les tergiversations des autorités, mit à jour de graves défectuosités qui existaient dans les machines et qui furent la cause pour laquelle la bataille de Port-Saïd se termina d’une manière si peu satisfaisante pour nous. Afin de bien comprendre ce qui arriva, il vaut mieux suivre les événements.
L’escadre du canal était ancrée dans la baie de Plymouth, et se composait des vaisseaux suivants, supposés être tous en état pour un départ immédiat:
Le Minotaur, 17 canons, portant le pavillon du vice-amiral Sir James Weldon;
Northumberland, 27 canons;
Hercule, 14 canons;
Azincourt, 17 canons, portant le pavillon du contre-amiral Hawkins;
Achille, 16 canons;
Sultan, 12 canons.
L’escadre n’était pas nombreuse ni les navires bien puissants, mais ils avaient été bien exercés ensemble et on n’aurait pu trouver à redire à leurs évolutions, à la manière de croiser les cacatois et en général aux manœuvres réglementaires. Chaque escadre a sa manie particulière; dans celle-ci tout était aux évolutions et à l’astiquage et, en route, elle excellait à éviter les froissements et rencontres qui pouvaient endommager les peintures extérieures: les vaisseaux devaient avoir une apparence irréprochable. L’escadre dont je parle était bien exercée, et quoique plusieurs des navires ne fussent pas du type le plus nouveau, toujours est-il que ces six cuirassés formaient un ensemble respectable de navires qu’il eût été difficile de crocher, sur lesquels il eût été malaisé de jeter le grappin.
L’amiral Weldon avait conscience et appréciait grandement les désavantages de la situation dans laquelle se trouvaient les navires sous son commandement, eu égard à la grande longueur de quatre de ses six cuirassés; aussi il chercha à y obvier en insistant sur ce que chaque capitaine-commandant commander et lieutenant connaisse parfaitement tout ce qui se rapporterait à la gération, à la plus grande vitesse, aux effets de gouvernail sur la vitesse des navires, sur les effets de bande et de roulis, et les changements que l’on obtient par les mouvements de l’artillerie et de l’équipage, etc.
Comme de raison, ceci n’eut pas lieu sans beaucoup de peine; et que de journées difficiles et amères furent passées par les officiers et les équipages des vaisseaux composant l’escadre, à noter la tenue de leur navire respectif lorsqu’ils s’exerçaient à tourner autour des bouées placées pour la circonstance, tiraient leurs bordées par le moyen de l’électricité et cherchaient à éperonner des cibles remorquées.
Ce dernier exercice fut trouvé excellent comme exercice pratique, car il permettait aux officiers commandants de juger le moment opportun de changer le gouvernail pour éperonner. Dans les premiers temps, les officiers tournèrent cet exercice en plaisanterie, pensant qu’il était toujours possible d’atteindre un but, marchant à petite vitesse; mais quand ils l’essayèrent avec les navires, cela ne fut pas trouvé si aisé, et nombreux furent les essais avant que l’on pût arriver à quelque chose de satisfaisant.
Cet exercice fut commencé avec des cibles, mais peu après on se servit pour cela de vieilles embarcations sur lesquelles on appareillait une voile; le bateau partait avec vent arrière, alors le navire se dirigeait sous le vent, et quand il se trouvait à environ un mille du bateau il tournait au vent et se dirigeant sur lui essayait de l’éperonner lorsqu’il passait, représentant ainsi, jusqu’à certain point, le cas d’un navire en chargeant un autre.
Il était extraordinaire de voir combien ces embarcations duraient longtemps.
Quelquefois, tous les vaisseaux de l’escadre lançaient leurs chaloupes courant sur elles en même temps et le mouvement devenait une évolution de flotte. L’amiral Weldon changea aussi souvent de plan pour l’instruction et l’exercice des diverses forces qu’il dirigeait; mais mon temps est limité et, comme vous le verrez, l’escadre n’eut aucune chance de donner raison au vieux proverbe: «l’union fait la force», car, par suite des accidents arrivés dans les machines, elle n’arriva pas à temps pour produire un effet utile.
Ce fut le 2 mai 1886 que l’escadre reçut soudainement, par télégraphe, l’ordre de se rendre à Malte en touchant à Gibraltar pour le ravitaillement du charbon, si cela était nécessaire.
Vous pouvez vous imaginer l’émotion qui eut lieu dans l’escadre, quand les ordres suivants lui furent signalés: «Chauffez à toute vapeur. Préparez-vous à lever l’ancre à midi. Tous les capitaines à l’ordre sur vaisseau amiral». (Le télégramme avait été reçu à 10 heures du matin.)
Remue-ménage de la cale à toutes les parties des vaisseaux; on hisse les embarcations, on met en place les saisines des porte-manteaux, on prend autant de vivres frais qu’il est possible, les étuis de chauffe et les mâts sont mis en place, les canons amarrés, etc.
Il n’y eut pas une âme à bord de l’escadre qui ne sentît que l’heure de la lutte, si longtemps attendue, ne fût arrivée. Les midshipmen, en particulier, étaient pleins d’ardeur pour vaincre ou mourir, et l’un deux, âgé de quatorze ans et demi, qui arrivait de la Britannia, fut surpris aiguisant son poignard à la meule, pour l’avoir tout apointé au moment voulu.
Vous allez peut-être rire de l’idée de ce gamin préparant l’arme qui lui a été remise pour sa défense personnelle. Mais je ferai remarquer que si chacun eût suivi son exemple et eût mis en état les armes ou autres appareils qui lui avaient été confiés, il y eût eu moin de confusion et plus de résultat au moment critique, donnant raison au proverbe: «Ne jamais remettre au lendemain ce que l’on peut faire la veille.»
A midi le signal de lever l’ancre, suivi bientôt de celui de se former en colonnes de division en ligne en avant, fut fait par l’amiral, et aussitôt vous auriez vu les vaisseaux prenant leur vitesse et descendant vers le canal en deux divisions.
Le Minotaur, le Northumberland et l’Hercule formaient la première division de tribord, pendant que l’Azincourt, l’Achille et le Sultan formaient celle de babord.
Au bout de deux heures on obtint une vitesse de 12 nœuds, et l’escadre maintint cette allure; ce ne fut pas pour longtemps cependant, car à 9 heures du soir, un signal de l’Achille informa l’amiral que les coussinets de sa machine s’étaient échauffés et qu’il allait être obligé de stopper.
Vous pouvez vous imaginer combien cet accident parut intolérable à toute l’escadre; mais il n’y avait pas d’aide à donner et on fit le signal d’arrêt général. On perdit ainsi une couple d’heures, de sorte que dans les premières vingt-quatre heures on ne fit que 265 milles .
Le lendemain, ce fut encore pis: il y eut des arrêts répétés pour cause d’échauffements ou autres défauts dans les machines. En fait, l’Achille causa tellement d’ennuis que l’amiral décida de ne pas arrêter plus longtemps l’escadre pour ce navire; elle continua sa route en donnant l’ordre à l’Achille de manœuvrer isolément et de suivre aussitôt que possible. Le résultat fut que les cinq navires de l’escadre arrivèrent à Gibraltar à 8 heures du matin, ayant fait le passage en quatre jours vingt heures. «Au charbon, immédiatement», fut l’ordre du jour en arrivant; le charbon consommé ayant été de 350 tonnes en moyenne par navire et peu en ayant assez pour arriver jusqu’à Malte en prenant pour base la consommation faite suivant la vitesse.
Les autorités de Gibraltar avaient tout préparé, et il n’y eut aucun retard pour le ravitaillement du charbon. Deux des navires s’amarrèrent près de la nouvelle jetée et y prirent leur combustible, pendant que les autres les recevaient à l’aide de bateaux spéciaux qui les abordèrent presque au moment où ils jetaient l’ancre.
Maintenant, un autre coup atteignait l’escadre infortunée. Le Northumberland découvrit qu’un de ses cylindres était fendu; ce qui le mettait dans l’impossibilité de se remettre en route au moins avant trois jours. Officiers et matelots de l’escadre étaient écœurés. Toute une escadre de six cuirassés qui devait être prête à résister à toute éventualité, est réduite à quatre bâtiments après quatre jours et demi de navigation à vapeur! C’était vraiment trop fort! Comment cela se fait-il? lorsqu’on voit nos navires de commerce traverser l’Atlantique à toute vitesse sans un seul arrêt.
«Les mécaniciens doivent être des ganaches, des ânes! Ils sont incapables et sans souci! pas à la hauteur! » Telles étaient les aménités que l’on entendait partout et dont plusieurs étaient plus ou moins méritées. Les mécaniciens des autres navires étaient au moins aussi montés, si ce n’est plus, contre leurs malheureux collègues du Northumberland; avec l’assurance que donne le succès, ou plutôt la chance, ils se croyaient plus capables que leurs malheureux voisins.
Ce qui était évident, c’est que le Northumberland était pour le moment incapable de faire route, et l’amiral était indécis, ne sachant s’il devait attendre la fin des réparations ou continuer sa route avec les navires restants.
Dans ces circonstances, l’amiral télégraphia en Angleterre et reçut l’ordre de continuer sa route à toute vitesse avec le restant de ses navires, un engagement maritime paraissant imminent. Tous les vaisseaux ayant fait leur charbon, les quatre navires reprirent leur route vers l’est le 25 mai à 8 heures du soir, à l’ancienne vitesse de 12 nœuds et demi à l’heure. Le temps était magnifique, il faisait un beau calme, et tout alla bien pendant trente-six heures; mais les équipages étaient harassés et sur les dents; comme le nombre réglementaire des chauffeurs et des soutiers était insuffisant pour la besogne qu’il y avait, on fut obligé de les renforcer par une centaine de matelots de pont et d’hommes d’élite de première classe, afin que tout marchât convenablement.
Le principal intérêt de ma narration s’est concentré jusqu’à ce moment et avec raison sur la manière dont les machines se comportèrent. J’ai suivi avec le plus grand soin la marche de l’escadre, non pas parce qu’elle aurait pu prendre une part active à la bataille de Port-Saïd, mais pour montrer comment, en cas d’urgence, les machines, qui sont la partie la plus importante de l’armement d’un navire, peuvent faire défaut.
Plusieurs éminents ingénieurs émirent l’opinion que les accidents provenaient de ce fait que les machines étaient trop faibles pour ce qu’elles avaient à faire, et cela parce qu’on avait réduit au minimum le poids de toutes les pièces qui les composaient afin de permettre aux navires de porter une cuirasse plus forte.
Que ce soit cela ou autre chose, il était évident que tout était mal arrangé.
Enfin, pour couper court, ce fut bientôt le tour du Minotaur; une de ses bielles cassa, et cet accident devint la cause d’autres avaries dont les conséquences se firent bientôt sentir, car si la bielle seule s’était brisée, on eût pu se contenter de la remplacer par celle de rechange; mais il n’en était pas ainsi.
Cela devenait très sérieux. Des six cuirassés partis de Plymouth, il n’en restait plus que quatre en état, et maintenant, pour comble de malheur, le vaisseau amiral était lui-même désemparé.
L’amiral Weldon était furieux de ces échecs successifs, il ne savait qui en rendre responsable; il décida qu’une enquête sérieuse serait faite plus tard au sujet de ces accidents; pour le moment, il fallait parer au plus pressé et se tirer du mieux possible de ce mauvais pas. Il se décida à arborer son pavillon sur l’Hercule, et en donnant liberté de manœuvre au vieux Minotaur pour se rendre à Malte, continua sa route sur cet endroit avec les trois navires restants: Hercule, Azincourt et Sultan.
Cette triste expérience convainquit l’amiral Weldon de l’incapacité dans laquelle se trouvaient les navires de son escadre pour se maintenir à grande vitesse pendant plusieurs jours de suite, et, afin de ne perdre aucun autre de ses bâtiments par suite d’accidents de machine, il diminua la vitesse à 10 nœuds, et le 29 mai, à 5 heures du soir, l’escadre de la Manche, réduite maintenant à trois cuirassés, entra avec ses deux amiraux dans le port de Malte; elle avait franchi en trois jours et vingt-une heures, la distance de 980 milles qui existe entre Gibraltar et Malte. Là, comme à Gibraltar, l’amiral trouva tout disposé pour faire promptement le plein des soutes, et il reçut un télégramme de l’amiral Doel l’informant que la flotte de la Méditerranée quitterait Chypre le 1er juin au plus tard, et que si l’escadre du canal pouvait ancrer en temps à Larnaca, c’est là que se ferait la concentration; sinon, elle devait faire route directement pour Port-Saïd et agir selon les circonstances.
Comme on était au 29 mai, il y avait peu de chances d’arriver en temps à Larnaca; l’amiral Weldon se décida donc à se rendre directement à Port-Saïd, sauf à faire route ensuite pour Chypre si la flotte n’était pas encore arrivée.
Le Neptune, cuirassé à tourelles portant 4 canons de 38 tonnes, avait été laissé à Malte comme stationnaire; eu égard aux circonstances, l’amiral le joignit au restant de son escadre, laissant l’ordre au Minotaur de faire le nécessaire dès son arrivée devant l’île.
Lorsque la guerre fut terminée, on nomma une Cour d’enquête afin de rechercher les causes pour lesquelles les machines des trois cuirassés s’étaient trouvées en si mauvais état et avaient été avariées pendant leur voyage à Malte; des faits fort curieux furent élucidés, mais pour cela je vous le raconterai lorsque j’aurai terminé le récit de la bataille.
Dans la matinée du 30 mai, l’escadre du canal, composée de quatre cuirassés, appareillait de Malte au milieu des acclamations de la foule amassée sur tous les points d’où on peut apercevoir l’entrée du grand port.
Les derniers sons entendus par la flotte qui se dirigeait sur le théâtre où devait avoir lieu l’action, furent les accents de la musique du 101e régiment qui, au fort Ricasoli, jouait l’air si cher aux matelots anglais: «Hearts of Oak» (Les cœurs de chêne). Comme ce vieux chant national, duquel les auditeurs en d’autres temps disaient en haussant les épaules: «Encore cette vieille rengaîne!», comme ce vieil air démodé trouvait alors un écho dans tous les cœurs! On sentait maintenant que c’était pour de bon et pour la Patrie, et qu’il représentait une réalité ; que de la force de leurs nerfs et de la vaillance de leurs cœurs dépendait le bonheur ou le malheur, la perte ou le triomphe «de la vieille Angleterre».
Plus d’un homme se sentit oppressé en entendant ces refrains dont les sons s’éteignaient graduellement, et jurait en lui-même que ce ne serait nullement sa faute si les cœurs de ceux qui maintenant se trouvaient derrière ces murailles garnies de fer, ne se montraient pas aussi vaillants que ceux qui, dans les temps passés, avaient gagné tant de gloire à l’Angleterre derrière des murailles de bois.