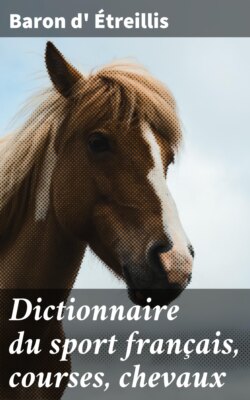Читать книгу Dictionnaire du sport français, courses, chevaux - Baron d' Étreillis - Страница 4
B
ОглавлениеBACKER, mot anglais, qui signifie Parieur pour. (Voy. PARIEUR.)
BADE. Les courses de Bade sont une création de date relativement récente; elle est due à l’initiative de M. Bénazet, fermier des jeux, qui pensa, avec raison, qu’une fondation de cette nature serait une puissante attraction pour attirer à Bade toutes les individualités saillantes et cosmopolites du monde élégant. Ce projet fut presque aussitôt exécuté que conçu, grâce à la baguette magique de l’or et au concours que lui prêtèrent, en France, MM. Reiset et Mackensie-Grieves, deux des membres de la Société d’encouragement les plus honorablement connus, et dont la coopération était une garantie pour la nouvelle fondation.
Le champ de course fut placé à Iffezheim, petit village situé à deux lieues de Bade et à une lieue de la station de Oos.
La plaine où la piste est tracée doit être un terrain occupé autrefois par le Rhin, et laissé à nu par le retrait des eaux. Au moins la nature du sol très-doux, mais manquant d’élasticité, semblerait l’indiquer. Partout où il n’est pas l’objet de soins permanents, il reste profond et sujet à des infiltrations souterraines.
M. Bénazet affecta la magnifique subvention de 80 000 fr. à la dotation du nouvel hippodrome. D’élégantes tribunes furent construites. Derrière elles, mais faisant également partie de l’enceinte du pesage, on installa de confortables écuries pour que les chevaux puissent se loger sans peine à leur arrivée. Avec de semblables éléments, le succès du nouvel hippodrome était assuré : son inauguration eut lieu avec éclat le 5 septembre 1858.
Le caractère principal du programme de Bade, pris dans son ensemble, est international. C’est-à-dire qu’à l’exception de quelques prix réservés aux chevaux nés et élevés sur le continent, il reste ouvert aux concurrents de toute provenance. Le programme est, au reste, à peu près le calque de celui des réunions de Paris et de Chantilly, du moins conçu dans le même esprit, avec les modifications que comportaient le moment de la saison et la localité où plusieurs intérêts contraires étaient mis en présence.
Les deux événements principaux de la réunion de Bade sont le grand prix de Bade, d’une valeur qui, avec les entrées, peut parfois s’élever à une somme de 20 000 fr., plus un objet d’art offert par le grand-duc de Bade et le grand steeple-chase qui termine la réunion.
L’élevage de pur-sang et l’art de l’entraînement n’étant pas encore très-developpés en Allemagne, les chevaux anglais n’entreprenant qu’exceptionnellement un aussi long déplacement; toutes les courses importantes étaient, en réalité, réservées par avance aux chevaux français. Il en fut de même au début pour le steeple-chase. Mais les sportsmen allemands adonnés de préférence à cette spécialité pour laquelle ils avaient une prédilection particulière, réclamèrent, par l’entremise de leur commissaire, M. le baron de Malthzan, le droit de déterminer eux-mêmes le tracé à parcourir pour le steeple-chase.
Ils avaient assez judicieusement remarqué que nos chevaux, absolument parlant, d’une qualité supérieure aux leurs, étaient habitués à courir sur des pistes plates où l’on construisait des obstacles artificiels. Par conséquent, plus on leur susciterait des difficultés entièrement naturelles, plus, enfin, le tracé présenterait l’aspect d’une véritable «Hunting Country», pays de chasse, moins ils auraient de chance de gagner. Les chevaux allemands, au contraire, familiarisés avec les terrains de cette nature, s’y trouvaient avantageusement placés. Cette disposition est, il faut en convenir, beaucoup plus conforme à l’aspect et au but du steeple-chase.
A partir de ce moment, les choses changèrent de face, relativement au grand steeple-chase. Nos chevaux, dans le cours de ce tracé parsemé de champs labourés, plantés de topinambours et de maïs, entrecoupés de bois de marais, perdirent, en partie, leur supériorité, et la course fut presque invariablement gagnée par un cheval allemand très-médiocre en lui-même, comme Effenberg, qui gagna, deux années de suite; sur un terrain ordinaire, il n’aurait pu aller cinq cents mètres avec le moins bon de tous nos chevaux d’obstacles.
Cet état de choses avait fini par créer entre les sportsmen français et allemands une sorte d’antagonisme croissant chaque année, qui donnait, en dehors de la course même, un intérêt exceptionnel au grand steeple-chase de Bade. Cette rivalité se traduisait par des sommes considérables engagées sur celui des deux chevaux de chaque nationalité choisi pour champion. L’année où Valentino, monté par M. de Saint-Germain, tomba dans la grande rivière presqu’au début de la course, abandonnant, pour ainsi dire sans lutte, la victoire à Effenberg, les parieurs français laissèrent plus de cent mille, francs aux mains de leurs adversaires. Aussi fut-ce un triomphe bruyamment célébré , quand, en 1866, Régalia, monté par M. le vicomte Artus Talon, battit contre toute attente, au petit galop, cet invincible Effenberg, monté par un des meilleurs cavaliers allemands, M. le comte de Westphalen.
Le grand steeple-chase de Bade doit être monté par des Gentlemen-Riders (voyez ce mot). Cette condition est non-seulement rigoureusement exécutée, mais encore très-restreinte par la clause qui détermine et limite, en cette occasion, la qualité de gentlemen-rider.
Après la mort de M. Bénazet, son successeur, M. Dupressoir non-seulement continua son œuvre, mais se proposa de lui donner une extension plus grande encore. Les événements de la guerre de 1870 vinrent modifier ces projets. Les courses ne purent nécessairement avoir lieu. En 1871, elles présentèrent peu d’intérêt. Les propriétaires français, par un sentiment de réserve qu’il est aisé de comprendre, s’abstinrent d’y envoyer leurs produits, bien que, pour certaines courses, ils fussent engagés depuis longtemps. A l’exception des chevaux appartenant à M. le duc Hamilton, que sa nationalité d’Anglais affranchissait de cette abstention, aucun produit français n’a donc paru sur le terrain d’Iffezheim en 1871. Les événements survenus entre les deux pays, et la fin du bail de la ferme des jeux qui expire en 1872, marqueront probablement la fin de l’existence de la réunion de Bade, destinée à disparaître ou à devenir un hippodrome exclusivement allemand.
GAGNANTS DU GRAND PRIX DE BADE.
GAGNANTS DU STEEPLE-CHASE DE BADE.
BAI. Les anciens auteurs d’hippiatrique attachaient une assez grande importance à la robe d’un cheval. Ils y trouvaient une indication de son tempérament, de son caractère et de ses qualités. Cette opinion est aujourd’hui presque tombée en désuétude, et l’on ne s’attache généralement à la robe que pour se conformer à un certain courant de mode, nécessairement assez changeant.
La vérité pourrait bien se trouver entre ces deux opinions extrêmes. Comme principe général, le poil est évidemment un indice du tempérament de l’animal, puisqu’il est le résultat de son économie générale, et que son aspect sert fréquemment de diagnostic sur l’état de santé où il se trouve.
Quant à sa couleur, elle subit l’influence climatérique du pays où l’animal naît, vit et est élevé. Cette action s’exerçant lentement peut-être, mais sûrement sur une race tout entière, finit par généraliser dans chaque pays une couleur particulière, au préjudice des autres, qui deviennent alors des exceptions plus ou moins nombreuses. L’observation confirme notre opinion à ce sujet. En effet, une couleur particulière domine presque exclusivement dans chaque pays. En Arabie, le poil blanc ou gris et l’alezan sont les plus communs. Le bai, le noir, ainsi que les robes composées, sont beaucoup plus rares. En Russie c’est le noir qui domine.
Dans certaines parties de l’Europe occidentale, au contraire, comme la France, l’Angleterre et l’Allemagne, la robe baie existe dans une proportion anormale. La mode exerce évidemment ici une importance assez influente. L’on produit généralement ce qui se vend le mieux. Par conséquent, les éleveurs et les marchands ayant remarqué que le public avait une prédilection marquée pour cette robe, se sont efforcés, les premiers de la produire en choisissant de préférence des reproducteurs de cette couleur, les seconds en les payant un prix plus élevé.
Ce goût presque exclusif pour le poil bai, s’est considérablement accentué en France pendant la période des derniers vingt ans que nous venons de traverser. L’extension de cette mode tient au reste à un fait tout particulier. Les écuries de l’empereur Napoléon étaient exclusivement remontées en chevaux de cette couleur; sauf quelques exceptions admises en faveur des chevaux de selle, toute autre robe était rigoureusement proscrite. Le grand écuyer de l’empereur Napoléon III appliquait cette règle avec une telle sévérité, qu’il exigeait non-seulement que les chevaux admis dans les écuries impériales fussent bais, mais encore zains, c’est-à-dire sans aucune balzane, ou marque blanche aux jambes. Comme cette règle uniforme devenait assez difficile à exécuter, en raison du nombre considérable de chevaux indispensables au service, on teignait les balzanes ou les pelotes des animaux atteints de cette imperfection de convention. C’était au reste le plus grand nombre, car le cheval zain est toujours une exception, même dans la robe baie, une des moins sujettes aux bigarrures.
Le goût de l’uniformité poussé ainsi à l’extrême, peut avoir une certaine raison d’être dans une maison souveraine, comme ensemble, mais il est d’abord difficile à satisfaire, et de plus, très-dispendieux. Il serait d’une meilleure administration d’affecter chacune des quatre couleurs primordiales à un service spécial et déterminé ; l’exclusion des robes bigarrées se comprend pour une destination de cette nature.
Il est, au reste, assez difficile de se rendre compte de cette prédilection pour la robe baie, la plus insignifiante et la plus incolore de toutes. Dans l’assimilation des animaux à l’homme, elle peut correspondre aux nuances multiples du châtain, c’est-à-dire à tout ce qui n’est ni brun, représenté dans l’espèce chevaline par le gris (celui qui blanchit le plus vite), et le blond, pour les chevaux alezans. La robe baie est donc la moins significative de toutes, celle où les individualités s’effacent le plus, pour se confondre dans un ensemble. Il est en effet beaucoup plus difficile de garder le souvenir d’un cheval bai et de le distinguer d’un autre de même couleur; s’il fallait le classer en établissant une sorte de hiérarchie chevaline, il correspondrait assez à la petite bourgeoisie, dont il présente l’aspect uniforme et monotone.
Comme nuance, la couleur baie est une sorte de mélange fauve du brun et du marron; il compte plusieurs variétés; le caractère général de la robe est d’avoir les crins, c’est-à-dire la crinière et la queue toujours noires, ainsi que les quatre jambes, depuis les genoux et les jarrets. Dans ce cas, le cheval est bai zain; s’il a des marques blanches (balzanes) à une ou plusieurs jambes, il est simplement bai.
Les nuances principales de la robe baie, sont 1° bai clair; 2° bai doré ; 3° bai cerise, marron obscur ou rouge, quatre variétés d’une même nuance, enfin 4° le bai brun.
Le bai brun est sans contredit la plus séduisante et la meilleure des variétés de la robe baie, rarement on trouve un mauvais cheval sous ce poil. Le bai brun arrive souvent à une nuance tellement foncée, qu’on le distinguerait difficilement du noir sans une marque distinctive. Elle consiste dans des teintes roussâtres au nez et aux ars, que l’on nomme feux de renard. Si ces teintes roussâtres sont pâles, tirant sur le jaune clair, on dit que le cheval est bai brun, fesses lavées; quand ces marques n’existent pas, le cheval est simplement bai foncé.
Il se produit fréquemment dans la robe baie, des taches foncées et rondes, semblant exister sons la peau, et apparentes surtout quand l’animal commence à transpirer; on dit en ce cas, qu’il est bai miroité ou pommelé.
Souvent les jambes, au lieu de devenir noires du genou et du jarret aux pieds, comme ce fait se produit plus ou moins dans la grande généralité des chevaux bais, conservent la couleur du corps et même deviennent plus pâles. Le cheval est alors bai lavé, ou poil de vache, comme l’alezan de la même nuance.
BAISSER peut être pris dans deux acceptions, qui ont, au reste, beaucoup de similitude. Quand un cheval n’a pas assez de travail et est trop gros, on dit: il a besoin d’être baissé. Quand il a trop de vigueur, qu’il bondit, présente quelques difficultés à mener, on dit également: il est trop frais et a besoin d’être baissé. — Voyez: CONDITION, ENTRAINEMENT et FRAIS.
BALANCE. Les jockeys se pèsent avant la course, pour s’assurer qu’ils portent le poids légal, et après, pour constater qu’ils ne l’ont pas perdu. Une balance est placée à cet effet, pour toutes les réunions de course, dans l’enceinte du pesage. On dit fréquemment d’un jockey: il est dans la balance; cette affirmation veut dire pour les parieurs, que le cheval partira certainement et que l’on peut parier pour lui. — Voyez: COURSES et HIPPODROMES.
BALZANES. Les balzanes sont des marques blanches, enveloppant comme un bas, plus ou moins haut, la partie inférieure de la jambe. La corne est en ce cas blanche en totalité ou en partie, suivant qu’elle correspond à une partie du poil blanc, ou au reste de la couleur de l’animal. La corne blanche est plus cassante et moins dure que la corne noire. Sans attacher à cette observation plus d’importance qu’elle ne le comporte, il est à remarquer, cependant, que quand un cheval a une balzane antérieure, c’est-à-dire à l’une des jambes de devant, il boitera plus facilement de cette jambe que de l’autre. Une observation de plus de trente ans nous a amené à être absolument convaincu de ce fait, pour les chevaux de course comme pour ceux destinés aux usages ordinaires.
La mode attache aujourd’hui une dépréciation en dehors de la qualité même de l’animal, aux chevaux qui ont beaucoup de blanc, c’est-à-dire à ceux dont la robe est bigarrée par des balzanes ou une lisse en tête, sorte de grande raie blanche plus ou moins large, qui partage la tête du cheval du front aux naseaux. Le préjugé exerce évidemment une large part dans cette appréciation. Cependant il ne faut jamais se hâter de rejeter l’avertissement d’une tradition ancienne; comme elle est le fruit des observations successives de plusieurs générations, elle est presque toujours basée sur l’expérience des faits.
Il y a évidemment ici à établir une foule de distinctions dont le plus grand nombre est saisissable seulement pour l’homme de cheval. Ainsi, généralement un cheval ayant des balzanes aux membres antérieurs, sans présenter les mêmes particularités aux jambes postérieures, boitera plus facilement du devant, soit des pieds, soit du boulet, que celui dont les balzanes se trouvent placées aux membres postérieurs. Les balzanes aux jambes de derrière ont, sans contredit, moins d’importance, cependant il vaut mieux que les deux membres en soient affectés. Dans le cas contraire, celle où se trouve la balzane est plus sujette à s’engorger que l’autre. Cette observation peut paraître puérile, mais si l’on veut examiner attentivement un certain nombre de chevaux, suffisant pour établir une règle générale, on verra qu’elle se trouve confirmée. Généralement les balzanes antérieures, surtout pour les chevaux bais, ne sont pas un signe favorable. La robe alezane est celle pour laquelle les balzanes ont le moins d’importance; peut-être parce qu’elles sont plus fréquentes chez les chevaux de ce poil, et qu’elles. font en quelque sorte partie de leur nature.
On disait autrefois qu’un cheval avec un bipède blanc (les deux jambes du même côté), était travat. Dans le cas contraire, c’est-à-dire avec le bipède transversal blanc, il devenait transtravat; on appelait également balzan les chevaux ayant des balzanes apparentes.
Quand la balzane recouvre une assez grande partie de la jambe du cheval, on dit qu’elle est haut chaussée. Si au contraire elle s’étend seulement autour de la couronne, sans dépasser le paturon, c’est une trace de balzane; parfois, surtout dans ce dernier cas, elle est intermittente, ou plutôt interrompue, c’est-à-dire que la marque blanche faisant le tour du pied, se trouve parsemée de bouquets de poils noirs; c’est alors une balzane herminée. Il arrive parfois, mais assez rarement, qu’un cheval se trouve avoir une jambe mélangée de poils blancs et noirs en partie égale, de sorte que le membre se trouve gris, sans cependant que cette transition dans l’uniformité de son poil ait une marque nette et tranchée. Dans ce cas, ce n’est pas une balzane, le mot rubicané serait beaucoup mieux applicable à cette particularité. Les Anglais la désignent sous le nom de silver leg (jambe d’argent).
Les anciens auteurs, français ou étrangers, attachaient une grande importance à la robe et aux marques. Sans méconnaître la justesse de leurs observations, elles se trouvent dans la pratique trop souvent confirmées et démenties, pour qu’il soit possible d’établir une règle fixe à ce sujet. L’axiome moderne, «il est de bons chevaux sous toute robe, et avec toute marque,» est beaucoup plus juste dans l’application. A la confirmation d’une opinion de cette nature, on peut immédiatement opposer un argument sans réplique en faveur de l’opinion contraire.
Pour citer seulement comme exemples les deux plus grandes célébrités chevalines, le légendaire Eclipse avait deux balzanes postérieures, chaussées très-haut, suivant quelques portraits de lui, ses quatre jambes même auraient été blanches, et Monarque, dont le nom est une date dans les annales des courses, est entièrement zain, particularité qui se retrouve chez le plus grand nombre de ses enfants et spécialement chez le plus célèbre de tous, Gladiateur; la même remarque est applicable à Patricien, l’un des meilleurs produits de Monarque, après Gladiateur.
Astrolabe, dont la supériorité s’est maintenue et se maintient dans les steeple-chases depuis plusieurs années, a trois balzanes, deux postérieures et une antérieure. Elle justifie ainsi, du moins dans l’une de ses interprétations, l’ancien proverbe «Cheval de trois, cheval de roi.» Les uns prétendent que cet axiome prenait sa source dans la grande qualité présumée d’un cheval à trois balzanes, qui le rendait ainsi digne de devenir la monture d’un roi; d’autres, au contraire, que cette destination lui était attribuée, parce que les chevaux portant cette marque, avaient plus de brillant que de fond. Astrolabe confirmerait la première de ces deux opinions contraires.
BANK (mot anglais). Mot à mot, tertre, levée, talus, banquette; le mot Irish-Bank, que nous traduisons par banquette irlandaise, explique la signification de ce mot en langage de sport. La banquette est le mode de clôture le plus usité dans la plupart des comtés d’Irlande, c’est à leur configuration qu’est due l’adresse merveilleuse des sauteurs de ce pays. Ces obstacles, qui dans certains endroits ont l’aspect de vrais ouvrages militaires en terre, varient de forme suivant les comtés. Certains comtés comme celui de Cork par exemple, en raison de sa dimension et de ses cultures variées offre une collection complète de tout ce que l’Irlande possède en ce genre; aussi les hunter de ce comté sont-ils les chevaux les plus complets au point de vue du saut. Dans le comté de Limerick, pays de grands et riches pâturages, les banquettes ou talus sont extrême ment larges à leur sommet, mais les deux faces en sont inclinées. Ces talus sont précédés et suivis de deux rigoles profondes dont la largeur varie de 4 à 8 pieds. Dans les terrains nouvellement enclos les obstacles sont presque infranchissables. Dans le Tipperary, grand pays de chasse, les talus sont droits comme un mur, très-hauts et très-étroits au sommet; mais s’il n’y a point de rigoles à craindre, il arrive quelquefois que la face du talus est maçonnée jusqu’à une certaine hauteur, ce qui en rend l’abord plus difficile. Dans le Queens’County, Kilkenny, Wiklou, les talus varient de forme et de dimensions, mais on comprendra facilement l’adresse et l’habileté que ces obstacles doivent donner à un cheval, quand on saura, qu’à n’importe quel train un hunter véritable doit changer de pied sur le sommet du talus pour pouvoir surmonter avec sécurité les difficultés qui peuvent surgir de l’autre côté. Les talus irlandais varient de 4 à 7 pieds de haut. Le comté de Galway diffère des autres parties de l’Irlande en ce qu’il est presque partout clos de murs; nous en parlerons plus loin. En Angleterre les talus sont rares et l’on n’en trouve guère que dans le Devonshire, le pays de Galles et le Val of the Withe Horse. Dans le pays de Galles ils sont très-sévères, dans le Vale of the Withe Horse ils sont souvent surmontés d’une petite claie qui les rend fort sérieux. Il faut en effet un cheval bien adroit pour en toucher sûrement le sommet avec cette complication, ou un sauteur bien puissant pour les franchir d’un bond.
BANQUETTE. Une banquette est un des obstacles existant dans presque tous les tracés de steeple-chases. Il consiste en un talus de terre dont la hauteur varie. Ce talus est construit sur un plan légèrement incliné, le sommet suffisamment aplati, pour qu’en prenant son saut, le cheval puisse poser ses pieds en arrivant en haut de l’obstacle, et trouver un point d’appui pour se lancer de l’autre côté. La banquette est un des obstacle parfois dangereux pour un cheval inexpérimenté, mais les vieux steeple-chasers Je passent en jouant et presque sans le regarder, pourvu toutefois qu’ils ne soient pas fatigués ou que la banquette ne soit pas d’une hauteur démesurée.
Souvent on creuse un fossé plus ou moins large de chaque côté de la banquette; si l’on veut augmenter encore la difficulté, on place une haie au sommet. C’est un saut plus effrayant à regarder qu’à exécuter. Un cheval, connaissant son métier, l’aborde toujours avec beaucoup d’entrain, et le saute en général heureusement, pourvu qu’il ait une place, si petite qu’elle soit, pour poser ses pieds de derrière au sommet. Quelques-uns exécutent ce mouvement avec une telle prestesse, que l’on croit qu’ils franchissent l’obstacle d’un bond, l’instant où ils posent les pieds sur la crête étant insaisissable. Auricula passait toujours de cette manière; mais il est très-rare qu’un cheval saute une banquette sans poser ses pieds sur le sommet. Cela arrive cependant, soit que le cheval s’élance d’effroi, ou qu’il soit amené trop vite par son cavalier et gêné dans son saut; dans ce cas, à de bien rares exceptions près, il tombe.
On connaît généralement, en France, cette nature d’obstacle sous le nom de banquette irlandaise, parce qu’il ressemble et a, du reste, beaucoup d’analogie avec les clôtures de champs que l’on rencontre fréquemment en Irlande. Au reste, les chevaux irlandais excellent dans ces sortes de saut, et accomplissent même, sous ce rapport, de véritables tours de force, auxquels, à moins de les avoir vus, on ajoute difficilement foi.
BARRE CASSÉE. Il arrive assez fréquemment, par suite de son caractère ou le plus souvent de la maladresse de ceux qui le mènent, qu’un cheval prend l’habitude de s’appuyer démesurément sur la main, autrement dit de tirer. Il devient alors plus ou moins difficile à diriger. Pour remédier à cet inconvénient, on lui met des mors de plus en plus durs, au fur et à mesure que cette insensibilité augmente. Presque toujours, à un moment donné, dans un effort violent du cheval ou de l’homme qui le conduit, les barres se trouvent tellement offensées, qu’il se produit, sur l’une d’elles et souvent sur toutes les deux, des enkymoses qui rendent le contact du mors très-douloureux pour l’animal, et augmentent nécessairement la difficulté de le conduire.
On dit alors: il a les barres cassées, ce qui est une expression impropre; si le cheval avait la mâchoire cassée, il ne pourrait plus manger. L’effet trop violent et trop répété du mors a seulement déterminé des enkymoses et une inflammation très-douloureuse qui dénaturent l’effet ordinaire du mors, parce que l’animal n’a qu’une pensée, celle de s’y soustraire.
BARRES On nomme barres la partie de l’os de la mâchoire dépourvue de dents entre les crochets et les mâchelières, et sur laquelle on place le mors dans la bouche du cheval. Elles sont quelquefois plus ou moins aiguës ou plates, recouvertes d’une peau plus ou moins épaisse. On attribue à ces différences une certaine action sur la sensibilité ou l’insensibilité de la bouche du cheval. C’est une erreur, tous les chevaux ont, absolument parlant, la même sensibilité de bouche. Ils sont seulement plus ou moins lourds à la main, suivant leur conformation ou la manière dont on les conduit.
BARRIÈRE FIXE. La barrière fixe se compose d’une poutre passée transversalement dans deux madriers plantés en terre, et ayant absolument l’aspect, d’une barrière de forêt. C’est toujours un obstacle sérieux, quelle que soit sa hauteur, parce que le cheval peut rarement le toucher impunément, même légèrement. Aussi en fait-on un usage très-modéré dans les tracés de steeple-chase, et ne lui donne-t-on jamais une bien grande élévation. Il faut surtout éviter de la placer à un endroit de la piste où les chevaux arrivent épuisés par une longue distance parcourue, ou dans la dernière partie de la course au moment où les concurrents vont entamer la lutte finale.
Dans des circonstances ordinaires, tout cheval ayant la prétention d’être un hunter (cheval de chasse) doit pouvoir aborder sans crainte une barrière de 1 mètre 10 cent. à 1 mètre 15 cent; au delà, il faut un sauteur très-sûr pour attaquer un obstacle fixe. A partir de 1 mètre 50 cent., le saut devient exceptionnel et abordable seulement pour les chevaux possédant une aptitude particulière. On parle généralement beaucoup de sauter, faisant en paroles bon marché de la mesure. Les hommes pratiques sont plus prudents, surtout quand il s’agit d’obstacles fixes. Il suffit, en effet, qu’un cheval touche peu ou beaucoup, même en effleurant seulement un mur ou une barrière, et il peut faire une chute le plus souvent dangereuse. Aussi est-ce sur un obstacle fixe que l’on peut se rendre un compte exact du mérite d’un bon sauteur. Sur toute autre difficulté, il est aisé de tricher quand on peut impunément brocher dans une haie ou passe, mais cela ne peut réellement s’appeler sauter.
Cette donnée admise, quatre pieds constituent un saut peu ordinaire. Au delà, on rentre dans les faits très-rares, et que l’on peut citer comme tout à fait exceptionnels. A notre connaissance, du moins, le saut de cinq pieds a été fait deux fois seulement en France. Nous parlons nécessairement ici de pieds français, il existe une assez notable différence entre les deux mesures. Ainsi, cinq pieds anglais équivalent à peu près à quatre pieds et demi français.
Le premier de ces deux chevaux ayant accompli cette performance hors ligne, était un grand animal rouan lavé, espèce de carrossier, dont cette aptitude était à peu près, au reste, la seule qualité. On lui avait donné le nom de Latréaumont. Il savait été ramené d’Angleterre par un marchand de chevaux assez à la mode à cette époque, Stephen Dracke. Acheté par Lord Henri Seymour, en raison précisément de son aptitude particulière, un pari fut engagé par son propriétaire, Latréaumont devait sauter une barrière fixe de cinq pieds.
Le jour désigné, l’obstacle fut établi dans le bois de Boulogne, près la porte d’Auteuil. Il consistait en une poutre d’équarrissage scellée, d’un côté, dans le mur de clôture du bois (alors entouré d’une muraille de ceinture), et, de l’autre, dans un madrier de même grosseur. Le tout fut recouvert d’une énorme haie dépassant la poutre de quelques pouces.
Latréaumont gagna son pari, mais effectua le saut d’une manière toute particulière. Il arriva sur la barrière, la chargeant à fond de train la tête basse, marqua sur l’obstacle même un temps d’arrêt tellement brusque, que l’on put croire qu’il refusait, puis pointant perpendiculairement, il s’enleva par-dessus l’obstacle, jetant la croupe tellement de côté, qu’il retomba presque parallèlement à la barrière et s’arrêta court. Il avait, au reste, touché l’obstacle, et l’on avait pu distinctement entendre le choc de ses fers sur la poutre; mais il n’était pas tombé et se trouvait transporté de l’autre côté. Latréaumont a, croyons-nous, terminé ses jours au château de Beaurepaire, chez M. le baron de Curnieu.
Le second cheval, par qui fut accompli le même exploit, était un cheval de pur-sang, nommé Paddy, appartenant à M. le baron Pierre. Il était monté par M. de La Motte, propriétaire de Franc-Picard et de The Colonel; mais, cette fois, l’expérience fut faite sans danger aucun, ni pour l’homme ni pour le cheval. On établit une haie de cinq pieds et quelques pouces, un fil de laine fut tendu à cinq pieds juste, et Paddy, arrivant à plein train, enleva la haie sans casser le fil de laine.
Des obstacles aussi élevés se sautaient, il y a quelques années, dans la campagne de Rome, où l’on chassait le renard, mais toujours à l’état d’exception. Dans un champ de vingt-cinq à trente chasseurs, deux ou trois seulement se risquent à attaquer un saut de cet ordre. L’un d’eux au moins tombait, et comme la barrière se compose de trois barreaux d’une moyenne grosseur, le premier barreau tombe avec le cavalier, les autres passent par la brèche.
BAS. On dit qu’un cheval est trop bas quand il a trop travaillé, qu’il est trop maigre, et que le maximum de sa condition a été dépassé. (Voyez CONDITION et ENTRAÎNEMENT.)
BATTRE (Se). Un cheval se bat lui-même quand la course l’impressionne de telle sorte, qu’au lieu d’aller tranquillement avec ses concurrents, il se précipite en avant, tirant tellement que son jockey le maintient difficilement, ou se tourmentant au milieu du peloton, si le jockey parvient à le placer où il veut. C’est un défaut assez fréquent, surtout chez les juments, généralement plus impressionnables que les chevaux. Dans ce cas, il vaut presque toujours mieux laisser aller le cheval, on peut encore conserver la chance qu’il ne soit pas rejoint. Quand cette tactique ne réussit pas et que le cheval a perdu, ce qui arrive le plus souvent, on dit: Il s’est battu lui-même.
BATTU est le mot dont on se sert pour désigner les chevaux partis dans une course, et qui n’ont pas gagné, c’est-à-dire ceux arrivés derrière le vainqueur. Battu a encore une autre signification, absolument identique, mais exprimant cependant une idée un peu plus compliquée. Les propriétaires, les parieurs, ou toute autre personne suit attentivement pendant la course le cheval auquel il s’intéresse. Tant que celui-ci galope aisément, et conserve une chance de gagner, on dit: il va bien. Mais dès qu’il commence à donner quelque signe de détresse, qu’il démontre enfin par un signe quelconque qu’il est fatigué, ou que le train est trop vite pour lui, bien que la course soit quelquefois à ce moment encore loin d’être terminée, on dit en parlant du cheval dont on s’occupe: il est battu, ce qui équivaut en ce cas à il n’a plus aucune chance de gagner. C’est en ce sens que l’on dit parfois d’un cheval, il est battu avant de courir. Cela veut dire qu’en raison de la supériorité de ses adversaires ou par toute autre raison, il n’a aucune chance de gagner.
BEAUFORT (Duc de), pair d’Angleterre. Le nom de M. le duc de Beaufort s’est plusieurs fois trouvé mêlé aux événements importants du Sport Français. Il gagna en 1866 le Grand Prix de Paris, avec Ceylan. M. le duc de Beaufort comme presque tous les grands noms anglais est d’origine française; aussi s’est-il toujours montré pour la France et pour les Français d’une bienveillance et d’une courtoisie qui lui sont habituelles en toute occasion, mais qu’il accentuait davantage encore vis-à-vis de notre pays ou de nos compatriotes.
L’écurie de M. le duc de Beaufort est aujourd’hui très-réduite, la chasse étant sa passion dominante. Il possède un des équipages les mieux montés du Royaume-Uni, comme chevaux et comme chiens.
La meute de M. le duc de Beaufort fit un déplacement il y a quelques années, dans l’Ouest de la France. Cet essai ne fut pas très-heureux, quant au résultat, mais il a laissé en France le souvenir du grand seigneur le plus accompli que l’on puisse imaginer, et de l’équipage de chasse le mieux tenu qu’il soit possible de rêver.
Le duc ayant entendu dire qu’un grand loup passait pour inforçable, s’imagina probablement que cette réputation des vieux loups tenait à l’infériorité de nos chiens. Cette chasse étant absolument inconnue en Angleterre, M. le duc de Beaufort, confiant dans la vitesse et la tenue de sa magnifique meute, voulut tenter l’aventure.
Si ce livre était un dictionnaire de vénerie, nous dirions pourquoi les chiens anglais ne purent mener à bien une pareille entreprise. L’insuccès fut complet. Les chiens de M. le duc de Beaufort n’attaquèrent même pas, bien que les veneurs de la contrée se fussent mis à sa disposition, et lui aient donné une excellente brisée. A peine mis sur la voie, les chiens revinrent dans les jambes des piqueurs, refusant absolument d’entrer sous bois. Cependant, pour ne pas avoir fait faire un déplacement absolument infructueux à un hôte aussi aimable, les veneurs français lui donnèrent le spectacle d’une chasse au loup. Mais ce furent les chiens français qui attaquèrent et mirent l’animal sur pied. Après une demi-heure de chasse, les chiens de M. le duc de Beaufort, enhardis par l’exemple, se mêlèrent aux Vendéens, et s’en tirèrent suffisamment bien pour prouver qu’après quelques expériences du même genre, ils chasseraient cette voie comme toute autre.
Cet insuccès n’est à vrai dire pas un échec. La chasse du loup est la plus difficile de toutes, et demande des chiens confirmés dans cette voie. Même dans les pays où ces chasses sont le plus habituelles, on ne forme qu’avec beaucoup de peine un bon équipage de loup.
M. le duc de Beaufort a laissé en France le souvenir d’un homme éminemment distingué, grand seigneur de naissance, de manières et de caractère. Son passage dans le pays est resté légendaire.
BEAUVAIS. La réunion de Beauvais a été fondée en 1869 seulement. La situation de Beauvais, son organisation, le patronnage de plusieurs sportsmen connus, étaient autant de garanties d’une réussite complète. Aussi, ses débuts furent-ils un succès. La guerre de 1870 a interrompu le cours de cet avenir plein de promesses. Beauvais a subi le sort de toutes les réunions françaises. Mais les événements sont plus regrettables encore pour une réunion de fraîche date, à la première année de sa formation, et qui aura peut-être quelque peine à se reconstituer.
BEAUVAIS, étalon bai-brun, né en 1857 chez Mme Latache de Fay, par Ethiron et Wirthschaft, fille de Gygès et mère de Valbruant. Il gagna à Paris le prix de l’Empereur en 1860 et la même année celui du Jockey-Club à Chantilly, mais cette dernière course donna lieu à une lutte vive et acharnée qui ne permit pas d’établir une différence bien sensible entre le vainqueur et les vaincus. La suite a surabondamment prouvé que cette manière de voir était la seule vraie et même que le meilleur des quatre n’était pas le gagnant. Beauvais n’en reste pas moins cependant avoir fait preuve d’un mérite qui n’est pas à dédaigner; il est incontestablement un des meilleurs chevaux de son année et l’on peut à bon droit s’étonner qu’il ne soit pas devenu la propriété de l’Administration des Haras, qui aurait pu en tirer d’excellents services comme étalon de croisement. Remarquablement fort et régulier, il est fait pour porter des poids lourds facilement; un excellent tempérament joint à l’incontestables qualités le rendent propre à être employé presque partout avec de grandes chances de succès.
BEAUVAU (Prince Marc de). M. le prince Marc de Beauvau est un de nos plus anciens propriétaires de chevaux de course Il monta modestement son écurie avec deux chevaux achetés à lord Seymour, et confiés à la direction d’Henry Jennings. Cet humble début était le point de départ de la réputation d’un entraîneur qui devait promptement se placer aux premiers rangs de cette spécialité, une des plus difficiles qui existent. L’écurie ne tarda pas à prendre une prépondérance notable et se trouva bientôt renforcée d’un haras d’où sortent encore aujourd’hui chaque année de remarquables produits. M. le prince Marc de Beauvau gagna le prix du Jockey-Club en 1844 avec Lanterne. Il eut en outre plusieurs autres chevaux remarquables, principalement des juments et entre autres, Nativa, Dorade et Jenny. En 1853 il vendit son écurie, ou pour mieux dire, la mit en actions, en y conservant un intérêt. Les chevaux continuaient au reste à courir sous son nom et avec ses couleurs. La Société se composait de MM. le prince Marc de Beauvau, M. le prince Étienne de Beauvau (mort aujourd’hui), M. le comte Wladimir de Komar (également mort), M. le comte Manuel de Noailles, M. le vicomte Onésime Aguado.
L’écurie ne démentit pas les promesses de ses débuts. Malgré sa nouvelle organisation, elle était restée sous la direction d’Henry Jennings. La Société gagna le prix du Jockey-Club en 1856 avec Lion, qui se cassa la jambe l’année suivante sur le même terrain, après avoir eu la gloire de faire galoper Monarque.
L’association ayant été rompue, l’écurie fut vendue à M. le baron Nivière qui en devint l’unique propriétaire; elle atteignit pendant cette période son plus haut point de prospérité, où elle s’est maintenue depuis, et qu’elle a même surpassée en 1869. En 1860, M. le baron Nivière et M. le comte de Lagrange s’associèrent et fondèrent le plus formidable établissement d’entraînement qui ait encore existé en France. Henry Jennings était resté à la tête de l’écurie. Enfin, en 1865, l’association de MM. le comte de Lagrange et le baron Nivière fut dissoute, et l’écurie de La Morlaye devint la propriété commune de MM. le baron Nivière et Ch. Laffite (Major Fridolin), qui en est aujourd’hui seul maître. Elle passa sous la direction de Ch. Pratt, qui jusqu’ici y avait occupé la place de jockey. Cette modification dans son organisation n’a pas interrompu le cours de ses succès. En 1869 elle gagna, la même année avec deux chevaux, Sornette et Bigareau, le prix du Jockey-club, celui de Diane, et le grand prix de Paris.
BERNY (La Croix de) est un carrefour situé sur la route d’Orléans, qui se croise à cet endroit avec celle de Bièvre à Versailles. Cette localité fut choisie en 1834 pour servir de théâtre aux premiers steeple-chases, genre de course absolument inconnu en France à cette époque. Le pays se prêtait merveilleusement à cette destination, et nulle part, même en Angleterre, on ne trouverait un emplacement plus favorable à ce genre de luttes.
Le premier steeple-chase eut lieu le 1er avril 1834 dans la vallée de la Bièvre près de Jouy. Le rendez-vous était à la Croix-de-Berny. La course fut gagnée par May-Fly, jument grise appartenant au comte de Vaublanc, montée par son propriétaire, battant Napoléon, monté par le capitaine Allouard; Deamingten, par M. Wilkinson; Guitare, appartenant à M. le duc d’Orléans; sir Rob, monté par M. de Normandie, et Sidney, appartenant à M. Ch. Laffite et monté par M. Horlock.
C’est à la Croix-de-Berny, en 1839, que se tua le célèbre Barcha, appartenant à lord Seymour, en passant le talus qui sépare les champs de la route. Après ces premiers essais, le terrain de la Croix-de-Berny fut abandonné. Deux steeple-chases seulement y ont eu lieu depuis. Le premier fut gagné par Colvertrop, monté par M. le capitaine Peel, le second par Bristish-Yeoman. Le terrain était si profond, que la course fut courue au trot, et même parfois au pas. Fling-Buck arrivait premier, gagnant très-facilement, quand il est tombé sur le terrain plat en sautant le dernier obstacle.
Depuis, aucune tentative nouvelle n’a été faite pour résusciciter les steeple-chases de Berny; cet abandon est regrettable, car on ne trouvera nulle part un tracé où ces genres de courses présentent un intérêt plus réel.
BÊTE A CHAGRIN est une expression vulgaire, peut-être un peu triviale, mais ne manquant pas d’un certain pittoresque, et exprimant parfaitement la pensée de celui qui s’en sert. Elle ne s’applique pas précisément à un mauvais cheval mais au contraire à un animal sur lequel on a fondé quelques espérances, et qu’une circonstance imprévue empêche toujours de réaliser ce que l’on attendait de lui; soit qu’il tombe malade, au moment où l’on a besoin de lui, ou qu’un accident imprévu vienne lui faire perdre une course, qu’il aurait dû gagner. On l’emploie fréquemment pour désigner un cheval, que l’on a à diverses reprises essayé chez soi, d’une manière satisfaisante, et qui court dans une toute autre forme en public. C’est plutôt un animal peu chanceux que mauvais, qui cause du chagrin à son maître.
BETTING. La traduction littérale du mot Betting est pariant, participe présent du verbe anglais équivalant en français au verbe parier. Betting s’applique donc indifféremment à l’universalité des parieurs, et par extension à leurs actes et leur réunion. Ainsi Betting-Man veut dire: homme pariant, Betting Room: chambre où on parie. Dans le langage usuel on a pris l’habitude de désigner les parieurs réunis, soit sur un hippodrome, soit dans un endroit quelconque, parle nom générique de Betting. On dit donc le Betting, l’opinion du Betting, etc. L’idée que représente ce mot pris dans son acception usuelle, devrait se traduire en français par le marché.
C’est effectivement en réalité, l’ordre d’idées qu’il exprime. L’extension prise pendant le cours de ces dernières années par les paris, a fait des courses une véritable valeur publique, ayant son cours et ses variations comme une action de chemin de fer ou tout autre titre qui se négocie à la Bourse. Plus le cercle s’est élargi, plus il a compris un nombre considérable de personnes étrangères les unes aux autres, ayant par conséquent besoin d’un centre commun pour débattre leurs intérêts. Un cheval de courses ou tout au moins sa chance dans la course où il était engagé, est alors devenue une valeur ayant cours négociable, et subissant des alternatives de hausse et de baisse, subordonnées aux circonstances qui augmentaient ou diminuaient ses probabilités de réussite. Ce besoin a rendu presque indispensable la fondation d’un Betting-Room où les parieurs se réunissaient à un jour et à une heure donnés pour débattre leurs intérêts, établir la cote des chevaux engagés dans une réunion prochaine, ou même à long terme. Cette cote s’établissait nécessairement sur la moyenne de l’offre et de la demande. Le Betting-Room présente donc une extrême analogie avec la Bourse, et pour en donner une idée on ne peut effectivement l’appeler autrement que Bourse des courses. Il a pris en France le nom de Salon des courses. (Voy. PARI.)
Dès qu’un pari est consenti, les parties contractantes doivent l’écrire sur leur book ou carnet. Cette formalité une fois accomplie, ils peuvent avec sécurité continuer leur opération, soit en se couvrant, c’est-à-dire en faisant le pari contraire, s’ils ont quelque inquiétude, soit en doublant le même pari, s’ils ont confiance dans leur opinion. En tout état de cause, ils sont toujours à même de se rendre compte de leur situation. La veille des courses importantes, on fait le pointage des paris. Cette opération consiste dans une vérification que les parties contractantes font réciproquement sur le livre de chacune d’elles, pour s’assurer si le pari a été bien exactement inscrit sur le livre de la partie adverse, tel qu’il a été compris, enfin si lès deux parieurs sont parfaitement d’accord, sur la teneur de leur engagement réciproque. Cette vérification a pour but d’empêcher tout malentendu, et par conséquent, toute discussion après l’événement.
En dépit de toutes ces précautions les contestations et les réclamations sont assez fréquentes au salon des courses. Quand elles se présentent, elles sont soumises à un comité qui statue après examen des livres des deux parties. Une présomption favorable existe toujours en faveur de celui dont le livre est le plus régulièrement tenu. Le book d’un parieur présente une extrême analogie avec le carnet d’un agent de change.
BIENNAL (Prix). Le prix biennal est une course dans laquelle les chevaux sont engagés pour deux années de suite; c’est-à-dire que leur engagement se trouve double, bien que les deux courses soient de fait parfaitement distinctes et isolées. Un cheval peut donc s’abstenir de se présenter la première année et courir la seconde, et réciproquement. Il a par conséquent le droit de profiter de l’un de ces engagements et de renoncer à l’autre en payant forfait. Une certaine somme fixe est attribuée à chacun des prix, et reste en tout cas définitivement acquise à chacun des vainqueurs, quand bien même, ce qui arrive presque toujours, le même cheval ne gagnerait pas les deux courses. Cette combinaison ne présente donc aucune assimilation avec la partie liée.
La pensée qui a présidé à la création des prix biennaux, était d’amener deux années de suite les mêmes chevaux sur le terrain afin de voir s’il s’était produit quelques modifications dans leur qualité respective, ou si la différence de la distance de chacune des deux courses suffisait pour intervertir le résultat. Les prix biennaux sont réservés aux chevaux ayant trois ans au moment de leur engagement. Dans le cas où la combinaison réussirait, ils se trouveraient donc courir ensemble à trois ans, pour une distance de 2 400 mètres, et à quatre sur un parcours de 3 200.
Ces sortes de courses devraient présenter un véritable intérêt, mais leur but réel s’est, jusqu’ici, réalisé une fois seulement. Cet insuccès tient, croyons-nous, à ce que le mérite relatif des. chevaux de trois ans étant toujours à la fin de l’année parfaitement déterminé, quand ils se rencontrent de nouveau à l’âge de quatre ans, leurs propriétaires savent à quoi s’en tenir sur la différence existant entre eux. Les moins bons cèdent la place aux meilleurs pour aller chercher fortune ailleurs. Les prix biennaux auraient probablement plus de chance de succès si les chevaux étaient engagés à deux et à trois ans, parce qu’il se produit généralement plus de modifications dans leur valeur respective de deux à trois ans que de trois à quatre.
Dans le langage usuel, on désigne les prix biennaux par le seul mot de biennal. On dit le dixième ou douzième biennal de telle ou telle année.
BIGARREAU. Cheval bai, par Light et Bataglia, né en 1867, à Villebon, à M. le major Fridolin. Il courut à trois ans à Tarbes, dans le prix de l’Empereur qu’il gagna, battant Chevreuse et Glaïeul, — dans le prix de Garche à Paris, non placé, — à Paris, dans le prix de Longchamps qu’il gagna, battant Miss Hervine et Minotaure, — gagna le prix du Jockey-Club à Chantilly, battant Monseigneur et Minotaure (77 000 fr.). Il ne fut pas placé dans le grand prix de Paris, gagné par sa compagne d’écurie Sornette.
Depuis 1870 Bigarreau n’a pas couru, mais est en ce moment à l’entraînement, et on espère le voir au printemps 1872.
BLACK-LEG. La traduction littérale de Black-Leg est jambe noire; cette expression s’emploie pour désigner une classe d’individus se livrant à un genre particulier d’escroqueries presque impossibles à saisir par la loi, mais assez apparentes cependant pour déconsidérer l’homme qui pratique cette industrie interlope. La désignation de Black-Leg est plus particulièrement usitée dans le langage des courses et s’applique aux parieurs qui font un pari, sachant d’avance qu’ils ne pourront pas payer s’ils perdaient. On désigne généralement ainsi tous les gens qui se livrent dans les courses à des manœuvres douteuses réprouvées plutôt par la délicatesse que par le règlement avec lequel le Black-Leg se met rarement en guerre ouverte.
BLAIR-ATHOL. Étalon alezan, né en Angleterre, en 1861, par Stockwell et Blink-Bonny. Vainqueur du Derby à Epsom en 1864, il appartenait à cette époque à M. Anson.
A l’exception de Nunnykirk, fils de Touchstone, et BeesWing, c’est-à-dire des deux plus grandes illustrations chevalines de leur temps, aucun cheval n’est sorti d’un plus haut lignage. Sa mère Blink-Bonny, par Melborne et Queen-Mary, fille de Gladiator, offrit en 1857 le rare exemple d’une double victoire dans le Derby et dans les Oaks. Sa vitesse dans la première de ces courses passa pour la plus grande obtenue jusqu’à cette époque, et n’a, croyons-nous, jamais été égalée depuis que par Kettledrum en 1861.
Son père Stockwell (propre frère de Rataplan), par The Baron et Pocahontas, gagna le Saint-Léger, les 2 000 guinées, le Great Yorkshire, le Whip, à Newmarket; il est considéré comme l’un des meilleurs reproducteurs d’Angleterre.
On devait beaucoup attendre du produit d’une semblable union. L’apparence extérieure de Blair-Athol justifiait pleinement ces espérances. Il ne courut pas à deux ans et fit sa première apparition dans le Derby de 1864, où il battit Général Peel, le vainqueur des 2000 guinées. Quelques doutes s’élevèrent en ce moment sur sa supériorité relativement à ce dernier, et elle n’est pas encore suffisamment prouvée aujourd’hui.
Cette victoire le faisait néanmoins considérer comme un adversaire impossible à battre dans le grand prix de Paris en 1864, où General Peel ne devait pas paraître. Se reposant sur lui du soin de les représenter dans ce tournoi international, tous les concurrents anglais se retirèrent et Blair-Athol vint seul en France, entouré du prestige du meilleur cheval de son année en Angleterre. Il fut à son arrivée avidement examiné et provoqua une admiration générale.
Blair-Athol est de haute taille, il porte en lui un caractère de grande race, dont l’aspect impressionne vivement au premier examen. Les lignes de son avant-main sont remarquables, mais peut-être un peu massives, comparées surtout à celles de l’arrière-main. La croupe est tout à fait horizontale et la queue attachée trop haut. Sa tête élégante et distinguée, emprunte une expression particulière à une longue lisse qui la partage régulièrement. Il paraît, dans une certaine mesure du moins, avoir hérité des mauvais pieds, assez communs dans la descendance de Melbourne. Cette infirmité devait, surtout sur les terrains durs, paralyser quelquefois ses hautes qualités. Ces imperfections disparaissent dans l’ensemble de sa construction et rarement un sportsman s’est absorbé dans la contemplation d’un plus bel animal.
Il eut comme concurrent dans le grand prix de 100 000 fr., Vermout, le gagnant; il ne put arriver que second, laissant derrière lui Fille-de-l’Air, Bois-Roussel et Baronello. Son échec a été attribué à bien des choses, d’abord au manque de condition, et à sa lutte acharnée avec Fille-de-l’Air. Ces appréciations peuvent avoir une valeur, mais les faits comme les chiffres ont une éloquence brutale. Comme pour démentir les doutes exprimés sur la régularité de sa forme, de retour à Ascot, malgré la fatigue d’une double traversée, le vainqueur du Derby rencontra une facile victoire.
BLANC. On ne peut réellement donner à un cheval la désignation de blanc, qu’autant que sa peau est blanche. Les extrémités, c’est-à-dire les parties de l’animal où le poil se raréfie, et même disparaît entièrement, ainsi que le tour des yeux sont roses. Les chevaux blancs, c’est-à-dire ceux dans les conditions que nous venons de décrire, sont assez rares aujourd’hui en Europe et forment presque une variété albinos. Il en existe cependant quelques-uns, provenant pour la plupart d’origine orientale ou espagnole, ce qui revient au même. Le plus grand nombre des chevaux blancs que l’on rencontre en France ou en Angleterre, sont des chevaux gris dont la robe a subi l’influence de l’âge. Pour qu’un cheval soit blanc, il faut qu’il naisse blanc, circonstance très rare surtout en Europe, tous les chevaux gris viennent au monde alezans, ou plus généralement encore noirs,
BOIS-ROUSSEL. Étalon bai, né en 1861, en France, chez M. Delamarre, par the Nabob et Agar, issue de Sting, exporté en Autriche en 1865.
Il a gagné en 1864 la Poule des Produits (15 050 fr.), à Paris. — Prix de l’Empereur (30 400 fr.). — Prix du Jockey-Club (81 100 fr.), est arrivé troisième dans le grand prix de Paris (5000 fr.) où il est tombé broken-down.
BOIS-ROUSSEL (Haras de). Le haras de Bois-Roussel, situé dans le département de l’Eure, appartient à M. le comte P. Rœderer. C’est un des établissements les plus anciens et les plus complets qui existent en France. M. le comte P. Rœderer fit d’abord courir et eut d’assez nombreux succès. Par suite d’une association qui fonda l’écurie, dont les chevaux courent sous le nom de M. Delamarre, le haras de Bois-Roussel devint la pépinière de la Société. A partir de cette époque, il prit un beaucoup plus grand développement, les victoires de ses produits ne tardèrent pas à rendre son nom populaire. Le haras de Bois-Roussel a eu une chance exceptionnelle. Presque tous les éleveurs donnent le nom de leur propriété à l’un des produits qui y sont nés, à celui nécessairement qui leur inspire le plus de confiance. Par une assez étrange bizarrerie, rarement ce parrainage porte bonheur au filleul. Bois-Roussel fait exception à cette règle à peu près uniforme, il a été assez heureux pour donner son nom à un vainqueur du prix du Jockey-Club, l’un des bons chevaux qui soient nés en France. La même année Vermout, également né à Bois-Roussel, gagnait le grand prix de Paris. Peu d’éleveurs ont eu une aussi bonne fortune. Bois-Roussel a également vu naître Patricien et un grand nombre d’excellents chevaux, qui ont fait à l’écurie de M. Delamarre et à l’élevage de M. le comte Rœderer, une position importante sur le turf français.
BOITER. Un cheval est boiteux, quand par suite d’une souffrance, ou d’un accident, la régularité de sa marche se trouve interrompue. Les causes de boiterie sont multiples et le plus souvent apparentes. Il arrive parfois que le cheval boite sans que l’on puisse découvrir le siége du mal. En ce cas il souffre indubitablement du pied. Les vétérinaires, quand la cause de la boiterie leur échappe, la cherchent habituellement dans l’épaule. C’est une erreur, les boiteries d’épaules sont excessivement rares et quand elles existent sont le résultat d’accidents apparents. Toute boiterie sans cause extérieure réside dans le pied.
BOLDRICK (J.). Après avoir été jockey chez M. le comte de Cambis, J. Boldrick est entré au service de Mme Latache de Fay, comme entraîneur et comme jockey. Il a dirigé avec bonheur et succès cet établissement jusqu’à l’époque de la mort du propriétaire. Après être resté quelque temps au service de M. Lunel, Boldrick est devenu entraîneur public à Chantilly. Il a entraîné plusieurs chevaux, dont la carrière a marqué dans les annales des courses, entre autres Pédagogue, Festival, Fire-Worck et Beauvais, vainqueur du prix du Jockey-Club, l’année même qui suivit la mort de Mme Latache de Fay, dont cette victoire avait longtemps été le rêve.
BONDIR exprime cette défense d’un cheval, qui consiste à ramener sous lui les quatre extrémités en faisant le gros dos et s’enlevant brusquement de terre, dans cette position, par un mouvement violent. C’est une défense très-dure, et pour peu que le cheval y mette quelque énergie, les cavaliers tout à fait accomplis peuvent seuls y résister, et encore si l’animal persiste ils finissent généralement par tomber.
L’action de bondir est naturelle aux poulains non dressés qui sont soumis pour la première fois à la contrainte des sangles de la selle et de l’homme. Les poulains cèdent toujours plus ou moins à cette tentation les premières fois qu’ils sont montés, et ceux chez qui elle est accentuée à un certain point sont à peu près sûrs de désarçonner leurs cavaliers. L’habitude fait plus ou moins vite disparaître cette disposition. Quelques chevaux la conservent cependant jusqu’à un âge assez avancé, mais elle perd de sa puissance et les bonds d’un cheval fait, sont toujours beaucoup moins durs à supporter.
BOOK et BOOK MAKER. — Voy. PARIEUR CONTRE et BETTING.
BOOK (Stud-). Registre généalogique des chevaux de pur-sang. — Voyez STUD-BOOK.
BORDEAUX. La réunion de Bordeaux est une des plus importantes du Midi, elle jouit d’une vogue d’autant plus grande, que le caractère de son programme est en quelque sorte intermédiaire. Sur le plus grand nombre des hippodromes de la division du Midi, les prix sont, en grande partie du moins, exclusivement réservés aux produits nés dans la division même. Bordeaux, tout en se conformant à cette règle générale de la contrée, ouvre cependant certaines courses à l’ensemble de la production française. Les chevaux de la division du Nord, parmi lesquels figurent en première ligne les écuries de Chantilly, peuvent prendre part à ces courses, suivant les conditions à poids égal, ou avec une surcharge. La comparaison peut ainsi s’établir entre les différentes circonscriptions.
Les courses de Bordeaux ont lieu deux fois dans l’année. La première réunion, celle du Printemps, est en général fixée au début de la saison, pendant les courses de Paris. Cette coïncidence présente peu d’inconvénients: ces premières courses de Bordeaux étant réservées aux produits du Midi qui ne prennent que très-rarement part aux épreuves du Printemps à Paris et Chantilly.
La seconde réunion de Bordeaux est reculée aux derniers jours d’automne après la clôture de la saison sur presque tous les autres hippodromes, d’ordinaire après les courses de Marseille. Elle présente un intérêt réel en raison surtout des courses de deux ans assez significatives à ce moment de l’année.
L’installation matérielle de l’hippodrome de Bordeaux a longtemps laissé à désirer. La nature du sol le rend peu favorable à une destination de cette nature. Le Comité a fait tous ses efforts pour combattre cette mauvaise disposition, il s’est imposé des grands sacrifices, et d’importantes améliorations ont été effectuées sur le terrain qui se trouve aujourd’hui en aussi bon état qu’il était permis de l’espérer.
BOUCHER. L’âge des chevaux se connaît à l’inspection des dents. Quand on veut juger l’âge d’un cheval, on lui ouvre la bouche en écartant les deux mâchoires, et le forçant à tenir la tête à la hauteur de l’œil de l’homme, l’une des mains de celui-ci élevant la mâchoire supérieure, l’autre abaissant l’inférieure afin de pouvoir examiner les dents. En argot d’homme de cheval cela s’appelle boucher un cheval.
BOULET. Région articulaire, située entre le canon et le paturon et ainsi désignée à cause de sa forme sphéroïde. Cette articulation joue un grand rôle dans l’action locomotrice. C’est le premier point sur lequel le contre-coup, déterminé par la rencontre du pied sur le sol, se fait sentir. La netteté de cette articulation et sa largeur ont donc une grande importance puisqu’elle ne résiste qu’en raison de sa solidité et du jeu parfait des surfaces articulaires des attaches ligamenteuses et tendineuses.
Aussi les maladies de cette région ont-elles toujours pour point de départ un tiraillement, une déchirure, dus à un effort immodéré pendant la locomotion, effort du boulet. Le nom de l’affection est caractéristique de la cause.
Chez le jeune cheval de course très-long jointe, la partie postérieure du boulet vient quelquefois effleurer le sol si l’allure est un peu forcée et si la longueur du paturon est anormale.
BOULETÉ. Quand le boulet sort de la ligne d’aplomb, pour se porter en avant, le cheval est boulé ou bouleté. Boulet rond, droit sur ses membres, bouleté, voilà les expressions qui indiquent les degrés de ce vice de conformation ou le degré de déviation. Ferrure appropriée, frictions, feu, voilà le traitement.
BOULOGNE-sur-Mer. La réunion de courses de Boulogne est une des mieux placées de France, grâce à la situation de la ville qui donne toute facilité aux chevaux anglais de venir y courir sans un déplacement long et coûteux. La piste de Boulogne-sur-Mer est d’une excellente qualité, parfaitement propre aux courses plates, comme aux steeple - chases. Le terrain aux abords de la mer se trouve accidenté de manière qu’il n’est presque besoin de rien faire pour donner à un steeple-chase l’aspect de ce que l’on est convenu d’appeler hunting-country ou terrain naturel.
Malheureusement, le Comité des courses de Boulogne ne rencontre pas dans l’Administration des Haras, et dans le conseil municipal de la ville, l’auxiliaire sur lequel il serait en droit de compter. La réunion de Boulogne ne présente donc pas l’importance que comporterait sa situation et l’excellence de son terrain. Les courses ont lieu chaque année dans la première quinzaine d’août, elles ont toujours un certain intérêt en raison de celles qui les suivent où les précèdent.
Grâce à sa situation, aux facilités de transport existant entre Paris et Boulogne, et surtout aux agréments que présente toujours une ville d’eaux aussi passagère, l’hippodrome de Boulogne constitue un des déplacements ordinaires des habitués des courses. Le Ring, c’est-à-dire les parieurs, ne manque jamais de s’y rendre, dans une proportion suffisante pour donner une extrême animation à la réunion.
BOUSCULADE. On se sert du mot Bousculade quand, dans une course, deux ou plusieurs chevaux viennent en contact et qu’il résulte de ce choc une confusion générale.
BOUTE EN-TRAIN. — AGACEUR. — ESSAYEUR. Ce sont les différents noms donnés, suivant les localités, au cheval entier chargé d’exciter les femelles destinées à un autre étalon. Le Boute-en-train est une sorte de réactif physiologique fort précieux, — on sait par lui si la femelle est disposée, — sa présence, ses agaceries provoquent des révélations nécessaires — si l’on ne veut fatiguer inutilement un étalon précieux.
Dans les stations d’une certaine importance le Boute-en-train est presque indispensable. Il n’est pas indifférent qu’on prenne tel ou tel animal entier pour remplir ce rôle. Le sujet doit être pourvu de certaines qualités spéciales. On le prendra très-ardent et pourtant docile, impressionnable et non vicieux, bruyant, remuant, hardi.
BOX signifie littéralement boite. On l’emploie, en terme de sport, pour désigner une écurie isolée, où un cheval est mis seul et en liberté, au lieu d’être attaché dans une stalle à côté d’un autre. Les chevaux de courses sont tous en Box. Cette méthode présente de nombreux avantages pour tous les chevaux en général, et pour ceux destinés à la course en particulier. L’animal mis en Box se repose mieux, parce qu’étant ainsi isolé il est à l’abri des surprises ou des inquiétudes résultant nécessairement d’une écurie nombreuse, où il peut être tourmenté par un camarade guincheur, ou les allées et venues des hommes d’écurie. Cette précaution est indispensable pour les chevaux de course qui, prenant un travail sévère et régulier, ont besoin d’un repos absolu après leur exercice. Ils peuvent, dans un Box, se coucher à volonté, ce qui leur est difficile attachés dans une stalle. De plus la liberté relative, où ils se trouvent, remédie aux conséquences résultant de l’immobilité forcée à laquelle ils sont contraints dans une écurie ordinaire. On évite ainsi les engorgements de jambes et autres inconvénients de même nature.
BOY. Le mot boy, littéralement garçon, s’applique, comme terme générique, à des enfants dont l’âge varie de dix à quinze ou seize ans, et qui sont employés dans les écuries de courses pour soigner et monter à l’exercice les chevaux en entraînement. Ce sont généralement des fils ou parents de jockeys ou d’entraîneurs, faisant leur apprentissage, et aspirant à suivre la carrière de leurs pères. Tous les jockeys, même les plus célèbres, ont commencé par être simples boys. Quand l’un dé ces jeunes garçons démontre un goût et une aptitude particulière, l’entraîneur se risque à le faire monter, généralement dans un handicap, où on a toujours besoin de poids légers. L’avenir du Boy se trouve alors entre ses mains. Si son aptitude se confirme, et que l’on reconnaisse en lui les qualités indispensables à un jockey, on le pousse, et sa fortune est faite; les poids légers montant bien sont excessivement recherchés. A de rares exceptions près, tous les boys sont Anglais. On a bien essayé par par tous les encouragements possibles de donner ce goût à des jeunes Français, mais généralement, après un apprentissage plus ou moins infructueux, ils y renoncent; cette aptitude n’est pas dans leur nature, il y a cependant quelques exceptions, mais elles sont rares.
La traduction du mot boy en argot d’écurie serait gamin; employé dans le sens dont nous nous occupons ici, il présente absolument cette signification. Notre interprétation est si vraie que quand par hasard un enfant français persiste dans cette carrière, les entraîneurs le désignent sous le nom du gamin français.
Le mot gamin perd alors l’idée sinon injurieuse au moins dérisoire qu’il comporte toujours dans le langage ordinaire.
Il y a bien des années, un de ces enfants français, employé dans l’écurie de M. le prince Marc de Beauvau, sous la direction d’Henry Jennings, eut une chance inespérée; il gagna une course à Rouen montant une jument nommé Error. Le fait d’une course gagnée par un jockey français, concurremment avec des Anglais, parut à cette époque si anormal, que l’enfant acquit pendant plusieurs mois une sorte de célébrité. On ne le désignait plus à Chantilly, ou sur un terrain de course, que par la périphrase de: le gamin qui montait Error à Rouen. Lui-même acceptait cette pompeuse dénomination, et quant on lui demandait son nom, il répondait avec une sorte d’orgueil: Je suis le gamin qui montait Error à Rouen.
BRAS (Des). On se sert de cette expression pour exprimer le plus ou moins de force que l’on suppose à un jockey pour tenir et mener son cheval. On dit: il a ou n’a pas de bons bras. C’est une locution fausse, même relativement à l’idée qu’elle exprime. La force des bras d’un jockey est insignifiante pour bien ou mal mener son cheval. La manière dont il s’en sert est beaucoup plus importante. Si la difficulté se réduisait à une question de force, un fort de la halle ou un portefaix, s’ils avaient le poids, seraient supérieurs à tous les jockeys. La meilleure preuve, c’est que l’on voit des enfants, dont la force est très-limitée, mener parfois certains chevaux difficultueux, beaucoup mieux que des hommes dont la force leur est très-supérieure. L’expression: une bonne ou une mauvaise main, est beaucoup plus juste.
BRASSICOURT. On appelle brassicourt un cheval dont le canon antérieur, c’est-à-dire la partie de la jambe de devant comprise entre le genou et le boulet, au lieu d’être perpendiculaire, affecte une forme plus ou moins courbe en avant du genou et du pied, qui se trouve ainsi placé en arrière du genou dans une proportion égale à la cambrure du canon. On dit d’un cheval dont les membres affectent cette disposition, qu’il est brassicourt ou arqué.
Cette irrégularité provient généralement d’usure, de travail forcé ; mais elle existe également à l’état de nature, et beaucoup de chevaux naissent brassicourts. Un préjugé presque universellement admis les supposent moins sûrs et plus sujets à tomber; c’est une erreur, les chevaux arqués, surtout ceux qui le sont naturellement, ne font pas plus de fautes que d’autres. Les Anglais pensent même qu’un cheval légèrement brassicourt est plus agile et plus adroit.
Quand la jambe affecte une disposition contraire, et se trouve cintrée en dedans, par conséquent le pied en avant du genou, on dit: C’est un genou de veau. Ce défaut est beaucoup plus important que le premier, les chevaux qui en sont affectés manquent, en général, de sûreté et d’agrément.
BRIDE. Le mot bride constitue, dans le langage usuel, l’ensemble du mécanisme placé à la tête et dans la bouche d’un cheval pour le conduire et le dominer. Dans la pratique spéciale du cheval il y a quelques distinctions à établir parce qu’il y a plusieurs sortes de brides, très-différentes entre elles, et d’un effet diamétralement opposé.
La bride la plus commune, celle dont on se sert d’ordinaire dans l’usage habituel, c’est-à-dire à la chasse ou à la promenade, consiste en une double lanière de cuir faisant le tour de la tête du cheval, passant par-dessus ses oreilles et descendant jusqu’à la bouche, où elle vient s’adapter au mors à l’aide d’une boucle, d’une couture ou même d’un mousqueton, suivant la mode et le goût. En Angleterre les brides sont généralement cousues, en France le plus souvent elles tiennent au mors par une boucle. L’usage du mousqueton remplaçant ces deux premiers moyens de communication entre la bride et le mors a été inventé depuis quelques années, et n’est pas d’un usage très-répandu.
La bride elle-même se compose de plusieurs pièces: 1° les montants, c’est-à-dire deux morceaux de cuir partant du mors et venant se rattacher au-dessous de l’oreille du cheval à la têtière. 2° La têtière également en cuir et se composant elle-même de trois pièces, la têtière proprement dite qui passe par-dessus les oreilles du cheval, et se boucle de chaque côté aux deux montants qu’elle réunit. Le frontail qui passe sur le front du cheval au-dessous des oreilles, s’adaptant de chaque côté à la têtière pour l’empêcher de couler en arrière de la tête. La sous gorge, petite lanière généralement très-mince, qui passe sous la ganache du cheval en sens inverse du frontail, pour. s’opposer au mouvement contraire, c’est-à-dire celui où le cheval, en baissant la tête, ferait passer la têtière par-dessus ses oreilles. 3° Enfin deux ou quatre lanières partant du mors pour venir dans les mains du cavalier ou du cocher et à l’aide desquelles il dirige le cheval. Ces lanières se nomment rênes, s’il s’agit d’un cheval de selle, guides pour un cheval de harnais.
Le mors ne fait, à proprement parler, pas partie de la bride; ils sont le complément l’un de l’autre, mais ne peuvent être confondus puisque leur action est distincte, et qu’ils peuvent aisément se passer l’un de l’autre, le mors pour une autre bride et réciproquement.
D’ordinaire et dans l’usage habituel, le cheval a deux mors dans la bouche, le mors de bride et le mors de filet. Le premier est fixe et tout d’une pièce, formé dans la partie placée dans la bouche de cheval par une barre d’acier courbée en demi-cercle au milieu. Les deux parties droites et posant sur les deux côtés de la bouche, nommées barres, s’appellent canons. Le demi-cercle prend le nom de liberté de langue, parce que son but est d’affranchir la langue d’une pression trop continue dont la persistance arriverait à la tuméfaction. Ce fait se produit fréquemment avec les mors droits, ou dépourvus de liberté de langue, principalement quand on se sert de mors dits allemands. De chaque côté du mors viennent s’adapter deux crochets (dits crochets gourmette) parce qu’ils servent de soutien à une petite chaîne en acier qui, accrochée à chacun d’eux, passe sous le menton du cheval et se nomme gourmette. L’effet de cette gourmette consite à rendre l’action du mors plus puissante en faisant levier, quand le cavalier se sert des rênes. Par conséquent plus la gourmette est serrée, plus l’effet est intense.
La partie extérieure du mors consiste en deux branches plus ou moins longues tenant nécessairement aux canons et tombant parallèlement de chaque côté de la bouche. Les rênes sont bouclées ou cousues à l’extrémité de chacune d’elles. La longueur des branches exerce une influence très-grande sur l’action du mors: plus elles sont longues, plus l’instrument a de puissance.
Il existe des mors de forme et d’effet divers; les principaux sont: le mors dit hanovrien, dont les canons et la liberté de langue, au lieu d’être d’une seule pièce, se composent d’olives articulées, de telle sorte que quand il n’est pas dans la bouche du cheval, il se plie aussi facilement qu’un filet. On l’emploie habituellement pour les chevaux lourds ou à bouche sourde. Le mors à bascule, semblable au mors ordinaire, quant à la partie qui repose dans la bouche du cheval, mais très-différent dans l’appareil extérieur, c’est-à-dire les branches.
Les branches du mors à bascule sont brisées et faites en deux morceaux, à la hauteur des canons. La partie supérieure s’adapte aux montants, la gourmette et les rênes se mettent, la première en haut, les secondes au bas de la partie inférieure. L’effet du mors à bascule est excessivement puissant, aussi doit-on l’employer avec une extrême réserve, il devient dangereux dans une main mauvaise ou inexpérimentée.
Le second mors, faisant partie de la bride ordinaire, est beaucoup moins compliqué. Il se compose d’une barre d’acier, ronde, séparée en deux parties qui se réunissent au milieu par une courbure rivée à l’extrémité de chacune d’elles et faisant l’effet d’un anneau. Il se nomme le filet et se termine extérieurement par deux anneaux plus ou moins larges qui se bouclent ou se cousent à deux des quatre montants de la bride. L’effet du filet est doux, moins puissant, mais beaucoup plus direct, et dans certains cas beaucoup plus sûr que celui du mors de bride. On l’emploie, de préférence, avec les jeunes chevaux ou ceux qui ne sont encore qu’imparfaitement dressés.
BRIDON. Le bridon, n’est à vrai dire qu’un filet sous un autre nom. Il en diffère seulement en ce que l’on place entre les deux anneaux qui terminent le filet une barette en acier, pour empêcher le mors de sortir de la bouche, et de passer tout entier d’un côté, quand on se sert un peu violemment d’une seule rêne, pour faire tourner le cheval, ou l’empêcher de se jeter du côté où il veut aller. L’action du bridon est à la fois plus douce et plus sûre que celle du mors de bride, surtout pour les chevaux dont la bouche n’est pas faite, parce que ses effets sont multiples; le mors au contraire agit plus ou moins violemment, mais toujours dans le même sens, par une pression directe et non interrompue, tant que le cavalier appuie sur les rênes. Le bridon, au contraire, brisé, et n’ayant pas de gourmette, flotte et joue toujours dans la bouche du cheval, celui-ci résiste d’autant moins qu’il sent l’inoffensivité de l’instrument à l’aide duquel on le conduit, et peut plus facilement se soustraire à une compression trop forte ou manquant de justesse. Aussi le bridon est-il l’embouchure des chevaux et des cavaliers inexpérimentés. On l’emploie avec raison pour les poulains dont la bouche n’est pas faite. Mais une fois le cheval dressé, l’appareil complet de la bride devient nécessaire pour le plus grand nombre des usages ordinaires, parce que dans une foule de circonstances on a besoin d’une puissance qui fait défaut au bridon. C’est au cavalier à en modérer l’usage suivant ses besoins. On a donné de la ligne à pêcher une définition qui peut à merveille s’appliquer à la bride, c’est un instrument qui se termine par une bête de chaque côté, c’est le moins bête des deux qui mène l’autre, souvent le moins bête n’est pas le cheval.
BRIDON DE COURSE. L’usage et la destination du cheval de course étant exceptionnels et tout particuliers, il est aisé de comprendre, qu’à beaucoup de points de vue il sort de la loi commune. Son hygiène et son travail étant dirigés vers un but unique, il doit en être de même de presque tous les détails qui le concernent. La vie d’un cheval de course se partage exclusivement entre son entraînement et la course elle même. Ces deux destinations exclusives limitent donc singulièrement les moyens d’action, dont on a besoin vis-à-vis de lui. Effectivement, son travail se borne à marcher au pas, et galoper plus ou moins vite, soit en ligne droite, soit sur un hippodrome, c’est-à-dire un terrain préparé, où il est à peu près certain de ne rencontrer aucune de ces circonstances imprévues, qui forcent à de brusques temps d’arrêt ou à de subits changements de direction. Il doit, d’ailleurs, pouvoir s’étendre dans la plus grande extension de son allure, avec pleine et entière sécurité. Dès lors, il n’est nul besoin d’employer vis-à-vis de lui ces engins dont la puissance et les effets immédiats, non-seulement sont inutiles, mais encore seraient autant d’obstacles aux exigences qu’on lui impose. Un cheval de course (généralement un poulain) ne se sentirait pas en confiance avec un mors d’une certaine sévérité, il a, au contraire, besoin de s’y appuyer avec confiance. C’est donc avec raison que l’on a pris l’habitude de les monter sans autre embouchure qu’un simple filet. Mais c’est à tort, ou pour obéir à une manie, que certains cavaliers en ont induit que ce menage était applicable à l’usage général du cheval dans la vie ordinaire. Le dressage et le menage d’un cheval de course constituent une spécialité, et n’ont rien de commun avec celui des autres chevaux, puisqu’on leur demande exactement le contraire. Un homme de cheval consommé peut parfaitement se servir d’un cheval entraîné pour la chasse ou pour la promenade; mais c’est là une exception; la plupart des cavaliers seraient peu à leur aise, si on leur donnait un cheval de course avec un bridon pour se promener ou chasser. C’est donc par un esprit d’imitation, touchant parfois au ridicule, que l’on voit quelques cavaliers passer sur un poney inoffensif affublé d’un bridon de course. Ils sont simplement mal portés, ou mènent leur monture imparfaitement, et sans sûreté pour eux comme pour les autres, dans le cas où elle présenterait quelques difficultés. C’est absolument comme s’ils sortaient en tenue d’armes, parce que leur professeur conserve toute la journée son plastron, ses gants et son masque. Le bridon de course est la tenue de combat.
Le bridon de course diffère peu du bridon ordinaire, il est seulement plus mince, et fait, par conséquent, plus d’effet. Il présente peu de variétés; la principale est celle du filet à quatre anneaux. La différence consiste en ce que le mors, au lieu de s’adapter directement aux montants et aux rênes, s’y rattache par l’intermédiaire de deux anneaux de chaque côté, l’un à l’extrémité de chaque montant, l’autre à celtes du mors lui-même. Les rênes sont fixées aux anneaux faisant partie du mors, qui, ainsi ballotté, joue dans la bouche du cheval. On emploie ce mode de bridon pour les chevaux qu’une disposition naturelle, ou l’habitude de s’appuyer sur le mors, a rendus trop pesants à la main; il est également excellent pour ceux qui ont l’habitude de chercher à se soustraire à l’action de la main, en levant la tête trop haut.
Il y a quelques années, un grand nombre d’entraîneurs avaient pris l’habitude de remplacer le mors de bridon par une chaîne de gourmette dont les anneaux étaient très-espacés. Ce fut une sorte de fureur, on ne voyait à Chantilly que des chevaux embouchés de cette manière. Puis, cette manie, s’amoindrissant chaque jour, a disparu presque entièrement aujourd’hui.
Parfois, quand un cheval a la bouche susceptible, ou, ce qui revient au même, trop sensible, on substitue au filet un morceau de bois rond, auquel on donne le nom de billot. Le billot rond et assez épais atténue, sur les barres du poulain, l’effet irritant du bridon ordinaire. Mais c’est là une très-rare exception.
Le bridon est donc l’embouchure presque exclusivement employée avec les chevaux de course. Cependant, quand l’un d’eux devient trop pesant ou tirant trop à la main, on se sert d’une sorte de mors mixte appelé Palaam. Le palaam participe à la fois du bridon et du mors de bride; il ne diffère en rien du premier, quant à la partie placée dans la bouche, et ressemble exactement au second dans l’appareil extérieur, c’est-à-dire les branches. Comme au mors de bride, on lui adapte une gourmette; son effet est donc à la fois celui du mors de bride mitigé et du bridon augmenté. On se sert également assez fréquemment du palaam pour les chevaux employés aux services ordinaires.
Nous avons mentionné ces diverses embouchures, parce qu’elles existent, en détaillant l’effet attribué à chacune d’elles. Il ne faudrait cependant pas y attacher trop d’importance. Le meilleur mors pour le cheval est la main du cavalier.
BROKEN-DOWN veut dire littéralement brisé, en bas. On désigne ainsi une boiterie spéciale et particulière aux chevaux de course. Cette règle n’est pas sans exception; elle se produit parfois chez d’autres chevaux, mais rarement, et résulte toujours d’un effort violent fait par l’animal pour aller plus vite qu’il ne peut. Le broken-down est la terreur des propriétaires et des entraîneurs. Quand ce funeste accident frappe un cheval, il peut rarement être entraîné. S’il s’agit d’un sujet d’une certaine classe, on essaye, après l’avoir laissé reposer, de le remettre en travail. Suivant la gravité de l’accident, il résiste plus ou moins longtemps, mais, arrivé à un certain point de sa préparation, le même effet se reproduit presque infailliblement. On dit, en ce cas, la jambe est partie.
La cause du broken-down réside dans l’extension du galop que l’entraînement nécessite. Le cheval, continuellement étendu, projette sa masse sur l’avant-main à chaque foulée, les jambes de devant reçoivent une secousse qu’elles ne peuvent pas toujours supporter. Il se produit alors une inflammation progressive dans la gaine tendineuse, comme on dit en argot d’écurie, la jambe chauffe. Si l’entraîneur avait à ce moment la prudence d’arrêter le travail et de mettre le cheval au repos pendant un laps de temps suffisant, il serait possible d’éviter les suites de ce pronostic de triste augure. Mais les exigences de l’entraînement sont peu compatibles avec des précautions de cette nature. L’époque des courses approche, il faut être prêt, on ne peut interrompre le travail, on continue, on espère arriver. La jambe chauffe de plus en plus, et, après un galop un peu sévère, il se produit dans la gaine tendineuse une lésion tellement grave, que non-seulement le cheval boite, mais qu’il semble avoir la jambe cassée, et que l’on a, parfois, grande peine à le ramener à l’écurie; il est, de fait, estropié.
Il y a deux sortes de broken-down; la plus fréquente se produit dans la partie de la jambe que l’on nomme le gros tendon, c’est-à-dire celui qui part du genou, et se continue jusqu’à l’extrémité du boulet. Quand la lésion se trouve au milieu du tendon, par conséquent éloignée des deux articulations, elle est guérissable pour tout autre service que celui de la course. Le cheval peut souvent courir des steeple-chases, être employé sans inconvénient à la chasse, à la selle ou à l’attelage. Mais il faut renoncer à l’entraîner, ou, tout au moins, à le remettre ce que l’on appelle à point, c’est-à-dire dans le maximum de sa condition. Il peut encore quelquefois courir, mais contre des concurrents d’un ordre inférieur, avec lesquels il n’a pas besoin d’être mis dans la plénitude de ses moyens.
La seconde manière dont l’accident se produit, pour être moins apparente, n’en est pas moins dangereuse. Dans ce cas, la lésion a lieu dans le ligament suspenseur du boulet. Rarement la guérison peut s’opérer suffisamment pour mettre le cheval à même de faire un service un peu sévère, surtout un de ceux comme celui de la chasse, où une certaine vitesse est indispensable.
Au reste, tout cheval de course est à peu près fatalement destiné à devenir broken-down au bout d’un temps donné, si sa carrière se prolonge au delà d’un certain terme. Il arrive un moment où la somme du travail que comporte l’entraînement dépasse celle des forces de l’animal, et, si sa constitution est assez bonne pour le supporter, les jambes ne peuvent conserver la même solidité. Parmi toutes les célébrités de l’hippodrome, bien peu ont pu échapper à cette loi générale. Meilleurs ils sont, plus l’accident est à craindre, précisément parce qu’il résulte d’efforts dont les bons chevaux sont seuls capables. Les entraîneurs disent fréquemment, en parlant d’un mauvais cheval: il n’est pas assez bon pour tomber broken-down. Tout cheval broken-down est boiteux, mais tout cheval boiteux n’est pas nécessairement broken-down.
BROUSSER. On se sert du mot brousser pour désigner un cheval qui, au lieu de sauter un obstacle en s’enlevant de manière à ne pas le toucher, le heurte du poitrail et le traverse. Les vieux chevaux de steeple-chase arrivent presque tous à employer plus ou moins cette manière de passer, une longue expérience leur ayant appris qu’ils pouvaient le faire impunément pour un grand nombre d’obstacles, et éviter ainsi des efforts inutiles. Le brousseur n’est donc pas un cheval qui saute mal par inexpérience ou impuissance, il se rend parfaitement compte de ce qu’il fait, et ne tombe pas plus souvent qu’un autre, à moins qu’il ne rencontre un piège, c’est-à-dire un obstacle qu’il pense pouvoir traverser, et qui soit assez solide pour lui résister, auquel cas il fait une effroyable chute. Cette manière particulière lui réussit tant qu’il la pratique avec une certaine prudence, mais généralement il finit par prendre une telle confiance qu’il cherche à brousser indifféremment à travers tous les obstacles, et devient excessivement dangereux pour son jockey.
Le fameux The Colonel était, sur la fin de sa carrière, un modèle dans ce genre, il broussait quelquefois même avec succès, à travers des murs et des barrières fixes qu’il renversait.
BRUXELLES. Bien que les courses belges ne soient pas soumises à l’organisation française, elles se lient intimement à celles de notre pays, en ce sens que les chevaux français entrent pour une large part dans les éléments qui les alimentent. Il y a cependant plusieurs prix réservés aux chevaux du pays; mais comme l’élevage belge n’a pu encore acquérir une importance suffisante, on est convenu de leur assimiler les chevaux étrangers, qui, après avoir été achetés par des propriétaires belges, et accompli une résidence d’un certain temps déterminé dans le pays, sont assimilés aux chevaux belges.
L’organisation de l’hippodrome de Bruxelles est parfaite, sauf le terrain dont la qualité est si mauvaise, que malgré des soins constants et des dépenses considérables, il a été impossible, surtout par des temps pluvieux, de le rendre praticable. Aussi les accidents y sont-ils fréquents.
BULL-FINCH (Le) est un obstable composé d’un talus ou petit mur en terre, très-peu élevé, sur lequel est plantée une haie assez épaisse et tellement haute, qu’il est impossible de la franchir comme un saut ordinaire. Le cheval doit aborder le bull-finch assez bon train, sauter aussi haut qu’il peut, et passer au travers de l’obstacle, comme un sanglier. La haie, tout en présentant une certaine résistance, doit être construite de manière à céder sous le poids de l’animal. On établit quelquefois le bull-finch tellement haut que non-seulement le cheval, mais encore le cavalier, doivent passer au travers; dans ce cas, celui-ci est obligé de baisser la tête et souvent de se garantir la figure avec ses bras. C’est au reste un obstacle assez peu usité, du moins en France, où le plus souvent les steeple-chases ont lieu sur un hippodrome tournant et un terrain entièrement artificiel. Il faut, pour sauter un bull-finch, un cheval d’une excessive franchise ou très-habitué à cette sorte de difficultés, car il doit s’élancer avec la conscience qu’il lui est impossible de franchir l’obstacle qu’il aborde. Aussi les chevaux ne connaissant pas le bull-finch, le refusent-ils presque toujours.
BULLETIN OFFICIEL. L’organisation des courses françaises par la Société d’encouragement nécessitait une publicité, pour tenir les parties intéressées au courant de la publication des programmes, des conditions, de l’heure et du jour des engagements, des déclarations de forfait, de la publication des poids dans les grands handicaps, enfin des résultats des différentes courses. Il importait surtout que cet organe fût revêtu du caractère officiel, afin de faire foi en cas d’erreurs, de doutes ou de réclamations. La Société d’encouragement pour l’amélioration des races de chevaux en France, ayant fondé les courses, établi leur jurisprudence, se trouvant de fait le centre réel et effectif de l’institution, pouvait seule avoir une autorité suffisante pour prendre la responsabilité d’un semblable document. Le Bulletin officiel fut donc fondé sous ses auspices, il y a trente et un ans. La rédaction en fut confiée à M. Grandhomme, secrétaire de la Société, chez qui se font les engagements, les déclarations de programmes, etc.
La Bulletin officiel paraît régulièrement tous les samedis, et exceptionnellement deux fois par semaine pendant le fort de la saison des courses et quand les besoins l’exigent. Il contient l’énoncé des courses à venir avec leurs dates et un renvoi aux numéros du Bulletin où se trouvent in extenso le programme des réunions dont il est question; un tableau des engagements à faire et forfaits à déclarer; l’heure et le jour où ces déclarations doivent être faites; les errata, les avis sur les modifications ou les faits saillants que les événements de force majeure peuvent introduire dans la rédaction des programmes publiés; les noms des chevaux engagés dans chaque course, les poids des handicaps, enfin les comptes rendus des courses.
Le Bulletin officiel, bien qu’émanant de la Société d’encouragement, est ouvert à la publication des programmes de toutes les courses existant en France. L’inscription au Bulletin donne le caractère officiel à une publication de cette nature. Lui seul fait foi en cas de contestations sur l’interprétation des conditions, sur une décharge ou surcharge, un poids publié, etc.
BUT. Le but est l’endroit de l’hippodrome fixé pour la fin d’une course. Il est marqué par un poteau, désigné sous le nom de poteau gagnant, parce que le cheval qui le dépasse le premier est déclaré gagnant de la course. En face du poteau est une sorte de petite loge où se tient le juge chargé de déclarer quel est le cheval qui a dépassé le premier le poteau.