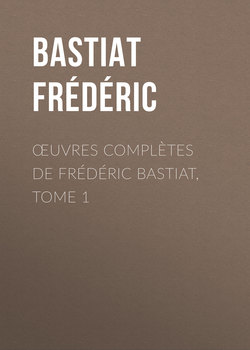Читать книгу Œuvres Complètes de Frédéric Bastiat, tome 1 - Bastiat Frédéric - Страница 2
NOTICE SUR LA VIE ET LES ÉCRITS DE FRÉDÉRIC BASTIAT
ОглавлениеFrédéric Bastiat est né à Bayonne, le 19 juin 1801, d'une famille honorable et justement considérée dans le pays. Son père était un homme remarquablement doué de tous les avantages du corps et de l'esprit, brave, loyal, généreux. On dit que Frédéric, son fils unique, avait avec lui la plus grande ressemblance. En 1810, F. Bastiat resta orphelin sous la tutelle de son grand-père; sa tante, mademoiselle Justine Bastiat (qui lui a survécu), lui servit de mère: – c'est cette parente dont les lettres de Bastiat parlent avec une si tendre sollicitude. Après avoir été un an au collége de Saint-Sever, Bastiat fut envoyé à Sorrèze, où il fit de très-bonnes études. C'est là qu'il se lia d'une amitié intime avec M. V. Calmètes, – aujourd'hui conseiller à la Cour de Cassation, – à qui sont adressées les premières lettres de la Correspondance.
Quelques particularités de cette liaison d'enfance révèlent déjà la bonté et la délicatesse infinies que Bastiat portait en toutes choses. Robuste, alerte, entreprenant et passionné pour les exercices du corps, il se privait presque toujours de ces plaisirs, pour tenir compagnie à son ami que la faiblesse de sa santé éloignait des jeux violents. Cette amitié remarquable était respectée par les maîtres eux-mêmes; elle avait des priviléges particuliers, et pour que tout fût plus complétement commun entre les deux élèves, on leur permettait de faire leurs devoirs en collaboration et sur la même copie signée des deux noms. C'est ainsi qu'ils obtinrent, en 1818, un prix de poésie. La récompense était une médaille d'or; elle ne pouvait se partager: «Garde-la, dit Bastiat qui était orphelin; puisque tu as encore ton père et ta mère, la médaille leur revient de droit.»
En quittant le collége de Sorrèze, Bastiat, que sa famille destinait au commerce, entra, en 1818, dans la maison de son oncle, à Bayonne. À cette époque, le plaisir tint naturellement plus de place dans sa vie que les affaires. Nous voyons pourtant, dans ses lettres, qu'il prenait sa carrière au sérieux, et qu'il gardait, au milieu des entraînements du monde, un penchant marqué pour la retraite; étudiant, quelquefois jusqu'à se rendre malade, tour à tour ou tout ensemble, les langues étrangères, la musique, la littérature française, anglaise et italienne, la question religieuse, l'économie politique enfin, que depuis l'âge de dix-neuf ans il a toujours travaillée.
Vers l'âge de vingt-deux à vingt-trois ans, après quelques hésitations sur le choix d'un état, il revint, pour obéir aux désirs de sa famille, se fixer à Mugron, sur les bords de l'Adour, dans une terre dont la mort de son grand-père (1825) le mit bientôt en possession. Il paraît qu'il y tenta des améliorations agricoles: le résultat en fut assez médiocre, et ne pouvait guère manquer de l'être dans les conditions de l'entreprise. D'abord, c'était vers 1827, et à ce moment la science agronomique n'existait pas en France. Ensuite, il s'agissait d'un domaine de 250 hectares environ, subdivisé en une douzaine de métairies; et tous les agriculteurs savent que le régime parcellaire et routinier du métayage oppose à tout progrès sérieux un enchevêtrement presque infranchissable de difficultés matérielles et surtout de résistances morales. Enfin, le caractère de Bastiat était incapable de se plier – on pourrait dire de s'abaisser – aux qualités étroites d'exactitude, d'attention minutieuse de patiente fermeté, de surveillance défiante, dure, âpre au gain, sans lesquelles un propriétaire ne peut diriger fructueusement une exploitation très-morcelée. Il avait bien entrepris, pour chaque culture et chaque espèce d'engrais, de tenir exactement compte des déboursés et des produits, et ses essais durent avoir quelque valeur théorique; mais, dans la pratique, il était trop indifférent à l'argent, trop accessible à toutes les sollicitations, pour défendre ses intérêts propres, et la condition de ses métayers ou de ses ouvriers dut seule bénéficier de ses améliorations.
L'agriculture ne fut donc guère, pour Bastiat, qu'un goût ou un semblant d'occupation. L'intérêt véritable, le charme sérieux de sa vie campagnarde, ce fut au fond l'étude, et la conversation qui est l'étude à deux, – «la conférence, comme dit Montaigne, qui apprend et exerce en un coup,» quand elle s'établit entre deux esprits distingués. Le bon génie de Bastiat lui fit rencontrer, à côté de lui, cette intelligence-sœur, qui devait, en quelque sorte, doubler la sienne. Ici vient se placer un nom qui fut si profondément mêlé à l'existence intime et à la pensée de Bastiat, qu'il l'en sépare à peine lui-même dans ses derniers écrits: c'est celui de M. Félix Coudroy. Si Calmètes est le camarade du cœur et des jeunes impressions, Coudroy est l'ami de l'intelligence et de la raison virile, comme plus tard R. Cobden sera l'ami politique, le frère d'armes de l'action extérieure et du rude apostolat.
Cette intimité a été trop féconde en grands résultats pour que nous ne nous arrêtions pas un moment à dire la manière dont elle s'engrena: – C'est M. F. Coudroy qui nous l'a racontée. Son éducation, ses opinions de famille, plus encore peut-être sa nature nerveuse, mélancolique et méditative, l'avaient tourné de bonne heure du côté de l'étude de la philosophie religieuse. Un moment séduit par les utopies de Rousseau et de Mably, il s'était rejeté ensuite, par dégoût de ces rêves, vers la Politique sacrée et la Législation primitive, sous ce dogme absolu de l'Autorité, si éloquemment prêché alors par les de Maistre et les Bonald, – où l'on ne comprend l'ordre que comme résultat de l'abdication complète de toutes les volontés particulières sous une volonté unique et toute-puissante, – où les tendances naturelles de l'humanité sont supposées mauvaises, et par conséquent condamnées à un suicide perpétuel, – où enfin la liberté et le sentiment de la dignité individuelle sont considérés comme des forces insurrectionnelles, des principes de déchéance et de désordre. Quand les deux jeunes gens se retrouvèrent, en sortant l'un de l'école de droit de Toulouse, l'autre des cercles de Bayonne, et qu'on se mit à parler d'opinions et de principes, Bastiat, qui avait déjà entrevu en germe, dans les idées d'Ad. Smith, de Tracy et de J. – B. Say, une solution tout autre du problème humain, Bastiat arrêtait à chaque pas son ami, lui montrant par les faits économiques comment les manifestations libres des intérêts individuels se limitent réciproquement par leur opposition même, et se ramènent mutuellement à une résultante commune d'ordre et d'intérêt général; – comment le mal, au lieu d'être une des tendances positives de la nature humaine, n'est au fond qu'un accident de la recherche même du bien, une erreur que corrigent l'intérêt général qui le surveille et l'expérience qui le poursuit dans les faits; – comment l'humanité a toujours marché d'étape en étape, en brisant à chaque pas quelqu'une des lisières de son enfance; – comment, enfin, la liberté n'est pas seulement le résultat et le but, mais le principe, le moyen, la condition nécessaire de ce grand et incontestable mouvement…
Il étonna d'abord un peu, puis finit par conquérir à ces idées nouvelles son ami, dont l'esprit était juste et le cœur sincèrement passionné pour le vrai. Toutefois, ce ne fut pas sans recevoir lui-même une certaine impression de ces grandes théories de Bonald et de Maistre: – car les négations puissantes ont le bon effet d'élever forcément à une hauteur égale le point de vue des systèmes qui les combattent. Il y eut sans doute des compromis, des concessions mutuelles; et c'est peut-être à une sorte de pénétration réciproque des deux principes ou des deux tendances qu'il faudrait attribuer le caractère profondément religieux qui se mêle, dans les écrits de Bastiat, à la fière doctrine du progrès par la liberté.
Nous n'avons pas la prétention de chercher quelle put être la mise de fonds que chacun des deux associés d'idées versa ainsi à la masse commune. Nous pensons que de part et d'autre l'apport fut considérable. Le seul ouvrage de M. Coudroy que nous connaissions, sa brochure sur le duel, nous a laissé une haute opinion de son talent, et l'on sait que Bastiat a eu un moment la pensée de lui léguer à finir le second volume de ses Harmonies. Il semblerait pourtant que dans l'association, l'un apportait plus particulièrement l'esprit d'entreprise et d'initiative, l'autre l'élément de suite et de continuité. Bastiat avait le travail capricieux, comme les natures artistes; il procédait par intuitions soudaines, et, après avoir franchi d'un élan toute une étape, il s'endormait dans les délices de la flânerie. L'ami Coudroy, comme le volant régulateur de la machine, absorbait de temps en temps cet excès de mouvement, pour le rendre en impulsion féconde à son paresseux et distrait sociétaire. Quand celui-ci recevait quelque ouvrage nouveau, il l'apportait à Coudroy, qui le dégustait, notait avec soin les passages remarquables, puis les lisait à son ami. Très-souvent, Bastiat se contentait de ces fragments; c'était seulement quand le livre l'intéressait sérieusement, qu'il l'emportait pour le lire de son côté: – ces jours-là, la musique était mise de côté, la romance avait tort, et le violoncelle restait muet.
C'est ainsi qu'ils passaient leur vie ensemble, logés à quatre pas l'un de l'autre, se voyant trois fois par jour, tantôt dans leurs chambres, tantôt à de longues promenades qu'on faisait un livre sous le bras. Ouvrages de philosophie, d'histoire, de politique ou de religion, poésie, voyages, mémoires, économie politique, utopies socialistes… tout passait ainsi au contrôle de cette double intelligence – ou plutôt de cette intelligence doublée, qui portait partout la même méthode et rattachait au moyen du même fil conducteur toutes ces notions éparses à une grande synthèse. C'est dans ces conversations que l'esprit de Bastiat faisait son travail; c'est là que ses idées se développaient, et quand quelqu'une le frappait plus particulièrement, il prenait quelques heures de ses matinées pour la rédiger sans effort; c'est ainsi, raconte M. Coudroy, qu'il a fait l'article sur les tarifs, les sophismes, etc. Ce commerce intime a duré, nous l'avons dit, plus de vingt ans, presque sans interruption, et chose remarquable, sans dissentiments. On comprend après cela comment de cette longue étude préparatoire, de cette méditation solitaire à deux, a pu s'élancer si sûr de lui-même cet esprit improvisateur, qui à travers les interruptions de la maladie et les pertes de temps énormes d'une vie continuellement publique et extérieure, a jeté au monde, dans l'espace de cinq ans, la masse d'idées si neuves, si variées et pourtant si homogènes que contiennent ces volumes.
Membre du Conseil général des Landes depuis 1832, Bastiat se laissait porter de temps en temps à la députation. Décidé, s'il eût été nommé, à ne jamais accepter une place du gouvernement et à donner immédiatement sa démission des fonctions modestes de juge de paix, il redoutait bien plus qu'il ne désirait un honneur qui eût profondément dérangé sa vie et probablement sa fortune. Mais il profitait, comme il le racontait en riant, de ces rares moments où on lit en province, pour répandre dans ses circulaires électorales, et «distribuer sous le manteau de la candidature» quelques vérités utiles. On voit que son ambition originale intervertissait la marche naturelle des choses; car il est certainement bien plus dans les usages ordinaires de faire de l'économie politique le marchepied d'une candidature, que de faire d'une candidature le prétexte d'un enseignement économique. Quelques écrits plus sérieux trahissaient de loin en loin la profondeur de cette intelligence si bien ordonnée: comme le Fisc et la Vigne, en 1841, le Mémoire sur la question vinicole, en 1843, qui se rattachent à des intérêts locaux importants, que Bastiat avait tenté un moment de grouper en une association puissante. C'est aussi à cette époque de ses travaux qu'il faut rapporter, quoiqu'il n'ait été fini qu'en 1844, le Mémoire sur la répartition de l'impôt foncier dans le département des Landes, un petit chef-d'œuvre que tous les statisticiens doivent étudier pour apprendre comment il faut manier les chiffres.
La force des choses allait jeter bientôt Bastiat sur un théâtre plus vaste. Depuis longtemps (dès 1825) il s'était préoccupé de la réforme douanière. En 1829 il avait commencé un ouvrage sur le régime restrictif dont nous avons deux chapitres manuscrits et que les événements de 1830 l'empêchèrent sans doute de faire imprimer1. En 1834 il publia sur les pétitions des ports des réflexions d'une vigueur de logique que les Sophismes n'ont pas surpassée. Mais la liberté du commerce ne lui était apparue encore que comme une vague espérance de l'avenir. Une circonstance insignifiante vint lui apprendre tout à coup que son rêve prenait un corps, que son utopie se réalisait dans un pays voisin.
Il y avait un cercle à Mugron, un cercle même où il se faisait beaucoup d'esprit: «deux langues, dit Bastiat, y suffisaient à peine.» Il s'y faisait aussi de la politique, et naturellement le fond en était une haine féroce contre l'Angleterre. Bastiat, porté vers les idées anglaises et cultivant la littérature anglaise, avait souvent des lances à rompre à ce propos. Un jour le plus anglophobe des habitués l'aborde en lui présentant d'un air furieux un des deux journaux que recevait le cercle: «Lisez, dit-il, et voyez comment vos amis nous traitent!..» C'était la traduction d'un discours de R. Peel à la Chambre des communes; elle se terminait ainsi: «Si nous adoptions ce parti, nous tomberions, comme la France, au dernier rang des nations.» L'insulte était écrasante, il n'y avait pas un mot à répondre. Cependant à la réflexion, il sembla étrange à Bastiat qu'un premier ministre d'Angleterre eût de la France une opinion semblable, et plus étrange encore qu'il l'exprimât en pleine Chambre. Il voulut en avoir le cœur net, et sur-le-champ il écrivit à Paris pour se faire abonner à un journal anglais, en demandant qu'on lui envoyât tous les numéros du dernier mois écoulé. Quelques jours après, the Globe and Traveller arrivait à Mugron; on pouvait lire le discours de R. Peel en anglais; les mots malencontreux comme la France n'y étaient pas, ils n'avaient jamais été prononcés.
Mais la lecture du Globe fit faire à Bastiat une découverte bien autrement importante. Ce n'était pas seulement en traduisant mal que la presse française égarait l'opinion, c'était surtout en ne traduisant pas. Une immense agitation se propageait sur toute l'Angleterre, et personne n'en parlait chez nous. La ligue pour la liberté du commerce faisait trembler sur sa base la vieille législation. Pendant deux ans, Bastiat put suivre avec admiration la marche et les progrès de ce beau mouvement; et l'idée de faire connaître et peut-être imiter en France cette magnifique réforme vint le mordre au cœur vaguement. C'est sous cette impression qu'il se décida à envoyer au Journal des Économistes son premier article: Sur l'influence des tarifs anglais et français. L'article parut en octobre 1844. L'impression en fut profonde dans le petit monde économiste; les compliments et les encouragements arrivèrent en foule de Paris à Mugron. La glace était rompue. Tout en faisant paraître des articles dans les journaux, et surtout cette charmante première série des Sophismes économiques, Bastiat commence à écrire l'histoire de la Ligue anglaise, et pour avoir quelques renseignements qui lui manquent, se met en rapport avec R. Cobden.
Au mois de mai 1845, il vient à Paris pour faire imprimer son livre de Cobden, – qui lui valut neuf mois plus tard le titre de membre correspondant de l'Institut. On l'accueille à bras ouverts, on veut qu'il dirige le Journal des Économistes, on lui trouvera une chaire d'économie politique, on se serre autour de cet homme étrange qui semble porter au milieu du groupe un peu hésitant des économistes le feu communicatif de ses hardies convictions. De Paris, Bastiat passe en Angleterre, serre la main à Cobden et aux chefs des Ligueurs, puis il va se réfugier à Mugron. Comme ces grands oiseaux qui essayent deux ou trois fois leurs ailes avant de se lancer dans l'espace, Bastiat revenait s'abattre encore une fois dans ce nid tranquille de ses pensées; et déjà trop bien averti des agitations et des luttes qui allaient envahir sa vie livrée désormais à tous les vents, donner un dernier baiser d'adieu à son bonheur passé, à son repos, à sa liberté perdue. Il n'était pas homme à se griser du bruit subit fait autour de son nom, il se débattait contre les entraînements de l'action extérieure, il eût voulu rester dans sa retraite, – ses lettres le prouvent à chaque page. Vaine résistance à la destinée! L'épée était sortie du fourreau pour n'y plus rentrer.
Au mois de février 1846, l'étincelle part de Bordeaux. Bastiat y organise l'association pour la liberté des échanges. De là il va à Paris, où s'agitaient, sans parvenir à se constituer, les éléments d'un noyau puissant par le nom, le rang et la fortune de ses principaux membres. Bastiat se trouve en face d'obstacles sans nombre. «Je perds tout mon temps, l'association marche à pas de tortue,» écrivait-il à M. Coudroy. À Cobden: «Je souffre de ma pauvreté; si, au lieu de courir de l'un à l'autre à pied, crotté jusqu'au dos, pour n'en rencontrer qu'un ou deux par jour et n'obtenir que des réponses évasives ou dilatoires, je pouvais les réunir à ma table, dans un riche salon, que de difficultés seraient levées! Ah! ce n'est ni la tête ni le cœur qui me manquent; mais je sens que cette superbe Babylone n'est pas ma place et qu'il faut que je me hâte de rentrer dans ma solitude…» Rien n'était plus original en effet que l'extérieur du nouvel agitateur. «Il n'avait pas eu encore le temps de prendre un tailleur et un chapelier parisiens, raconte M. de Molinari, – d'ailleurs il y songeait bien en vérité! Avec ses cheveux longs et son petit chapeau, son ample redingote et son parapluie de famille, on l'aurait pris volontiers pour un bon paysan en train de visiter les merveilles de la capitale. Mais la physionomie de ce campagnard était malicieuse et spirituelle, son grand œil noir était lumineux, et son front taillé carrément portait l'empreinte de la pensée.» Sancta simplicitas! Qu'on ne s'y trompe pas, du reste: il n'y a rien d'actif comme ces solitaires lancés au milieu du grand monde, rien d'intrépide comme ces natures repliées et délicates, une fois qu'elles ont mis le respect humain sous leurs pieds, rien d'irrésistible comme ces timidités devenues effrontées à force de conviction.
Mais quelle entreprise pour un homme qui tombe du fond des Landes sur le pavé inconnu de Paris! Il fallait voir les journalistes, parler aux ministres, réunir les commerçants, obtenir des autorisations de s'assembler, faire et défaire des manifestes, composer et décomposer des bureaux, encourager les noms marquants, contenir l'ardeur des recrues plus obscures, quêter des souscriptions… Tout cela à travers les discussions intérieures des voies et moyens, les divergences d'opinions, les froissements des amours-propres. Bastiat est à tout: sous cette impulsion communicative, le mouvement prend peu à peu un corps et l'opinion s'ébranle à Paris. La Commission centrale s'organise, il en est le secrétaire; on fonde un journal hebdomadaire, il le dirige; il parle dans les meetings, il se met en rapport avec les étudiants et les ouvriers, il correspond avec les associations naissantes des grandes villes de la province, il va faire des tournées et des discours à Lyon, à Marseille, au Havre, etc.; il ouvre, salle Taranne, un cours à la jeunesse des écoles; et il ne cesse pas d'écrire pour cela: «Il donnait à la fois, dit un de ses collaborateurs, M. de Molinari, des lettres, des articles de polémique et des variétés à trois journaux, sans compter des travaux plus sérieux pour le Journal des Économistes. Voyait-il le matin poindre un sophisme protectionniste dans un journal un peu accrédité, aussitôt il prenait la plume, démolissait le sophisme avant même d'avoir songé à déjeuner, et notre langue comptait un petit chef-d'œuvre de plus.» Il faut voir dans les lettres de Bastiat le complément de ce tableau: les tiraillements intérieurs, les découragements, les soucis de famille ou la maladie qui viennent tout interrompre, les menées électorales, la froideur ou l'hostilité soldée de la presse, les calomnies qui vont l'assaillir jusque dans ses foyers. On lui écrit de Mugron «qu'on n'ose plus parler de lui qu'en famille, tant l'esprit public y est monté contre leur entreprise…» Hélas! qu'étaient devenus les lectures avec l'ami Coudroy et les bons mots gascons du petit cercle!
Nous n'avons pas à apprécier ici le mérite ou les fautes des tentatives libre-échangistes de 1846-47. Personne ne peut dire ce que fût devenu ce mouvement, s'il n'eût été brusquement arrêté par la révolution de 1848. Depuis ce moment-là, l'idée a fait à petit bruit son chemin dans l'opinion qu'elle a de plus en plus pénétrée. Et quand est arrivé le Traité avec l'Angleterre, il a trouvé le terrain débarrassé des fausses théories, et les esprits tout prêts pour la pratique. Cette initiation, il faut le dire, manquait totalement alors: aussi, à l'exception de quelques villes de grand commerce, l'agitation ne s'est guère exercée que dans un milieu restreint d'écrivains et de journalistes. Les populations vinicoles, si nombreuses en France et si directement intéressées à la liberté des échanges, ne s'en sont même pas occupées. Bastiat, du reste, ne s'est jamais abusé sur le succès immédiat; il ne voyait ni les masses préparées, ni même les instigateurs du mouvement assez solidement ancrés sur les principes. Il comptait «sur l'agitation même pour éclairer ceux qui la faisaient.» Il déclarait à Cobden qu'il aimait mieux «l'esprit du libre-échange que le libre-échange lui-même.» Et c'est pour cela que tout en se plaignant un peu d'être «garrotté dans une spécialité,» il avait toujours soin, en réalité, d'élargir les discussions spéciales, de les rattacher aux grands principes, d'accoutumer ses collègues à faire de la doctrine, et d'en faire lui-même à tout propos – comme il est facile de le voir dans les deux séries des sophismes économiques et dans les articles où il commençait déjà à discuter les systèmes socialistes.
En cela Bastiat ne s'est pas trompé. Il a rendu un immense service à notre génération, qui s'amusait à écouter les utopies de toute espèce comme une innocente diversion aux romans-feuilletons. Il a accoutumé le public à entendre traiter sérieusement les questions sérieuses; il a réuni autour d'un drapeau, exercé par une lutte de tous les jours, excité par son exemple, dirigé par ses conseils et sa vive conversation une phalange jeune et vigoureuse d'économistes, qui s'est trouvée à son poste de combat et sous les armes, aussitôt que la révolution de Février a déchaîné l'arrière-ban du socialisme. Quand le mouvement du libre-échange n'aurait servi qu'à cela, il me semble que les hommes qui, à différents titres, l'ont provoqué et soutenu auraient encore suffisamment bien mérité de leur pays.
Après la révolution de Février, Bastiat se rallia franchement à la République, tout en comprenant que personne n'y était préparé. Comme dans l'agitation du libre-échange, il comptait sur la pratique même des institutions pour y mûrir et façonner les esprits. Le département des Landes l'envoya comme député à l'Assemblée constituante, puis à la Législative. Il y siégea à la gauche, dans une attitude pleine de modération et de fermeté qui, tout en restant un peu isolée, fut entourée du respect de tous les partis. Membre du comité des finances, dont il fut nommé huit fois de suite vice-président, il y eut une influence très-marquée, mais tout intérieure et à huis clos. La faiblesse croissante de ses poumons lui interdisait à peu près la tribune; ce fut souvent pour lui une dure épreuve d'être ainsi cloué sur son banc. Mais ces discours rentrés sont devenus les Pamphlets, et nous avons gagné à ce mutisme forcé, des chefs-d'œuvre de logique et de style. Il lui manquait beaucoup des qualités matérielles de l'orateur; et pourtant sa puissance de persuasion était remarquable. Dans une des rares occasions où il prit la parole, – à propos des incompatibilités parlementaires, – au commencement de son discours il n'avait pas dix personnes de son opinion, en descendant de la tribune il avait entraîné la majorité; l'amendement était voté, sans M. Billault et la commission qui demandèrent à le reprendre, et en suspendant le vote pendant deux jours, donnèrent le temps de travailler les votes. Bastiat a défini lui-même sa ligne de conduite dans une lettre à ses électeurs: «J'ai voté, dit-il, avec la droite contre la gauche, quand il s'est agi de résister au débordement des fausses idées populaires. – J'ai voté avec la gauche contre la droite, quand les griefs légitimes de la classe pauvre et souffrante ont été méconnus.»
Mais la grande œuvre de Bastiat, à cette époque, ce fut la guerre ouverte, incessante, qu'il déclara à tous ces systèmes faux, à toute cette effervescence désordonnée d'idées, de plans, de formules creuses, de prédications bruyantes, dont le tohu-bohu nous rappela pendant quelques mois ce pays Rabelaisien où les paroles dégèlent toutes à la fois. Le socialisme, longtemps caressé par une grande partie de la littérature, se dessinait avec une effrayante audace; il y avait table rase absolue; les bases sociales étaient remises en question comme les bases politiques. Devant la phraséologie énergique et brillante de ces hommes habitués sinon à résoudre, du moins à remuer profondément les grands problèmes, les avocats-orateurs, les légistes du droit écrit, les hommes d'État des bureaux, les fortes têtes du comptoir et de la fabrique, les grands administrateurs de la routine se trouvaient impuissants, déroutés par une tactique nouvelle, interdits comme les Mexicains en face de l'artillerie de Fernand Cortès. D'autre part, les catholiques criaient à la fin du monde, enveloppant dans un même anathème l'agression et la défense, le socialisme et l'économie politique, «le vipereau et la vipère2.» Mais Bastiat était prêt depuis longtemps. Comme un savant ingénieur, il avait d'avance étudié les plans des ennemis, et contre-miné les approches en creusant plus profondément qu'eux le terrain des lois sociales. À chaque erreur, de quelque côté qu'elle vienne, il oppose un de ses petits livres: – à la doctrine Louis Blanc, Propriété et loi; à la doctrine Considérant, Propriété et spoliation; à la doctrine Leroux, Justice et fraternité; à la doctrine Proudhon, Capital et rente; au comité Mimerel, Protectionnisme et communisme; au papier-monnaie, Maudit argent; au manifeste montagnard, l'État, etc. Partout on le trouve sur la brèche, partout il éclaire et foudroie. Quel malheur et quelle honte qu'une association intelligente des défenseurs de l'ordre n'ait pas alors répandu par milliers ces petits livres à la fois si profonds et si intelligibles pour tous!
Dans cette lutte – où il faut dire, pour être juste, que notre écrivain se trouva entouré et soutenu dignement par ses collègues du libre-échange, – Bastiat apporta dans la polémique une sérénité et un calme bien remarquables à cette époque de colère et d'injures. Il s'irritait bien un peu contre l'outrecuidance de ces despotiques organisateurs, de ces «pétrisseurs de l'argile humaine;» il s'attristait profondément de cet entraînement vers les réformes sociales qui compromettait les réformes politiques encore si mal assises; mais d'un autre côté il ne méconnaissait pas le côté élevé de ces aspirations égarées: Toutes les grandes écoles socialistes, disait-il, ont à leur base une puissante vérité… Le tort de leurs adeptes, c'est de ne pas savoir assez, et de ne pas voir que le développement naturel de la société tend bien mieux que toutes leurs organisations artificielles à la réalisation de chacune de leurs formules… – Magnifique programme qui indique aux économistes le vrai terrain de la pacification des esprits. Sa correspondance avec R. Cobden nous a révélé l'action pleine de grandeur que Bastiat cherchait à exercer en même temps sur la politique extérieure. Mais une autre préoccupation l'obsédait, toujours plus vive à mesure que sa santé s'affaiblissait. Il avait dans la tête, depuis longtemps, «un exposé nouveau de la science» et il craignait de mourir sans l'avoir formulé. Il se recueillit enfin pendant trois mois pour écrire le premier volume des Harmonies. Puisque cette œuvre, tout incomplète qu'elle soit, est le dernier mot de Bastiat, qu'on nous permette de chercher à définir l'esprit et la tendance de sa doctrine.
L'économie politique, en France, a eu, dès son origine, le caractère d'une sorte de morale supérieure. Les physiocrates lui donnaient pour objet le bonheur des hommes; ils la nommaient la science du droit naturel. Le génie anglais, essentiellement positif et pratique, commença tout de suite par restreindre ce vol ambitieux: en substituant la considération de la richesse à celle du bien-être, et l'analyse des faits à la recherche des droits. Ad. Smith renferma la science économique dans des limites plus précises sans doute, mais incontestablement plus étroites. Seulement, Ad. Smith, en homme de génie qu'il était, ne s'est pas cru obligé de respecter servilement les bornes qu'il avait posées lui-même; et à chaque pas sa pensée s'élève du fait à l'idée de l'utile général ou du juste, aux considérations morales et politiques. Mais sous ses successeurs, esprits plus ordinaires, on voit la science se restreindre et se matérialiser de plus en plus. Dans Ricardo surtout et ses disciples immédiats, l'idée de justice n'apparaît pour ainsi dire plus. – C'est de cette phase de l'école qu'on a pu dire qu'elle subordonnait le producteur à la production, et l'homme à la chose. Aussi faut-il voir avec quelle vivacité le vieux Dupont de Nemours protestait contre cet abaissement de l'économie politique: «Pourquoi, disait-il à J. – B. Say, restreignez-vous la science à celle des richesses? Sortez du comptoir… ne vous emprisonnez pas dans les idées et la langue des Anglais, peuple sordide qui croit qu'un homme ne vaut que par l'argent… qui parlent de leur contrée (country) et n'ont pas dit encore qu'ils eussent une patrie…» Dupont de Nemours était un peu sévère pour J. – B. Say, dont l'enseignement économique a été beaucoup plus large et plus élevé que les systèmes qui avaient de son temps la vogue en Angleterre. Mais tout en abordant, quand le sujet l'y conduit, les aperçus philosophiques et moraux, Say n'en persiste pas moins à les considérer, en principe, comme étrangers à l'économie politique. L'économie politique est, selon lui, une science de faits et uniquement de faits: elle dit ce qui est, elle n'a pas à chercher ce qui devrait être.
Un savant a parfaitement le droit de se renfermer dans les limites qui conviennent le mieux à ses forces; mais il ne faut pas qu'il rende la science elle-même solidaire de sa modestie, et qu'il l'entraîne à une abdication. La science doit être ambitieuse; si elle craint d'empiéter sur ses voisins, elle risque de laisser inoccupée une partie de ses domaines. Il ne nous est nullement démontré qu'il soit possible ou utile de séparer les études sociales en deux branches distinctes, – l'une qui serait la simple analyse des résultats de la pratique établie, – l'autre qui en discuterait les causes théoriques, le but final, la légitimité; mais quand même on admettrait ainsi une science du fait et une science du droit, il n'en est pas moins vrai que, puisqu'à côté de l'enseignement économique aucune science classée, aucun groupe d'hommes spéciaux ne s'occupait de rechercher la raison et le droit des faits sociaux, c'était à l'économie politique à prendre – ne fût-ce que provisoirement – cette position importante. Du moment qu'elle la laissait vide, il était évident qu'une rivale viendrait s'y établir, et qu'une protestation dangereuse battrait le fait avec l'idée du droit. Conformément au génie comme aux traditions nationales, cette protestation devait éclater surtout en France. Ce fut le socialisme. La fin de non-recevoir qu'il opposait à l'économie politique était spécieuse. «Le mal, disait-il, est dans les faits humains à côté du bien; votre science se borne à catégoriser ces faits, sans les soumettre au contrôle préalable du droit; par conséquent vos formules contiennent le mal comme le bien; elles ne sont, à nos yeux, que le mal mis en théories, érigé en axiomes absolus et immuables.» Si le socialisme eût ajouté: «Nous allons vérifier vos formules (p. xxviii) à la lumière du juste,» il n'y aurait pas eu un mot à lui répondre, et l'économie politique lui eût tendu la main. Mais, passionné et exclusif comme toutes les réactions, le socialisme nia au lieu de contrôler. On s'était contenté d'étudier, au point de vue de l'utile, les résultats de la propriété, de l'intérêt, de l'hérédité, de la concurrence, etc., en les prenant comme faits acceptés et sans discuter leur raison d'être et leur justice; – le socialisme nia au point de vue du juste et attaqua comme illégitimes la propriété, l'intérêt, l'héritage, la concurrence, etc. On s'était un peu trop borné à décrire ce qui est; – il se borna à décrire ce qui, dans ses rêves d'organisation nouvelle, devait être. On avait, disait-on, écrasé l'homme sous les choses et les faits; – par une sorte de vengeance, il écrasa sous ses pieds les faits et les choses pour remettre l'homme à son rang.
Dans cette situation, qu'y avait-il à faire, pour opérer la réconciliation des esprits? Évidemment, il fallait réunir et fondre ensemble les deux aspects distincts du fait et du droit; revenir à la formule des physiocrates, à la science des faits au point de vue du droit naturel; soumettre la pratique au contrôle du juste; faire du socialisme savant et consciencieux; prouver que ce qui est, dans son ensemble actuel et surtout dans sa tendance progressive, est conforme à ce qui doit être selon les aspirations de la conscience universelle.
Voilà ce qu'a voulu faire Bastiat, et ce qu'il a fait, autant du moins qu'il l'a pu dans un livre inachevé. Il a passé en revue les phénomènes économiques et les formes fondamentales de nos sociétés modernes: en les examinant au triple point de vue de l'intérêt particulier, de l'intérêt général, et de la justice, il a montré que les trois aspects concordaient. Au-dessus des divergences d'intérêts qu'on aperçoit d'abord entre le producteur et le consommateur, le capitaliste et le salarié, celui qui possède et celui qui ne possède pas, etc., il a fait voir qu'il existe des lois prédominantes d'équilibre et d'unité qui associent ces intérêts et englobent ces oppositions secondaires dans une harmonie supérieure. En sorte que «le bien de chacun favorise le bien de tous, comme le bien de tous favorise le bien de chacun;» et que «le résultat naturel du mécanisme social est une élévation constante du niveau physique, intellectuel et moral pour toutes les classes, avec une tendance à l'égalisation,» – développement qui n'a d'autre condition que le champ laissé à la recherche et à l'action, c'est-à-dire la liberté.
Pour caractériser plus nettement la grande et belle position prise par Bastiat, nous avons supprimé des transitions et des nuances. Il est essentiel de les rétablir; sans quoi il semblerait que Bastiat a créé une science nouvelle, tandis qu'il n'a prétendu, comme il le dit, que présenter un exposé nouveau d'une science déjà formée. Il faut donc faire remarquer que ses devanciers avaient déjà bien préparé son terrain, soit par leurs savantes analyses des phénomènes qu'il n'a eu le plus souvent qu'à rappeler, soit en s'élevant eux-mêmes aux considérations de l'intérêt général, – notion beaucoup moins éloignée qu'on ne pense de celle du juste. Il faut dire que, sans être aussi hautement formulée, l'idée des grandes lois sociales a été de tout temps en germe dans la pensée des économistes, et que la fameuse devise du laisser passer n'est au fond qu'une affirmation de la gravitation naturelle des intérêts vers l'ordre et le progrès. Enfin il faut ajouter, pour rendre justice à deux hommes que Bastiat a reconnus comme ses maîtres, que Ch. Comte et M. Dunoyer avaient, avant lui, déjà ramené très-sensiblement la science vers le point de vue élevé des physiocrates: – le premier, en soumettant au contrôle du droit naturel les formes diverses de la législation et de la propriété; – le second, en introduisant hardiment les fonctions de l'ordre intellectuel et moral dans le champ des études économiques.
C'est là précisément l'excellence du point de vue de Bastiat, qu'il se rattache aux meilleures traditions, tout en ouvrant des perspectives nouvelles. «Les sciences, pour employer une de ses expressions, ont une croissance comme les plantes;» il n'y a pas d'idées neuves, il n'y a que des idées développées; et l'initiateur est celui qui formule en un principe net et absolu des traditions hésitantes et incomplètes, celui qui fait un système d'une tendance. Bastiat, d'ailleurs, ne s'est pas borné à affirmer son principe dans toute sa généralité, sans exceptions ni réserves, – chose neuve déjà et hardie. Pour proclamer l'harmonie parfaite des lois économiques, il a fallu qu'il la fît en quelque sorte lui-même, en supprimant des dissonances, en rectifiant des erreurs appuyées de noms célèbres. Il a fallu dissiper la confusion établie entre la valeur et l'utilité, – l'utilité qui est le but et le bien, – la valeur, qui représente l'obstacle et le mal; asseoir solidement ce beau principe de la gratuité absolue du concours de la nature; attaquer toute cette théorie qui entachait la propriété foncière d'une accusation de monopole aggravateur du prix; débarrasser la loi du Progrès de cette effrayante perspective du renchérissement de la subsistance et de l'épuisement du sol, etc., etc.; – toutes choses qui peuvent paraître simples maintenant, mais qui alors ont été critiquées pour leur hardiesse extraordinaire.
Du reste, à notre sens, ce qu'il y a de plus grand encore dans le livre de Bastiat, c'est l'idée de l'harmonie elle-même: idée qui répond éminemment au travail secret d'unité dans les sciences que poursuit notre époque, et qui a plutôt le caractère d'une intuition et d'un acte de foi que d'une déduction scientifique. C'est comme un cadre immense dans lequel chaque étude partielle des lois sociales peut et doit venir se classer infailliblement. Bastiat aurait manqué son livre, qu'il nous semble qu'avec sa donnée seule, ce livre se serait fait tôt ou tard. Il est permis de croire qu'en le commençant il n'en voyait pas toute la portée. Il avait sans doute rassemblé d'abord quelques aperçus principaux; puis les vérités se sont attirées l'une l'autre; chaque rapport nouveau ouvrait de nouvelles équations, chaque groupe harmonisé ou identifié se résolvait en une synthèse supérieure. De sorte que les points de vue allaient en s'agrandissant toujours, et que Bastiat, à la fin, a dû se sentir écrasé, comme il le dit lui-même, par la masse des harmonies qui s'offraient à lui. Une note posthume très-précieuse nous indique comment cette extension de son sujet l'avait conduit à l'idée de refondre complétement tout l'ouvrage. «J'avais d'abord pensé, dit-il, à commencer par l'exposition des Harmonies économiques, et par conséquent ne traiter que des sujets purement économiques: valeur, propriété, richesse, concurrence, salaire, population, monnaie, crédit, etc. Plus tard, si j'en avais eu le temps et la force, j'aurais appelé l'attention du lecteur sur un sujet plus vaste: les Harmonies sociales. C'est là que j'aurais parlé de la constitution humaine, du moteur social, de la responsabilité, de la solidarité, etc… L'œuvre ainsi conçue était commencée quand je me suis aperçu qu'il était mieux de fondre ensemble que de séparer ces deux ordres de considérations. Mais alors la logique voulait que l'étude de l'homme précédât les recherches économiques. Il n'était plus temps…»
Il n'était plus temps en effet! Bastiat ne s'était décidé à écrire les Harmonies que parce qu'il commençait à sentir que ses jours étaient comptés. On le devine à l'entassement tumultueux d'idées du dernier chapitre3 et aux plaintes qui lui échappent sur le temps qui lui manque. Tout en continuant à jeter au courant des discussions du jour quelques-unes de ses belles pages, – comme la polémique avec Proudhon dans la Voix du Peuple, la Loi, Ce qu'on voit et ce qu'on ne voit pas, l'article Abondance, pour le Dictionnaire de l'économie politique, il préparait avec une ardeur fébrile les ébauches du second volume des Harmonies. Il ne voulut pas s'attarder à réparer dans le repos ses forces épuisées; il mit tout son enjeu sur un dé, il crut qu'il pourrait peut-être gagner de vitesse sur les progrès du mal, et arriver par un élan suprême à ne tomber qu'au but… Dans ce steeple-chase désespéré contre la mort, il a perdu.
Quand un homme, à l'âge de quarante-cinq ans, brise d'un seul coup tous les liens de son passé, comme l'a fait Bastiat, et, sans l'ombre d'ambition, se jette d'une solitude méditative dans l'ardente atmosphère de l'action, vous pouvez être sûr que cet homme ne s'arrêtera plus que dans (p. xxxiii) la tombe. Il y a quelque chose de plus terrible cent fois, de plus implacable au repos que l'ambition même: c'est le fanatisme de l'idée, c'est le sentiment d'une mission. Chez l'ambitieux, l'égoïsme veille et ménage ses ressources; chez l'homme que domine l'idée, le moi est foudroyé, il n'avertit plus par sa résistance de l'épuisement des forces. Une volonté supérieure s'installe en souveraine dans sa volonté, une sorte de conscience étrangère dans sa conscience: c'est le devoir. Il se dresse sur la dernière marche de sa vie passée, comme l'ange au glaive de feu sur le seuil de l'Eden; il ferme la porte sur les rêves de bonheur et de paix. Désormais, proscrit, tu n'as plus de chez toi; tu ne rentreras plus dans l'indépendance intime de ta pensée, tu ne reviendras plus te délasser dans l'asile de ton cœur; tu ne t'appartiens pas, tu es la chose de ton idée; – vivant ou mourant, ta mission te traînera.
Or la mission que Bastiat s'était donnée, ou plutôt que les événements lui imposèrent, était au-dessus des forces humaines. Bastiat, par le malheur d'une organisation trop riche, était à la fois homme de théories avancées, génie créateur, – et homme d'action extérieure, esprit éminemment vulgarisateur et propagandiste. Il eût fallu opter entre les deux rôles. On peut être à la rigueur Ad. Smith et R. Cobden tour à tour; mais à la fois et en même temps, non. Ad. Smith n'a pas essayé de jeter aux masses les vérités nouvelles qu'il creusait lentement dans sa retraite, et R. Cobden n'a fait passer dans l'opinion publique et les faits que des axiomes anciens et acceptés de longue date par la science. Bastiat, lui, a jeté dans le tumulte des discussions publiques les lambeaux de sa doctrine propre, et c'est au milieu de l'action qu'il a eu l'air d'improviser un système. Défricher les terrains vierges de la science pure, porter en même temps la hache au milieu de la forêt des préjugés gouvernementaux, et labourer en pleine révolution l'opinion publique, le sol le plus ingrat, le plus tourmenté, le plus impropre à une moisson prochaine, c'était faire triplement le métier de pionnier; – et l'on sait que ce métier-là est mortel.
Tant qu'on ne s'agita qu'autour du libre-échange, comme il y avait là un symbole commun et un drapeau reconnu, Bastiat se trouva aidé et soutenu vigoureusement; et contre la résistance de l'ignorance, des préjugés et des intérêts égoïstes, la lutte, en dépit de quelques tiraillements, fut possible. Mais quand arriva le socialisme et la grande bataille où l'on n'avait plus le temps de s'entendre d'avance, quand Bastiat fut entraîné par l'urgence du péril à combattre à sa manière, et à jeter de plus en plus dans la mêlée ses idées à lui, – idées presque aussi neuves pour ses alliés que pour ses adversaires, – il se trouva dans la position d'un chef qui, au milieu du feu, changerait l'armement et la tactique de son parti: tout en admirant sa nouvelle manière de faire, on se contenta de le regarder; et plus il s'avançait ainsi, plus il se trouvait seul. Or la collectivité est indispensable aux succès d'opinion et à l'effet sur les masses: un homme qui combat isolé ne peut que mourir admirablement. Quand les Harmonies parurent et mirent plus au jour les vues nouvelles que les Sophismes et les Pamphlets avaient seulement fait pressentir, il se fit un silence froid dans l'école déroutée, et la plupart des économistes se prononcèrent contre les idées de Bastiat.
Cet abandon lui fut très-sensible, mais il ne s'en étonna ni ne s'en plaignit: il se sentait trop près de sa fin pour laisser un adieu de reproche à ses anciens compagnons de travaux, restés unis à lui par le cœur, sinon par les idées. D'autres chagrins se joignaient à la pensée de son œuvre incomprise et inachevée; la mort avait fauché dans sa famille pendant son absence, la politique amoncelait de sombres nuages, et de ce côté-là encore il voyait l'opinion égarée tourner contre lui. Il n'avait plus la force ni le désir de lutter. Son esprit commençait à entrer dans cette région plus haute de suprême bienveillance, dans ce jour crépusculaire triste et doux qui assouplit les contours heurtés et adoucit les oppositions de couleur. «Nous autres souffreteux, écrivit-il à un de ses amis, nous avons, comme les enfants, besoin d'indulgence: car plus le corps est faible, plus l'âme s'amollit, et il semble que la vie à son premier, comme à son dernier crépuscule, souffle au cœur le besoin de chercher partout des attaches. Ces attendrissements involontaires sont l'effet de tous les déclins: fin du jour, fin de l'année, demi-jour des basiliques, etc. Je l'éprouvais hier, sous les sombres allées des Tuileries… Ne vous alarmez cependant pas de ce diapason élégiaque. Je ne suis pas Millevoye, et les feuilles, qui s'ouvrent à peine, ne sont pas près de tomber. Bref, je ne me trouve pas plus mal, mais seulement plus faible, et je ne puis plus guère reculer devant la demande d'un congé. C'est en perspective une solitude encore plus solitaire. Autrefois je l'aimais; je savais la peupler de lectures, de travaux capricieux, de rêves politiques, avec intermèdes de violoncelle. Maintenant, tous ces vieux amis me délaissent, même la fidèle compagne de l'isolement, la méditation. Ce n'est pas que ma pensée sommeille. Elle n'a jamais été plus active; à chaque instant elle saisit de nouvelles harmonies, et il semble que le livre de l'humanité s'ouvre devant elle. Mais c'est un tourment de plus, puisque je ne puis transcrire aucune page de ce livre mystérieux sur un livre plus palpable…»
Dès le printemps de 1850, en effet, la maladie de poitrine contre laquelle il se débattait depuis longtemps avait fait des progrès graves. Les eaux des Pyrénées, qui l'avaient sauvé plusieurs fois, aggravèrent son mal. L'affection se porta au larynx et à la gorge: la voix s'éteignit, l'alimentation, la respiration même devinrent excessivement douloureuses. Au commencement de l'automne, les médecins l'envoyèrent en Italie. Au moment où il y arrivait, le bruit prématuré de sa mort s'était répandu, et il put lire dans les journaux les phrases banales de regret sur la perte du «grand économiste» et de «l'illustre écrivain.» Il languit quelque temps encore à Pise, puis à Rome. Ce fut de là qu'il envoya sa dernière lettre au Journal des Économistes4. M. Paillottet, qui avait quitté Paris pour aller recueillir les dernières instructions de son ami, nous a conservé un journal intéressant de la fin de sa vie5. Cette fin fut d'un calme et d'une sérénité antiques. Bastiat sembla y assister en spectateur indifférent, causant, en l'attendant, d'économie politique, de philosophie et de religion. Il voulut mourir en chrétien: «J'ai pris, disait-il simplement, la chose par le bon bout et en toute humilité. Je ne discute pas le dogme, je l'accepte. En regardant autour de moi, je vois que sur cette terre les nations les plus éclairées sont dans la foi chrétienne; je suis bien aise de me trouver en communion avec cette portion du genre humain.» Son intelligence (p. xxxvii) conserva jusqu'au bout toute sa lucidité. Un instant avant d'expirer, il fit approcher, comme pour leur dire quelque chose d'important, son cousin l'abbé de Monclar et M. Paillottet. «Son œil, dit ce dernier, brillait de cette expression particulière que j'avais souvent remarquée dans nos entretiens, et qui annonçait la solution d'un problème.» Il murmura à deux fois: La vérité… Mais le souffle lui manqua, et il ne put achever d'expliquer sa pensée. Goethe, en mourant, demandait la pleine lumière, Bastiat saluait la vérité. Chacun d'eux, à ce moment suprême, résumait-il l'aspiration de sa vie, – ou proclamait-il sa prise de possession du but? Était-ce le dernier mot de la question – ou le premier de la réponse? l'adieu au rêve qui s'en va – ou le salut à la réalité qui arrive?..
Bastiat mourut le 24 décembre 1850, âgé de quarante-neuf ans et six mois. On lui fit, à l'église de Saint-Louis des Français, de pompeuses funérailles. C'est en 1845 qu'il était venu à Paris; sa carrière active d'économiste n'a donc embrassé guère plus de cinq ans.
F. Bastiat était de taille moyenne; mince et maigre, il était doué d'une force physique que son extérieur ne semblait pas annoncer; dans sa jeunesse, il passait pour le meilleur coureur du pays basque. Sa figure était agréable, la bouche extrêmement fine, l'œil doux et plein de feu sous un sourcil épais, le front carré largement encadré d'une forêt de longs cheveux noirs. Sa conversation était celle d'un homme qui comprend tout et qui s'intéresse à tout, vive, variée, sans prétention, colorée de l'accent comme de l'esprit méridional. Jamais il ne causait d'économie politique le premier, jamais non plus il n'affectait d'éviter ce sujet, quel que fût le rang ou l'éducation de son (p. xxxviii) interlocuteur. Dans les discussions sérieuses, il était modeste, conciliant, plein d'aménité dans sa fermeté de convictions. Rien dans sa parole ne sentait le discours ou la leçon. En général, son opinion finissait par entraîner l'assentiment général; mais il n'avait pas l'air de s'apercevoir de son influence. Ses manières et ses habitudes étaient d'une extrême simplicité. Comme les hommes qui vivent dans leur pensée, il avait quelque chose souvent de naïf et de distrait: L. Leclerc l'appelait le La Fontaine de l'économie politique. Il convenait en riant qu'il n'avait jamais été de la rue de Choiseul au Palais-Royal sans se tromper de chemin. Un jour qu'il était parti pour aller faire un discours à Lyon, il se trouvait débarqué dans un cabaret au fond des Vosges. Pour tout ce qui s'appelle affaires, il était d'un laisser-aller d'enfant. Sa bourse était ouverte à tout venant, quand il était en fonds; il n'y a pas d'auteur qui ait moins tiré parti de ses livres. Le détail matériel des choses lui était antipathique; jamais il n'a su prendre une précaution pour sa santé; jamais il n'a voulu s'occuper d'une annonce ou d'un compte-rendu pour ses ouvrages. Il était si ennemi du charlatanisme en tout, il craignait tellement d'engager son indépendance dans l'engrenage des coteries, qu'après cinq ans de séjour à Paris, il ne connaissait pas un des écrivains de la presse quotidienne. Aussi les comptes-rendus de journaux sur les livres de Bastiat sont-ils extrêmement rares. Le Journal des économistes, lui-même, attendit six mois avant de parler des Harmonies, et son article ne fut qu'une réfutation.
Nous avons déjà dit, je crois, que Bastiat écrivait avec une extrême facilité. On le devine à la netteté remarquable de ses manuscrits, où la plume semble, la plupart du temps, avoir couru de toute sa vitesse. Peut-être le travail préalable qui se faisait dans sa tête était-il long et pénible; mais je crois plutôt que c'était une de ces intelligences saines qui tournent naturellement du côté de la lumière, comme certaines fleurs vers le soleil, et que la vérité lui était facile, comme aux natures honnêtes la vertu. Il est certain cependant que Bastiat se préoccupait de la forme… à sa manière. Nous avons vu, dans ses cahiers, un de ses Sophismes, entre autres, refondu entièrement trois fois, – trois morceaux aussi finis l'un que l'autre, mais très-différents de ton. La première manière, la plus belle à mon avis, c'était la déduction scientifique, ferme, précise, magistrale; – la seconde offrait déjà quelque chose de plus effacé dans la tournure et de plus bourgeois, une causerie terre à terre, débarrassée des mots techniques et à la portée du commun des lecteurs; – la troisième, enfin, encadrait tout cela dans une forme un peu légère, un dialogue ou une petite scène demi-plaisante. La première, c'était Bastiat écrivant pour lui, se parlant ses idées; – la dernière, c'était Bastiat écrivant pour le public ignorant ou distrait, émiettant le pain des forts pour le faire avaler aux faibles. Un écrivain ordinaire ne se donne pas tant de peine pour s'amoindrir et ne s'efface pas ainsi volontairement pour faire passer son idée: il faut pour cela cette souveraine préoccupation du but qui caractérise l'apôtre.
Il ne nous appartient pas de préjuger le rang que la postérité assignera à Bastiat. M. M. Chevalier a placé hautement les Harmonies à côté du livre immortel d'Ad. Smith. Tout récemment, R. Cobden a exprimé la même opinion. Pour nous, en cherchant à mettre cette simple et noble figure sur un piédestal, nous craindrions de faire quelque maladresse. Et puis, nous l'avouons, il nous semble qu'un éloge trop cru blesserait encore cet homme que nous avons connu si désintéressé de lui-même, qui ne s'est jamais mis en avant que pour être utile et n'a brillé que pour éclairer. Tout ce que nous pouvons dire, c'est que les idées neuves et d'abord contestées de son système ont fait leur chemin depuis sa mort, et que, sans parler de l'école américaine, des économistes marquants, en Angleterre, en Écosse, en Italie, en Espagne et ailleurs, professent hautement et enseignent ses opinions. Et s'il est certain que le caractère matériel, en quelque sorte, de la vérité, dans une doctrine comme dans une religion, est la puissance du prosélytisme qu'elle possède, on peut dire que la doctrine de Bastiat est vraie: car les nombreux convertis qui passent aujourd'hui à l'économie politique, y vont à peu près tous par Bastiat et sous son patronage. Son œuvre de propagande se poursuit et se poursuivra longtemps encore après lui: – c'est la seule espèce d'immortalité qu'il ait ambitionnée.
Bastiat était tout simplement une belle intelligence éclairée par un admirable cœur, un de ces grands pacifiques auxquels, selon la parole sacrée, le monde finit toujours par appartenir. Nous préférons hautement ces hommes-là aux génies solitaires et aux penseurs sibyllins. Ce ne sont, en effet, ni les idées ni les systèmes qui nous manquent aujourd'hui, mais le trait d'union et le lien d'harmonie. La masse incohérente des matériaux épars de l'avenir ressemble à ces gangues où le métal précieux abonde, mais disséminé dans la boue. Ce qu'il faut à notre siècle, c'est l'aimant qui rassemblera le fer autour de lui, c'est la goutte de mercure, qui, promenée à travers le mélange, s'assimilera les parcelles d'or et d'argent. Or, ce rôle assimilateur nous paraît éminemment réservé aux natures sympathiques qui ont soif du bien et du vrai et vont le cherchant partout, aux hommes de foi plutôt encore que de science.
Voilà pourquoi nous souhaitons à notre pays des hommes comme Bastiat, et des vérités comme la doctrine de l'Harmonie, de ces vérités simples et fécondes qu'on ne découvre et qu'on ne perçoit qu'avec l'esprit de son cœur, comme a dit de Maistre —mente cordis sui.
R. DE FONTENAY.
Voici quelques extraits du journal de M. Paillottet, qui sont le complément naturel de cette notice:
NEUF JOURS PRÈS D'UN MOURANT
Le 16 décembre, vers midi, j'arrive chez lui, je le vois. Nous nous embrassons, mais à son premier mouvement tout affectueux succède une impression chagrine. Sa figure s'attriste, et il murmure, en élevant les mains: «Est-il possible que vous ayez fait un si long voyage? Quelle folie!»
Pendant cette première entrevue je le trouvai, à ma grande surprise, impatient, irritable… Comme je voulais lui éviter la peine de monter un étage, à l'aide d'une précaution que j'aurais prise, il me dit: «Je ne puis pas souffrir qu'on s'occupe de moi.» Il lui répugne d'être vu pendant qu'il boit et mange, à cause des efforts pénibles qu'exige de lui l'inglutition. Toutefois cette répugnance ne paraît pas exister vis-à-vis des étrangers. Ainsi à 2 heures ½ il entre au café prendre un verre de sirop et ne veut pas que je l'accompagne.
17 DÉCEMBRE 1850
… En rentrant chez lui, il me parle de la seconde édition du premier volume des Harmonies, puis du second volume qu'il lui est impossible d'achever. Sur le chapitre des salaires, qui était déjà fort avancé quand il a quitté Paris, il me dit: «Si jamais on publie cela, il faudra bien expliquer que ce n'est qu'un premier jet. J'aurais voulu refaire en entier ce chapitre.»
Il trouve un éclair de gaieté en me racontant les singulières conventions qu'il avait faites avec son hôtesse. Celle-ci avait par rapport à lui la double qualité de propriétaire et de domestique. Le mobilier et la batterie de cuisine étaient à elle. Lorsqu'elle brisait un ustensile quelconque dans ses fonctions de domestique, comme propriétaire elle en réclamait aussitôt le prix et se faisait payer par lui. Elle avait aussi l'art de maintenir le chiffre de la dépense quotidienne au même taux, bien que les consommations du malade allassent toujours diminuant…
… Ce second jour les impatiences furent moins marquées… «À quelle heure viendrez-vous demain?» me demanda-t-il lorsque je le quittai.
Je suis convenu avec l'abbé de Monclar que je tiendrai compagnie à notre malade depuis onze heures du matin jusqu'à l'heure du dîner; l'abbé lui consacre le commencement et la fin de la journée.
18 DÉCEMBRE
En arrivant près de lui, je lui remets quelques exemplaires de la réimpression des Incompatibilités parlementaires, et lui explique que je viens de les retirer du ministère de l'Intérieur des États Romains.
Voici ce qui m'était arrivé pour ces brochures. Les douaniers de Civita-Vecchia les avaient extraites de mon sac de voyage et envoyées à la police. Je les croyais perdues, quand, passant ce matin devant le magasin du libraire Merle… je vois exposés en vente plusieurs pamphlets de Bastiat. J'entre et demande à Merle s'il a les Incompatibilités parlementaires: «Pas encore, répond-il, mais je ne tarderai sans doute pas; car cet écrit vient d'être réimprimé! Je le sais, à telles enseignes que les douaniers de Civita-Vecchia ont été assez stupides, ces jours-ci, pour en saisir une demi-douzaine d'exemplaires à un voyageur français.» – «Comment donc êtes-vous si bien informé? repris-je; je suis le voyageur dont vous faites mention.» Alors Merle m'apprend qu'il tenait la nouvelle de ma mésaventure du comte Z… attaché au ministère de l'Intérieur. Le comte Z… avait blâmé le procédé des douaniers, et ajouté que, si le propriétaire se présentait pour réclamer ces brochures, elles lui seraient immédiatement rendues. Sur ces explications, je m'étais empressé d'aller à Monte-Cavallo, où un employé fort poli, après m'avoir adressé beaucoup d'excuses sur ce qui s'était passé, m'avait remis toutes mes brochures, moins une. Cette dernière ne pouvait m'être rendue qu'un peu plus tard, parce que Monseigneur, qui était alors absent, en avait commencé la lecture, curieux de connaître cette production d'un auteur qu'il avait en grande estime. Le même employé, me montrant sur la couverture d'un pamphlet la liste imprimée des divers écrits de Bastiat, posa l'index sur les mots Harmonies économiques, et dit: «Voilà un bien bel ouvrage.»
J'informai de cette particularité mon cher malade, en ajoutant que très-certainement en France, au ministère de l'Intérieur, ses œuvres étaient moins connues que dans les bureaux de Monte-Cavallo.
Par un fort beau temps, nous prenons une voiture… Il veut me servir de cicerone, et m'expliquer les monuments antiques; mais j'obtiens qu'il se taise jusqu'à ce que nous descendions de voiture… Il m'entretient beaucoup de son projet de rentrer en France, d'un domestique, nommé Dargeau, qu'il fait venir de son pays, pour s'assurer ses soins éprouvés, et m'interroge sur la durée probable de mon séjour à Rome. Je me garde bien de lui dire que je m'en irai probablement le lendemain de son départ.
… Quand nous sommes rentrés chez lui, il me parle de mettre en ordre ses ébauches. Il voudrait bien me dicter quelques indications importantes et notamment sur le sujet de la population… L'article qu'il a publié, il y a quatre ans environ, dans le Journal des Économistes, lui paraît incomplet et à refaire. La principale objection contre la théorie de Malthus n'y est pas exposée.
Les impatiences ont disparu.
19 DÉCEMBRE
Je le trouve bien fatigué!.. Nous sortons un peu tard, et rentrons bientôt après…
Il monte son escalier plus péniblement que de coutume. Quand enfin il est assis sur son canapé, je remarque que sa respiration est plus difficile que la veille. Des bruits sourds et de mauvais augure grondent dans sa poitrine oppressée. Il se remet cependant un peu, et entame le chapitre de l'Économie politique.
«Un travail bien important à faire pour l'Économie politique, me dit-il, c'est d'écrire l'histoire de la spoliation. C'est une longue histoire, dans laquelle, dès l'origine, apparaissent les conquêtes, les migrations de peuples, les invasions, et tous les funestes excès de la force aux prises avec la justice.»
«De tout cela il reste aujourd'hui encore des traces vivantes, et c'est une grande difficulté pour la solution des questions posées dans notre siècle. On n'arrivera pas à cette solution tant qu'on n'aura pas bien constaté en quoi et comment l'injustice, faisant sa part au milieu de nous, s'est impatronisée dans nos mœurs et dans nos lois.»
… Il m'entretient de plusieurs de nos amis de Paris, sujet sur lequel il s'arrête volontiers; puis, se préoccupant de mon dîner, il me renvoie après m'avoir dit: «Puisque vous avez fait ce long voyage, je suis bien aise maintenant que vous soyez ici.»
20 DÉCEMBRE
En arrivant près de lui à l'heure accoutumée, je lui demande la permission de le quitter pour aller à l'ambassade où je me suis déjà rendu en vain ce matin. J'ai trois lettres pour la France à remettre à une personne que je n'ai pas rencontrée. Cette demande le contrarie, et l'abbé de Monclar, qui était sur le point de sortir, se charge de faire tenir mes lettres à l'ambassade.
Dès que nous sommes seuls, il me dit: «Vous ne devineriez jamais ce que j'ai fait ce matin.» Inquiet et le soupçonnant d'une imprudence, je conjecturai qu'il avait écrit. «Non, reprit-il, cela m'eût été, cela m'est impossible. Voici ce que j'ai fait, je me suis confessé. Je veux vivre et mourir dans la religion de mes pères. Je l'ai toujours aimée, quoique je n'en suivisse pas les pratiques extérieures.» Ce mot de vivre n'était employé là que par ménagement pour moi. Je lui rappelai qu'en 1848 il m'avait dit, en parlant de Jésus-Christ: «Il est impossible d'admettre qu'un mortel ait pu avoir, de l'humanité et des lois qui la régissent, une connaissance aussi profonde que celle qui est dans l'Évangile.»
Il me propose de prendre ses ébauches économiques dans sa malle; car le temps menaçait, et il n'eût pas été prudent de sortir. Je savais, d'ailleurs, dès la veille au soir, qu'aux yeux du docteur Lacauchie il déclinait d'une manière rapide.
Je pris les papiers, et commençai à les compulser, assis près de lui, interrompant ma tâche au moindre signe pour prêter l'oreille à ce qu'il voulait me dire.
… Voici une recommandation… sur laquelle il a beaucoup insisté. «Il faut traiter l'économie politique au point de vue du consommateur. Tous les phénomènes économiques, que leurs effets soient bons ou qu'ils soient mauvais, se résolvent, à la fin de leur évolution, par des avantages ou des préjudices pour les consommateurs. Ces mêmes effets ne font que glisser sur les producteurs, dont ils ne peuvent affecter les intérêts d'une manière durable.»
«Le progrès de la civilisation doit amener les hommes à se placer à ce point de vue et à calculer leur intérêt de consommateurs plutôt que leur intérêt de producteurs. On voit déjà ce progrès s'opérer en Angleterre, et des ouvriers s'y occuper moins de l'élévation de leur salaire que de l'avantage d'obtenir à bas prix tous les objets qu'ils consomment.»
Il m'a répété que c'était là un point capital, et j'étais étonné de la profondeur comme de la lucidité de ses explications.
Vers la nuit, il m'a parlé de Rome considérée au point de vue religieux. «Ce qui m'a le plus frappé, dit-il, c'est la solidité de la tradition des martyrs. Ils sont là, on les voit, on les touche dans les catacombes; il est impossible de les nier.» Son langage était plein d'onction.
Demain je continuerai le dépouillement de ses papiers scientifiques. Cette journée a été bien triste. La mort se montre à nous dans tous nos entretiens. Nous ne prononçons pas son nom, lui par un sentiment délicat, afin de m'éviter une affliction, et moi pour ne pas me laisser aller à un attendrissement qui le gagnerait peut-être et lui serait douloureux. C'est lui qui me donne l'exemple du courage…
21 DÉCEMBRE (SAMEDI)
L'affaiblissement continue. À 11 h. ½, par un temps superbe, il sent le besoin de se coucher quelques instants avant d'essayer une promenade. Nous sortons à 1 h. 1/4, mais quelques nuages menacent d'intercepter les rayons du soleil… Les nuages se dispersent, et nous jouissons d'un soleil magnifique, qui fait mieux ressortir la beauté des sites dont nous sommes entourés. La sérénité du ciel semble se communiquer à son âme, et il répète fréquemment: «Quelle délicieuse promenade! Comme nous avons bien réussi!» Il m'indique une haute colline couronnée d'ifs, au sommet de laquelle il s'est fait conduire quelques jours avant mon arrivée. Quand je cherche à me rendre compte de ses impressions, il me paraît heureux de voir une dernière fois les splendeurs de la nature et s'applaudir de les rencontrer pour leur faire ses adieux. Car il ne se fait pas d'illusion sur son état. Plus explicite avec l'abbé de Monclar qu'avec moi sur ce triste sujet, il lui disait hier: «Je trouve depuis trois jours que le déclin de mes forces est bien rapide. Si cela continuait ainsi, Dieu me ferait une grande grâce et m'épargnerait bien des souffrances.»
… Il prend un livre de prières, et moi je continue le classement de ses papiers…
Il me fait quitter mon classement pour m'asseoir tout près de lui. Après un instant d'assoupissement, comme s'il venait d'y puiser une force nouvelle, il me donne une explication pour corroborer sa théorie de la valeur.
«Avez-vous trouvé dans mes notes, me demanda-t-il, un passage sur ce sujet? C'est un fragment auquel j'attache quelque importance. Vous le reconnaîtrez à cette formule que j'y ai employée: Do ut des, facio ut facias, etc.»
Je n'ai pas encore découvert ce fragment…
Avant de nous quitter, qui s'y serait attendu? nous nous sommes livrés à un mouvement d'hilarité. Il m'a raconté qu'ayant vu dans un magasin de librairie son Cobden et la Ligue, il avait marchandé cet ouvrage. Comme on lui en demandait le prix de 7 fr. 50, il s'était récrié, avait qualifié ce livre de vieux bouquin, et en avait offert seulement 4 fr. C'est, je crois, la seule fois de sa vie qu'il ait réclamé un rabais, et le moyen qu'il employait pour l'obtenir est fort plaisant. Décrier un de ses écrits pour l'obtenir à meilleur marché, c'est ce que peu d'auteurs se seraient avisés de faire.
22 DÉCEMBRE 1850 (DIMANCHE)
Ce matin il a communié. La cérémonie a eu lieu de bonne heure, et cependant, en entrant chez lui, je vois qu'il n'a pas encore déjeuné. Pour qu'il s'acquittât de cette pénible tâche sans être gêné de ma présence, j'allai me promener jusqu'à 11 h. ½.
… Avez-vous un crayon? me demanda-t-il. Je lui remis aussitôt celui que contient mon portefeuille, et le vis tracer les lignes suivantes sur son livre de prières:
«Les 20 et 21 décembre je me suis confessé à M. l'abbé Ducreux. Le 22, j'ai reçu la communion des mains de mon cousin Eugène de Monclar.»
Il me parla aussitôt après du sacrement qu'il avait reçu le matin, et à ce propos il m'expliqua ses idées religieuses.
«Le déiste, dit-il, n'a de Dieu qu'une idée trop vague. Son Dieu, il l'oublie souvent, ou bien il l'appelle une cause première et ne se croit plus obligé d'y penser. Il faut que l'homme s'appuie sur une révélation pour être véritablement en communication avec Dieu. Quant à moi, j'ai pris la chose par le bon bout et en toute humilité. Je ne discute pas le dogme, je l'accepte. En regardant autour de moi, je vois que sur cette terre les nations les plus éclairées sont dans la foi chrétienne. Je suis bien aise de me trouver en communion avec cette portion du genre humain.»
Un peu plus tard, il s'enquit de nouveau du fragment sur la valeur. Je venais de le découvrir. Il désira que je lui en donnasse lecture, puis m'arrêta à la 6me page en me disant de ne continuer que pour moi seul. Quand j'eus achevé et déclaré que la démonstration me paraissait complète, il dit que, si l'état de sa santé l'eût permis, il eût fondu ce fragment dans le chapitre De la valeur au premier volume des Harmonies; mais qu'il suffisait de l'introduire en forme de note dans la 2me édition… Il me recommanda en même temps, à l'égard (p. xlviii) des chapitres inachevés, de les faire suivre de points suspensifs…
Comme je lui demandais à emporter dans ma chambre quelques liasses pour les lire attentivement et à loisir, il me répondit en ces termes: «Prenez tout; il faut que vous emportiez tout à Paris. Si je ressuscite, vous me les rendrez.»
… Le docteur Lacauchie le trouve dans un état tel qu'il serait imprudent de ne pas lui donner de garde pendant la nuit.
Après notre dîner, l'abbé et moi nous revînmes pour le décider à recevoir une garde qui allait lui être envoyée. Il résista et ne voulut pas qu'elle commençât son service, au moins pour cette nuit.
23 DÉCEMBRE 1850 (LUNDI)
Le temps est beau, mais frais. Le pauvre malade est encore plus faible que la veille. Il me parle de la seconde édition de ses Harmonies, et pense qu'il faudrait comprendre dans le premier volume, comme se rattachant intimement au chapitre de la Concurrence, un autre chapitre intitulé Production et Consommation… Après l'avoir dissuadé de sortir, à cause de la vivacité du vent qui souffle du nord, l'abbé et moi, voyant que le soleil échauffe l'atmosphère de ses rayons, nous nous rendons à son désir et entreprenons avec lui une promenade en voiture fermée.
… La durée de notre promenade avait été de 2 heures ½. Au seuil de la porte, l'abbé et moi voulûmes le prendre sur nos bras, pour lui éviter la fatigue de l'ascension. Mais il s'y refusa avec opiniâtreté, et, pendant que je payais le cocher, se mit à grimper au premier étage. Arrivé sur le palier, il s'assit un instant sur une chaise que lui présentait son hôtesse, puis, ayant repris haleine, il monta le second étage. «Je suis bien aise, nous dit-il en manière de justification de son imprudence, d'avoir pu constater que je pouvais faire aujourd'hui ce que j'ai fait hier.» À partir de ce moment, je pus observer qu'il s'attachait de plus en plus à l'idée d'un retour en France. Ce voyage devint sa constante préoccupation.
Vers quatre heures arriva l'ambassadeur, M. de Rayneval. Cette visite tira notre ami d'un état prononcé d'accablement. Il se leva, fit asseoir l'ambassadeur sur le canapé et s'assit à côté de lui. Son premier soin fut de parler de son départ d'Italie. Il s'enquit du nom du navire sur lequel M. de Rayneval se chargeait de lui procurer une chambre d'officier. M. de Rayneval l'entretint dans son illusion. Ensuite la conversation se porta sur les monuments de Rome, et Bastiat exprima son admiration pour Saint-Pierre. Ses éloges comprenaient cependant des réserves et étaient entremêlés de critiques.
… Je me mis en quête d'une garde… Il me fut impossible d'en trouver une disponible. Alors l'abbé de Monclar se décida à passer la nuit… Le médecin était venu… Il n'estimait pas que le malade pût vivre encore trente-six heures, et même en comptant les pulsations de son pouls, il s'étonnait qu'il fût au nombre des vivants.
24 DÉCEMBRE 1850 (MARDI)
J'arrive chez lui à 5 h. du matin, comme j'en étais convenu avec M. de Monclar, que je devais remplacer. Le cher malade avait passé une nuit plus calme, grâce sans doute à l'effet de la potion calmante; toutefois il se plaignait de n'avoir pas dormi. Quand il me vit si matin, il me dit: «Mes amis sont mes victimes.» Il m'entretint de l'effet de la potion à laquelle il attribuait une action sur son cerveau. «Je sens là deux pensées, disait-il en posant le doigt sur son front; ma pensée ordinaire et une autre.» Ce même matin, il voulut se lever un peu plus tôt que de coutume. À 8 h. ½ il quitta son lit. Mais il se sentit faible, et n'essaya pas de se laver les mains et le visage, ce qu'il avait fait encore debout, la veille.
Assis sur son canapé, il m'interrogea de nouveau sur la durée de mon séjour à Rome. Ensuite il me parla de son retour en France, s'inquiétant beaucoup de savoir s'il serait possible de lui procurer des moyens de transport commodes de Marseille à Mugron, de l'installer dans chaque hôtel, au rez-de-chaussée, dans une pièce bien chaude, etc. Quand je le vis s'arrêter sur ces détails et en prendre souci, je crus devoir, pour soulager son esprit, lui proposer de l'accompagner dans son voyage… Il accepta de suite mon offre, et me dit que nous ne nous séparerions qu'à Mugron. Puis, un instant après, comme s'il se fût fait un cas de conscience de son acceptation, il ajouta: «Vous vous sacrifiez pour moi seul, attendez-vous à toutes sortes de déceptions.»
Ces déceptions qui m'attendaient entre Marseille et Mugron, le scrupule exagéré qui les lui faisait entrevoir, m'eussent égayé dans tout autre moment.
La veille au soir il avait dit à son cousin qu'il désirait faire son testament et se servir du ministère du chancelier de l'ambassade. Cette résolution étant bien arrêtée dans son esprit, j'allai, un peu avant onze heures, chercher M. de Gérando, chancelier. Celui-ci ne put venir aussi promptement que nous l'eussions désiré. Il n'arriva qu'à 1 h. Notre malade s'était remis au lit. C'est de son lit qu'il déclara lentement ses intentions à M. de Gérando, s'inquiétant beaucoup, non-seulement de les énoncer, mais de les motiver, ce qui était superflu.
… Pendant que le chancelier s'occupait de la rédaction définitive du testament, il me témoignait encore la crainte de n'avoir pas été compris. Pour le rassurer, je lui répétai, non ses propres paroles, mais le sens qu'elles exprimaient, et qui était fort clair. Alors il étendit son bras, posa sa main sur mon cou, attira ma tête près de la sienne, mon oreille près de ses lèvres, et dit en donnant à son faible souffle un accent inimitable: «Voyez-vous, Paillottet, ma tante, c'est ma mère! C'est elle qui m'a élevé, qui a veillé sur mon enfance!»
Le testament allait s'achever. Pour savoir s'il était en état de le signer, je lui remis une plume et une feuille de papier blanc sur laquelle il traça ces lettres: Frede… Nous vîmes qu'il pouvait signer, et en effet, il signa lisiblement.
Un instant après il me dit: «Je fais une réflexion. Mon oncle jouit actuellement de ma maison de Sengresse: je voudrais qu'il ne fût pas troublé dans cette jouissance, et j'aurais dû insérer une disposition à ce sujet dans mes dernières volontés. Il est trop tard.» Je lui promis de faire connaître ce vœu, et, d'après ce que j'avais ouï dire de Mlle sa tante, j'ajoutai que de son propre mouvement elle ferait pour son frère ce que son neveu désirait qu'elle fît.
À 2 h. ½, malgré la fatigue qu'il venait d'éprouver, il voulut quitter son lit. L'abbé venait de rentrer. Nous aidâmes le malade à se lever, et vîmes que ses forces diminuaient sensiblement. Il resta silencieux, et vers 4 h. demanda à se recoucher. Quand il fut près de son lit, ses jambes fléchirent. Nous le soulevâmes; mais à raison de la position qu'il avait prise, nous fûmes obligés de le coucher à rebours, ses pieds se trouvant à la tête du lit. Pour lui éviter des secousses, nous changeâmes de place les oreillers, et le laissâmes se reposer un instant, enveloppé de sa robe de chambre. Sa respiration devenait de plus en plus pénible, et les bouillonnements à l'intérieur de sa poitrine étaient de plus en plus sonores. Il eut un court assoupissement, à la suite duquel il trouva la force de changer de position et de se mettre au lit comme de coutume. Puis un nouvel accablement survint. J'étais assis près de lui, les yeux fixés sur son visage, écoutant cette respiration qui rencontrait tant d'obstacles. L'impression que je ressentais devint si poignante que je dus me retirer dans la pièce voisine. L'abbé de Monclar, que j'avais laissé en prières auprès de la fenêtre, vint bientôt me chercher. Le malade me demandait. Quand je fus près de lui, assis à son chevet, il désigna du geste son cousin, et fit entendre ces mots: «tous deux.» C'était à nous deux qu'il voulait s'adresser.
Il souleva un peu sa tête, l'appuya sur sa main droite, et se disposa à parler. L'intelligence brillait encore dans ses yeux. Son regard avait une expression que j'avais souvent remarquée au milieu de nos entretiens. Il semblait annoncer la solution d'un problème. La première phrase qu'il prononça sortit si faible de ses lèvres que l'abbé, placé debout à la tête du lit, n'en put rien entendre, et que je n'en recueillis que le dernier mot. C'était l'adjectif philosophique. Après une courte pause, il prononça distinctement: LA VÉRITÉ; puis s'arrêta, redit le même mot, et le répéta encore, en s'efforçant de compléter sa pensée. Émus à ce spectacle, nous le conjurâmes de suspendre son explication et de se reposer un peu; l'abbé se pencha pour l'aider à replacer sa tête sur l'oreiller. Dans cette situation le souffle de ses lèvres ne pouvait plus m'arriver. Il dit alors, sans que je les entendisse, ces mots que l'abbé me transmit immédiatement et me répéta le jour suivant: «Je suis heureux de ce que mon esprit m'appartient.» L'abbé ayant changé de position, je pus entendre le mourant articuler encore ceci: «Je ne puis pas m'expliquer.» Ce furent les derniers mots qui sortirent de sa bouche.
À ce moment arriva le docteur Lacauchie. Pendant qu'il se trouvait avec l'abbé, je crus pouvoir m'absenter un instant, et sortis à 5 h. Quand je revins, mon ami n'existait plus. Cinq minutes après ma sortie il avait rendu le dernier soupir…
Voici ce que m'apprirent MM. de Monclar et Lacauchie, tous deux témoins de sa fin. Au moment où je m'éloignais, ils s'approchèrent de son lit et virent aussitôt que la mort allait frapper. M. de Monclar se mit en devoir d'administrer au mourant l'Extrême-Onction, et pour s'assurer de ses dispositions à recevoir ce dernier sacrement, il lui dit: «Mon ami, baise le crucifix.» Les lèvres du mourant s'avancèrent, et obéirent complétement à l'exhortation. À cette vue le docteur fit un geste d'étonnement; il ne s'expliquait pas que l'intelligence et la volonté fussent encore là quand la vie se retirait.
Je contemplai longtemps cette tête chérie que l'âme venait d'abandonner, et vis que la mort n'y avait laissé aucune trace de souffrance.
Deux jours après, dans l'Église de Saint-Louis des Français, on fit à l'homme éminent, qui avait vécu si simple et si modeste, de pompeuses funérailles. C'était un premier acte de justice envers sa mémoire.
Le surlendemain, 28 décembre, je quittais Rome pour revenir en France. Quelques heures avant de partir, je lus dans l'Église de Santa Maria degli Angeli une belle et courte épitaphe latine qui semblait faite pour lui. Je la traduis de cette manière:
Il vécut par le cœur et la pensée,
Il vit dans nos souvenirs,
Il vivra dans la postérité.
1
Voir la lettre à M. Calmètes, p. 10.
2
Donoso Cortès.
3
Le chapitre X. Le reste de l'ouvrage se compose de fragments recueillis après sa mort et réunis dans l'ordre indiqué par Bastiat lui-même.
4
Page 209.
5
On trouvera quelques extraits de ce journal à la suite de cette notice.