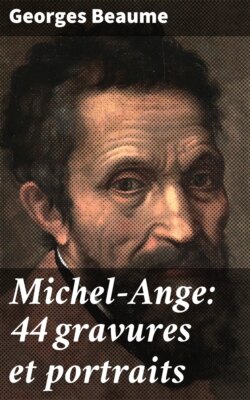Читать книгу Michel-Ange: 44 gravures et portraits - Beaume Georges - Страница 7
DEUX ÉMULES
ОглавлениеQUARANTE ans auparavant, l’œuvre de Santa-Maria-del-Fiore avait confié un énorme bloc de marbre de Carrare a plusieurs sculpteurs, entre autres à Agostino di Duccio, pour en sortir la figure d’un prophète. Tous avaient avoué, après de patients efforts, leur impuissance. Léonard de Vinci lui-même s’était récusé.
Michel-Ange, qui tentait l’impossible, accepta d’animer cette énorme matière. Il s’enferma dans son atelier, qui fut construit sur la place même, sans permettre à personne d’y pénétrer; et après dix-huit mois de labeur, il montra son David colossal. Le gonfalonier Soderini, glorieux de prouver son goût d’amateur, son autorité de maître, prétendit que le nez de David lui paraissait trop gros. Michel-Ange, sans répondre, et toujours railleur en son orgueil, grimpa sur son échafaud; ayant d’abord ramassé une poignée de poussière, il la laissa tomber en pluie sur son critique, pendant qu’avec son ciseau il faisait le simulacre de corriger le nez de la statue.
— Qu’en pensez-vous, maintenant? dit-il au gonfalonier.
— Admirable! répondit Soderini. Vous lui avez donné la vie.
Michel-Ange, en descendant de l’échafaud, riait de cet amateur, «semblable à tant d’autres qui parlent vaniteusement, sans savoir ce qu’ils disent». Ce David fut, suivant le désir de l’artiste, transporté devant le Palais de la Seigneurerie. Pendant la nuit, des gens du peuple essayèrent de briser la statue à coups de pierres. Il fallut faire bonne garde autour d’elle. Jusqu’en 1873, elle est restée sur cette place, d’où elle a été transportée, afin de l’abriter des intempéries, dans une rotonde spéciale, à l’Académie des Beaux-Arts de Florence. Là, du moins, elle ne risque plus rien également de l’injure des hommes. Car, savez-vous que si, dès ses premiers jours, le peuple la lapida, ce fut parce que, ramassis de brutes hypocrites, il fut choqué par la franche nudité du marbre?
Michel-Ange reçut à cette époque, de la part de l’État de Florence, la commande d’un David en bronze, destiné au maréchal de Gié. Ce maréchal, prince de Rohan, dirigeait en Italie les armées françaises de Louis XII. Tout en servant les intérêts de son maître, il n’oubliait pas les siens, et c’est pourquoi il caressait la seigneurie de Florence, afin d’en retirer quelques avantages, et toutes les œuvres d’art qui lui plaisaient. Les magistrats, désireux de le satisfaire pour le David qu’il sollicitait, en confièrent donc l’exécution à Michel-Ange.
Michel-Ange, lui, ne se pressa guère. Aux instances du maréchal de Gié, les magistrats de Florence répondirent que la statue serait prête à la Saint-Jean, si le statuaire tenait sa promesse,
«sur laquelle pourtant il ne faut pas beaucoup compter, attendu les cervelles de ces gens-là ». Sur ces entrefaites, Michel-Ange partit pour Rome, s’occuper aux fresques de la chapelle Sixtine: le pape ne consentit pas à le laisser s’absenter, pas même vingt-cinq jours, «et il n’y a personne en Italie capable de terminer une œuvre de cette importance. Il faut que lui, et lui seul, accomplisse tout le travail, parce qu’un autre, ne connaissant pas ses intentions, pourrait le gâter». En résumé, Michel-Ange ne termina pas ce David, qui, embarqué, vers la fin de 1508, à Livourne pour la France, s’est perdu en route.
Michel-Ange travaillait aussi à deux bas-reliefs circulaires, la Vierge et l’Enfant, l’un pour Taddeo Taddei, l’autre pour Bartolommeo Pitti. Il commençait aussi, pour les conseils de la confrérie des tisseurs de laine, les Douze Apôtres, en marbre de Carrare, qui devaient être placés dans l’église de Santa-Maria-del-Fiore. On lui avait fait construire, en vue de ce travail, une maison tout exprès, qui serait devenue sa propriété pour un douzième chaque année. Il se rebuta dans cette entreprise, après avoir simplement ébauché la figure de saint Mathieu, qui se trouve aujourd’hui dans la cour de l’Académie de Florence. En 1502 encore, il commença une Tête de femme, dont l’expression et les traits sont admirables. Mais le sculpteur, qui peut-être jamais plus que dans ce buste n’approcha de la beauté idéale, était surchargé de travaux.
Afin de ne pas abandonner tout à fait la peinture, il peignit la Vierge de la tribune: la Vierge avec saint Joseph, les deux enfants, et des personnages nus dans le fond. Tout le monde connaît ce tableau, si souvent reproduit par la gravure. L’aspect en est dur, heurté. Michel-Ange souffrait mal d’être gêné par les limites d’un cadre. Pour répandre tout l’horizon de sa pensée, il lui fallait l’espace libre de la fresque. Ce tableau, il l’avait exécuté pour un riche amateur, Agnolo Doni.
David.
A ce propos, Vasari rapporte une anecdote qui montre avec quelle roideur Michel-Ange défendait la dignité de sa profession. En lui envoyant son ouvrage, il demanda, comme prix, à l’acquéreur, une somme de soixante-dix ducats. Celui-ci, économe, ne lui donna que quarante ducats. Aussitôt, Michel-Ange les lui retourna, et, pour le punir, il réclama cent ducats ou son ouvrage. Agnolo répondit qu’il paierait les soixante-dix; Michel-Ange, furieux de ces marchandages, exigea alors cent quarante ducats.
Au printemps de 1505, les magistrats de Florence avaient chargé Léonard de Vinci de décorer un côté de la salle du Conseil au Palais-Vieux. Ils chargèrent Michel-Ange de décorer la muraille opposée. Véritable concours entre ces deux héros de l’art. L’un, Vinci, fatigué déjà dans sa nature délicate et sceptique, se dégoûta bientôt de son œuvre; l’autre, au contraire, ardent de jeunesse et d’ambition, exposa un des épisodes tumultueux de la guerre de Pise: des soldats florentins se baignant dans l’Arno, sont surpris par des cavaliers ennemis.
L’animation de la scène, le désarroi de ces soldats sortant de l’eau en toute hâte, ou se précipitant sur leurs armes, la science de l’arrangement, la fermeté du dessin, la hardiesse des lumières, enchantèrent les contemporains.
«Tant que ce carton demeura debout, raconte Benvenuto Cellini dans ses Mémoires, il fut l’école du monde. Quoique le divin Michel-Ange ait composé, depuis ce temps-là, ses peintures de la grande chapelle du pape Jules II, il n’atteignit jamais à la moitié du talent qu’il avait prodigué dans ce chef-d’œuvre. Jamais il ne remonta à l’éclat de cette première étude.»
On prétend que Raphaël vint à Florence étudier cette œuvre. D’ailleurs, l’influence de Michel-Ange sur le peintre des Sibylles est généralement admise. Et Jules II a pu dire à Sébastien del Piombo: «Regarde les œuvres de Raphaël, qui, lorsqu’il vit celles de Michel-Ange, abandonna aussitôt la manière du Pérugin et se rapprocha autant qu’il put de la sienne. Mais Michel-Ange est terrible; on ne peut pas vivre avec lui.» Ces peintures de Michel-Ange et de Léonard de Vinci sont perdues.
Benvenuto rapporte encore dans ses Mémoires que, l’an 1512, au milieu de l’émeute, tandis que la République succombait sous les coups des Médicis qui rentraient vainqueurs dans Florence, Buccio Bandinelli se glissa traîtreusement, un poignard à la main, dans la salle où était exposé le carton de Michel-Ange. Pendant qu’on s’égorgeait dans la rue, le stupide Bandinelli enfonça plusieurs fois le couteau dans le carton, le mit en pièces, qu’il dispersa ensuite.
Et Benvenuto ajoute:
«J’étais bien décidé à jeter cet assassin par terre et à le fouler aux pieds, partout où je le rencontrerais. Un jour, sur la place Saint-Dominique, je l’aperçus qui, d’un côté opposé au mien, survenait d’un pas de promenade. Colère, je courus à sa rencontre. Mais, enfin hors de la foule indifférente, je n’eus pas plutôt levé les yeux sur Bandinelli, que je le vis sans armes, à califourchon sur un mulet qui avait bien moins l’air d’un mulet que d’un âne. Auprès de lui, cheminait un petit garçon d’une dizaine d’années, son fils peut-être.
«Bandinelli, en me voyant, devint pâle comme un mort, trembla de la tête aux pieds. J’eus un scrupule. Ne serait-ce Point une lâcheté que de tuer ce lâche sans défense?
«— Sauve-toi! lui dis-je. Vil poltron, tu n’es pas digne de mes coups. Mais ne te trouve jamais sur mon chemin!...»
«Léonard était un homme de belle figure, de manières avenantes et distinguées. Il flânait un jour avec un ami, dans les rues de Florence. Il était vêtu d’une tunique rose, tombant jusqu’aux genoux; sur sa poitrine flottait sa barbe bien bouclée et arrangée avec art.
«Auprès de Santa Trinita, quelques bourgeois causaient: ils discutaient ensemble un passage de Dante. Ils appelèrent Léonard, et le prièrent de leur en éclaircir le sens. A ce moment, Michel-Ange passait. Léonard dit:
«— Michel-Ange vous expliquera les vers dont vous parlez.
«Michel-Ange, croyant que Léonard voulait le railler, répliqua amèrement:
«— Explique-les toi-même, toi qui as fait le modèle d’un cheval de bronze, et qui n’as pas été capable de le fondre, mais qui, pour ta honte, t’es arrêté en route. (Allusion à la statue équestre de Francesco Sforza, laissée inachevée par Léonard, et dont les archers gascons de Louis XII s’amusèrent à prendre pour cible le modèle de plâtre.)
«Là-dessus, Michel-Ange tourna le dos au groupe et continua son chemin. Léonard resta, et il rougit. Et Michel-Ange, non satisfait encore, et brûlant du désir de le blesser, cria:
«— Et ces chapons de Milanais, qui te croyaient capable d’un tel ouvrage!... .»
En 1505, Jules II invita Michel-Ange à lui soumettre le projet de son tombeau, qu’il voulait magnifique. L’artiste élabora immédiatement ce projet. Le pape, en sa ferveur coutumière, en fut enthousiasmé. Michel-Ange qui, par malheur pour sa santé, voulait tout faire par lui-même, l’entrepreneur, le contremaître, le surveillant, se rendit à Carrare, afin de choisir le marbre, l’extraire, le transporter par bateaux à Rome, où les blocs énormes couvrirent la moitié de la place Saint-Pierre.
Jules II avait fait construire un pont couvert, qui lui permît d’aller secrètement, seul, causer avec l’artiste. Mais ses visites, au gré de celui-ci, se multiplièrent trop fréquemment. Or, l’un autant que l’autre avaient un caractère peu commode. Et la brouille, comme souvent entre très bons amis, survint d’un excès d’intimité.
Michel-Ange, agacé dans ses habitudes de travail qu’il aimait solitaire, abandonna brusquement la partie. Voici, d’après Vasari, le récit de la rupture entre les deux personnages, qui étaient aussi difficiles à manier l’un que l’autre:
«Tandis que Michel-Ange s’occupait de ces travaux, un dernier transport de marbres de Carrare arriva à Ripa et fut conduit sur la place de Saint-Pierre. Comme il fallait payer les mariniers, Michel-Ange, suivant sa coutume, se rendit chez le pape lui demander de l’argent. Ce jour-là, Sa Sainteté était gravement préoccupée des affaires de Bologne. L’artiste, alors, acquitta les frais de ses propres deniers, ayant l’espoir de se voir bientôt remboursé.
Étude pour «la Vierge et l’Enfant».
«Quelque temps après, il retourna au palais, afin d’entretenir le pape de cette dette. D’abord, il se heurta, pour être introduit, à quelques difficultés; un valet lui dit de prendre Patience. Un évêque qui se trouvait là, fit observer à ce domestique que sans doute il ne connaissait pas la personne qu’il refusait.
«— Je la connais très bien, répliqua le valet. Mais je suis ici pour exécuter les ordres du pape.
«Michel-Ange, à qui jusqu’alors toutes les portes avaient été ouvertes, s’indigna d’une telle résistance:
«— Quand le pape aura besoin de moi, déclara-t-il au valet, vous lui direz que je suis allé ailleurs...
«De retour chez lui, à deux heures du matin, il intima l’ordre à deux de ses domestiques de vendre tous ses effets aux Juifs et de venir ensuite le rejoindre à Florence. Étant monté à cheval, il ne s’arrêta qu’à Poggibonzi, sur le territoire florentin. A peine y est-il arrivé qu’il est rattrapé coup sur coup par cinq courriers du pape, chargés des lettres les plus pressantes lui enjoignant de retourner à Rome, s’il voulait éviter la disgrâce.
«Invitation, menaces, tout fut inutile. Les courriers purent seulement, à force de supplications, obtenir de lui qu’il écrivît à Sa Sainteté qu’il la priait de l’excuser s’il ne paraissait plus en sa présence, mais «qu’ayant été traité comme un misérable
«pour prix de ses services et de son attachement, le pape
«pouvait faire choix d’un autre sculpteur».
Jules II ne souffrait de personne la moindre résistance. A trois reprises il réclama Michel-Ange auprès de la seigneurie de Florence. Michel-Ange désirait, afin d’avoir le prétexte de fuir très loin, accepter, sur l’invitation du Grand Seigneur, le projet de construire un pont qui unirait Constantinople à Péra. Devant les menaces du pape, il a peur: il n’est qu’un sujet. Cependant, par fierté, il résiste toujours. «Nous avons vu Michel-Ange, écrivait le gonfalonier de Florence au cardinal de Vol-terri; nous avons fait tout notre possible pour lui persuader de retourner à Rome; mais il continue à se méfier.»
Soderini disait, d’autre part, à Michel-Ange: «Tu t’es mis là dans une affaire où ne se serait pas risqué le roi de France. C’est assez se faire prier. Nous ne pouvons pas pour toi exposer l’État à soutenir la guerre contre le pape; par conséquent, Prépare-toi à partir.» Enfin, Michel-Ange cède; il emporte, vers Bologne, vers Jules II, une lettre du gonfalonier, sorte de talisman, qui le recommande aux cardinaux de Pavie et de Volterre:
«Le porteur de la présente est Michel-Ange, sculpteur, que nous vous envoyons pour complaire à Sa Sainteté et satisfaire à son désir. Nous certifions à votre seigneurie que c’est un jeune homme distingué, et dans son métier l’unique en Italie, peut-être dans le monde. Il est fait de telle manière qu’on tire de lui tout ce qu’on veut avec des paroles affectueuses et des caresses.»
Sur le caractère de Michel-Ange, Condivi confirme le jugement du gonfalonier: «Comme il arrive à ceux qui s’adonnent à la vie contemplative, il était timide, sauf lorsqu’il avait un juste sujet d’indignation, et qu’on faisait tort ou injure à lui ou aux autres. Alors, il avait plus de courage que ceux qui sont tenus pour courageux. Dans les circonstances ordinaires il était très patient.»
Condivi fait un récit pathétique de la rencontre de Jules II et du sculpteur:
«Michel-Ange, étant arrivé le matin à Bologne, alla à San Petronio entendre la messe. Il y rencontra des palefreniers du Pape qui le reconnurent et le conduisirent devant Sa Sainteté. Le pape était à table, dans le palais des Seize. Lorsqu’il le vit en sa présence, il lui dit avec un visage indigné :
«— Tu avais à venir nous trouver, et tu as attendu que nous allassions à ta recherche.
«Michel-Ange plia le genou, et d’une voix ferme et calme, ayant élevé la voix, il s’excusa, expliquant qu’il avait agi non par méchanceté, mais par amour-propre, et qu’il n’avait pas pu supporter d’être chassé. Le pape, la tête basse, sans répondre, paraissait fort troublé. Un évêque, chargé par Soderini d’excuser Michel-Ange, s’interposa:
«— Que votre Sainteté lui pardonne. Il a péché par ignorance. Ces artistes sont tous pareils...
«Le pape, alors, répondit violemment à l’évêque:
«— Tu dis des sottises, que je ne dis pas, moi! C’est toi qui es l’ignorant. Tu l’insultes!... va-t’en au diable!...
«Comme l’évêque ne s’en allait pas, les domestiques le mirent dehors à grands coups de poing. Le pape, ayant ainsi essuyé sur son subalterne la plus grande partie de son courroux, fit approcher Michel-Ange, lui pardonna, lui donna sa bénédiction, et lui enjoignit de ne pas quitter Bologne avant d’avoir reçu ses ordres. Au bout de peu de temps, il le fit venir et lui commanda sa statue, qu’il voulait mettre sur le frontispice de San Petronio.»
A ces mots, Michel-Ange se récusa, disant qu’il n’entendait rien à la fonte du bronze. Il dut l’apprendre, et il se mit aussitôt à l’œuvre. Ses tentatives furent d’abord infructueuses. Il s’acharna au travail. «J’ai à peine le temps de manger, écrivait-il à son frère (novembre 1507). Je vis dans la plus grande incommodité ; je ne pense à rien autre qu’à travailler nuit et jour; j’ai enduré de telles souffrances, et j’en endure de telles, que je crois que si j’avais à faire la statue une seconde fois, ma vie n’y suffirait pas; c’est un travail de géant.»
Au bout de seize mois, il terminait cette statue, trois fois grande commme nature. Le pape, avant de repartir pour Bologne, vint en voir le modèle. Michel-Ange lui demanda s’il pouvait placer un livre, dans la main gauche.
«— Comment! un livre? se récria Jules II. Je ne suis pas un lettré, moi!... Tu y placeras une épée. Dis-moi, est-ce que ta statue donne la bénédiction ou la malédiction?
«— Saint Père, elle menace le peuple pour le cas où il ne serait pas sage...»
En 15 11, le peuple de Bologne, dans un de ses accès de guerre civile, la brisa, sur la grande porte de San Petronio. Le duc Alphonse de Ferrare en acheta les morceaux, pour en fabriquer une pièce d’artillerie qu’il nomma la Julienne. On ignore ce qu’en est devenue la tête, que le peuple, à son insu, avait épargnée, et que le duc Alphonse avait, pendant quelques années, conservée dans son cabinet.