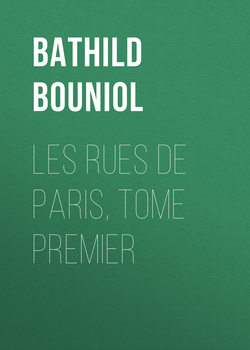Читать книгу Les rues de Paris, Tome Premier - Bouniol Bathild - Страница 7
SYLVAIN BAILLY
I
ОглавлениеBailly, célèbre comme savant avant la Révolution est aujourd'hui connu surtout par sa fin tragique. À peine âgé de vingt-quatre ans6, il comptait déjà parmi les astronomes distingués. Élu membre de l'académie des sciences à l'âge de vingt-sept ans (1763), il devint plus tard membre de l'académie française, (1783) et deux ans après de celle des inscriptions et belles-lettres. Ces distinctions, il les devait à ses publications littéraires et scientifiques encore que les dernières surtout aux yeux des juges compétents aient aujourd'hui perdu beaucoup de leur valeur.
«Bailly par des études opiniâtres avait acquis beaucoup d'instruction; mais il avait le jugement faux ou du moins sujet à s'égarer en poursuivant des systèmes qui ne sont fondés sur rien de précis. Son Histoire de l'astronomie est un véritable roman de physique dont le but est de faire le monde très vieux contrairement aux écrivains, sacrés et profanes, qui en ont déterminé l'âge, en opposition, d'ailleurs avec l'aspect du globe et les découvertes de la géologie. Qui pourra concevoir en effet la possibilité d'une révolution qui aura transporté la Sibérie des régions équinoxiales aux régions polaires; qui trouvera comme lui dans les Samoyèdes les pères des sciences et des arts? Son histoire de l'astronomie indienne n'est pas moins remplie de paradoxes, il en est de même des Lettres de l'Atlantide et sur l'origine des sciences. Aussi, tout en reconnaissant en lui de l'imagination, de la science et le talent d'écrire, les savants de son temps appelèrent ses systèmes astronomiques: Les Rêveries de Bailly7».
La réputation d'honnêteté de Bailly le fit nommer, en 1786, membre de la commission chargée d'inspecter les hôpitaux. Le rapport de Bailly choisi par ses collègues pour tenir la plume, n'est pas le moins intéressant de ses ouvrages, quoiqu'il attriste profondément par la révélation d'un état de choses qui nous semble aujourd'hui monstrueux. D'abord quand les commissaires se présentent à l'Hôtel-Dieu afin d'examiner par eux-mêmes l'établissement où les abus leur avaient été particulièrement signalés, la porte leur est refusée. «Nous avions besoin de divers éléments, nous les avons demandés, aussi bien qu'une personne qui pût nous guider et nous instruire; nous n'avons rien obtenu.»
«Quelle était donc l'autorité, dit Arago8, qui se permettait ainsi de manquer aux plus simples égards envers des commissaires investis de la confiance du roi, de l'académie et du public? Cette autorité se composait de divers administrateurs (le type, dit-on, n'est pas entièrement perdu) qui regardaient les pauvres comme leur patrimoine, qui leur consacraient une activité désintéressée mais improductive; qui souffraient impatiemment toute amélioration dont le germe ne s'était pas développé dans leur tête ou dans celles de quelques hommes philanthropes par naissance ou par privilége d'emploi.»
Malgré ce mauvais vouloir, la commission put remplir sa mission: «ce qu'elle fit avec une conscience qui n'avait d'égale que sa patience et sa fermeté.» Quelques extraits seulement du rapport de Bailly, analysé par Arago, suffiront pour montrer si la susceptibilité des administrateurs était légitime.
«En 1786, on traitait à l'Hôtel-Dieu les infirmités de toute nature… tout était admis, mais aussi tout présentait une inévitable confusion. Un malade arrivant était souvent couché dans le lit et les draps du galeux qui venait de mourir.
»L'emplacement réservé aux fous étant très restreint, deux de ces malheureux couchaient ensemble. Deux fous dans les mêmes draps! L'esprit se révolte en y songeant.
»Dans la salle St-François, exclusivement réservée aux hommes atteints de la petite vérole, il y avait quelquefois, faute de place, jusqu'à six adultes ou huit enfants dans un lit qui n'avait pas 1 mètre 1/2 de large.
»Les femmes atteintes de cette affreuse maladie se trouvaient réunies, dans la salle Ste-Monique, à de simples fébricitantes; celles-ci étaient livrées comme une inévitable proie à la hideuse contagion dans le lieu même où, pleines de confiance, elles avaient espéré recouvrer la santé.
»Les femmes enceintes, les femmes en couche étaient également entassées pêle-mêle sur des grabats étroits et infects.
»… Dans l'état habituel, les lits de l'Hôtel-Dieu, des lits qui n'avaient pas 1 mètre 1/2 de large, contenaient quatre et souvent six malades; ils y étaient placés en sens inverse: les pieds des uns répondaient aux épaules des autres; ils n'avaient chacun pour leur quote-part que 25 centimètres… Aussi se concertaient-ils, tant que leur état le permettait, pour que les uns restassent levés dans la ruelle pendant une partie de la nuit, tandis que les autres dormaient.
»… Tel était l'état normal de l'ancien Hôtel-Dieu. Un mot, un seul mot dira ce qu'était l'état exceptionnel (en temps d'épidémie); alors on plaçait des malades jusque sur les ciels de ces mêmes lits où nous avons trouvé tant de souffrances, tant de légitimes malédictions…»
Combien d'autres détails non moins tristes, par exemple, relatifs à la salle des opérations et sur lesquels nous glissons pour ne pas trop attrister le lecteur.
À qui, d'ailleurs, imputer la longue durée de cette organisation vicieuse, inhumaine? «à la vulgaire toute puissance de la routine, à l'ignorance!» s'écrie Arago s'appuyant des conclusions de Bailly qui dit avec tous les ménagements que la circonstance exigeait:
«L'Hôtel-Dieu existe peut-être depuis le VIIe siècle, et si cet hôpital est le plus imparfait de tous, c'est parce qu'il est le plus ancien. Dès les premiers temps de cet établissement, on a cherché le bien, on a désiré s'y tenir, et la constance a paru un devoir. De là, toute nouveauté utile a de la peine à s'y introduire; toute réforme est difficile; c'est une administration nombreuse qu'il faut convaincre; c'est une masse énorme qu'il faut remuer.»
L'énormité de la masse à remuer ne découragea pas les commissaires de l'Académie. Aussi, grâce à leur énergique persistance, les choses changèrent, nos hôpitaux furent réformés, transformés, et c'est avec toute justice et vérité qu'Arago a pu dire naguère: «Chaque pauvre est aujourd'hui couché seul dans un lit, et il le doit principalement aux efforts habiles, persévérants, courageux de l'Académie des sciences. Il faut que le pauvre le sache et le pauvre ne l'oubliera pas.»
Hélas! il fut trop prompt à l'oublier, au contraire, en ce qui concerne Bailly du moins, dont la triste destinée prouve une fois de plus quel fond il faut faire sur la popularité, avec la terrible mobilité des multitudes, si promptes à subir toutes les influences, et qui, elles aussi, tournent au moindre vent. Bailly en fit la cruelle expérience et combien ne dut-il pas regretter souvent d'avoir cédé, qui sait à quelle tentation fatale d'ambition? au lieu de se contenter de la gloire modeste de savant et de lettré, à l'exemple de son maître l'astronome Lacaille dont on a dit qu'il était le calculateur le plus courageux et l'observateur le plus zélé, le plus actif, le plus assidu qui ait jamais existé, «et avec cela» doux, simple, gai, égal avec ses amis; l'intérêt ni l'ambition ne le tentèrent jamais; il sut se contenter de peu, sa probité faisait son bonheur, les sciences ses plaisirs, et l'amitié ses délassements.»
6
Il était né à Paris, le 15 septembre 1736.
7
Encyclopédie catholique.
8
Éloge de Bailly.