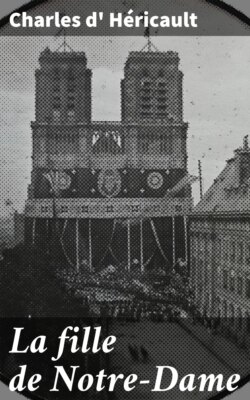Читать книгу La fille de Notre-Dame - Charles d' Héricault - Страница 5
PROLOGUE
ОглавлениеEn l’année631, la troisième du règne du grand roi Dagobert, et pendant le pontificat de l’illustre Audomare ou Omer, évêque de Therouanne, il y eut une grande tempête sur les côtes de la Morinie, vers le temps de la fête des Saints-Innocents, c’est-à-dire, comme chaque chrétien le sait, à la fin du mois de décembre.
Ainsi commence l’histoire des Deladame, qui sont les principaux personnages de notre roman; et cette histoire continue ainsi:
Quand l’orage fut un peu calmé, les hardis pêcheurs d’une petite bourgade–célèbre sous le nom de Gessoriac et qui est devenue la ville, fort connue, de Boulogne-sur-Mer–s’embarquèrent à la recherche des épaves que le Dieu des tempêtes avait dû, dans sa bienfaisance, semer sur toutes les côtes voisines.
Ils ne rapportèrent rien qu’un homme presque nu et à demi mort. Ils l’avaient trouvé, au milieu du Détroit, bercé par les vagues encore furieuses et se tenant désespérément aux débris d’un mât.
C’était un homme jeune, grand et beau, mais si brun, avec des cheveux si noirs, des dents si aiguës et si blanches, que les femmes des pêcheurs furieuses de ce maigre butin, furent tentées de le rejeter à la mer, le prenant pour le grand diable d’enfer ou quelqu’un de ses suppôts.
Heureusement pour le naufragé, il revint complètement à lui. Il ouvrit tout grands ses yeux qu’il avait brillants comme des charbons magiques, et, se voyant bien décidément sur le sable ferme, il se prosterna, baisa la terre en murmurant des paroles dans une langue harmonieuse, mais absolument étrangère aux oreilles des auditeurs.
Il aperçut une grande croix de bois. Elle surmontait une petite chapelle couverte en genêts qui s’élevait au haut de la montagne, où était bâtie la bourgade. Il tendit les bras vers la croix. Ses yeux prirent, en se remplissant de larmes, une expression de douceur et de gratitude qui toucha ces rudes âmes.
Bien des mois s’écoulèrent. L’Etranger était toujours dans la bourgade. Comme on le voyait homme bon, habile et courageux marin, on s’était mis à l’aimer et à le traiter comme un enfant de la Morinie. Il était surtout pieux, et il passait la plupart du temps qu’il ne donnait pas à la mer dans la petite chapelle que nous désignions plus haut. Là, prosterné, méditant et priant, il restait pendant des heures entières, relevant parfois la tête pour sourire à des visions célestes.
Qui était-il? d’où venait-il? Il avait raconté–car il avait appris la langue gallo-romaine avec une surprenante facilité–qu’il était Arabe, que son pays avait été ravagé par des païens, qu’il avait habité longtemps auprès de Jérusalem, en la ville même de Nazareth et proche de la maison où avait logé la mère du Sauveur. Puis il s’était embarqué sur les côtes de la Palestine, fuyant avec un grand nombre de gens de sa race et de sa famille devant les païens sarrazins. La tempête avait saisi son navire. Après l’avoir balloté pendant de longs jours sur des mers inconnues, elle l’avait brisé. Lui s’était attaché à un débris de la mâture. C’est là qu’on l’avait trouvé.
Il ajoutait qu’il était allié à la famille de saint Luc et qu’il avait gardé de cette alliance une tendresse infinie pour la sainte Vierge.
C’était pour cela, disait-on, qu’il paraissait indifférent aux charmes des jeunes filles gauloises, que son port noble et son étrange beauté n’avaient pas laissées indifférentes.
Deux années s’étaient passées depuis l’arrivée du Syrien dans le port boulonnois. On entrait en l’année 633. On était à la fin d’avril,–car la nouvelle année s’ouvrait alors à Pâques.–La tradition dit que c’était le dimanche proche de la fête de saint Marc l’evagéliste. L’illustre évêque Audomare, alors en Boulonnois, allait achever une instruction qu’il faisait au peuple assemblé dans la chapelle rustique que nous connaissons, quand il s’interrompit pour désigner, au milieu de la foule, un homme dont la face paraissait resplendir d’une lumière surnaturelle.
L’étranger, la figure levée vers les cieux, les regards vagues et comme noyés dans un rêve divin, les lèvres agitées par un sourire séraphique, les bras étendus comme s’il eut voulu retenir une vision prête à s’échapper, l’étranger était soulevé de terre.
Le saint évêque connaissait les artifices de l’Esprit malin, qu’il avait terrassé dans maint combat et chassé après de longues prières. Il ordonna, par trois fois, au Syrien de lui répondre, au nom de Dieu.
Deux fois l’étranger répondit: Victoire; Victoire.
A la troisième interpellation de l’évêque, il jeta un grand cri, ses bras parurent vouloir comme repousser la vue d’un spectacle affreux; de grosses larmes coulèrent sur ses joues, et il murmura: Ruine, ruine.
Il joignit quatre fois les mains qu’il ouvrait et refermait chaque fois avec des soupirs suppliants. Un sourire revint sur ses lèvres et il sortit à demi de son extase.
Obéissant aux ordres du vénérable serviteur de Dieu, il dit que Notre-Seigneur, pour récompenser la foi et la fidélité chrétienne de la peuplade morinienne, allait lui envoyer un don merveilleux qui répandrait pendant des siècles sur la terre boulonnoise, et particulièrement sur la cité, des trésors inestimables. La bourgade en deviendrait une grande ville, les marécages et les forêts de la Morinie, une terre riche, nourrissant de vaillants hommes, des femmes pieuses, et devant donner naissance à un héros qui vengerait la chrétienté. Dans peu d’instants, le don allait arriver à sa destination. Il voyait, oui, il voyait à deux lieues environ des côtes, au milieu de la mer, un navire, sans pilote et sans matelots, mais conduit par deux anges vers le rivage de Boulogne. Ce navire renfermait une des statues de la sainte Vierge que saint Luc avait sculptées.
Comme il achevait ces paroles, l’église fut envahie par une bande d’hommes et de femmes, au milieu desquels se tenait une jeune fille aussi belle et aussi blonde que l’étranger était beau et brun.
On reconnut ceux qu’on nommait les Payens.
C’était une petite tribu de Saxons chassés des Flandres et réfugiés sur une colline émergeant des marais que la rivière Liane et le reflux de la mer avaient formés au pied de la montagne sur le haut de laquelle la bourgade était bâtie. (Cette colline a gardé de ces exilés saxons le nom d’Ostrohove, ou cours de l’Ouest.) Tous avaient résisté jusque-là aux prédications d’Audomare, sauf la fille de leur chef, Hertha ou Bertha, qui était devenue chrétienne.
Bertha avait eu d’abord fort à souffrir des mauvais traitements de ses proches. Son père l’avait un jour frappée si violemment au front, de sa hache de bronze, qu’elle en avait gardé, exactement à la racine de ses beaux cheveux retroussés, une cicatrice légère qui s’arrondissait, comme une couronne de perles blanches, d’une tempe à l’autre.
La tribu saxonne s’avançait donc en tumuke. Elle venait demander à ses voisins et amis, les Gallo-Romains, la permission de traverser les rues de la bourgade en grande masse, pour descendre de là sur le bord de la mer.
Et pour expliquer leur demande et leur nombre, ils racontaient à l’évêque que Hertha venait d’avoir une vision. Cette vision était en tout pareille à celle du Syrien.
Gaulois et Saxons, précédés d’Audomare, qu’accompagnaient ses diacres et ses clercs, descendirent au pied de la montagne.
L’étranger et Bertha, marchaient au milieu de la foule, mais enchaînés. Le peuple de l’une et de l’autre nation avait décidé, par acclamation, qu’ils seraient lapidés si l’événement ne répondait pas à la prophétie, car il y aurait dans cette ressemblance des deux visions une preuve qu’ils s’étaient entendus pour abuser des choses saintes et tromper le peuple.
Quand on fut sur le rivage, rien n’apparaissait encore. La mer était calme, comme il arrive toujours après les grands orages, et nous avons oublié de dire que le Détroit avait été battu depuis huit jours par un vent violent. A cette heure, les flots moutonnaient tranquillement avec des grondements sourds et joyeux comme ceux d’un lion apaisé; et les rayons du clair soleil d’avril, en faisant étinceler les petites vagues somnolentes, montraient une surface au loin déserte.
On attacha le jeune homme et la jeune fille à une pointe de rocher. Tous deux souriaient au ciel et se souriaient en s’étonnant de se sourire, car ils ne s’étaient jamais vus.
Audomare, touché de leur sérénité, fit signe qu’on attendit quelque temps encore avant de commencer leur supplice.
Bientôt, étendant vers la mer son bâton recourbé, il indiqua un navire qui venait comme de sortir de derrière une vague plus forte que les autres. Le navire s’avançait avec une lenteur majestueuse, bercé par le flot. Sans voiles, sans rameurs, il se dirigeait vers le point du rivage où l’on avait attaché les deux jeunes gens.
Tous les matelots boulonnois se précipitèrent vers leurs bateaux qui étaient étendus sur le rivage et travaillèrent à les mettre à flot. Mais à peine quelques canots furent-ils à la mer que le navire mystérieux s’arrêta, puis recula. L’évêque fit revenir les canots.
Le navire recommença à s’avancer vers le rocher où devait avoir lieu le supplice du Syrien; et, à mesure qu’il approchait, on distinguait une lumière extraordinaire qui enveloppait l’esquif mystérieux.
Cette lumière rayonnait de l’avant du bateau, et bientôt, quand il fut plus prêt du rivage, on vit que la lueur partait d’une statue debout sur un banc. Le navire toucha le sable et le peuple se prosterna, tant l’éclat qui brillait autour de la statue, tant l’expression majestueuse et douce de son visage avaient saisi les âmes.
Cette statue représentait la Sainte-Vierge tenant l’enfant Jésus. Elle était noire, d’un bois dont on ne put jamais reconnaître l’essence. Elle avait, disent nos traditions, la taille d’un enfant de sept ans, et, en effet, elle était haute de près de quatre pieds.
Pendant que le peuple se tenait agenouillé, les clercs s’avancèrent près du navire. Mais, par un mouvement inexplicable, il se dégagea des sables et reprit la mer.
L’évêque se dirigea à son tour vers la statue. Le navire s’arrêta. On vit l’image divine sourire au Saint. Mais l’esquif ne se rapprocha pas.
Audomare, éclairé d’un rayon d’en haut, se jeta à genoux, confessant hautement au peuple son orgueil et la pesanteur de sa foi. Il alla détacher lui-même le Syrien et la Saxonne, qui s’avancèrent, aussi légèrement que s’ils étaient portés par les nuées, vers les flots.
Un grand silence s’était fait au milieu de cette foule. Mais une clameur de bénédictions, entremêlées de larmes, de prières et de chants pieux, s’éleva vers le ciel quand on vit le bateau miraculeux reprendre sa marche vers le rivage, où il s’arrêta de nouveau.
Les deux jeunes gens se prosternèrent, et, s’approchant de l’esquif, les mains jointes, les lèvres agitées, les regards baissés devant l’éclat qui entourait l’image bénie, ils la prirent pieusement et la soulevèrent. Puis, guidés par elle plutôt qu’ils ne la conduisaient, ils se mirent à marcher. L’évêque et tout le peuple suivaient en chantant: Benedictus qui venit in nomine Domini.
Bertha soutenait le bras gauche, qui portait le Seigneur Jésus. L’étranger avait posé son poing sous le bras droit, qui, levé jusqu’à hauteur de poitrine, ouvrait la main, les doigts en l’air, avec un geste de doux commandement.
Une ceinture de lumière entourait le groupe et paraissait unir les deux jeunes gens entre eux et à la Vierge divine.
Le Syrien sentait comme une chaleur céleste qui sortait de la main de Marie et pénétrait dans son cœur.
Il entendit de nouveau résonner dans son cerveau ces trois mots qu’il avait prononcés en son extase: Victoire! Victoire! Ruine!
Il comprenait qu’ils résumaient l’histoire de sa race liée aux destinées de l’image merveilleuse.
Ainsi, la statue monta jusqu’à la bourgade.
Mais, résistant aux efforts de ceux oui se dirigeaient vers la petite chapelle, elle voulut être déposée à une centaine de pas plus loin. L’étranger, saisi de nouveau d’un mouvement surnaturel, annonça que c’était là qu’il fallait bâtir une église, qui deviendrait une des plus célèbres de l’univers entier. Il engagea, d’ailleurs, les habitants de Boulogne à creuser hardiment le sol à l’endroit même où était déposée la statue. Il affirmait qu’on y trouverait assez de pierres pour construire une grande basilique.
En effet, on découvrit les ruines d’un temple païen dont les galeries souterraines servirent de fondation à l’église chrétienne.
Le Syrien et Bertha furent fiancés par l’évêque Audomare, et après quelques années passées dans les chastes fiançailles, quand l’église consacrée à la Sainte-Vierge fut achevée, ils s’épousèrent.
Leurs descendants sont nommés dans nos vieux documents: Li fil del dam, li serv de le Dame, li enfes de le Dame, les fils, les serviteurs, les enfants de la Dame. Plus tard, on dit les gens de la Dame, enfin les Deladame, nom sous lequel on les trouve connus à partir du pèlerinage de Louis XI en Boulonnais.
Ce fut par milliers que les saints, les rois, les reines, les princes, les grands seigneurs de toute l’Europe, par millions que les pèlerins vinrent s’agenouiller aux pieds de cette Dame, de cette statue envoyée ainsi miraculeusement à Boulogne. Ce fut elle que Louis XI reconnut comme dame suzeraine du comté de Boulonnois. A ce titre, il lui rendit un hommage solennel, promettant que chacun de ses successeurs reconnaîtrait cette suzeraineté et rendrait cet hommage. Tous le firent, en effet, sauf Louis XVI, Charles X, Louis-Philippe et les deux Napoléon, qui ne finirent point heureusement, dit-on.
L’histoire des Deladame fut constamment mêlée à celle de leur patronne.
Leurs traditions assurent qu’ils sauvèrent une première fois la statue miraculeuse, quand, à la fin du IXe siècle, les Normands ravagèrent la Picardie.
Ils prirent une part vaillante à la défense de Boulogne, assiégée par Henri VIII, et ils suivirent en Angleterre la statue, que les Anglais vainqueurs y avaient transportée après la prise de la ville. Ils la suivirent encore quand elle fut restituée à son sanctuaire boulonnais.
Ils la défendirent de leur mieux contre les Huguenots. Quand elle fut saisie par ceux-ci et jetée dans les flammes, ce ne fut pas sans avoir été arrosée du sang des Deladame. Ils ne purent la sauver de l’outrage; mais ils passèrent dix ans à la chercher-car, après avoir résisté merveilleusement aux flammes, elle avait été cachée.
Ils la trouvèrent enfin et ce fut un Deladame qui aida le père Gillot à la retirer du puits du château d’Honvault.
En dehors de ces circonstances solennelles, où ils montraient l’héroïsme de leur fidélité, les Deladame se cachaient dans l’obscurité, humbles, doux, enfants pieux et modestes serviteurs de la patronne du Boulonnais
Médiocres ou petits, riches ou pauvres, selon les hasards de la fortune, ils tenaient obstinément à ne pas sortir du rang de la petite bourgeoisie, parce qu’elle les gardait plus sûrement à l’ombre du sanctuaire béni. Ils n’avaient jamais voulu profiter des chances que les siècles leur avaient fournies pour entrer dans la noblesse. Ils avaient même toujours évité les grandes charges municipales du Mayorat et de l’Echevinage, de crainte que les intérêts de la bonne ville ne se trouvassent en contradiction avec ceux de l’antique sanctuaire. Toute leur ambition se bornait à défendre les privilèges pieux et honorifiques que les vieux usages accordaient aux Enfants de la Dame, et qui les mettaient plus en honneur et en lumière que les gentilshommes, les pairs même du comté du Boulonnais.
C’est ainsi que, vaillants selon les occasions, mais toujours dévoués et fidèles; humbles, mais fiers d’être la plus ancienne famille historique de France, plus ancienne que les Montmorency, les Maillé, les Bourbons même; charitables et gardant leurs yeux sans cesse fixés sur l’Etoile des Mers, c’est ainsi que nous trouvons les Deladame jusqu’à la période du XVIIIe siècle, où commence notre roman.