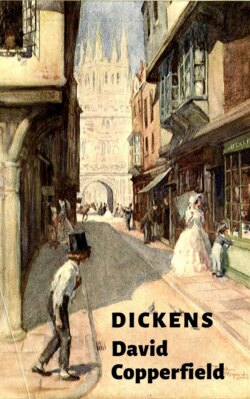Читать книгу David Copperfield (Édition intégrale) - Charles Dickens - Страница 8
CHAPITRE V.
Je suis exilé de la maison paternelle.
ОглавлениеNous n’avions pas fait plus d’un demi mille, et mon mouchoir de poche était tout trempé, quand le voiturier s’arrêta brusquement.
Je levai les yeux pour voir ce qu’il y avait, et je vis, à mon grand étonnement, Peggotty sortir de derrière une haie et grimper dans la carriole. Elle me prit dans ses bras, et me serra si fort contre son corset que mon pauvre nez en fut presque aplati, ce qui me fit grand mal, mais je n’y pensai seulement pas sur le moment ; ce ne fut qu’après que je m’en aperçus, en le trouvant très-sensible. Peggotty ne dit pas un mot. Elle plongea son bras jusqu’au coude dans sa poche, en tira quelques sacs remplis de gâteaux qu’elle fourra dans les miennes avec une bourse qu’elle mit dans ma main, mais tout cela sans dire un mot. Après m’avoir de nouveau serré dans ses deux bras, elle redescendit de la carriole : j’ai toujours été persuadé, comme je le suis encore, qu’en se sauvant, elle n’emporta pas un seul bouton à sa robe. Moi j’en ramassai un, j’avais de quoi choisir, et je l’ai longtemps gardé précieusement comme un souvenir.
Le voiturier me regarda comme pour me demander si elle n’allait pas revenir. Je secouai la tête, et lui dis que je ne le croyais pas. « Alors, en marche, » dit-il à son indolente bête, qui se mit effectivement en marche.
Après avoir pleuré toutes les larmes de mes yeux, je commençai à réfléchir que cela ne servait à rien de pleurer plus longtemps, d’autant plus que ni Roderick Random, ni le capitaine de la marine royale, n’avaient jamais, à ma connaissance, pleuré dans leurs situations les plus critiques. Le voiturier voyant ma résolution, me proposa de faire sécher mon mouchoir sur le dos de son cheval. Je le remerciai et j’y consentis. Mon mouchoir ne faisait pas grande figure, en manière de couverture de cheval.
Je passai ensuite à l’examen de la bourse. Elle était en cuir épais, avec un fermoir, et contenait trois shillings bien luisants que Peggotty avait évidemment polis et repolis avec soin pour ma plus grande satisfaction. Mais ce qu’elle contenait de plus précieux, c’étaient deux demi-couronnes enveloppées dans un morceau de papier, sur lequel ma mère avait écrit : « Pour Davy avec toutes mes tendresses. » Cela m’émut tellement, que je demandai au voiturier d’avoir la bonté de me rendre mon mouchoir de poche ; mais il me répondit que selon lui, je ferais mieux de m’en passer, et je trouvai qu’il avait raison ; j’essuyai donc tout bonnement mes yeux sur ma manche et ce fut fini pour de bon.
Cependant il me restait encore de mes émotions passées, un profond sanglot de temps à autre. Après avoir ainsi voyagé pendant quelque temps, je demandai au voiturier s’il devait me conduire tout le long du chemin.
« Jusqu’où ? demanda le voiturier.
– Eh bien ! jusque-là, dis-je.
– Où ça, là ? demanda le voiturier.
– Près de Londres, dis-je.
– Mais ce cheval-là, dit le voiturier en secouant les rênes pour me le montrer, serait plus mort qu’un cochon rôti, avant d’avoir fait la moitié du chemin.
– Vous n’allez donc que jusqu’à Yarmouth ? demandai-je.
– Justement, dit le voiturier. Et là je vous mettrai dans la diligence, et la diligence vous mènera… où c’que vous allez. »
C’était beaucoup parler pour le voiturier (qui s’appelait M. Barkis), homme d’un tempérament flegmatique, comme je l’ai dit dans un chapitre précédent, et point du tout conversatif. Je lui offris un gâteau, comme marque d’attention ; il l’avala d’une bouchée, ainsi qu’aurait pu faire un éléphant, et sa large face ne bougea pas plus que n’aurait pu faire celle d’un éléphant.
« Est-ce que c’est elle qui les a faits ? dit M. Barkis, toujours penché, avec son air lourdaud, sur le devant de sa carriole, un bras placé sur chacun de ses genoux.
– C’est de Peggotty que vous voulez parler, monsieur ?
– Ah ! dit M. Barkis. Elle-même.
– Oui, c’est elle qui fait tous les gâteaux chez nous, d’ailleurs elle fait toute la cuisine.
– Vraiment ? » dit M. Barkis.
Il arrondit ses lèvres comme pour siffler, mais il ne siffla pas. Il se pencha pour contempler les oreilles de son cheval, comme s’il y découvrait quelque chose de nouveau, et resta dans la même position pas mal de temps, enfin il me dit :
« Pas d’amourettes, je suppose ?
– Des amourettes de veau, voulez-vous dire, monsieur Barkis ? Je vous demande pardon, elle les accommode aussi à merveille, car je croyais qu’il avait envie de prendre quelque chose, et qu’il désirait particulièrement se régaler d’un plat d’amourettes.
– Non, des amourettes… d’amour. Il n’y a personne qui aille se promener avec elle ?
– Avec Peggotty ?
– Ah ! dit-il, elle-même !
– Oh ! non, jamais, jamais elle n’a eu d’amour ni d’amourettes.
– Non, vraiment ? » dit M. Barkis.
Il arrondit de nouveau ses lèvres comme pour siffler, mais il ne siffla pas plus que la première fois, et se mit à considérer encore les oreilles de son cheval.
« Et ainsi, dit M. Barkis, après un long silence, elle fait toutes les tartes aux pommes, et toute la cuisine, n’est-ce pas ? »
Je répondis que oui.
« Eh bien ! dit M. Barkis, je vais vous dire. Peut-être que vous lui écrirez ?
– Je lui écrirai certainement, repris-je.
– Ah ! dit-il en tournant lentement les yeux vers moi. Eh bien ! si vous lui écrivez, peut-être vous souviendrez-vous de lui dire que Barkis veut bien, voulez-vous ?
– Que Barkis veut bien, répétai-je innocemment. Est-ce là tout ?
– Oui, dit-il lentement, oui, Barkis veut bien.
– Mais vous serez demain de retour à Blunderstone, monsieur Barkis, lui dis-je (et mon cœur se serrait à la pensée que moi j’en serais bien loin), il vous serait plus facile de faire votre commission vous-même. »
Mais il me fit signe de la tête que non, et répéta de nouveau du ton le plus grave : « Barkis veut bien. Voilà tout. » Je promis de transmettre exactement la chose. Et ce jour-là même en attendant à Yarmouth la diligence, je me procurai un encrier et une feuille de papier, et j’écrivis à Peggotty un billet ainsi conçu :
« Ma chère Peggotty, je suis arrivé ici à bon port. Barkis veut bien. Mes tendresses à maman. Votre bien affectionné,
« Davy. »
« P. S. Il tient beaucoup à ce que vous sachiez que Barkis veut bien. »
Lorsque j’eus fait cette promesse, M. Barkis retomba dans un silence absolu ; quant à moi, je me sentais épuisé par tout ce qui m’était arrivé récemment, et me laissant tomber sur une couverture, je m’endormis. Mon sommeil dura jusqu’à Yarmouth, qui me parut si nouveau et si inconnu dans l’hôtel où nous nous arrêtâmes, que j’abandonnai aussitôt le secret espoir que j’avais eu jusqu’alors d’y rencontrer quelque membre de la famille de M. Peggotty, peut-être même la petite Émilie.
La diligence était dans la cour, parfaitement propre et reluisante, mais on n’avait pas encore attelé les chevaux, et dans cet état il me semblait impossible qu’elle allât jamais jusqu’à Londres. Je réfléchissais sur ce fait, et je me demandais ce que deviendrait définitivement ma malle, que M. Barkis avait déposée dans la cour, après avoir fait tourner sa carriole, et ce que je deviendrais moi-même, lorsqu’une dame mit la tête à une fenêtre où étaient suspendus quelques gigots et quelques volailles, et me dit :
« Êtes-vous le petit monsieur qui vient de Blunderstone ?
– Oui, madame, dis-je.
– Votre nom ? demanda la dame.
– Copperfield, madame, dis-je.
– Ce n’est pas ça, reprit la dame. On n’a pas commandé à dîner pour une personne de ce nom ?
– Est-ce Murdstone, madame ? dis-je.
– Si vous êtes le jeune Murdstone, dit la dame, pourquoi commencez-vous par me dire un autre nom ? »
Je lui expliquai ce qu’il en était, elle sonna et cria : « William, montrez à monsieur la salle à manger » sur quoi un garçon arriva en courant, de la cuisine qui était de l’autre côté de la cour, et parut très-surpris de voir que c’était pour moi seul qu’on le dérangeait.
C’était une grande chambre, garnie de grandes cartes de géographie. Je crois que, quand les cartes auraient été de vrais pays étrangers, au milieu desquels on m’aurait lancé comme une bombe, je ne me serais pas senti plus dépaysé. Il me semblait que je prenais une étrange liberté d’oser m’asseoir, ma casquette à la main, sur un coin de la chaise la plus rapprochée de la porte, et lorsque je vis le garçon mettre une nappe sur la table, tout exprès pour moi, et y placer une salière, je suis sûr que je devins tout rouge de modestie.
Il m’apporta des côtelettes et des légumes, et enleva les couvercles des plats avec tant de brusquerie que j’avais la plus grande peur de l’avoir apparemment offensé. Mais je me sentis rassuré en le voyant mettre une chaise pour moi devant la table, et me dire du ton le plus affable : « Maintenant, mon petit géant, asseyez-vous. »
Je le remerciai et je m’établis devant la table ; mais il me semblait extraordinairement difficile de manier un peu adroitement mon couteau ou ma fourchette, ou d’éviter de jeter de la sauce sur moi, tant que le garçon serait là debout en face de moi, ne me quittant pas des yeux, et me faisant rougir jusqu’aux oreilles chaque fois que je le regardais. Lorsqu’il me vit entamer la seconde côtelette :
« Voilà, dit-il, une demi-pinte d’ale pour vous. La voulez-vous à présent.
– Merci, lui dis-je, je veux bien. »
Alors il versa la bière dans un grand verre, et la mit devant la fenêtre pour m’en faire admirer la belle couleur.
« Ma foi ! dit-il, il y en a beaucoup, n’est-ce pas ?
– Il y en a beaucoup, répondis-je en souriant. »
Car j’étais charmé de le trouver si aimable. C’était un petit homme, aux yeux brillants, avec un visage rougeaud et des cheveux tout hérissés ; il avait l’air très-avenant, le poing sur la hanche, et de l’autre main il tenait en l’air le verre plein d’ale.
« Il y avait bien ici un monsieur, dit-il, un gros monsieur qu’on nommait Topsawyer, peut-être le connaissez-vous ?
– Non, dis-je, je ne crois pas.
– En culotte courte et en guêtres, un chapeau à larges bords, un habit gris, un cache-nez à pois, dit le garçon.
– Non, dis-je avec embarras, je n’ai pas ce plaisir.
– Il est venu ici hier, dit le garçon en regardant la bière au jour, il a demandé un verre de cette ale, il l’a voulu absolument, je lui ai dit qu’il avait tort, il l’a bue et il est tombé mort. Elle était trop forte pour lui. On ne devrait plus en donner, voilà le fait. »
J’étais épouvanté de ce terrible accident, et je lui dis que je ferais peut-être mieux de ne boire qu’un verre d’eau.
« C’est que, voyez-vous, dit le garçon tout en regardant toujours la bière à la fenêtre, et en clignant de l’œil, on n’aime pas beaucoup ici qu’on laisse ce qu’on a commandé. Ça blesse mes maîtres. Mais moi, je peux la boire si vous voulez. J’y suis habitué, et l’habitude fait tout. Je ne crois pas que cela me fasse mal, pourvu que je renverse ma tête en arrière, et que j’avale lestement. Voulez-vous ? »
Je lui répondis qu’il me rendrait un grand service en la buvant, pourvu que cela ne pût pas lui faire de mal, sans cela je ne voulais pas en entendre parler. Quand il rejeta sa tête en arrière pour avaler lestement, je fus saisi, je l’avoue, d’une terrible frayeur ; je croyais que j’allais le voir tomber sans vie sur le parquet, comme le malheureux M. Topsawyer. Mais cela ne lui fit aucun mal. Au contraire, il ne m’en parut que plus frais et plus gaillard.
« Qu’avons-nous donc là ? dit-il en mettant sa fourchette dans mon plat. N’est-ce pas des côtelettes ?
– Des côtelettes, dis-je.
– Que Dieu me bénisse ! je ne savais pas que ce fussent des côtelettes, s’écria-t-il. C’est justement ce qu’il faut pour neutraliser les mauvais effets de cette bière. Quelle chance ! »
D’une main il saisit une côtelette, de l’autre il prit une pomme de terre, et mangea le tout du meilleur appétit à mon extrême satisfaction. Puis il prit une autre côtelette et une autre pomme de terre, et encore une autre pomme de terre et une autre côtelette. Quand nous eûmes fini, il m’apporta un pudding, et l’ayant placé devant moi, il se mit à ruminer en lui-même, et resta quelques instants absorbé dans ses réflexions.
« Comment trouvez-vous le pâté ? dit-il tout d’un coup.
– C’est un pudding, répondis-je.
– Un pudding ! s’écria-t-il. Oui, vraiment ! mais, dit-il en le contemplant de plus près, ne serait-ce pas un pudding aux fruits ?
– Oui, certainement.
– Et mais, dit-il en s’armant d’une grande cuiller, le pudding aux fruits est mon pudding favori, n’est-ce pas heureux ? Allons, mon petit homme, voyons qui de nous deux ira le plus vite. »
Le garçon fut certainement celui qui alla le plus vite. Il me supplia plus d’une fois de me dépêcher de gagner la gageure, mais il y avait une telle différence entre sa cuiller à ragoût et ma cuiller à café, entre son agilité et mon agilité, entre son appétit et mon appétit que je restai promptement en arrière. Je crois que je n’ai jamais vu personne aussi charmé d’un pudding ; il avait déjà fini qu’il riait encore de plaisir, comme s’il le savourait toujours.
Je le trouvai si complaisant et de si bonne humeur, que je la priai de me procurer une plume, du papier et de l’encre pour écrire à Peggotty. Non-seulement il me l’apporta immédiatement, mais encore il eut la bonté de regarder par-dessus mon épaule pendant que j’écrivais ma lettre. Quand j’eus fini, il me demanda où j’allais en pension.
« Près de Londres, lui dis-je. C’était tout ce que je savais.
– Oh ! mon Dieu, dit-il de l’air le plus triste, j’en suis désolé.
– Pourquoi donc ? lui demandai-je.
– Oh ! mon Dieu, dit-il en hochant la tête, c’est justement la pension où on a brisé les côtes d’un petit garçon, les deux côtes ; il était encore tout jeune. Il avait à peu près : voyons, quel âge avez-vous ? »
Je lui dis que j’avais huit ans et demi.
« Tout juste son âge, dit-il. Il avait huit ans et demi quand on lui a brisé sa première côte ; huit ans et huit mois quand on lui a brisé la seconde, et ma foi ! c’était fini. »
Je n’eus pas la force de me dissimuler, non plus qu’au garçon, que c’était une malheureuse coïncidence, et je lui demandai comment cela était arrivé. Sa réponse n’eut rien de consolant, car il ne me répondit que cette phrase épouvantable : « En le fouettant. »
Heureusement le son du cor qui rappelait tous les voyageurs vint faire diversion à mes inquiétudes. Je me levai et je demandai d’un ton moitié défiant, moitié orgueilleux, tout en tirant ma bourse, s’il y avait quelque chose à payer.
– Une feuille de papier à lettres, répondit-il. Avez-vous jamais acheté du papier à lettres ? »
Je n’en avais aucun souvenir.
« Il est cher, dit-il, à cause des droits : trois pence. Et voilà comment on nous taxe dans ce pays-ci. Il ne reste plus que le pourboire du garçon. Quant à l’encre, ce n’est pas la peine d’en parler, ce sont mes profits.
– Combien croyez-vous… Combien faut-il que… combien dois-je… combien serait-il convenable de donner pour le garçon, je vous prie ? balbutiai-je en rougissant.
– Si je n’avais pas une petite famille, et si cette petite famille n’avait pas la petite-vérole volante, je n’accepterais pas six pence, dit le garçon. Si je n’avais pas à soutenir une vieille mère et une charmante jeune sœur (ici le garçon parut vivement ému), je n’accepterais pas un farthing. Si j’avais une bonne place, et que je fusse bien traité ici, j’offrirais volontiers une bagatelle plutôt que de l’accepter. Mais je vis des restes… et je couche sur les sacs à charbon. » Ici le garçon fondit en larmes.
J’éprouvais la plus profonde pitié pour ses infortunes, et je sentais qu’il fallait avoir le cœur bien dur et bien brutal pour lui offrir moins de neuf pence. Je finis par lui donner un de mes trois beaux shillings ; il le reçut avec beaucoup d’humilité et de vénération, et la minute d’après il le fit sonner sur son ongle, pour voir si la pièce était bonne.
Je fus un peu déconcerté au moment de monter dans la voiture, lorsque je découvris qu’on me supposait capable d’avoir mangé le dîner tout entier à moi seul. Je m’en aperçus en entendant la dame qui était à la fenêtre, dire au conducteur : « Prenez garde, George, ou cet enfant va éclater en route ! » Les servantes de l’hôtel qui étaient dans la cour venaient me contempler comme un jeune phénomène et me rire au nez. Mon malheureux ami, le garçon de l’hôtel, qui avait tout à fait repris sa bonne humeur, ne paraissait nullement embarrassé, et prenait, sans la moindre confusion, part à l’admiration générale. Je ne sais pas si cela ne me donna pas quelques soupçons sur son compte, mais j’incline pourtant à penser que, plein comme je l’étais de cette confiance naturelle aux enfants et du respect qu’ils ont en général pour ceux qui sont plus âgés qu’eux (qualités que je suis toujours fâché de voir perdre trop tôt aux enfants pour prendre les habitudes du monde), je n’eus pas, même alors, de doutes sérieux sur son compte.
Je trouvais pourtant un peu dur, il faut que je l’avoue, de servir de point de mire aux plaisanteries continuelles du cocher et du conducteur, sur ce que mon poids faisait pencher la diligence d’un côté, ou que je ferais bien de voyager à l’avenir dans un fourgon. L’histoire de mon appétit supposé se répandit bientôt parmi les voyageurs de l’impériale qui s’en divertirent aussi infiniment ; ils me demandèrent si, à la pension où j’allais, on devait payer pour moi comme pour deux seulement ou pour trois ; si on avait fait des conditions particulières, ou bien si on me prenait au même prix que les autres enfants ; avec une foule d’autres questions du même genre. Mais ce qu’il y avait de pis, c’est que je savais que, lorsque l’occasion se présenterait, je n’aurais pas le courage de manger la moindre chose, et qu’après avoir fait un assez pauvre dîner, j’allais me laisser affamer toute la nuit, car dans ma précipitation j’avais oublié mes gâteaux à l’hôtel. Mes craintes furent bientôt réalisées. Lorsqu’on s’arrêta pour souper, je ne pus jamais trouver la force de m’asseoir à la table d’hôte, et j’allai, fort à contre-cœur, me mettre dans un coin près de la cheminée, en disant que je n’avais besoin de rien. Cela ne me mit pourtant pas à l’abri de nouvelles plaisanteries, car un monsieur à la voix enrouée et au visage enluminé, qui n’avait cessé de manger des sandwiches que pour boire d’une bouteille qu’il ne quittait guère, fit observer que j’étais comme le boa constrictor, qui mangeait assez à un repas pour pouvoir rester ensuite plusieurs jours à jeun ; après quoi, il se servit une énorme portion de bœuf bouilli.
Nous avions quitté Yarmouth à trois heures de l’après-midi, et nous devions arriver à Londres le lendemain matin à huit heures.
L’automne commençait, et la soirée était belle. Quand nous traversions un village, je cherchais à me représenter ce qui se passait dans l’intérieur des maisons, et ce que faisaient les habitants ; puis quand les petits garçons se mettaient à courir pour grimper derrière la diligence, je me demandais s’ils avaient encore leurs pères, et s’ils étaient heureux chez eux. J’avais donc beaucoup de sujets de réflexion, sans compter que je songeais sans cesse à l’endroit de ma destination, triste sujet de méditation. Quelquefois aussi, je me le rappelle, je me laissais aller à penser à la maison de ma mère et à Peggotty ; ou j’essayais confusément de me rappeler comment j’étais avant d’avoir mordu M. Murdstone, mais je ne pouvais jamais réussir, tant il me semblait que tout cela datait de l’antiquité la plus reculée.
La nuit ne fut pas aussi agréable que la soirée ; il faisait froid. Comme on m’avait casé entre deux messieurs (celui qui avait la figure enluminée et un autre) de peur que je ne glissasse des banquettes, ils manquaient à chaque instant de m’étouffer en dormant et me tenaient comme dans un étau. J’étais parfois tellement écrasé que je ne pouvais m’empêcher de crier : « Oh ! je vous en prie ! » ce qui leur déplaisait fort, parce que cela les réveillait. En face de moi était assise une vieille dame avec un grand manteau de fourrure, qui avait l’air, dans l’obscurité, plutôt d’une meule de foin que d’une femme, tant elle était empaquetée. Cette dame avait un panier, et pendant longtemps elle n’avait su où le fourrer ; elle découvrit enfin qu’elle pourrait le glisser sous mes jambes qui étaient très-courtes. Ce panier me mettait à la torture ; il me cognait et me meurtrissait les jarrets ; mais au moindre mouvement que je faisais, le verre contenu dans le panier allait se choquer contre un autre objet, et la vieille dame me donnait un terrible coup de pied, tout en disant :
« Allez-vous vous tenir tranquille ! vous êtes bien peu endurant pour votre âge. »
Enfin, le soleil se leva, et mes compagnons de route eurent un sommeil moins agité. On ne saurait dépeindre toutes les angoisses qui les avaient oppressés durant la nuit, et qui se manifestaient par des ronflements épouvantables. À mesure que le soleil s’élevait à l’horizon, leur sommeil devenait moins profond, et peu à peu ils se réveillèrent tous l’un après l’autre. Je me souviens que je fus bien surpris de les voir tous soutenir qu’ils n’avaient pas dormi une minute, et repousser cette insinuation avec la plus vive indignation. J’en suis encore étonné à l’heure qu’il est, et je n’ai jamais pu m’expliquer comment, de toutes les faiblesses humaines, celle que nous sommes tous le moins disposés à confesser (je vous demande un peu pourquoi), c’est la faiblesse d’avoir pu dormir en voiture.
Je n’ai pas besoin de raconter ici quelle étrange ville me parut Londres lorsque je l’aperçus dans le lointain, ni comment je me figurais que les aventures de mes héros favoris se renouvelaient à chaque instant dans cette grande cité, pleine à mes yeux de plus de merveilles et de plus de crimes que toutes les villes de la terre. Nous arrivâmes enfin à un hôtel situé sur la paroisse de White-Chapel, où nous devions nous arrêter. J’ai oublié si c’était le Taureau-Bleu ou le Sanglier-Bleu, mais ce que je sais, c’est que c’était un animal bleu, et que cet animal était aussi représenté sur le derrière de la diligence.
Le conducteur fixa les yeux sur moi en descendant, et dit à la porte du bureau :
« Y a-t-il ici quelqu’un qui demande un jeune garçon inscrit au registre sous le nom de Murdstone, venant de Blunderstone, Suffolk, et qui était attendu ? Qu’on le vienne réclamer. »
Personne ne répondit.
« Essayez de Copperfield, monsieur, je vous prie, dis-je en baissant piteusement les yeux.
– Y a-t-il ici quelqu’un qui demande un jeune garçon inscrit au registre sous le nom de Murdstone, venant de Blunderstone, Suffolk, mais qui répond au nom de Copperfield, et qui doit attendre qu’on le vienne réclamer ? dit le conducteur. Parlez ! y a-t-il quelqu’un ? »
Non, il n’y avait personne. Je regardai avec inquiétude tout autour de moi, mais cette question répétée n’avait pas fait la moindre impression sur ceux qui étaient présents, sauf sur un homme à longues guêtres, qui n’avait qu’un œil, et qui suggéra qu’on ferait bien de me mettre un collier de cuivre et de m’attacher à un poteau dans l’étable, comme aux chiens perdus. On plaça une échelle, et je descendis après la dame qui ressemblait à une meule de foin : je ne me permis de bouger que lorsqu’elle eut enlevé son panier. Tous les voyageurs eurent promptement quitté leurs places ; on descendit tous les bagages, et les garçons d’écurie firent rentrer la diligence sous la remise. Et cependant personne ne paraissait pour réclamer l’enfant tout poudreux qui venait de Blunderstone, Suffolk.
Plus solitaire que Robinson Crusoé, qui du moins n’avait près de lui personne pour venir l’observer et remarquer qu’il était solitaire, j’entrai dans le bureau de la diligence, et sur l’invitation du commis, je passai derrière le comptoir, et je m’assis sur la balance où on pesait les bagages. Là, tandis que j’étais assis au milieu des paquets, des livres et des ballots, respirant le parfum des écuries (qui s’associera éternellement dans ma mémoire avec cette matinée), je fus assailli par une foule de réflexions toutes plus lugubres les unes que les autres. À supposer qu’on ne vint jamais me chercher, combien de temps consentirait-on à me garder là où j’étais ? Me garderait-on assez longtemps pour qu’il ne me restât plus rien de mes sept shillings ? Est-ce que je passerais la nuit dans un de ces compartimente en bois avec le reste des bagages ? Faudrait-il me laver tous les matins à la pompe de la cour ? Ou bien me renverrait-on tous les soirs et serais-je obligé de revenir tous les matins jusqu’à ce qu’on vînt me chercher ? Et si ce n’était pas une erreur ; si M. Murdstone avait inventé ce plan pour se débarrasser de moi, que deviendrais-je ? Si on me permettait de rester là jusqu’à ce que j’eusse dépensé mes sept shillings, je ne pouvais toujours pas espérer d’y rester lorsque je commencerais à mourir de faim. Cela serait évidemment gênant et désagréable pour les pratiques, et de plus cela exposerait le je ne sais quoi bleu à avoir à payer les frais de mon enterrement. Si je me mettais immédiatement en route et que je tentasse de retourner chez ma mère, comment pourrais-je marcher jusque-là ? Et d’ailleurs étais-je sûr d’être bien accueilli par d’autres que par Peggotty, lors même que je réussirais à arriver ? Si j’allais m’offrir aux autorités voisines comme soldat ou comme marin, j’étais un si petit bonhomme qu’il était bien probable qu’on ne voudrait pas de moi. Ces pensées, jointes à un millier d’autres, me faisaient monter le rouge au visage, et je me sentais tout étourdi de crainte et d’émotion. J’étais dans cet état violent lorsqu’entra un homme qui murmura quelques mots à l’oreille du commis ; celui-ci me tira vivement de la balance et me poussa vers le nouveau venu comme un colis pesé, acheté, payé, enlevé.
En sortant du bureau, la main dans celle de ma nouvelle connaissance, je me hasardai à jeter les yeux sur mon conducteur. C’était un jeune homme au teint jaune, à l’air dégingandé, aux joues creuses, avec un menton presque aussi noir que celui de M. Murdstone ; mais là cessait la ressemblance, car ses favoris étaient rasés, et ses cheveux, au lieu d’être luisants, étaient rudes et secs. Il portait un habit et un pantalon noirs, un peu secs et râpés aussi ; l’habit ne descendait pas jusqu’au poignet ni le pantalon jusqu’à la cheville de leur propriétaire ; sa cravate blanche n’était pas d’une propreté exagérée. Je n’ai jamais cru, et je ne veux pas croire encore, que cette cravate fût tout le linge qu’il avait sur lui, mais c’était au moins tout ce qu’il en laissait entrevoir.
« Vous êtes le nouvel élève ? me dit-il.
– Oui, monsieur, » lui dis-je. Je le supposais. Je n’en savais rien.
« Je suis l’un des maîtres d’études de la pension Salem, » me dit-il.
Je le saluai, j’étais terrifié. Je n’osais faire la moindre allusion à une chose aussi vulgaire que ma malle en présence du savant maître de Salem-House ; ce ne fut que lorsque nous fûmes sortis de la cour que j’eus la hardiesse d’en faire mention. Nous revînmes sur nos pas, d’après mon observation très-humble qu’elle pourrait plus tard m’être utile, et il dit au commis que le voiturier devait venir la prendre à midi.
« Monsieur, lui dis-je, lorsque nous eûmes fait à peu près le même trajet, auriez-vous la bonté de me dire si c’est bien loin ?
– C’est du côté de Blackheath, me dit-il.
– Est-ce loin, monsieur ? demandai-je timidement.
– Il y a un bon bout de chemin, dit-il ; nous irons par la diligence ; on compte environ six milles. »
Je me sentais si las et si épuisé, que l’idée de faire encore six milles sans me restaurer était au-dessus de mes forces. Je m’enhardis jusqu’à lui dire que je n’avais pris absolument rien pendant toute la nuit, et que je lui serais très-reconnaissant s’il voulait bien me permettre d’acheter quelque chose pour manger. Il parut surpris (je le vois encore s’arrêter et me regarder) ; après avoir réfléchi un instant, il me dit qu’il avait besoin de s’arrêter chez une vieille femme qui habitait près de là, et que ce que j’aurais de mieux à faire, ce serait d’acheter un peu de pain, ou toute autre nourriture à mon choix, pourvu qu’elle fût saine, et de déjeuner chez cette personne qui me procurerait du lait.
Nous nous rendîmes chez un boulanger, où, après avoir jeté mon dévolu sur une foule de petits gâteaux succulents qu’il refusa de me laisser prendre les uns après les autres, nous finîmes par nous décider pour un bon petit pain de seigle qui me coûta trois pence. Plus loin, nous achetâmes un œuf et une tranche de lard fumé ; tout cela me laissa encore possesseur de pas mal de petite monnaie sur mon second shilling que j’avais changé, ce qui me fit penser que Londres était un endroit où l’on vivait à très-bon marché. Lorsque nous eûmes fait nos provisions, nous traversâmes, au milieu d’un tapage et d’un mouvement qui troublaient singulièrement ma pauvre tête, un pont, London-Bridge sans doute (je crois même qu’il me le dit, mais j’étais à moitié endormi), et enfin nous arrivâmes chez la vieille femme qui logeait dans un hospice, comme je pus le voir à l’apparence du bâtiment et aussi à l’inscription placée au-dessus de la grille, qui disait que cette maison avait été fondée pour vingt-cinq femmes pauvres.
Le maître d’études de Salem-House leva le loquet d’une de ces portes noires qui se ressemblaient toutes : d’un côté il y avait une fenêtre à petits carreaux, et au-dessus de la porte une autre fenêtre à petits carreaux ; nous entrâmes dans la maison d’une de ces pauvres vieilles femmes, qui soufflait son feu sur lequel était placée une petite casserole. En voyant entrer mon conducteur, la vieille femme cessa de souffler, et dit quelque chose comme : « Mon Charles ! » Mais en me voyant entrer après lui, elle se leva, et fit en se frottant les mains une espèce de révérence embarrassée.
« Pouvez-vous faire cuire le déjeuner de ce jeune monsieur, je vous prie, dit le maître d’études de Salem-House.
– Si je le peux ? dit la vieille femme ; mais oui, certainement.
– Comment va mistress Fibbitson aujourd’hui ? » dit le maître d’études en regardant une autre vieille femme assise sur une grande chaise près du feu ; elle avait si bien l’air d’un paquet de vieux chiffons, qu’à l’heure qu’il est je me félicite encore de ce que je n’ai pas commis l’erreur de m’asseoir dessus.
« Ah ! elle ne va pas trop bien, dit la première vieille femme ; elle est dans un de ses mauvais jours. Je crois vraiment que, si par malheur le feu s’éteignait, elle s’éteindrait avec lui pour ne plus jamais revenir à la vie. »
Ils la regardaient tous deux, je fis de même. Bien qu’il fît très-chaud dehors, elle semblait ne songer à rien au monde qu’au feu. Je crois même qu’elle était jalouse de la casserole, et j’ai quelque soupçon qu’elle lui en voulait de lui cacher le feu pour faire cuire mon œuf et frire mon lard, car je la vis me montrer le poing quand tout le monde avait le dos tourné, pendant ces opérations culinaires. Le soleil entrait par la petite fenêtre, mais elle lui tournait le dos, et, assise dans sa grande chaise qui tournait aussi le dos au soleil, elle semblait couver le feu comme pour lui tenir chaud, au lieu de s’y chauffer elle-même, et elle le surveillait d’un œil méfiant. Lorsqu’elle vit que les préparatifs de mon déjeuner touchaient à leur terme et que le feu allait enfin être délivré, elle éclata de rire dans sa joie, et je dois dire que son rire était loin d’être mélodieux.
Je m’assis en face de mon pain de seigle, de mon œuf, de ma tranche de lard, auxquels s’était ajoutée une jatte de lait, et je fis un repas délicieux. J’étais encore à l’œuvre, lorsque la vieille femme qui habitait la maison, dit au maître d’études :
« Avez-vous votre flûte sur vous ?
– Oui, répondit-il.
– Jouez-en donc un petit air, dit la vieille femme ; d’un ton suppliant. Je vous en prie. »
Le maître d’études mit la main sous les pans de son habit, et sortit les trois morceaux d’une flûte qu’il remonta, puis il se mit immédiatement à jouer. Mon opinion, après bien des années de réflexions, c’est que personne au monde n’a jamais pu jouer aussi mal. Il en tirait les sons les plus épouvantables que j’aie entendus, naturels ou artificiels. Je ne sais quel air il jouait, si tant est que ce fussent des airs, ce dont je doute, mais le résultat de cette mélodie fut primo, de me faire songer à toutes mes peines, au point de me faire venir les larmes aux yeux ; secondo, de m’ôter complètement l’appétit, et tertio, de me donner une telle envie de dormir que je ne pouvais tenir mes yeux ouverts. Le seul souvenir de cette musique m’assoupit encore. Je revois la petite chambre avec l’armoire du coin entr’ouverte, les chaises au dossier perpendiculaire, et le petit escalier à pic qui conduisait à une autre petite chambre au premier, enfin les trois plumes de paon qui ornaient le manteau de la cheminée ; je me souviens, qu’en entrant, je me demandais si le paon serait bien flatté de voir ses belles plumes condamnées à cet emploi, mais tout cela disparaît peu à peu devant moi, ma tête se penche, je dors. La flûte ne se fait plus entendre, c’est le son des roues qui retentit à mon oreille ; je suis en voyage ; la diligence s’arrête, je me réveille en sursaut, et voilà de nouveau la flûte ; le maître d’études de Salem-House en joue d’un air lamentable, et la vieille femme l’écoute avec ravissement. Mais elle disparaît à son tour, puis il disparaît aussi, enfin tout disparaît, il n’y a plus ni de flûte, ni de maître d’études, ni de Salem-House, ni de David Copperfield, il n’y a qu’un profond sommeil.
Je rêvais probablement, lorsque je crus voir, tandis qu’il soufflait dans cette épouvantable flûte, la vieille maîtresse du logis qui s’était approchée de lui dans son enthousiasme, se pencher tout d’un coup sur le dossier de sa chaise, et prendre sa tête dans ses bras pour l’embrasser ; un instant la flûte s’arrêta. J’étais apparemment entre la veille et le sommeil, alors et quelque temps après, car, lorsqu’il recommença à jouer, (ce qu’il y a de sûr c’est qu’il s’était interrompu un instant), je vis et j’entendis la susdite vieille femme demander à mistress Fibbitson si ce n’était pas délicieux (en parlant de la flûte), à quoi mistress Fibbitson répondit, « oui, oh oui ! » et se pencha vers le feu, auquel elle rapportait, j’en suis sûr tout l’honneur de cette jolie musique.
Il y avait déjà longtemps que j’étais endormi, je crois, lorsque le maître d’études de Salem-House démonta sa flûte, mit dans sa poche les trois pièces qui la composaient, et m’emmena. Nous trouvâmes la diligence tout près de là, et nous montâmes sur l’impériale, mais j’avais tellement envie de dormir que, lorsqu’on s’arrêta sur la route pour prendre d’autres voyageurs, on me mit dans l’intérieur où il n’y avait personne, et là je dormis profondément, jusqu’à une longue montée que les chevaux gravirent au pas entre de grands arbres. Bientôt la diligence s’arrêta ; elle avait atteint sa destination.
Après quelques minutes de marche, nous arrivâmes, le maître d’études et moi, à Salem-House ; un grand mur de briques formait l’enceinte, et le tout avait l’air fort triste. Sur une porte pratiquée dans le mur était placé un écriteau où on lisait : Salem-House. Nous vîmes bientôt paraître, à une petite ouverture près de la porte, un visage maussade, qui appartenait à ce que je vis, lorsque la porte nous fut ouverte, à un gros homme, avec un cou énorme comme celui d’un taureau, une jambe de bois, un front bombé, et des cheveux coupés ras tout autour de la tête.
« C’est le nouvel élève, » dit le maître d’études.
L’homme à la jambe de bois m’examina de la tête aux pieds, ce qui ne fut pas long, car je n’étais pas bien grand, puis il referma la porte derrière nous, et prit la clef. Nous nous dirigions vers la maison, au milieu de grands arbres au feuillage sombre, quand il appela mon conducteur.
« Holà ! »
Nous nous retournâmes ; il était debout à la porte de la petite loge, où il demeurait, une paire de bottes à la main.
« Dites donc ! le savetier est venu depuis que vous êtes sorti, monsieur Mell, et il dit qu’il ne peut plus du tout les raccommoder. Il prétend qu’il ne reste pas un seul morceau de la botte primitive, et qu’il ne comprend pas que vous puissiez lui demander de les réparer. »
En parlant ainsi il jeta les bottes devant M. Mell, qui retourna quelques pas en arrière pour les ramasser, et qui les regarda de l’air le plus lamentable, en venant me retrouver. J’observai alors, pour la première fois, que les bottes qu’il portait étaient fort usées, et qu’il y avait même un endroit par où son bas sortait, comme un bourgeon qui veut percer l’écorce ?
Salem-House était un bâtiment carré bâti en briques avec deux pavillons sur les ailes, le tout d’une apparence nue et désolée. Tout ce qui l’entourait était si tranquille que je dis à M. Mell que probablement les élèves étaient en promenade, mais il parut surpris de ce que je ne savais pas qu’on était en vacances, et que tous les élèves étaient chez leurs parents, M. Creakle, le maître de pension, était au bord de la mer avec Mme et miss Creakle, et quant à moi, on m’envoyait en pension durant les vacances pour me punir de ma mauvaise conduite, comme il me l’expliqua tout du long en chemin.
Il me mena dans la salle d’études ; jamais je n’avais vu un lieu si déplorable ni si désolé. Je la revois encore à l’heure qu’il est. Une longue chambre, avec trois longues rangées de bancs et des champignons pour accrocher les chapeaux et les ardoises. Des fragments de vieux cahiers et de thèmes déchirés jonchent le plancher. Il y en a d’autres sur les pupitres qui ont servi à loger des vers à soie. Deux malheureuses petites souris blanches, abandonnées par leur propriétaire, parcourent du haut en bas une fétide petite forteresse construite en carton et en fil de fer, et leurs petits yeux rouges cherchent dans tous les coins quelque chose à manger. Un oiseau, enfermé dans une cage à peine plus grande que lui, fait de temps à autre un bruit monotone, en sautant sur son perchoir, de deux pouces de haut, ou en redescendant, sur son plancher, mais il ne chante ni ne siffle. Par toute la chambre, il règne une odeur malsaine, composé étrange, à ce qu’il me semble, de cuir pourri, de pommes renfermées et de livres moisis. Il ne saurait y avoir plus d’encre répandue dans toute cette pièce, lors même que les architectes auraient oublié d’y mettre une toiture, et que, pendant toute l’année, le ciel y aurait fait pleuvoir, neiger, ou grêler de l’encre.
M. Mell me quitta un moment, pour remonter ses bottes irréparables ; je m’avançai timidement vers l’autre bout de la chambre, tout en observant ce que je viens de décrire. Tout à coup j’arrivai devant un écriteau en carton, posé sur un pupitre ; on y lisait ces mots écrits en grosses lettres : « Prenez garde. Il mord. »
Je grimpai immédiatement sur le pupitre, persuadé que dessous il y avait au moins un gros chien. Mais j’avais beau regarder tout autour de moi avec inquiétude, je ne l’apercevais pas. J’étais encore absorbé dans cette recherche, lorsque M. Mell revint, et me demanda ce que je faisais là-haut.
« Je vous demande bien pardon, monsieur, mais je regarde où est le chien.
– Le chien ! dit-il, quel chien ?
– N’est-ce pas un chien, monsieur ?
– Quoi ? qu’est-ce qui n’est pas un chien ?
– Cet animal auquel il faut prendre garde, monsieur, parce qu’il mord.
– Non, Copperfield, dit-il gravement, ce n’est pas un chien. C’est un petit garçon. J’ai pour instruction, Copperfield, de vous attacher cet écriteau derrière le dos. Je suis fâché d’avoir à commencer par là avec vous, mais il le faut. »
Il me fit descendre et m’attacha derrière le dos, comme une giberne, l’écriteau bien adapté pour ce but, et partout où j’allais ensuite j’eus la consolation de le transporter avec moi.
Ce que j’eus à souffrir de cet écriteau, personne ne peut le deviner. Qu’il fût possible de me voir ou non, je me figurais toujours que quelqu’un était là à le lire ; ce n’était pas un soulagement pour moi que de me retourner et de ne voir personne, car je me figurais toujours qu’il y avait quelqu’un derrière mon dos. La cruauté de l’homme à la jambe de bois aggravait encore mes souffrances ; c’était lui qui était le mandataire de l’autorité, et toutes les fois qu’il me voyait m’appuyer le dos contre un arbre ou contre le mur, ou contre la maison, il criait de sa loge d’une voix formidable : « Hé ! Copperfield ! faites voir la pancarte, ou je vous donne une mauvaise note. » L’endroit où l’on jouait était une cour sablée, placée derrière la maison, en vue de toutes les dépendances, et je savais que les domestiques lisaient ma pancarte, que le boucher la lisait, que le boulanger la lisait, en un mot que tous ceux qui entraient ou qui sortaient le matin, tandis que je faisais ma promenade obligée, lisaient sur mon dos qu’il fallait prendre garde à moi parce que je mordais. Je me rappelle que j’avais fini positivement par avoir peur de moi comme d’une espèce d’enfant sauvage qui mordait.
Il y avait dans cette cour de récréation une vieille porte sur laquelle les élèves s’étaient amusés à sculpter leurs noms ; elle était complètement couverte de ce genre d’inscriptions. Dans ma terreur de voir arriver la fin des vacances qui ramènerait tous les élèves, je ne pouvais lire un seul de ces noms sans me demander de quel ton et avec quelle expression il lirait : « Prenez garde, il mord. » Il y en avait un, un certain Steerforth qui avait gravé son nom très-souvent et très-profondément. « Celui-là, me disais-je, va lire cela de toutes ses forces et puis il me tirera les cheveux. » Il y en avait un autre nommé Tommy Traddles ; je me figurais qu’il se ferait un amusement de m’approcher par mégarde, et de se reculer avec l’air d’avoir grand’peur. Quant au troisième, George Demple, je l’entendais chanter mon inscription. Enfin, dans ma frayeur, je contemplais en tremblant cette porte, jusqu’à ce qu’il me semblât entendre tous les propriétaires de ces noms (il y en avait quarante-cinq, à ce que me dit M. Mell) crier en chœur qu’il fallait m’envoyer à Coventry, et répéter, chacun à sa manière : « Prenez garde, il mord. »
Et de même pour les pupitres et les bancs, de même pour les lits solitaires que j’examinais le soir quand j’étais couché. Toutes les nuits j’avais des rêves où je voyais tantôt ma mère telle qu’elle était jadis, tantôt l’intérieur de M. Peggotty ; ou bien je voyageais sur l’impériale de la diligence, ou je dînais avec mon malheureux ami le garçon d’hôtel ; et partout je voyais tout le monde me regarder d’un air effaré ; on venait de s’apercevoir que je n’avais pour tout vêtement que ma chemise de nuit et mon écriteau.
Cette vie monotone et la frayeur que me causait la fin prochaine des vacances, me causaient une affliction intolérable. J’avais chaque jour de longs devoirs à faire pour M. Mell, mais je les faisais (M. Murdstone et sa sœur n’étaient plus là), et je ne m’en tirais pas mal. Avant et après mes heures d’étude je me promenais, sous la surveillance, comme je l’ai déjà dit, de l’homme à la jambe de bois. Je me rappelle encore, comme si j’y étais, tout ce que je voyais dans ces promenades, la terre humide autour de la maison, les pierres couvertes de mousse dans la cour, la vieille fontaine toute fendue et les troncs décolorés de quelques arbres ratatinés qui avaient l’air d’avoir reçu plus de pluie et moins de rayons de soleil que tous les arbres du monde ancien et moderne. Nous dînions à une heure, M. Mell et moi, au bout d’une longue salle à manger parfaitement nue, où on ne voyait que des tables de sapin qui sentaient le graillon, et puis nous nous remettions à travailler jusqu’à l’heure du thé ; M. Mell buvait son thé dans une petite tasse bleue, et moi dans un petit pot d’étain. Pendant toute la journée et jusqu’à sept ou huit heures du soir, M. Mell était établi à son pupitre dans la salle d’études ; il s’occupait sans relâche à faire les comptes du dernier semestre, sans quitter sa plume, son encrier, sa règle et ses livres. Quand il avait tout rangé le soir, il tirait sa flûte et soufflait dedans avec une telle énergie que je m’attendais à tout moment à le voir passer par le grand trou de son instrument, jusqu’à son dernier souffle, et à le voir fuir par les clefs.
Je me vois encore, pauvre petit enfant que j’étais alors, la tête dans mes mains au milieu de la pièce à peine éclairée, écoutant la douloureuse harmonie de M. Mell tout en méditant sur mes leçons du lendemain ; je me vois également, mes livres fermés à côté de moi, prêtant toujours l’oreille à la douloureuse harmonie de M. Mell, et croyant entendre à travers ces sons lamentables le bruit lointain de la maison paternelle et le sifflement du vent sur les dunes de Yarmouth. Ah ! combien je me sens isolé et triste ! je me vois montant me coucher dans des chambres presque désertes, et pleurant dans mon petit lit au souvenir de ma chère Peggotty ; je me vois descendant l’escalier le lendemain matin et regardant, par un carreau cassé de la lucarne qui l’éclaire, la cloche de la pension suspendue tout en haut d’un hangar, avec une girouette par dessus ; je la contemple et je songe avec effroi au temps où elle appellera à l’étude Steerforth et ses camarades, et pourtant j’ai encore bien plus peur du moment fatal où l’homme à la jambe de bois ouvrira la grille aux gonds rouillés pour laisser passer le redoutable M. Creakle. Je ne crois pas avec tout cela que je sois un très-mauvais sujet, mais je n’en porte pas moins le placard toujours sur mon dos.
M. Mell ne me disait pas grand’chose, mais il n’était pas méchant avec moi ; je suppose que nous nous tenions mutuellement compagnie sans nous parler. J’ai oublié de dire qu’il se parlait quelquefois à lui-même, et qu’alors il grinçait des dents, il serrait les poings et il se tirait les cheveux de la façon la plus étrange ; mais c’était une habitude qu’il avait comme ça. Dans les commencements cela me faisait peur, mais je ne tardai pas à m’y faire.