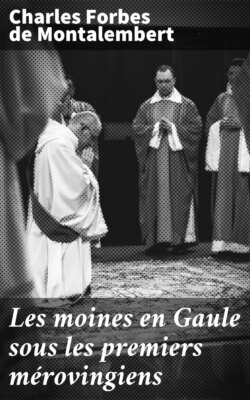Читать книгу Les moines en Gaule sous les premiers mérovingiens - Charles Forbes De Montalembert - Страница 4
La Gaule conquise par les Francs.
ОглавлениеÉtat de la Gaule sous l’empire romain. — Bienfaits relatifs de l’invasion des barbares. — Les Francs arrêtent et refoulent les autres barbares. — Caractères de la domination des Francs dans la Gaule: égalité des Gaulois et des Francs. — Contact funeste de la barbarie franque avec la dépravation des Gallo-Romains. — La noblesse des deux races tient tète aux rois, qui penchent vers l’autocratie et la fiscalité romaines. — Les Francs échappent seuls à l’arianisme: ils respectent la liberté de la foi. — Munificence des Mérovingiens envers les monastères, étrangement mêlée à leurs vices et à leurs crimes. — Les moines viennent assurer l’influence civilisatrice de l’Église sur les Francs.
Nous allons concentrer notre récit dans la Gaule, dans cette contrée où Marmoutier et Lérins; Condat et d’autres grandes fondations n’avaient pas suffi pour épuiser la séve monastique, et que la Providence destinait à fournir au grand arbre bénédictin ses rameaux les plus vigoureux et les plus féconds.
Clovis avait commencé à régner sur les Francs saliens en l’année même où naissait saint Benoît, et pendant toute la durée de la vie du patriarche, la Gaule, disputée par les Francs aux Goths et aux Burgondes, avait de plus en plus subi la puissante étreinte des Mérovingiens et de leurs bandes conquérantes. On sait quels furent les maux qui accompagnèrent cette conquête. Mais ce qu’il faut encore moins oublier, c’est l’état où la domination romaine avait réduit la Gaule quand les Francs, venus les derniers après tant d’autres barbares, en firent leur proie. Sous les empereurs, Rome avait porté la corruption dans toutes les provinces du monde conquis sous la république. On voit dans Tacite que le siége de toute administration romaine était une école permanente d’oppression et de dépravation où régnaient l’avarice et la sensualité, toujours insatiables et toujours impunies. De ces vieux Gaulois qui avaient inondé l’Espagne, l’Italie, la Grèce et jusqu’à l’Asie Mineure; qui avaient rempli le monde du fracas de leurs armes et de la terreur de leur nom; qui avaient conquis Rome; que Rome avait ensuite vaincus et asservis, mais qu’elle n’avait ni surpassés ni même égalés en héroïsme et en grandeur d’âme, de ces hommes-la il ne restait rien. La tyrannie des Césars les avait anéantis. En vain leurs fils s’étaient-ils soulevés contre Auguste, contre Tibère, contre Néron, contre Vespasien, et avaient-ils protesté ainsi contre la prétendue amélioration du sort des provinces romaines sous l’empire. En vain, de siècle en siècle, la Gaule, désespérant de retrouver son indépendance, avait-elle essayé de tromper sa misère en imposant à Rome des empereurs gaulois. En vain les Bagaudes insurgés et à moitié chrétiens avaient-ils pensé à substituer une sorte d’empire gaulois à l’empire romain. Broyée sous la meule implacable de la centralisation et de la fiscalité impériales, la Gaule avait perdu successivement sa nationalité, ses institutions civiles et municipales, sa richesse territoriale, sa vieille langue celtique et jusqu’à son nom: on ne connaissait plus ses habitants que sous le nom de Romains, devenu pour eux le symbole de la décrépitude et de la honte. A la place du vieux culte national, des sacrifices druidiques interdits sous peine de mort, on lui avait imposé la hideuse idolâtrie des Césars divinisés par un sénat avili. Cet indomptable courage qui les avait naguère signalés à l’admiration du monde avait disparu avec leur liberté. Les classes dominantes avaient été asservies et dégradées sans que le bas peuple y eût rien gagné : tout au contraire, à mesure que la grande propriété s’était étendue, les cultivateurs avaient vu leur sort s’aggraver et la servitude universelle faire peser sur eux le joug le plus écrasant. Les clients libres dont parle César avaient disparu. Le chef gaulois, transformé en patricien dégénéré, faisait cultiver par ses esclaves de vastes domaines qu’il n’habitait guère, semblables aux plantations de nos colonies avant l’émancipation des noirs. De cette immense population qui, avant la conquête de César et ses guerres d’extermination, débordait en flots pressés par l’émigration sur les contrées voisines, on a calculé qu’il restait à peine, sous Constantin, un million d’hommes libres dans toute cette immense région.
Sous cette effroyable oppression, l’Église restait debout, seul asile de la liberté et de la dignité humaines. Elle seule mettait quelque frein à l’injustice et à la tyrannie, mitigeait la pauvreté accablante du peuple, encourageait l’agriculture dans ses domaines, maintenait dans son sein le souvenir et la pratique de l’élection populaire, et assurait dans la personne de ses évêques des défenseurs aux cités abandonnées ou rançonnées par leurs magistrats. Mais son influence, bien loin d’être prépondérante, ne luttait qu’imparfaitement contre la décomposition universelle et ne suffisait point à enfanter les vertus civiques étouffées avec les cités libres sous le despotisme cosmopolite des empereurs. Dans l’ordre civil, quatre siècles de domination romaine avaient suffi pour faire disparaître en Gaule toute force et tout droit, en même temps que toute indépendance nationale et personnelle. Comment ces populations, avilies et épuisées par un régime dont la tyrannie inepte et minutieuse croissait en raison de sa faiblesse, eussent-elles pu résister aux flots successifs des barbares? Seule l’aristocratie arverne, que semblait animer encore le souffle du grand Vercingétorix et qui avait conservé, on ne sait comment, la sympathie populaire, lutta avec l’opiniâtreté du désespoir contre les Visigoths d’abord, puis contre les fils de Clovis. Partout ailleurs la domination barbare fut acceptée comme une sorte de délivrance.
C’en était une en effet, car les peuples germains apportaient avec eux l’énergie virile qui manquait aux serfs de l’empire. La vie s’était retirée de partout: ils en inspirèrent une nouvelle au sol qu’ils envahissaient comme aux hommes qu’ils incorporaient à leur domination victorieuse. Ce qu’il restait du patriciat gaulois dut les voir arriver avec effroi; mais qu’avaient à perdre les colons ruraux et les petites gens des villes à ce changement de maître? Tout au contraire, ils ne pouvaient que gagner à la destruction de cette fiscalité romaine, la plus rapace qu’on ait jamais rêvée. Prendre pour soi une quote-part, la moitié ou le tiers, des biens fonciers ou des esclaves, comme firent les Burgondes et les Visigoths, mais en même temps exempter tout le reste des exactions qui, sous les Romains, réduisaient les propriétaires à abandonner au fisc tout leur avoir, c’était évidemment apporter un soulagement réel à un état de tout point insupportable .
Quant aux Francs, rien n’indique qu’ils aient opéré des confiscations en masse. Les découvertes de l’érudition moderne ont au contraire établi qu’ils avaient généralement respecté la propriété privée des Gallo-Romains. Ils se contentèrent, selon toute apparence, des territoires qui leur avaient été d’abord concédés par les empereurs, puis des vastes espaces de terrain inculte délaissés par suite de l’appauvrissement universel, qu’ils se partagèrent entre eux par le sort, à titre d’alleux, tandis que leurs rois s’attribuaient les domaines incommensurables du fisc impérial. Ajoutons qu’en expulsant les magistrats romains ils semblent s’être peu immiscés dans l’administration municipale et y avoir laissé aux évêques la principale part, et l’on concevra que le plus récent de nos historiens ait pu affirmer que la masse populaire avait plus d’horreur pour l’oppression savante et systématique de l’empire que pour le régime brutal et capricieux des barbares.
En outre, les Romains de l’empire, comme on l’a souvent remarqué, avaient transporté en Gaule le principe qui leur était propre, le principe fatal de la suprématie des villes. Les Germains, au contraire, dans leur état primitif, ne connaissaient que la vie des champs, la vie rurale et sylvaine. Le village était, comme cela se voit encore dans l’Inde, la base de leur existence nationale. En venant conquérir la Gaule, ils rendirent la vie aux campagnes; ils y créèrent le village, la commune rurale et libre, et les émancipèrent de la domination urbaine; ils y constituèrent l’élément prépondérant de la nouvelle nationalité. Cette prépondérance ne fit que se manifester et se consolider de plus en plus, à mesure que la féodalité se développa et s’enracina dans le sol.
Les Francs, d’ailleurs, rendirent à la Gaule le service capital qu’elle attendait en vain des derniers empereurs: Saint Jérôme nous a laissé la formidable énumération des nations barbares qui l’avaient envahie sous la domination impériale. «Tout ce qui se trouve entre les Alpes et les Pyrénées, entre le Rhin et l’Océan, a été dévasté par le Quade, le Vandale, le Sarmate, l’Alain, le Gépide, l’Hérule, le Burgonde, l’Aleman et, ô calamité suprême, par le Hun!» Venus après tous ces féroces prédécesseurs, qui tous, excepté les Burgondes, n’avaient fait que passer sur la Gaule comme un ouragan, les Francs en fermèrent l’accès aux autres peuples païens qui se pressaient sur leurs pas. Ils se retournèrent contre le courant qui les avait eux-mêmes apportés. Ils tinrent vigoureusement tête aux Alemans, aux Saxons, aux Slaves, aux Avares, qui, sans eux, auraient franchi le Rhin et envahi la Gaule. Devenus chrétiens, non pas en masse et tout à coup, à la suite de Clovis, comme on se l’est à tort figuré, mais très-graduellement et très-lentement, ils firent face aux ennemis de la chrétienté. Ils restèrent, longtemps après leur conversion, sauvages, avides et cruels comme auparavant. Ils ne se transformèrent pas en un jour. Deux siècles de guerres fratricides entre les rois mérovingiens ne le démontrent que trop, en même temps qu’elles constatent l’espèce de vénération superstitieuse, d’idolâtrie païenne que les Francs professaient pour cette dynastie aux longs cheveux dont ils déposaient, dont ils égorgeaient en détail les rejetons, mais en dehors de laquelle nul ne s’avisait encore de chercher des chefs d’un autre sang.
Il ne faut donc pas nier leur barbarie; il faut non-seulement croire tout ce que les historiens en rapportent, mais bien se dire que, comme pendant toute l’antiquité, leurs récits sont loin d’atteindre tout ce qu’il y eut «de tyrannies ignorées, de spoliations impunies, de ruines sans vengeurs.» Mais il ne faut pas croire que les Francs fussent, comme on l’a prétendu, moins civilisés, moins humains, plus oppresseurs que les autres barbares. A aucun point de vue on n’a le droit de les placer au-dessous des Visigoths ou des Burgondes. Ils avaient notamment tout autant de goût et d’attrait pour la culture des lettres et de l’esprit. La chapelle que les rois mérovingiens instituèrent dès les premiers temps de leur conversion, et l’école qui y fut aussitôt attachée, comme une dépendance inséparable de la résidence royale, devinrent promptement une pépinière de clercs instruits et zélés, où la jeune noblesse franque et gallo-romaine puisait l’instruction la mieux adaptée au temps et aux mœurs d’alors. Les charges importantes de l’Église et de la cour se donnaient à ceux qui s’y étaient distingués . Toutes les biographies de saints sont unanimes à constater ce fait; et Grégoire de Tours le confirme en parlant de l’érudition palatine comme d’une sorte de noviciat ecclésiastique et politique, en pleine activité sous les petits-fils de Clovis.
Il est encore plus certain que l’oppression des Gallo-Romains par les Francs ne fut jamais systématique, ni surtout aussi cruelle, aussi complète que le veut une théorie habilement préconisée de nos jours, mais démentie par tous les mémoires contemporains. Sans doute, dans la région du nord-est, qui fut la première occupée par les Francs encore complétement païens, la population romaine fut cruellement spoliée et maltraitée, sinon entièrement exterminée. Mais après leur conversion, à mesure qu’ils s’approchèrent de la Loire, et surtout lorsqu’ils se répandirent au midi de ce fleuve, on voit les Gallo-Romains conserver toutes leurs propriétés et jouir absolument des mêmes droits que les conquérants. On voit, parmi les Francs comme parmi les Gaulois, des pauvres, des artisans, des esclaves, en même temps que des nobles et des riches. Les nobles gaulois, les membres des familles qualifiées de sénatoriales, occupent le même rang que sous l’empire romain et s’associent, dans la cour et dans le cortége militaire des rois mérovingiens, aux leudes et aux antrustions de race franque. On trouve partout des Gallo-Romains aux premiers rangs, et non-seulement dans l’Église, où ils possèdent presque exclusivement les évêchés jusqu’à la fin du sixième siècle, mais parmi les convives du roi, parmi les ducs et les comtes, à la tête des armées et même dans les offices de la domesticité royale, qui sembleraient avoir dû être exclusivement réservés aux compagnons et aux compatriotes du prince.
Il faut toutefois signaler la différence qu’établit la loi salique dans le prix de compensation dû pour les meurtres commis sur les Francs ou sur les Romains, et d’après laquelle on apprend que la vie du Romain n’était estimée que. la moitié de celle du Franc. Hormis cette seule disposition où survit l’orgueil naturel du vainqueur, on ne trouve aucune trace de distinction radicale entre la race conquérante et la race conquise. Le Gallo-Romain conserve son droit privé, mais il est soumis aux mêmes lois et il obtient les mêmes garanties que le Franc. Quant au droit public, comme le barbare, mais pas plus que lui, l’indigène est exposé aux violences atroces qui éclataient chaque jour dans la société d’alors, et qu’il commettait à son tour et aussi souvent que le Franc ou le Burgonde. Car il y avait des Gallo-Romains tout aussi imbus que les barbares de la férocité qu’inspire la possession de la force et de la richesse sans contrôle. On les trouve de moitié dans presque tous les forfaits et toutes les perfidies qu’énumèrent les annales de cette malheureuse époque. On l’a dit avec raison: «Le plus grand mal de la domination barbare était peut-être l’influence des Romains avides et corrompus qui s’insinuaient auprès des nouveaux maîtres .» C’est surtout à eux que l’on doit attribuer ces raffinements de débauche et de perfidie que l’on voit avec surprise se produire au sein de la brutalité sauvage des hommes de race germanique. Ils enseignaient à ceux-ci l’art d’opprimer et de dégrader leurs compatriotes par des moyens que la grossièreté naturelle des Goths ou des Teutons ne leur eût jamais inspirés. Il s’en faut bien que tout ait été profit pour les barbares dans leur contact avec le monde romain, dépravé sous l’empire. Ils lui apportaient des vertus viriles dont il avait perdu le souvenir, mais ils lui empruntaient en même temps des vices abjects et infects dont le monde germanique n’avait pas idée. Ils y rencontrèrent le christianisme; mais, avant d’en subir la bienfaisante influence, ils eurent le temps de se tremper dans toutes les bassesses et tous les débordements d’une civilisation corrompue longtemps avant d’être vaincue. Le régime patriarcal qui caractérisait les anciens Germains dans leurs rapports avec leurs enfants, leurs esclaves, comme avec leurs chefs, tomba en ruine au contact de cette dépravation contagieuse.
Plus tard, lorsque l’esprit chrétien eut établi son empire, et lorsque tous les vieux débris romains eurent été absorbés et transformés par l’élément germain, sous les premiers Carlovingiens, le mal s’atténua, et s’il ne disparut pas complétement, du moins toutes les nations de la chrétienté purent se constituer sous des lois et des mœurs dont il n’y avait ni à rougir ni à se plaindre. Mais à l’époque où nous sommes, rien de plus triste que cette première fusion de la barbarie germanique avec la corruption romaine. Tous les excès de l’état sauvage s’y combinent avec les vices d’une civilisation savamment dépravée. C’est de cette origine perverse et fatale que découlent ces abus révoltants du droit seigneurial qui, conservés et développés à travers les siècles, ont si cruellement affaibli et dépopularisé la féodalité. Et c’est là qu’il faut chercher le secret de ces exemples monstrueux de trahison et de férocité qui, en se reproduisant presque à chaque page du récit de Grégoire de Tours, projettent une si sanglante lueur sur les premiers temps de notre histoire.
De là aussi ces tentatives des rois mérovingiens pour rétablir, en l’aggravant, la fiscalité romaine. Tantôt c’est aux églises qu’ils veulent faire payer le tiers de leurs revenus; tantôt c’est la capitation qu’ils veulent établir, non plus, comme chez les Romains, sur les plébéiens sans propriétés foncières, mais sur tout le monde, et sur les Francs tout les premiers. Mais ici le vieux droit germanique reprit le dessus. Même en l’absence des assemblées’ nationales qui semblent avoir été suspendues pendant le règne de Clovis et de ses successeurs immédiats, la résistance fut énergique et triomphante. Les rois mérovingiens eurent beau manifester un penchant précoce à imiter l’autocratie des empereurs romains, ils eurent toujours à compter avec les nobles francs, qui n’entendaient pas renoncer sur le sol conquis par eux aux libertés de leurs aïeux, et qui, renforcés par les descendants des vieilles races chevaleresques de la Gaule, constituèrent bientôt autour de la royauté une aristocratie à la fois civile et guerrière, aussi libre que puissante, aussi fière de son origine que de ses droits, et bien résolue à ne pas se laisser réduire au vil niveau du sénat romain. Selon le vieux privilége de la liberté germanique, ils prétendaient parler haut à qui que ce fût, intervenir activement dans tous les intérêts publics, résister à toutes les usurpations et frapper tous les coupables . Leur respect superstitieux pour le sang des Mérovingiens, leur dévouement traditionnel à la personne du chef, les portaient à remplir auprès de leurs rois des offices domestiques qui, chez les anciens Romains, étaient réservés aux esclaves, mais qui, chez les peuples germains, n’avaient aucun caractère servile, et étaient au contraire l’apanage des principaux de la nation, sous le nom de fidèles. Mais cette fidélité ne les empêchait pas d’opposer à la violence du maître des violences non moins redoutables et souvent non moins illégitimes.
«Adieu,» disait une députation de seigneurs austrasiens au roi Gontran de Bourgogne, petit-fils de Clovis; «adieu, ô roi! nous prenons
«congé de toi, en te rappelant que la
«hache qui a brisé le crâne de tes frères est
«encore bonne, et bientôt c’est à toi qu’elle
«fera sauter la cervelle.»
Par quel changement prodigieux ces barbares, à peine baptisés, devinrent-ils le peuple chéri de l’Église et la race d’élite du monde chrétien, c’est ce qu’on verra dans la suite de ce récit. Dès à présent il faut reconnaître que, par un privilége unique, ils ne furent jamais ariens. Seuls, parmi les conquérants de l’empire romain, ils ne laissèrent pas leur énergie et leur simplicité devenir la proie de cette hérésie dont nul n’a encore expliqué l’inconcevable et irrésistible ascendant sur toutes les nations germaniques, et qui, vaincue chez les vieux peuples chrétiens, sut se créer au sein même de leurs vainqueurs un triomphant asile. Fermer l’accès de la Gaule à tous les autres barbares, et à l’intérieur assurer l’unité catholique en chassant sans persécution ouverte l’hétérodoxie, c’était rendre à la chrétienté naissante deux services souverains. Au midi de la Loire, les populations catholiques, qui ne savaient que trop comment les barbares ariens avaient poursuivi le clergé orthodoxe en Afrique et en Espagne, soupiraient avec passion après la domination des Francs. C’est pourquoi saint Remi disait aux détracteurs de Clovis: «Il
«faut pardonner beaucoup à qui s’est fait le
«propagateur de la foi et le sauveur des provinces.» C’est encore ce qui explique, sans les justifier, ces formules adulatrices que prodiguent la plupart des auteurs ecclésiastiques à des princes dont la vie publique et privée était chargée de crimes atroces. A la différence des empereurs byzantins, qui faisaient à tout propos intervenir l’autorité de l’État dans les choses spirituelles, et qui se croyaient meilleurs théologiens que les évêques, ils se mêlaient peu de théologie, et, sauf les cas trop nombreux où ils attentaient à la liberté des élections pontificales au profit de leurs domestiques ou de leurs favoris, ils laissaient à l’Église une pleine indépendance dans les matières de foi et de discipline. Ils se montraient aussi d’une grande munificence envers les évêques et les moines: ils ne se contentèrent pas de restituer aux églises tout ce qui leur avait été enlevé ; ils détachèrent encore des immenses possessions dont la conquête avait constitué leur domaine royal, en même temps que les lots de terre érigés en bénéfices pour leurs fidèles laïques, d’autres terrains très-vastes, mais la plupart du temps incultes, déserts ou couverts de forêts inaccessibles, dont ils firent la dotation des principaux monastères érigés pendant la période mérovingienne. Plus d’une fois ces grandes fermes ou villes, où les rois francs tenaient leur cour au centre d’une exploitation agricole, se transformèrent elles-mêmes en établissements religieux.
Et cependant c’étaient de pitoyables chrétiens. Tout en respectant la liberté de la foi catholique, tout en la professant extérieurement, ils violaient sans scrupule tous ses préceptes en même temps que les plus saintes lois de l’humanité. Après s’être prosternés devant le tombeau de quelque saint martyr ou confesseur, après s’être quelquefois signalés par un choix d’évêque irréprochable, après avoir écouté avec respect la voix d’un pontife ou d’un religieux, on les voyait, tantôt par des accès de fureur, tantôt par des cruautés de sang-froid, donner libre carrière à tous les mauvais instincts de leur nature sauvage. C’était surtout dans ces tragédies domestiques, dans ces exécutions et ces assassinats fratricides dont Clovis donna le premier l’exemple et qui souillent d’une tache ineffaçable l’histoire de ses fils et de ses petits-fils, qu’éclatait leur incroyable perversité. La polygamie et le parjure se mêlaient dans leur vie quotidienne à une superstition semi-païenne, et en lisant leurs sanglantes biographies, que traversent à peine quelques lueurs passagères de foi et d’humilité, l’on est tenté de croire qu’en embrassant le christianisme ils n’avaient ni abdiqué un seul des vices païens ni adopté une seule des vertus chrétiennes.
C’est contre cette barbarie des âmes, bien plus épouvantable encore que la grossièreté et la violence des mœurs, que l’Église va triomphalement lutter. C’est au milieu do ces désordres sanglants, de ce double courant de corruption et de férocité que va se lever la pure et resplendissante lumière de la sainteté chrétienne. Mais le clergé séculier, lui-même atteint par la démoralisation commune aux deux races, ne saurait suffire à cette tâche . Il lui faut le concours puissant et bientôt prépondérant de l’armée monastique. Elle ne lui manquera pas: l’Église et la France lui devront la victoire définitive de la civilisation chrétienne sur une race bien autrement difficile à réduire que les sujets dégénérés de Rome ou de Byzance. Pendant que les Francs venus du nord achèvent d’assujettir la Gaule, les bénédictins vont l’aborder par le midi, et superposer à la conquête barbare une domination pacifique et bienfaisante. C’est la rencontre et l’entente de ces deux forces si inégalement civilisatrices qui va exercer l’influence souveraine sur l’avenir de notre patrie.