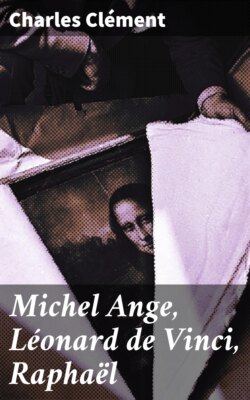Читать книгу Michel Ange, Léonard de Vinci, Raphaël - Charles Julian Clement - Страница 4
DE L’ART EN ITALIE
ОглавлениеAVANT LE SEIZIÈME SIÈCLE
JUSQU’A FRA ANGELICO DE FIESOLE
Une étude sommaire et trop générale des manifestations de l’activité humaine jette l’esprit dans de douloureuses perplexités. A certains moments de l’histoire, les labeurs de générations entières semblent perdus, et le trésor de science et de vérité, si obstinément amassé pendant des siècles, est abandonné à de désastreux retours d’ignorance. Le fanatique ou le barbare qui brûle les livres de la sagesse humaine et qui brise les chefs-d’œuvre de l’art, qui oublie des exemples sublimes, qui dépossède l’esprit et livre le gouvernement de son être à la brutalité des instincts naturels; qui, doué de conscience, de sentiment, de raison, se rue sur des civilisations avancées pour les anéantir, appartient-il à la race de ces hommes attachés à bien faire, qui devaient espérer que leurs œuvres, si chèrement payées par tant de sueurs, de larmes et de sang, ne périraient pas? Et comment transmettrait-il à ses fils ce dont il ne connaît ni l’importance, ni la beauté, ce dont il n’a pas même gardé la mémoire? Ces temps néfastes, où toute tradition du passé semble perdue, sont-ils la mort de la civilisation ou une préparation nécessaire à une vie plus parfaite, et les convulsions d’une nouvelle naissance?
A considérer les choses au point de vue du temps, relativement si éclairé, où nous vivons, il peut sembler, en effet, que les dix siècles qui séparent la décadence de l’Europe ancienne de la renaissance italienne sont couverts d’une complète obscurité. Il est certain, cependant, que la vie ne se tarit pas plus dans les sociétés que dans la nature; que le fil de la tradition et des progrès humains disparaît par moments et s’égare sans se perdre ni se rompre. Car sans parler du christianisme, qui poussait, dès l’époque dont je parle, les profondes et puissantes racines du monde moderne, il est facile de discerner, dans ces ténèbres, des formes anciennes qui se traînent avant de mourir ou se modifient; des formes nouvelles qui s’élancent dans des directions inconnues jusque-là ; et dans le ciel tragique de ces temps barbares, à la fois les lueurs sinistres d’un incendie qui s’éteint et les palpitations lumineuses d’un jour nouveau.
Cependant, encore aujourd’hui, on ne peut étudier aucune des trois ou quatre grandes directions dans lesquelles l’homme a poursuivi la science et la vérité, sans éprouver un grand trouble et sans se sentir le cœur serré. Nous sommes encore loin du but. Bien des générations périront encore à la peine; bien des héros obscurs ou fameux se coucheront découragés dans leurs tombeaux. Les sciences sont nées d’hier; les arts, après avoir à deux reprises touché la perfection, sont retombés au-dessous de leur niveau; les littératures imitent plus qu’elles ne créent; la solution des problèmes de la vie sociale et de ceux même de la vie morale est cherchée aux pôles opposés. Et pourtant, ce que le peu que nous sommes a coûté d’efforts inouïs fait frémir.
Quand, en remontant à l’origine du développement des arts et des sciences modernes, on fait l’inventaire de ce qui avait été conservé des conquêtes du passé, on ne trouve qu’un amas confus de merveilles et d’objets sans valeur, comme ce que sauveraient d’une catastrophe subite des hommes pris de terreur, qui emporteraient de leurs richesses, au hasard, ce qui leur tomberait sous la. main, le pire autant que le meilleur. La conquête de la Grèce par Rome avait fait affluer en Italie une foule d’ouvriers habiles qui y apportèrent les traditions de leur pays, mais qui ne tardèrent pas à se laisser entraîner et corrompre par la décadence générale. La petite église de Santa Costanza qui servait de baptistère à Sainte-Agnès avant de devenir la chapelle sépulcrale des deux filles de Constantin, Hélène et Constance, le chœur de San Lorenzo fuori le Mura, qui date du règne du premier empereur chrétien, ne présentent aucun caractère qui leur soit propre et qui annonce que la religion nouvelle dût avoir un art qui lui appartiendrait. C’est à ce moment, d’ailleurs, qu’il faut rapporter la destruction de la plupart des monuments d’art de l’antiquité. Le règne tolérant de Constantin, qui, tout sectateur de la religion nouvelle qu’il était, se laissait adorer dans les temples païens, est suivi de ceux de Théodose et d’Honorius, qui poursuivirent le culte de Jupiter avec l’acharnement que les premiers empereurs avaient montré contre celui du Christ. Tout ce qui rappelait le paganisme fut aveuglément sacrifié à la crainte de laisser quelques traces d’une religion qui déifiait la matière, et qui faisait de la beauté l’objet suprême de ses aspirations. Grégoire le Grand acheva l’œuvre de Théodose. C’est donc à tort qu’on accuse les barbares de ces destructions; ils ne trouvèrent en Italie que des ruines, et il est probable qu’ils se fussent peu inquiétés de conserver ou d’anéantir des objets dont ils ne comprenaient ni la valeur, ni les dangers.
Lorsque le christianisme triomphant remplaça l’idolâtrie et que des jours comparativement tranquilles et heureux succédèrent aux épreuves terribles qu’il avait traversées, presque tous les monuments de la sculpture antique que nous possédons aujourd’hui étaient enfouis sous les ruines des temples et des palais qu’ils avaient ornés. Quelques tombeaux avaient cependant échappé à la destruction: ceux entre autres de Tarquinia et des Nasons; et il est évident qu’ils servirent de modèles aux bas-reliefs de l’arc de triomphe de Constantin, à ceux des sarcophages de sainte Constance, de Junius Bassus et à d’autres ouvrages assez considérables conservés pour la plupart au Vatican. L’idée chrétienne est à peine sensible dans ces premiers essais de l’art nouveau. Des personnages mythologiques s’y trouvent mêlés aux scènes de l’Évangile et se rencontrent dans des compositions où ils n’ont assurément que faire. Les expressions sont peu marquées, la physionomie générale est indécise et sans caractère-personnel. La composition, par contre, est supérieure à ce qu’elle deviendra plus tard. Mais à mesure qu’on s’éloigne de ces premiers temps, que le style s’affaiblit, que les dernières traditions léguées par la décadence romaine à l’art nouveau se perdent et s’effacent, la pensée nouvelle se fait jour. La beauté disparaît, et les figures ne présentent plus rien qui rappelle l’idéal antique; mais les expressions se précisent, le caractère spiritualiste et ascétique du christianisme naissant s’accuse, et souvent avec une énergie singulière; les expressions deviennent saisissantes, et des ouvrages qui ne frappent d’abord que par leur barbarie finissent par agir fortement sur l’esprit de celui qui les étudie sans parti pris de les dénigrer.
Ainsi, à l’origine, perfection relative des ouvrages d’art, sous l’influence des souvenirs de l’antiquité ; puis, de siècle en siècle, et à travers bien des incertitudes, aspirations vers un but nouveau, élimination ou plutôt ignorance et oubli des traditions et des moyens classiques, infériorité apparente des résultats. En dehors de ce double mouvement qui, tout contradictoire qu’il peut paraître, se laisse bien clairement discerner, il serait imprudent et présomptueux de chercher à classer avec quelque précision des faits isolés et peu nombreux, et il n’y aurait ni bonne foi, ni profit à céler des hésitations qui sont le caractère même de ce temps. Du commencement à la fin de cette longue et navrante période, pendant ce mystérieux crépuscule qui sépare la Renaissance de l’antiquité, les événements se suivent sans paraître s’enchaîner. Ils vont au hasard comme emportés par un vaste fleuve, sans direction fixe et presque sans courant. Leur marche est indécise, irrégulière, obscure, et souvent contradictoire comme celle des aveugles éléments, et il ne faut pas s’étonner que les arts partagent leur destinée.
Le culte nouveau ne garda du paganisme que les monuments qui pouvaient être appropriés à son usage. Les temples païens n’étaient que des sanctuaires habités par le dieu et par le prêtre; ils n’auraient pu contenir la foule des fidèles que le dogme chrétien admettait à participer aux mystères. La plupart d’entre-eux avaient été détruits dans les premiers transports d’un zèle aveugle, et ceux qui restaient debout ne rappelaient que des souvenirs détestés. On leur préféra les basiliques, vastes monuments qui convenaient par leurs dimensions et par la simplicité de leur ornementation au culte nouveau. Ces basiliques étaient des tribunaux, et le peuple avait l’habitude de s’y réunir, soit pour entendre les plaidoiries, soit pour parler d’affaires après l’audience. Ce n’est donc qu’à une simple convenance qu’il faut attribuer la forme des premiers temples chrétiens. Il est probable que, jusqu’au quatrième siècle, les chrétiens, persécutés et poursuivis, obligés de changer à chaque instant leurs lieux de culte, n’eurent ni les moyens, ni l’imprudence de les orner. Mais aussitôt après l’adoption de la basilique comme temple d’une religion tolérée ou reconnue, sa forme fut modifiée d’une manière caractéristique, la cathedra, c’est-à-dire le siége épiscopal, remplaça le tribunal; la chaire était dans la nef comme aujourd’ hui; l’autel fut placé vers le fond de l’édifice, sous l’arc du milieu, qu’on nomma «arc triomphal.» A l’ordinaire, une poutre dorée ou argentée, coupant le cintre, supportait une statue du Christ. Enfin, il est vraisemblable que, de très-bonne heure, on décora les parois du monument de peintures et de mosaïques. Ces modifications se firent sans doute peu à peu; les dates et les caractères précis en sont mal connus. Je ne m’y arrête pas, préférant rechercher quelques traces du développement de l’art à ces époques reculées dans les ouvrages de peinture et de sculpture dont il nous reste quelques exemples, et dont la date peut être fixée avec certitude.
L’époque à laquelle appartiennent les peintures qui ornent les tombeaux des catacombes de Rome me paraît pouvoir être déterminée avec une assez grande précision. On a voulu rapporter plusieurs de ces ouvrages aux premiers temps de notre ère; il se pourrait que, dès les jours de la persécution, les chrétiens aient enseveli leurs martyrs dans les parties les plus secrètes de ces souterrains et aient marqué leurs tombes de quelques symboles, mais il paraît improbable que les catacombes aient servi, d’une manière un peu générale, de nécropoles avant la seconde moitié du quatrième siècle. Comment supposer, en effet, que les premiers chrétiens, qui se réunissaient à la vérité dans les catacombes pour célébrer leur culte, mais qui s’y réunissaient à la dérobée, qui y étaient souvent surpris et traqués, massacrés et même murés vivants, y aient déposé les restes vénérés de leurs martyrs? Comment supposer, surtout, qu’ils aient volontairement désigné leurs tombes à des ennemis acharnés en les décorant de symboles et de peintures? Comment expliquer le silence de saint Jérôme, qui visitait souvent ces lieux, pour lesquels il avait une vénération particulière? Comment, enfin, les actes du deuxième concile de Nicée, où se trouvent énumérées et recommandées à la dévotion des fidèles un grand nombre d’images anciennes, n’en feraient-ils aucune mention? Ces peintures ne sont certainement pas antérieures aux ouvrages sculptés dont j’ai parlé précédemment. Il est vrai que l’imitation de l’antique y est encore sensible: l’ordonnance est simple; la composition, souvent très-bien entendue, rappelle par ses traits caractéristiques les ouvrages d’art de l’antiquité païenne, mais les nudités qui se trouvent encore fréquemment dans les sculptures des tombeaux mentionnés plus haut ont disparu; les membres ont pris de la roidéur, les draperies de la sécheresse. Par contre, les expressions sont plus marquées; et quoiqu’elle s manquent de caractère individuel et qu’elles se rapportent toutes au même type conventionnel, le sentiment mystique y est déjà sensible, et le souffle d’un esprit nouveau s’y mêle aux souvenirs anciens. Il est naturel de penser que ce fut après la fin des persécutions que les chrétiens songèrent à transformer en nécropoles les lieux consacrés par leurs malheurs, et que ce n’est qu’à ce moment qu’ils ornèrent de peintures de quelque importance et les sépultures nouvelles et les tombes de ceux de leurs martyrs qui y avaient été précédemment déposés.
C’est aussi vers cette époque, au commencement ou au milieu du quatrième siècle, que furent déterminés d’une manière plus précise les types de l’art chrétien, ceux que nous voyons dominer d’une manière presque exclusive dans les peintures des catacombes, et dont les artistes religieux de la Renaissance ne s’écartèrent que très-peu. Pendant une première période, on paraît avoir proscrit d’une manière absolue les représentations artistiques des scènes religieuses, tant on redoutait le retour à l’idolâtrie et tout ce qui pouvait rappeler le culte ancien. Mais du moment où le christianisme triomphe, il se sert de l’art comme d’un moyen de prosélytisme et de popularisation, tout en continuant cependant à rejeter et à condamner, comme «œuvre de Satan,» toute reproduction des ouvrages de l’antiquité ; et, de même qu’il s’était trouvé des docteurs pour interdire toute représentation des scènes religieuses, comme contraires à l’essence du dogme, il s’en trouva d’autres pour les recommander, notamment saint Basile, parce que, dit-il, «elles engagent à la vertu.» Cependant les types de l’art chrétien, qui prirent plus tard l’importance de véritables dogmes, et dont tous les traits furent réglés avec un soin minutieux, donnèrent lieu à bien des hésitations; et les quelques monuments authentiques de cette époque qui se sont conservés témoignent de la vivacité et de la durée des controverses engagées à ce sujet. L’élément gentil, celui que représente saint Paul pour les premiers docteurs, et qui fut plus particulièrement mis en lumière par les Pères grecs et par les Églises de l’Asie Mineure, semble avoir d’abord dominé. Les colonies grecques avaient conservé, avec leur langue, des souvenirs de la mère patrie; et les ouvrages d’art en portèrent l’empreinte aussi longtemps que leur influence eut le dessus. Jusqu’au concile d’Éphèse, en 431, et même plus tard, la Vierge est représentée sous les traits d’une jeune femme, belle, suivant les idées de l’antiquité, debout une main sur la poitrine, la tête levée vers le ciel. Ce n’est que postérieurement que la mère apparaîtra. Cette idée d’un Dieu né d’une femme semble avoir paru scandaleuse aux premiers peintres chrétiens; ils évitent d’accuser, par une représentation précise, un fait qui devait paraître inouï à des gens imbus des idées de la Grèce, qui regardaient la femme comme un être inférieur, destiné aux plaisirs d’un maître et aux occupations vulgaires de la vie. Il fallut les influences juives et romaines réunies pour lui donner sa place. L’égalité de la femme, cette seule base possible donnée à la famille par le christianisme, devait être facilement acceptée par les Juifs, qui y étaient préparés par l’importance extrême qu’ils donnaient à la filiation légitime. Quant aux Romains, leur admirable instinct juridique leur avait fait prévoir, comme vérité sociale, une idée qui devait jeter plus tard de si profondes racines dans la conscience et dans les mœurs.
Il se passa longtemps avant qu’on essayât de reproduire la figure du Christ. Plusieurs docteurs, et entre autres saint Cyrille, citant Tertullien, prétendirent que son visage était ignoble. Était-ce tradition ou un souvenir des paroles d’Isaïe: «Il n’y a en lui ni forme ni apparence; quand nous le regardons, il n’y a rien en lui à le voir qui fasse que nous le désirions ;» ou simplement une expression énergique pour marquer le mépris qu’il fallait avoir de la chair et de la beauté, et l’importance qu’on devait donner à l’être moral sans se soucier de la forme? Tout en convenant de la part importante que les prophéties messianiques durent avoir sur la formation de cette idée et de la sanction qu’elles lui donnèrent, il est peut-être plus simple et plus naturel de supposer qu’on ne voulait que détourner et dégoûter des représentations matérielles, qui auraient pu fournir un aliment à l’idolâtrie encore menaçante. Les plus anciennes peintures des catacombes de Sainte-Agnès, de Saint-Calixte, représentent le Christ sous une forme allégorique, très-souvent sous les traits d’Orphée, sous ceux de Moïse, de Tobie, de Jonas, d’un jeune homme sans barbe au milieu des disciples, enfin sous ceux du bon Pasteur. Cette dernière forme est la plus fréquente, et elle se perpétue très-longtemps. Cependant on ne tarde pas à voir apparaître et grandir l’influence judaïco-romaine, qui tend à remplacer, dans ces monuments presque barbares, ce qu’ils avaient conservé de l’antiquité classique entre les mains des chrétiens grecs. L’expression est de plus en plus marquée, et en même temps que la beauté s’efface, le sentiment se révèle sur le masque jusqu’alors immobile et indifférent. Le type historique du Christ se formule plus nettement: les cheveux longs, la barbe partagée, le visage amaigri, grave et souffrant. Ce type n’est du reste pas dû au hasard. Je ne veux pas parler des portraits attribués à saint Luc, qui se rencontrent dans presque toutes les villes d’Italie, et qui n’ont aucune espèce d’authenticité ; mais il existe une pièce ancienne et assurément très-curieuse, qui a sans doute contribué à mettre fin aux discussions qui nous occupent, et à faire pencher la balance du côté de la tradition latine. C’est une lettre de Lentulus, citoyen romain, qui se trouvait à Jérusalem au commencement de notre ère. Je n’ignore pas qu’on a contesté, par des raisons très-plausibles, l’authenticité de cette pièce. On a dit, entre autres choses, que ce Lentulus, qu’on donne comme prédécesseur de Ponce-Pilate, ne l’a point été. Il se pourrait que ce détail particulier fût inexact, et que la lettre elle-même fût cependant authentique. Mais en supposant qu’elle ne le soit pas, que Lentulus lui-même ne soit qu’un être d’imagination, il n’en est pas moins vrai, et c’est le seul point qui nous importe ici, que cette lettre paraît avoir été assez anciennement connue et regardée comme authentique et qu’elle a pu par conséquent servir à fixer la tradition.
«Il est arrivé dans nos murs, où il est encore, dit Lentulus, un homme très-extraordinaire: on l’appelle Jésus; beaucoup de personnes le regardent comme un prophète de vérité. Ses adeptes le nomment Fils de Dieu. Il ressuscite les morts et guérit les blessés. Il est d’un extérieur remarquable, de taille haute et tellement imposante qu’il inspire à tous l’amour et en même temps la crainte. Sa chevelure est brune, de la couleur du fruit du noisetier lorsqu’il est mûr; elle est épaisse et polie sur le dessus de la tête, où elle est séparée à la mode des Nazaréens; puis elle retombe en boucles ondoyantes sur ses épaules. Son front est large et son visage sévère. La bouche et le nez sont d’une forme parfaite; sa barbe, qu’il laisse croître, est de la couleur de ses cheveux; elle n’est pas très-longue et elle est séparée par le milieu. Ses traits respirent la persévérance et la candeur. Ses yeux sont grands et brillants, terribles lorsqu’il adresse des réprimandes, doux et remplis de bonté lorsqu’il exhorte. Une douce sérénité. règne sur son visage quoiqu’il soit toujours sérieux, car on ne l’a jamais vu rire: mais plus d’une fois on l’a vu pleurer. Il parle peu, mais tout ce qu’il dit est plein d’autorité ; enfin tout en lui semble au-dessus de l’humanité.»
Il me semble qu’il est impossible de méconnaître, dans cette description, les traits de beauté intelligente et morale que les peintres chrétiens ont prêtés au visage du Christ. C’est aussi ce type qui a servi de modèle à l’école italienne du XVIe siècle, et auquel Léonard de Vinci devait donner un caractère d’une idéalité sublime.
A partir du Ve siècle, les compositions où se trouve la figure du Christ sont nombreuses. Elles représentent les principales scènes de sa vie, et très-souvent aussi le couronnement de la Vierge, sujet pour lequel les peintres mystiques montrent une grande prédilection. Mais il semble qu’on ait hésité longtemps devant la représentation du sacrifice final de cette vie sublime. C’est dans la catacombe de Saint-Valentin que se trouve le premier crucifiement. Cette peinture paraît dater du VIIe siècle; et c’est en effet en 692 que le concile quinisexte permit de représenter le Christ sur la croix.
La mosaïque que les anciens avaient beaucoup pratiquée, qu’ils employaient aux usages les plus humbles et les plus élevés: à paver les salles et les cours de leurs maisons, et à reproduire les ouvrages les plus célèbres de la peinture, comme on en a la preuve dans la Bataille d’Alexandre du Musée de Naples, n’a pas, pendant la période qui nous occupe, le caractère d’élévation mystique qu’elle présente à partir du XIe siècle. Les ouvrages de cette nature, que l’on voit encore à Saint-Jean-de-Latran et à Sainte-Marie-Majeure à Rome, et qui sont du Ve siècle, appartiennent au style latin. Elles en ont le caractère sombre, austère, énergique. Les expressions sont rudes, les figures trapues. Cependant un assez grand nombre de mosaïques de ce temps, aussi bien à Rome que dans la haute Italie, sont certainement dues à des ouvriers grecs, qui modifièrent jusqu’à un certain point le style des Latins, par leur goût plus élégant et plus élevé.
Pour l’architecture, même lutte et même résultat. Le style oriental dont Justinien avait élevé, dans Sainte-Sophie de Constantinople, un si admirable modèle, tente en vain de s’établir dans la haute Italie. Amalasunte, fille de Théodoric, et l’archevêque Nion, construisent à Ravenne, dès le vie siècle, le baptistère de Saint-Jean et la grande église octogone de Saint-Vital. L’origine orientale de ces deux monuments est évidente. Mais cet essai de naturalisation d’une architecture étrangère était prématuré, et lorsqu’il fallut construire de nouvelles églises pour remplacer les basiliques anciennes, on donna la préférence au style latin modifié et plié aux exigences nouvelles. Cette architecture est improprement nommée lombarde de la première époque. Les Lombards n’ont rien apporté en Italie, que la barbarie et un sang nouveau. Ils prirent, ainsi que l’avaient fait les Goths, les mœurs, la langue, les arts des vaincus, et ils ne servirent la civilisation qu’en rendant aux races appauvries qu’ils conquirent une séve vigoureuse et les éléments d’une nouvelle jeunesse.
Au milieu de ce sombre moyen âge, le xe siècle se distingue de ses devanciers par sa tristesse et par sa stérilité. La croyance généralement répandue que le monde devait finir à cette époque avait frappé les esprits de stupeur et de découragement. Pourquoi entreprendre ce qu’on ne doit pas terminer? Construit-on des œuvres durables lorsque l’on doute du lendemain? On vivait au jour le jour, dans une attente terrible; et les arts, qui semblaient avoir pris quelque essor dans les siècles précédents, retombent au plus bas dans celui-ci. Le découragement et la stupeur sont partout, et il faut convenir qu’à aucune époque l’Europe occidentale n’avait été accablée de pareils malheurs. L’Italie avait particulièrement souffert. Pendant des siècles, les invasions et des maux de toutes sortes avaient balayé son sol, comme les flots déchaînés d’une tempête, sans répit et sans fin. Aussi tous les ouvrages d’art de ce temps ont-ils un caractère de désolation qui fait frémir. On ne croyait plus à la vie, et c’est vers la mort que se tournait l’espérance. Tous ces saints, tous ces martyrs, tous ces pénitents exténués, dont les souffrances, les prières et les macérations n’ont pu fléchir la colère céleste, semblent crier d’une seule voix: «Qui me délivrera de ce corps de mort?»
Mais aussitôt que le terme fatal est franchi, l’espérance en de meilleurs jours renaît; les populations, hier encore atterrées, reprennent leur activité, et c’est dans la période qui suit ce siècle néfaste que l’Italie se couvrit des monuments admirables que nous y voyons encore aujourd’hui. Le style oriental va triompher, bien qu’il eût été repoussé d’Italie une première fois au VIe siècle, et que Charlemagne lui-même, qui avait pressenti sa valeur, et fait imiter à Aix-la-Chapelle le Saint-Vital de Ravenne, n’eût pu réussir à l’implanter en Occident. Tantôt accueilli, tantôt délaissé, ou accouplé à la lourde architecture latinobarbare, suivant que la civilisation ou la barbarie l’emportait, il avait rencontré de la part de la voûte romaine la même résistance qu’il devait lui-même opposer, deux siècles plus tard, à l’invasion de l’ogive gothique. Il rentra en Italie par deux voies opposées, apporté à la fois par les croisés et par les Sarrasins. En Sicile, il est presque entièrement arabe; à Venise et dans la haute Italie, plus franchement byzantin. Il ne faudrait pas cependant se figurer qu’il se soit fait alors un changement complet dans le caractère et dans les décorations des monuments religieux . Les dispositions générales restent les mêmes; mais une influence très-sensible du génie grec-arabe donne aux peintures, et aux mosaïques plus d’élévation et de mysticité, à l’architecture plus de légèreté et d’élégance. Dans l’architecture surtout, c’est la basilique qui continue à servir de point de départ. Mais les modifications que lui fait subir l’influence nouvelle méritent d’être remarquées. La partie transversale qui formait la croix latine est étendue, la nef principale dépasse de beaucoup le transsept. Ces deux traits sont bien évidemment d’origine orientale, et rapprochent les constructions nouvelles du type grec. Enfin, l’innovation la plus importante, la plus caractéristique, est la construction d’une coupole à l’intersection des deux nefs. Ce style nouveau, appelé roman ou lombard de la deuxième époque, conserve des constructions latines, outre les dispositions principales, quelque chose de trapu, de fort, de sombre, que les élégances byzantines ne parviennent pas à lui enlever. C’est en vain que les architectes nouveaux ornent les murs de marbres variés, les revêtent souvent de galeries superposées, vraies merveilles de grâce et de fantaisie, couvrent les colonnes d’arabesques et les font reposer sur des animaux chimériques en guise de socles, le caractère austère de l’architecture latine se dénote encore avec toute sa puissance, et je ne connais pas d’autre exemple où la réunion d’éléments si divers ait produit des œuvres d’une beauté si impressionnante et d’une convenance si parfaite.
Le génie oriental marqua la mosaïque d’un caractère étrange et gigantesque, et donna aux artistes italiens la largeur qui se trouve, à partir de cette époque, dans tous leurs ouvrages. Cet art si grossier de représenter, au moyen de pierres de couleurs, les scènes que les substances les plus dociles ne parviennent qu’avec peine à exprimer; cet art incomparable que le Ghirlandajo nommait «la peinture pour l’éternité, » et dont le principal mérite paraît, au premier abord, ne consister que dans la solidité et la durée, a produit des monuments qui laissent dans l’esprit une profonde impression. J’ai oublié bien des statues célèbres et de bien admirables tableaux, mais jamais les décorations de Saint-Marc, de Venise, des églises des îles de l’Adriatique, de la basilique de Montréale, de la chapelle royale de Palerme, ne s’effaceront de mon souvenir. Ces gigantesques figures à demi barbares, dessinées sans art, qui n’ont ni modelé, ni perspective, placées contre les parois et dans le fond de vastes édifices obscurs, les remplissent de leur présence. Elles resplendissent, sur leur fond d’or, d’un éclat mystérieux et terrible; et si le but de l’art religieux est de frapper vivement l’imagination, je ne pense pas qu’il l’ait jamais plus complètement atteint que dans les mosaïques. Il serait certainement insensé de soutenir que la science est un mal et que tout perfectionnement mène à la décadence. Le moyen âge a tort. Sa langue est mauvaise, l’insuffisance de celle des premiers temps de la Renaissance elle-même est manifeste; mais il est certain que les raffinements du métier, la recherche de l’effet, les soins minutieux donnés aux détails, disséminent et distraient l’attention; les idées que bégayent les premiers artistes chrétiens et qu’exprime déjà si nettement l’école de Giotto, ont une si grande importance et sont à un tel degré le principal intérêt de l’art moderne, qu’elles valent bien que l’on passe sur des imperfections qui tiennent au temps et qu’on cherche le fruit excellent enfermé dans l’enveloppe amère. Je ne demande pas que, sous prétexte de retrouver les idées fécondes, on retourne à la barbarie de cet âge; mais les artistes de nos jours trouveraient sans doute grand profit à se retremper dans la contemplation de ces œuvres simples et puissantes.
Dans ces mosaïques, qui produisent une impression si vive et si profonde, presque tout cependant est à reprendre et porte le cachet d’un art à ses premiers pas. Le dessin est d’une incorrection et d’une insuffisance choquantes, la science anatomique d’une nullité complète, et les traits du visage, à peine ébauchés, s’éloignent des types justement consacrés de la beauté. Mais malgré les entraves de procédés insuffisants et barbares, la pensée de l’artiste se fait jour. C’est comme l’éloquence inculte d’un homme qui ne saurait ni les raffinements ni même le nécessaire de sa langue, mais qui se ferait comprendre par la vigueur et la netteté du geste, par l’accent vrai de sa parole malhabile, et par une vertu mystérieuse, par quelque chose qui sortirait de sa personne et qui convaincrait. Les ouvrages parfaitement équilibrés, ceux où se trouvent réunis la conception profonde du sujet, c’est-à-dire la pensée, et les procédés les plus propres à la bien exprimer, sont fort rares, et il faut le concours du génie et des circonstances pour les produire. Les plus grands artistes des meilleurs temps n’en comptent qu’un ou deux tout au plus dans leur œuvre, et pour la peinture, il faut aller jusqu’au XVIe siècle pour les trouver: la Cène, de Léonard de Vinci; la Vision d’Ézéchiel, de Raphaël; les Prophètes, de Michel-Ange. Une fois que ce point culminant est atteint, une force fatale porte sur l’autre pente. L’art compris dans le sens. matériel et de métier l’emporte sur la conception et sur la pensée; les détails prennent une importance exagérée et détruisent l’unité, la simplicité, la force de l’impression, et les questions de couleur et d’agrément, de subordonnées qu’elles étaient et qu’elles devaient être, prennent le premier rang.
La nature intime de cet art byzantin, qui fut une des sources fécondes de la renaissance italienne, qui donna l’élégance à l’architecture, et à la peinture, quoi qu’on en ait dit, son sens intime et profond, mériterait d’être étudiée à part et avec soin. Byzance ne fut pas une patrie, mais un asile où se réfugièrent, poussés par des causes diverses, et se réunirent sans se fondre jamais complétement, d’une part les survivants fugitifs d’une civilisation exquise, mais déjà sur son déclin, qui n’avait conservé de sa perfection que l’élégance et la subtilité, de l’autre, les flots de mille peuples et les soldats de la religion nouvelle, avec la rudesse, l’ardeur et le mysticisme de leur foi. Byzance brilla comme un fanal étrange et splendide: mais sitôt qu’elle eut communiqué sa lumière aux peuples de l’Occident, elle retomba dans une obscurité profonde. Gardienne providentielle du feu sacré de la science et de l’art, ce foyer s’éteignit dès qu’elle eut embrasé le monde moderne. Cette agglomération de races et d’idées diverses ne constitua jamais une nation. Sans ancêtres, elle ne pouvait pas avoir de postérité directe, mais son héritage se répandit sous toutes les formes dans les civilisations modernes, et on retrouve des traces de son influence dans le monde entier. Dans sa littérature aussi bien que dans ses monuments d’art se trouvent mêlés les éléments les plus dissemblables, les plus discordants. C’est un assemblage de grandeur et de subtilité, du plus grossier matérialisme et d’ascétisme, d’un spiritualisme raffiné et de superstitions puériles. On sent le souffle puissant de la Grèce antique, au milieu des plus inconcevables défaillances du goût et de la raison. Ces mêmes Néo-Grecs qui apportèrent à Venise les mosaïques sublimes qui nous ravissent encore y introduisirent en même temps leur goût fastueux, désordonné et chimérique; et c’est dans cette ville de Byzance, où vécurent tant d’hommes passionnés pour le bien, que nous trouvons la société la plus dissolue du monde, et les désordres jusqu’alors sans exemple et sans nom.
A partir du XIe siècle, les arts se précipitent avec un tel élan dans une direction nouvelle, que je ne veux plus marquer que les étapes les plus importantes de cette route triomphale.
Nous avons vu que pendant les XIe et XIIe siècles, soit par suite des rapports que les croisades rendirent plus fréquents entre l’Orient et les peuples de l’Europe occidentale, soit à cause de l’impuissance, tous les jours plus évidente, de l’art latin proprement dit, le génie néo-grec régnait presque sans partage en Italie. Mais cet art lui-même, qui n’était qu’emblématique et pour ainsi dire hiératique, qui ne se retrempait jamais dans la nature, qui avait, il est vrai, conservé à travers des siècles obscurs le flambeau du spiritualisme et une grandeur qu’on ne saurait nier, devait disparaître dans le bouillonnement de vie nouvelle qui travaillait dès ce temps la société latine. Le foyer de l’art ne fut plus à Venise, à Rome, à Palerme, mais au centre même du pays, à Pise, à Florence, d’où il rayonna sur l’Italie tout entière.
Il s’était conservé à Pise, parmi d’autres fragments antiques, un sarcophage qui avait servi de sépulture à la mère de la comtesse Mathilde, celle-là même qui donna au saint-siége le territoire nommé «Patrimoine de saint Pierre.» Ce sarcophage se trouve encore au Campo Santo de Pise. Il est couvert de bas-reliefs d’un bon style, qui représentent une chasse d’Hippolyte ou de Méléagre. Il est probable que c’est à l’école de cet ouvrage antique que se forma Nicolas de Pise, regardé à bon droit comme le père de l’art moderne. Cette étude dut le conduire à reconnaître la nécessité de retourner à la nature dont on s’était tant éloigné, et il éleva en effet, sur cette unique base ferme de l’inspiration, des monuments admirables, qui s’écartent d’une manière très-sensible du style néo-grec qui avait régné jusqu’à lui. Le Santo à Padoue, le campanile de Saint-Nicolas à Pise, l’église de la Trinité à Florence, ses sculptures du tombeau de saint Dominique à Bologne, et celles de la chaire du baptistère à Pise, répandirent dans toute l’Italie sa réputation et son exemple.
Cimabué fondait presque à la même époque l’école de Florence. Le progrès qu’il fit faire à la peinture est loin cependant d’être aussi marqué que celui que la sculpture doit à Nicolas de Pise. L’influence nouvelle est sensible dans le très-petit nombre de tableaux authentiques de ce maître que nous possédons; mais ils sont encore conçus et exécutés dans la manière byzantine. Même sécheresse, même roideur, même longueur démesurée des extrémités. La Madone portant l’Enfant, conservée aux Offices de Florence, ne paraît pas différer essentiellement des ouvrages purement byzantins de la même époque. Mais dans celle de Sainte-Marie-Nouvelle, qui fut, d’après Vasari, portée processionnellement à sa destination, au bruit des trompettes et aux acclamations du peuple, les progrès sont évidents. Les chairs sont plus colorées, les plis des draperies moins roides, les têtes d’anges traitées dans un sentiment plus vif de réalité. Cimabué ne rompt pas avec la tradition, mais il la modifie en l’élevant et en la faisant incliner du côté de la liberté .
Peintre, architecte et sculpteur, Giotto, le berger de Vespignano, l’élève de Cimabué, naquit avec les qualités les plus rares, et son temps seconda merveilleusement son génie. Je ne crois pas qu’on puisse trouver beaucoup d’exemples d’une pareille réunion de facultés diverses et presque opposées. Doué de grandeur et de finesse, réunissant à l’étude précise de la nature l’élévation des écoles byzantines, d’une imagination brillante et d’un goût plein de sobriété et de choix, Giotto possède toute la force du génie alliée aux élégances les plus exquises du talent. Il vécut dans la compagnie habituelle de Dante, et l’esprit indépendant du poëte dut influer puissamment sur celui du peintre et l’encourager dans la voie d’émancipation que Nicolas de Pise avait ouverte. Dante de son côté ne dédaignait pas de s’inspirer des œuvres de l’artiste, et il ne serait pas impossible qu’il dût la sonorité pleine et la forme magistrale de son vers à la contemplation habituelle des plus belles œuvres de la plastique. On voit encore sur la place du Dôme, à Florence, une pierre, nommée le Siège de Dante, où ce grand homme venait souvent s’asseoir. C’est là qu’entouré de merveilles, en face du baptistère de Santa Maria del Fiore, du campanile de son ami Giotto, son poëme titanique grandissait dans son orageuse pensée, et que son esprit, troublé par les luttes incessantes de sa patrie et par l’instabilité des choses, se rassurait en contemplant des œuvres durables.
Giotto remplit l’Italie de ses ouvrages. Ses élèves répandirent sa doctrine dans l’Europe entière, et bien que les travaux qu’il fit à Milan, à Ferrare, à Ravenne, à Lucques, à Avignon, aient péri, les fresques dont il décora la voûte du tombeau de saint François d’Assise, celles du Campo Santo de Pise, la chapelle de l’Arena à Padoue, la voûte de Sainte-Claire de Naples, les admirables compositions récemment retrouvées du chœur de Santa Croce à Florence, les reliefs et les statues qui ornent la base du campanile de Santa Maria del Fiore; ce campanile lui-même, chef-d’œuvre inouï de force et de grâce, toutes ces œuvres empreintes du génie nouveau, débarrassées des langes de la tradition, inspirées, vivantes, suffisent pour mettre Giotto au rang des plus grands artistes. Il eut la rare fortune de n’être pas dédaigné des plus célèbres de ses contemporains, qui comprirent l’importance de la révolution qu’il avait opérée. «Giotto changea complétement l’art, dit Ghiberti, et le fit latin, de grec qu’il était.» Et Pétrarque, voulant laisser au seigneur de Padoue un souvenir de valeur, lui légua, selon Vasari, un tableau de Giotto, en se servant d’expressions qui marquent dans quelle estime il tenait ce maître: «Comme je n’ai rien autre chose qui soit digne de toi, je te lègue mon tableau de la Sainte Vierge, œuvre du célèbre peintre Giotto, dont les ignorants ne comprennent pas la beauté, mais devant laquelle les maîtres de l’art restent muets d’étonnement.»
André Orgagna ne fut pas élève de Giotto, mais il lui succéda dans le génie et dans l’ordre du temps. Quoiqu’il ait vécu à Florence, au milieu des artistes qui se retrempèrent dans l’étude de l’antiquité et dans celle de la nature, il ne procéda que de lui-même; et si l’on voulait à toute force trouver une source à son inspiration, c’est dans le poëme de Dante qu’il faudrait la chercher. Poëte, peintre, architecte et sculpteur, on pourrait le comparer à Michel-Ange, dont il a l’universalité, le dédain des idées régnantes, l’imagination sombre et grandiose. Les sculptures d’Or San Michele à Florence sont conçues dans les données traditionnelles, mais dénotent une rare originalité de conception et une liberté d’exécution qui n’est pas surpassée par les élèves de Giotto. La Loggia dei Lanzi, où il dédaigne l’emploi de l’arc aigu pour retourner au plein cintre, est une œuvre à part dans l’histoire de l’art, merveille de puissance élégante, de solidité et de convenance. Ses peintures du Campo-Santo de Pise et de la chapelle Strozzi à Florence montrent tout ce qu’il y avait d’invention et de grâce énergique dans cet homme extraordinaire. Mais c’est surtout dans sa grande fresque de la Vie humaine au Campo Santo que se déploient dans tout leur éclat son imagination et sa puissance créatrice. On ne se demande pas en voyant de telles œuvres: Est-ce juste, possible, dans la nature, ou suivant les règles de l’école? Il faudrait répondre: C’est impossible et en dehors de toutes les lois de la nature et de l’art. Mais ces grandes œuvres, qu’elles se nomment le Triomphe de la Mort, d’Orgagna, ou le Jugement dernier, de Michel-Ange, défient la raison et s’imposent à l’imagination avec une souveraine puissance. Elles perdent ceux qui les imitent et doivent rester isolées dans l’histoire des créations humaines.
Jusqu’à Giotto, l’art avait vécu dans la dépendance absolue du dogme religieux. L’Église ne lui permettait d’exister qu’à condition de la servir. Toute liberté était bannie; toute trace un peu marquée d’individualité humaine était exclue. La peinture ne servait qu’à traduire pour les yeux des scènes dont les moindres particularités étaient fixées par une tradition qui resta vague et disputée pendant longtemps, mais qui avait pris de jour en jour un caractère plus précis et plus tyrannique. Le XIIIe siècle brisa ces entraves et rendit à l’esprit humain la plénitude de sa liberté. Les sciences et les lettres resplendirent d’un éclat depuis bien longtemps oublié, et les arts du dessin marchèrent à pas de géant dans la route que Giotto venait de leur ouvrir. Cette école naturaliste, qui avait pris une nouvelle vigueur au contact de la réalité, devait aboutir, en passant par Masaccio, par Donatello, par Ghiberti, par le Ghirlandajo, à Léonard de Vinci et à Michel-Ange, puis, par un retour imprévu vers l’école mystique d’Ombrie, à Pérugin, à Fra Bartolommeo, à Lorenzo di Credi et à Raphaël.
Cependant à côté de cette grande école florentine, qui devait bientôt tout absorber dans son foyer vivant, une autre école dérivée des maîtres de Sienne vivait disséminée dans les couvents et dans les petites villes de la Toscane. Dépositaires fidèles des traditions religieuses, les peintres qui la composaient, tout en se laissant influencer par les progrès accomplis et en modifiant l’exécution si insuffisante de leurs devanciers, résistaient aux entraînements du naturalisme. Leurs peintures, très-souvent médiocres, mais très-souvent aussi exquises de sentiment religieux, et d’une-sorte de beauté immatérielle et idéale qui leur est particulière, sont des œuvres de foi, des élévations de l’âme, des adorations plutôt que des ouvrages d’art proprement dits. Aussi est-il difficile d’en parler et de faire passer dans l’esprit du lecteur l’impression vive et profonde qu’elles produisent. Ces peintres étaient pour la plupart des moines, camaldules ou dominicains, qui, se sentant des dispositions artistiques, s’adonnaient à la peinture comme d’autres à la musique, pour louer Dieu. Leurs ouvrages sont presque tous de petite dimension, miniatures sur vélin pour livres de chœur et de prières, ou tableaux d’autels. Les noms de ces artistes pieux qui vivaient loin du monde, sans chercher à tirer parti de leur talent pour leur intérêt ou pour leur gloire, sont presque tous inconnus. On peut citer, cependant, dom Jacques le Florentin et dom Sylvestre, camaldules des Anges, près de Florence, qui laissèrent à leur couvent vingt volumes de livres de chœur dont la beauté n’a probablement jamais été surpassée. Ces volumes sont perdus, à l’exception d’un seul, conservé à la Bibliothèque laurentienne, et qui suffit pour faire comprendre l’admiration enthousiaste de Vasari. C’est à cette école de peintres modestes et fervents, qui ne voyaient dans l’art qu’un moyen d’exprimer pour les yeux leurs sentiments de piété et les préoccupations habituelles de leur âme, qu’appartient Fra Angelico de Fiesole. Le système suivi par ces artistes était faux et devait tomber devant l’exemple de l’école rivale. Dans la représentation matérielle des faits, la matière a sa place et la forme son droit. Cette peinture, qui spiritualisait la nature humaine sans l’appuyer sur la réalité ; qui persistait à employer les teintes plates et une perspective grotesque lorsque la pratique du clair-obscur était générale, et que les travaux de Paolo Uccello avaient vulgarisé la perspective linéaire; qui ôtait toute liberté à l’imagination et tout choix à la pensée, devait tomber dans une médiocrité qui deviendrait d’autant plus choquante et manifeste que le naturalisme ferait des progrès plus marqués. Mais les ouvrages des peintres qui nous occupent respirent une candeur, une délicatesse, une ferveur inimitable; malgré l’insuffisance de la forme, ils méritent certainement l’attention et l’intérêt, et j’avoue que les compositions si imparfaites de ces hommes modestes me vont souvent plus à l’âme que bien des chefs-d’œuvre glorieux des maîtres.
Giovanni de Fiesole, dit l’Angelico, et qui se nommait, avant de prendre l’habit, Guido ou Guidolino, naquit en 1387, dans la province de Mugello, en Toscane. Vasari ne nous a laissé que très-peu de détails sur sa famille. Il avait un frère cadet, Benedetto, miniaturiste de talent et auteur d’un assez grand nombre d’ouvrages attribués à tort à l’Angelico. En 1407, les deux frères prirent l’habit des dominicains prêcheurs à Fiesole, près de Florence, et se rendirent à Cortone, où se trouvait le noviciat de l’ordre. Il est probable qu’ils revinrent à Fiesole en 1408, après avoir prononcé leurs vœux, pour quitter de nouveau cette ville à l’occasion du schisme qui divisait l’Église à cette époque. Grégoire XII, Benoît XIII et Alexandre V se disputaient la tiare; et la république de Florence, ayant abandonné le parti de Grégoire pour celui d’Alexandre, les dominicains de Fiesole, qui tenaient pour le premier, s’enfuirent à Foligno, en Ombrie, où leur ordre avait un couvent et Grégoire de nombreux partisans. On ne sait pas d’une manière précise si l’Angelico était de retour à Fiesole au moment où se passaient ces événements, s’il suivit ses frères en Ombrie et si c’est alors ou plus tard qu’il décora la façade de l’église de Cortone et qu’il fit les deux tableaux qu’on voit encore aujourd’ hui dans cette ville, l’un à l’église de Saint-Dominique, qui représente la Vierge entourée d’anges avec l’Enfant sur ses genoux; l’autre, une Annonciation, à l’église des jésuites. Quoi qu’il en soit, la communauté tout entière, chassée de Foligno par la peste, se rendit à Cortone, en 1414, et rentra définitivement, en 1418, dans la propriété de son abbaye de Fiesole, qui lui avait été.enlevée. C’est pendant la période de dix-huit années qui suivit ces tribulations et que l’Angelico passa dans le calme et la retraite, à Fiesole, au milieu de la nature tranquille et charmante des collines de Florence, qu’il peignit vraisemblablement les deux fresques qui ornent le réfectoire et la salle du chapitre du couvent, ainsi que les nombreux tableaux qui sont réunis pour la plupart dans les salles de l’Académie de Florence. C’est aussi de cette époque que date le grand tabernacle qu’il fit pour la confrérie des drapiers, et qui se trouve à la galerie des Offices. Ce tableau lui fut commandé en 1433 et payé 190 florins d’or; et c’est assurément l’un de ses plus parfaits ouvrages. Le sujet principal est une Madone plus grande que nature avec l’Enfant Jésus sur ses genoux; elle est entourée d’une guirlande de douze anges, qui jouent de divers instruments de musique, et qui sont d’une beauté merveilleuse. Les deux volets qui recouvrent le tableau principal représentent saint Jean-Baptiste, saint Pierre et saint Marc, protecteurs de la confrérie. Ces peintures ont un grand caractère qu’on ne s’attend pas à trouver chez un maître élevé à l’école des miniaturistes. La couleur est faible, le modelé insuffisant, la réalité peu marquée; mais on trouve dans ce tableau les prémices des grandes qualités que Fra Angelico devait mettre plus tard dans ses peintures murales du cloître de Saint-Marc, du Vatican et du dôme d’Orvieto. Au-dessous du tableau principal se trouvait un gradin qui en a été séparé ; il est formé de trois sujets: la Prédication de saint Pierre, l’Adoration des Mages et les Persécuteurs de l’Évangile effrayés par la colère céleste. Ces trois petits tableaux sont autant de merveilles; ils donnent une juste idée de tout ce que l’imagination de Fra Angelico avait de suave, de tendre, d’ingénieux. Ils résument tous ces ouvrages de petite et de moyenne dimension, disséminés en grand nombre dans les galeries, dans les collections particulières, et dont le Couronnement de la Vierge, du Louvre, avec les gradins qui l’accompagnent, est aussi un très-bel exemple.
La reconstruction du couvent de Saint-Marc, à Florence, récemment concédé aux dominicains, ayant été entreprise vers 1436, Fra Angelico fut chargé de sa décoration intérieure. Il couvrit de peintures, avec l’aide de son frère, les murs des cellules et des corridors de ce monastère, et prodigua des trésors d’imagination et de grâce dans ce lieu qui devait avoir, à la fin du xve siècle, une si légitime et si éclatante célébrité. C’est, en effet, sous un grand rosier de Damas, dans le jardin de ce couvent, que Savonarole commença ses prédications enthousiastes; et Fra Bartolommeo, le plus grand des peintres qu’on puisse rattacher à l’école religieuse proprement dite, était également moine de Saint-Marc.
Plusieurs des compositions qui décorent ce couvent sont loin cependant d’être du premier ordre; elles se ressentent de la collaboration de Benedetto. Elles ont d’ailleurs été dégradées à diverses reprises, et notamment pendant la dernière occupation autrichienne.
L’Adoration des Mages fait exception, et Fra Angelico n’a jamais mis à un plus haut degré, dans aucun de ses ouvrages, tant de candeur et de piété. Quant au Crucifiement, si on juge de sa valeur par l’impression que produit cette vaste et sublime composition, on doit la regarder comme le chef-d’œuvre du maître; elle occupe toute une des parois de la salle du chapitre. Au deuxième plan, se détachant sur la muraille nue, les trois crucifiés; sur le devant du tableau, d’un côté les saints et les docteurs de l’Église; de l’autre, la Vierge, soutenue par les deux Maries, et dont Madeleine, sublime de douleur, embrasse les genoux. De pareilles œuvres ne se commentent pas, ne s’analysent pas; il serait mal placé d’appuyer sur des imperfections qui n’échappent à personne. Il est évident que la science est au-dessous de la conception, que la main n’est pas au niveau de la pensée. Le système est détestable. Je ne prétends ni le conseiller, ni le défendre; mais de pareils ouvrages, conçus par l’âme, vont à l’âme, et on ne peut échapper en les contemplant, à une émotion que ne font pas éprouver les compositions parfaites des plus grands maîtres. Il faut bien convenir qu’il y a dans le domaine des arts, comme dans celui de la morale, des points qui échappent à la preuve directe et qui parlent souverainement, malgré l’imperfection des moyens employés pour les exprimer, à la conscience ou au sentiment.
La réputation de Fra Angelico grandissant de plus en plus, et ses travaux de Saint-Marc, à Florence, l’ayant placé à la tête des peintres religieux de son temps, le pape Eugène IV l’appela à Rome et le chargea de peindre au Vatican une chapelle contiguë aux salles que Raphaël devait plus tard décorer. Il y représenta, en six compartiments, les scènes principales de la vie de saint Laurent et de saint Étienne. L’Angelico était alors à l’apogée de son talent; et il est probable que les sculptures antiques qu’il dut voir à Rome, ainsi que l’exemple des peintres qui travaillaient en même temps que lui au Vatican, ne furent pas sans influence sur ses derniers ouvrages. Les peintures de cette chapelle ont une puissance, une beauté, une largeur de composition, qui ne se trouvent pas au même degré dans ses tableaux de petite dimension. Les têtes sont pleines de vie: l’ordonnance est savante; les draperies, mieux étudiées, appartiennent à la peinture d’histoire et ne rappellent plus les habitudes de la miniature. L’Angelico fit aussi, pendant ce séjour à Rome, pour l’église de la Minerve, quelques tableaux qui, au dire de Vasari, s’y trouvaient encore de son temps, mais qui sont perdus. S’il faut en croire le même auteur, l’archevêché de Florence étant devenu vacant à cette époque, Eugène IV, autant frappé de la piété de Fra Angelico que de son talent, voulut l’élever à la dignité archiépiscopale. Le modeste moine, effrayé de la responsabilité attachée à cette position et recherchant l’obscurité plus que les honneurs, supplia le pape «de se pourvoir d’un autre, parce qu’il ne se sentait pas propre à gouverner le peuple;» mais il lui parla «d’un moine de sa confrérie, amoureux des pauvres, très-savant, sachant commander, craignant Dieu, qui conviendrait mieux que lui-même.» Antonio, recommandé en de pareils termes par Fra Angelico, fut en effet nommé archevêque de Florence, en 1445. Je ne sais ce qu’il y a de vrai dans cette anecdote, l’exactitude n’étant pas la qualité dominante de Vasari. Mais, vraie ou fausse, elle s’accorde bien avec l’extrême modestie qui paraît avoir été le trait distinctif du caractère du pieux moine de Fiesole. Son biographe revient à plusieurs reprises sur sa simplicité et sur l’humilité de ses habitudes et de ses goûts. «Il ne se distingua pas moins, dit-il, par son talent de peintre que par ses vertus de religieux. Il lui eût été facile de figurer largement dans le monde; car, outre ses biens de famille, il pouvait gagner tout ce qu’il voulait avec son pinceau, que dès sa jeunesse il maniait habilement. Mais, d’un caractère doux et modeste, il préféra, pour son repos et pour son salut, entrer dans l’ordre des frères prêcheurs. On peut servir Dieu dans tous les états; quelques personnes, néanmoins, pensent qu’il est plus aisé de se sauver dans les monastères que dans le monde. Autant ce parti réussit aux bons, autant il procure une vie misérable à ceux qui l’embrassent dans un tout autre but que celui de travailler au salut de leur âme.»
C’est pendant ce séjour à Rome, vers 1447, que Fra Angelico, fut chargé de décorer la grande chapelle du dôme d’Orvieto. Il prépara les cartons de cet ouvrage considérable, et peignit même, avec l’aide de son élève préféré, Benozzo Gozzoli, le triangle de la voûte qui se trouve au-dessus de l’autel. Mais il abandonna ce travail, si glorieusement terminé par Luca Signorelli; et après avoir encore fait quelques tableaux de moindre importance, il mourut à Rome en 1455 et fut enseveli dans l’église de Santa Maria sopra Minerva.
L’influence artistique de l’Angelico fut très-grande, surtout en Ombrie, où la peinture religieuse et liturgique maintint sa prépondérance jusqu’à Pérugin. Ses élèves, et particulièrement Benozzo Gozzoli, répandirent sa doctrine, sans la modifier d’une manière très-sensible, dans toute l’Italie. Il paraît qu’on garda pendant longtemps un souvenir vif et attendri de son caractère et de ses vertus; car Vasari, d’ordinaire si fastidieux, si vide, si diffus, a parlé de l’Angelico, quoiqu’il vécût lui-même dans un temps où la peinture religieuse de ces maîtres naïfs n’était guère en honneur, en termes vrais et bien émus dans le portrait qu’il nous a laissé du moine de Fiesole: «Plût à Dieu que tous les religieux consacrassent leur vie, comme cet homme vraiment évangélique, au service de Dieu et du prochain! Que peut-on et que doit-on plus désirer que d’aoquérir le royaume du ciel en vivant saintement, et une renommée éternelle sur la terre en produisant des chefs-d’œuvre? Du reste, un talent comme celui de Fra Angelico ne pouvait et ne devait appartenir qu’à un homme de sainte vie. Les peintres qui traitent des sujets pieux doivent être pieux eux-mêmes. Je ne voudrais cependant pas que l’on arrivât à trouver pieux ce qui n’est que fade, et lascif ce qui n’est que beau. Que de gens qui crient au scandale dès qu’ils aperçoivent une figure d’homme ou de femme un peu plus belle que d’ordinaire..... Fra Giovanni était d’une simplicité de mœurs et d’une naïveté extraordinaires. Un jour le pape Nicolas V l’ayant invité à manger de la viande, il s’en fit conscience, parce qu’il n’avait pas de permission de son prieur, oubliant ainsi l’autorité du souverain pontife..... Sans cesse occupé de peinture, il ne voulut jamais employer son pinceau qu’à représenter des sujets pieux. Il aurait pu acquérir des richesses; mais il n’en faisait pas cas, et disait qu’elles consistaient à se contenter de peu. Il aurait pu commander; mais il s’y refusa constamment, prétendant qu’il est plus aisé d’obéir. Il aurait pu obtenir de hautes dignités; mais il les dédaigna, affirmant qu’il ne cherchait qu’à éviter l’enfer et à gagner le paradis. Plût à Dieu que les hommes n’eussent jamais que cette sainte ambition! D’une sobriété et d’une chasteté extrêmes, il sut éviter les piéges du monde, répétant souvent que le repos et la tranquillité sont nécessaires à un artiste, et que celui qui peint l’histoire du Christ ne doit penser qu’au Christ. On ne le vit jamais se mettre en colère, ce qui me paraît presque incroyable. Il se bornait à répondre à ses amis avec douceur et en riant. Il n’accomplissait aucun travail sans avoir d’abord demandé l’agrément de son prieur. Enfin toutes les actions de ce bon père sont empreintes d’humilité et de modestie. Ses tableaux, pleins de facilité, respirent la dévotion la plus profonde. Les saints qu’il peignit se distinguent par un aspect divin, que l’on ne rencontre chez aucun autre artiste..... On assure qu’il n’aurait pas touché ses pinceaux avant d’avoir fait sa prière. Il ne représenta jamais le Sauveur sur la croix sans que ses joues fussent baignées de larmes; aussi les visages et les attitudes de ses personnages laissent-ils deviner toute la sincérité de sa foi dans la religion chrétienne. »
On a souvent considéré les arts d’une vue trop courte, par leur côté agréable, et en ne leur demandant que de charmer les yeux ou de distraire momentanément l’esprit. Aucun reproche de futilité ne peut certes atteindre les artistes dont je viens d’esquisser les travaux. Mais je ne sais s’ils ont toujours eu une idée bien nette de l’importance de leurs ouvrages, et s’ils ont prévu que, de siècle en siècle, leurs compositions charmantes ou sublimes développeraient l’intelligence et raviraient le cœur de nombreuses générations. Ils ont, pour aussi longtemps que la terre vivra, éternisé leur propre pensée et donné à leur personnalité, dans ce qu’elle avait de plus élevé et de plus exquis, une forme arrêtée et durable. Ces créations de l’imagination nous arrachent aux préoccupations vulgaires, élèvent notre âme vers les plus nobles conceptions, et, comme les chefs-d’ œuvre de la littérature, peuplent nos souvenirs des meilleures pensées des plus grands esprits de tous les temps. Il ne faut rien dédaigner: les choses vraies ne se transforment pas en erreurs pour être revêtues de charme et de beauté ! Je conviens que le gouvernement moral de notre être doit avoir le pas sur le développement de l’intelligence et sur ce qui peut orner et charmer l’esprit. Mais ne m’accordera-t-on pas que la compagnie habituelle de ces grandes œuvres et de ces nobles conceptions nous retient dans notre véritable milieu, et dans une atmosphère saine et élevée, qui ne peut que nous amener, sur toutes choses, près de la vérité ?
Cependant l’art dont j’ai parlé ne devait pas vivre, parce que, se mettant sans réserve au service d’idées qui ne lui appartiennent pas en propre, il méconnut sa nature. L’art a besoin d’indépendance et de désintéressement. La perfection de la forme est la condition de son existence. Il doit arriver à la beauté, comme la littérature à la perfection du langage. C’est cette manière forte, élevée, absolue, en quelque sorte surnaturelle d’exprimer les idées et les sentiments, qui constitue ce qu’on est convenu d’appeler le style. Les arts se perdent en poursuivant avant tout un but pratique. Ils se perdent autant et davantage, il est vrai, en recherchant la forme pour la forme, et la beauté pour elle-mème. Que serait en effet la forme séparée de l’idée qu’elle représente, et une œuvre qui n’aurait pas pour terme et pour but son propre sujet? Que signifie cette absorption de l’idée par sa représentation, et la théorie de l’art pour l’art n’est-elle pas aussi inepte que grossière? Mais il faut convenir et dire très-haut que l’utilité n’est pas le but de l’art, ou plutôt, en étendant comme il convient le sens de cette notion d’utilité, reconnaître que l’art s’applique à des objets matériels aussi bien qu’aux idées, pour donner une représentation parfaite des premiers et pour revêtir les notions métaphysiques d’une forme qui puisse être perçue par nos sens; qu’il donne, pour parler en d’autres termes, l’idée vraie des choses en les représentant sous leur forme la plus parfaite.
Entre le monde métaphysique qui se révèle à l’esprit, à la conscience, à la raison, et le fait qui ne parle qu’à nos sens, se trouve cette notion si vaste de l’art qui relie les deux extrêmes de la nature humaine. L’art n’est l’organe ni de la matière ni de la pensée, mais il rend la vie à la première en lui donnant son sens intime, et prête à la seconde un corps et une réalité sensible. Il ne procède ni par l’expérience, ni par le raisonnement, mais s’adresse à ce qu’on est convenu d’appeler l’imagination, et détermine l’émotion plutôt que la certitude ou que la conviction. L’art n’est rien en lui-même, mais il vivifie toutes choses et donne aux êtres et aux idées leur forme vraie, suivant le modèle immuable que nous en avons dans l’esprit.
Une science insuffisante, le dédain de la beauté, des préoccupations avant tout dogmatiques, devaient amener la ruine de l’école liturgique; et c’est en se tenant à une égale distance d’un mysticisme chimérique et des aberrations du naturalisme, c’est en donnant une forme parfaite à des idées générales et réellement humaines, que les grands maîtres du XVIe siècle, dont nous allons étudier la vie et les œuvres, ont élevé les arts à un degré de splendeur qui ne sera jamais dépassé.