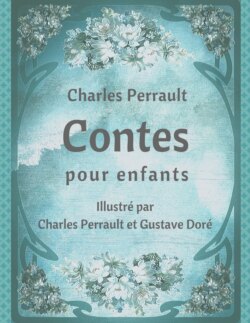Читать книгу Contes pour enfants - Charles Perrault, Charles Perrault, Samber Robert - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
PRÉFACE
ОглавлениеLa manière dont le public a reçu les pièces de ce recueil, à mesure qu’elles lui ont été données séparément, est une espèce d’assurance qu’elles ne lui déplairont pas en paraissant toutes ensembles. Il est vrai que quelques personnes qui affectent de paraître graves, et qui ont assez d’esprit pour voir que ce sont des contes faits à plaisir, et que la matière n’en est pas fort importante, les ont regardées avec mépris ; mais on a eu la satisfaction de voir que les gens de bon goût n’en ont pas jugé de la sorte.
Ils ont été bien aises de remarquer que ces bagatelles n’étaient pas de pures bagatelles, qu’elles renfermaient une morale utile, et que le récit enjoué dont elles étaient enveloppées n’avait été choisi que pour les faire entrer plus agréablement dans l’esprit et d’une manière qui instruisît et divertît tout ensemble. Cela devrait me suffire pour ne pas craindre le reproche de m’être amusé à des choses frivoles. Mais comme j’ai affaire à bien des gens qui ne se payent pas de raisons et qui ne peuvent être touchés que par l’autorité et par l’exemple des anciens, je vais les satisfaire là-dessus. Les fables milésiennes si célèbres parmi les Grecs, et qui ont fait les délices d’Athènes et de Rome, n’étaient pas d’une autre espèce que les fables de ce recueil. L’histoire de la Matrone d’Éphèse est de la même nature que celle de Griselidis : ce sont l’une et l’autre des nouvelles, c’est à dire des récits de choses qui peuvent être arrivées, et qui n’ont rien qui blesse absolument la vraisemblance. La fable de Psyché écrite par Lucien et par Apulée est une fiction toute pure et un conte de vieille comme celui de Peau d’Âne. Aussi voyons-nous qu’Apulée le fait raconter par une vieille femme à une jeune fille que des voleurs avaient enlevée, de même que celui de Peau d’Âne est conté tous les jours à des enfants par leurs gouvernantes, et par leurs grand-mères. La fable du Laboureur qui obtint de Jupiter le pouvoir de faire comme il lui plairait la pluie et le beau temps, et qui en usa de telle sorte, qu’il ne recueillit que de la paille sans aucuns grains, parce qu’il n’avait jamais demandé ni vent, ni froid, ni neige, ni aucun temps semblable ; chose nécessaire cependant pour faire fructifier les plantes : cette fable, dis-je, est de même genre que le conte des Souhaits Ridicules, si ce n’est que l’un est sérieux et l’autre comique ; mais tous les deux vont à dire que les hommes ne connaissent pas ce qu’il leur convient, et sont plus heureux d’être conduits par la Providence, que si toutes choses leur succédaient selon qu’ils le désirent. Je ne crois pas qu’ayant devant moi de si beaux modèles dans la plus sage et la plus docte antiquité, on soit en droit de me faire aucun reproche. Je prétends même que mes Fables méritent mieux d’être racontées que la plupart des contes anciens, et particulièrement celui de la Matrone d’Éphèse et celui de Psyché, si l’on les regarde du côté de la Morale, chose principale dans toute sorte de Fables, et pour laquelle elles doivent avoir été faites. Toute la moralité qu’on peut tirer de la Matrone d’Éphèse est que souvent les femmes qui semblent les plus vertueuses le sont le moins, et qu’ainsi il n’y en a presque point qui le soient véritablement.
Qui ne voit que cette Morale est très mauvaise, et qu’elle ne va qu’à corrompre les femmes par le mauvais exemple, et à leur faire croire qu’en manquant à leur devoir elles ne font que suivre la voie commune. Il n’en est pas de même de la morale de Griselidis, qui tend à porter les femmes à souffrir de leurs maris, et à faire voir qu’il n’y en a point de si brutal ni de si bizarre, dont la patience d’une honnête femme ne puisse venir à bout. À l’égard de la morale cachée dans la fable de Psyché, fable en elle-même très agréable et très ingénieuse, je la comparerai avec celle de Peau d’Âne quand je la saurai, mais jusqu’ici je n’ai pu la deviner. Je sais bien que Psyché signifie l’âme ; mais je ne comprends point ce qu’il faut entendre par l’amour qui est amoureux de Psyché, c'est-à-dire de l’âme, et encore moins ce qu’on ajoute, que Psyché devait être heureuse, tant qu’elle ne connaîtrait point celui dont elle était aimée, qui était l’amour, mais qu’elle serait très malheureuse dès le moment qu’elle viendrait à le connaître : voilà pour moi une énigme impénétrable. Tout ce qu’on peut dire, c’est que cette fable de même que la plupart de celles qui nous restent des anciens n’ont été faites que pour plaire sans égard aux bonnes mœurs qu’ils négligeaient beaucoup. Il n’en est pas de même des contes que nos aïeux ont inventés pour leurs enfants. Ils ne les ont pas contés avec l’élégance et les agréments dont les Grecs et les Romains ont orné leurs fables ; mais ils ont toujours eu un très grand soin que leurs contes renfermassent une moralité louable et instructive. Partout la vertu y est récompensée, et partout le vice y est puni. Ils tendent tous à faire voir l’avantage qu’il y a d’être honnête, patient, avisé, laborieux, obéissant et le mal qui arrive à ceux qui ne le sont pas. Tantôt ce sont des fées qui donnent pour don à une jeune fille qui leur aura répondu avec civilité, qu’à chaque parole qu’elle dira, il lui sortira de la bouche un diamant ou une perle ; et à une autre fille qui leur aura répondu brutalement, qu’à chaque parole il lui sortira de la bouche une grenouille ou un crapaud. Tantôt ce sont des enfants qui pour avoir bien obéi à leur père ou à leur mère deviennent grands seigneurs, ou d’autres, qui ayant été vicieux et désobéissants, sont tombés dans des malheurs épouvantables. Quelque frivoles et bizarres que soient toutes ces fables dans leurs aventures, il est certain qu’elles excitent dans les enfants le désir de ressembler à ceux qu’ils voient devenir heureux, et en même temps la crainte des malheurs où les méchants sont tombés par leur méchanceté. N’est-il pas louable à des pères et à des mères, lorsque leurs enfants ne sont pas encore capables de goûter les vérités solides et dénuées de tous agréments, de les leur faire aimer, et si cela se peut dire, les leur faire avaler, en les enveloppant dans des récits agréables et proportionnés à la faiblesse de leur âge. Il n’est pas croyable avec quelle avidité ces âmes innocentes, et dont rien n’a encore corrompu la droiture naturelle, reçoivent ces instructions cachées ; on les voit dans la tristesse et dans l’abattement, tant que le héros ou l’héroïne de conte sont dans le malheur, et s’écrier de joie quand le temps de leur bonheur arrive ; de même qu’après avoir souffert impatiemment la prospérité du méchant ou de la méchante, ils sont ravis de les voir enfin punis comme ils le méritent. Ce sont des semences qu’on jette qui ne produisent d’abord que des mouvements de joie et de tristesse, mais dont il ne manque guère d’éclore de bonnes inclinations.
J’aurais pu rendre mes Contes plus agréables en y mêlant certaines choses un peu libres dont on a accoutumé de les égayer ; mais le désir de plaire ne m’a jamais assez tenté pour violer une loi que je me suis imposé de ne rien écrire qui pût blesser ou la pudeur ou la bienséance. Voici un madrigal qu’une jeune demoiselle de beaucoup d’esprit a composé sur ce sujet, et qu’elle a écrit au-dessous du conte de Peau d’Âne que je lui avais envoyé.
Le Conte de Peau d’Âne est ici raconté
Avec tant de naïveté,
Qu’il ne m’a pas moins divertie,
Que quand auprès du feu ma Nourrice ou ma Mie
Tenaient en le faisant mon esprit enchanté.
On y voit par endroits quelques traits de Satire,
Mais qui sans fiel et sans malignité,
À tous également font du plaisir à lire :
Ce qui me plaît encore dans sa simple douceur,
C’est qu’il divertit et fait rire,
Sans que Mère, Époux, Confesseur,
Y puissent trouver à redire.