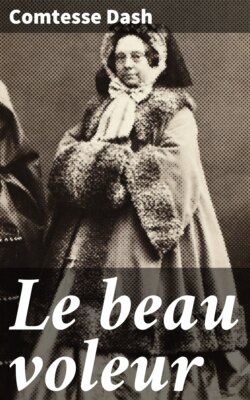Читать книгу Le beau voleur - Comtesse Dash - Страница 4
I
ОглавлениеDans un village de Bretagne, sur le bord de la mer, on célébrait un mariage, et tout le pays était sur pied, car il ne s’agissait de rien moins que de Jacques Poulailler, le hardi marin, et d’Isabeau Comblet la belle. Leurs amours étaient célèbres à dix lieues à la ronde; les parents s’étaient longtemps opposés à leur union; enfin ils avaient vaincu tous les obstacles, et on allait les conduire à l’autel.
De grand matin les cloches sonnaient à toutes volées, on tirait des coups de fusil en réjouissance, on défonçait les tonneaux, on embrochait les moutons et les oies; c’étaient de véritables noces de Gamache, toutes les maisons s’ouvraient joyeuses au soleil, les garçons brossaient leurs habits de fête et les jeunes filles préparaient leurs rubans.
Toute cette allégresse rendait d’autant plus remarquable l’isolement et la tristesse d’une habitation située à quelque distance du village, sur un promontoire élevé, d’où l’on dominait les falaises et la haute mer. Cette tour, à moité en ruines, était restée déserte pendant cinquante ans environ. Elle inspirait la terreur dans tout le voisinage, on prétendait qu’elle était hantée, et l’on racontait des horreurs sur ce qui s’y passait dans les longues nuits d’hiver. Il y avait de quoi faire trembler le plus brave.
Un matin, quelques années avant le mariage de Jacques Poulailler et d’Isabeau, par un orage épouvantable, un homme grand, sec, au teint pâle, aux cheveux ardents, vint s’établir dans la tour maudite. Personne ne l’avait vu arriver, personne ne pouvait dire quel chemin il avait suivi; on l’aperçut debout sur le rivage, au milieu des vieilles pierres, enveloppé dans un grand manteau noir. Il faisait de grands gestes, levait les bras et prononçait des paroles inconnues, que le vent apportait au milieu des éclats de la foudre. Les paysans se signaient, plusieurs coururent à l’église, l’effroi se répandit partout, un sorcier était établi dans la contrée.
Le lendemain le soleil était revenu: chacun s’attendait à ne plus revoir l’étranger, on l’aperçut néanmoins assis à la place qu’il avait choisie et raccommodant ses filets. Il ne descendit point au hameau, ne parla à personne, et ne sortit point de son refuge tant que dura le beau temps.
Les nuages s’amoncelèrent de nouveau, le tonnerre gronda, toutes les barques rentrèrent. Une seule se détacha du cap de la grande tour, s’avança en pleine mer et disparut bientôt sous les vagues furieuses. Un seul homme la montait bravant les éléments déchaînés, c’était l’inconnu. A moins d’être le diable, on ne pouvait résister à un pareil temps. Il y résista cependant et reparut deux jours après, son bateau rempli des plus beaux poissons de l’Océan.
Pour la première fois il descendit au village avec ses paniers et demanda si quelqu’un voulait lui acheter sa pêche. Pas un des plus hardis n’osa le refuser, ils le payèrent ce qu’il voulut, et lorsqu’il se retira, sans avoir échangé d’autres paroles avec ses voisins que les mots absolument nécessaires à son commerce, les petits enfants le poursuivirent. Il se retourna, et son regard les fit sauver, tant il était effrayant. A dater de ce jour ils le surnommèrent Roussart à cause de ses cheveux, et ce nom lui resta, faute de pouvoir lui en donner d’autres.
Il demeura plusieurs années dans la tour, et son genre de vie ne changea pas. Une seule fois il sembla obéir aux passions humaines, et fit à Isabeau Comblet une déclaration d’amour singulière par son emphase et par les promesses qu’elle renfermait. Si elle consentait à l’aimer, il lui promettait les honneurs, les richesses, elle verrait l’univers à ses pieds, elle serait la plus belle, la plus enviée de toutes, elle deviendrait reine, si elle en avait envie, enfin tous ses souhaits seraient accomplis. Isabeau le repoussa avec horreur, elle aimait Jacques et toutes les fortunes du globe ne l’auraient pas séparée de lui.
Roussart la persécuta pendant bien des mois. Souvent le soir, au moment où elle s’y attendait le moins, il apparaissait devant elle, au bord du chemin, en revenant des bois, et quand elle allait visiter ses bonnes amies. Un jour même elle le trouva dans sa chambre, sans savoir comment il y était entré ; il lui faisait une peur épouvantable, en elle-même, elle invoquait son ange gardien et la Vierge, mère du Sauveur.
Elle repoussait cet affreux soupirant de toutes ses forces, et pressait son mariage avec Jacques pour s’en débarrasser. Celui-ci ne demandait pas mieux et bientôt tout fut décidé selon leurs vœux.
Deux jours avant, au moment où Isabeau fermait sa fenêtre, avant de se coucher, elle aperçut Roussart dans le jardin, appuyé contre la maison, il étendit le bras vers elle, et lui dit:
— Tu m’as repoussé, Isabeau, tu épouses ton Jacques, mais tu te souviendras de moi, et malgré tes prières, ton premier enfant m’appartiendra.
— Je ne vous crains pas, répondit-elle, je vais maintenant avoir deux protecteurs: le bon Dieu qui m’a défendue jusqu’ici et le mari que mes parents me donnent, nous serons plus forts que vous.
Roussart disparut sans répondre. Jusqu’au moment du mariage, il ne se passa rien d’extraordinaire, la joie générale ne fut pas troublée. Isabeau jura devant Dieu d’aimer toujours son mari, et cela avec la bonne intention de le tenir. Les deux époux sortirent de l’église au comble du bonheur. Jacques laissa sa femme avec les gens de la noce et revint sur ses pas pour parler au bedeau, qui devait les faire danser le soir.
Comme il attendait dans le cimetière qui entourait la chapelle, Roussart parut devant lui, et lui dit avec un méchant sourire:
— Te voilà donc marié, maître Poulailler?
— C’est une chose sûre, monsieur.
— Pas plus sûre que le premier de tes enfants appartiendra au diable, et c’est moi, Roussart, qui te le prédis.
Poulailler resta tout attéré, pendant que son mystérieux et terrible voisin disparaissait à ses regards. Il se promit de garder pour lui cette prophétie et de n’en point parler, surtout à sa femme, dont l’imagination pourrait s’en frapper. Il rejoignit ses amis, et il eut bientôt oublié cet incident au milieu de la fête et des réjouissances.
Roussart ne parut plus dans le pays. Personne ne s’en souvint, si ce n’est dans les veillées, quand on racontait son histoire effrayante. Isabeau seule en gardait mémoire: elle avançait dans sa grossesse, et les phénomènes extraordinaires qu’elle éprouvait lui rappelaient la menace de son adorateur méprisé. Elle souffrait des douleurs horribles.
— Il me semble que je porte un brasier, disait-elle, j’étouffe et je brûle, c’est peut-être là un enfant extraordinaire. J’ai grande envie de me faire exorciser.
Poulailler n’était guère plus rassuré qu’elle; mais le curé qu’on alla consulter, et auquel on raconta les prédictions du Roussart, leur parla le langage de la raison, et soutint à Jacques, que son enfant étant bien à lui ne pouvait être celui du diable.
— D’ailleurs une pure et sainte femme telle qu’Isabeau ne pourrait mettre au monde un fils de Satan. Ce sont des chimères. Priez, ayez confiance en Dieu, il ne vous abandonnera pas.
Ces paroles du prêtre consolèrent un peu le jeune ménage, et le temps se passa un peu plus tranquillement jusqu’à l’accouchement d’Isabeau. Alors les inquiétudes recommencèrent. La mère éprouva de véritables tortures.
— Je brûle! je brûle! ne cessait-elle de crier, qu’on aille me quérir de l’eau bénite!
L’enfant naquit en criant plus haut que sa mère même; il était beau et fort, néanmoins les commères réunies trouvèrent dans son visage je ne sais quels traits extraordinaires qui leur donnèrent à penser, à parler secrètement. On le conduisit au baptême, et, lorsque l’eau sainte toucha son front, il fut saisi de convulsions épouvantables, il semblait un possédé.
Cet enfant fut nommé Jacques Poulailler, comme son père, et c’est lui dont les aventures ont fait tant de bruit dans le monde, avant et depuis sa mort.
Sa première enfance n’offrit rien de particulier. Il prit de très-bonne heure une force prodigieuse et une beauté qui, en se développant avec l’âge, devint sinistre et fatale; il annonçait des inclinations perverses, un caractère indomptable; ni les récompenses, ni les punitions n’avaient de pouvoir sur lui. Aussitôt qu’il fut assez grand pour sortir seul, il se mit à voler tout ce qui tentait ses désirs, rien ne lui était sacré, ni les bijoux de sa mère, ni l’argent de ses voisins, ni les fruits, ni les volailles, ni même les reliques de monsieur le curé, qu’il jetait au vent, ou qu’il profanait.
Des plaintes arrivèrent à ses parents de tous les côtés.
— Ah! disait Isabeau, nous aurons beau faire, le diable ne s’est pas trompé, il lui appartient.
— Pas encore, ma femme, ou du moins nous devons tout essayer pour le lui ravir.
— Mais, mon ami, c’est un garnement, il ne veut pas même apprendre sa croix de par Dieu, sous prétexte qu’appartenant au diable cela ne lui servirait à rien du tout. Chacun dans le pays ne l’appelle que Diabledonné au lieu de Dieudonné, ce nom de si heureux augure. Ah! mon pauvre Jacques, nous sommes bien à plaindre d’avoir donné le jour à un tel monstre.
L’honnête Jacques ne répondit rien; qu’aurait-il dit? Il sortit dans le village, et aperçut de loin son fils poursuivi par toute la marmaille et courant en avant des autres, orné d’une paire de cornes et d’une queue de papier. Les polissons le suivaient, criant du haut de leurs têtes:
— C’est le fils du diable! voilà le fils du diable.
— Pour qui me prennent donc ces petits impertinents? murmura Poulailler, je vais leur apprendre à vivre et à mon fils aussi.
Celui-ci ne semblait pas embarrassé de ses attributs, il les portait fièrement, comme une parure, comme un certificat de sa noble origine. Son père les lui arracha, en lui demandant où il prenait tant de hardiesse pour attrouper ainsi tout le village après lui.
— C’est pour me faire honneur, dit-il.
— Pour te faire honneur!
— Sans doute, je suis le fils du diable, et j’ai le droit de porter ses armes.
Un soufflet et un coup de pied, lancés juste à l’endroit où s’étalait la queue de papier, envoyérent le fils du diable tomber à six pas sur un fumier, ce qui ne l’humilia point du tout. Poulailler le releva, le prit par l’oreille et le conduisit ainsi à sa mère, qui pleurait en préparant la soupe de la famille.
— Tiens, ma femme, dit-il, voilà le garnement, je l’ai trouvé jouant au diablotin, et il a été d’une insolence digne du rôle qu’il se veut imposer. Il a dix ans, il a déjà commis plus de vols, plus de faussetés et de mauvaises actions qu’il n’en faudrait pour se faire pendre. Le navire qui se trouve en vue a besoin d’un mousse, il part pour les grandes Indes, embarquons-le. Peut-être il ne reviendra pas, ou bien il reviendra corrigé, ou bien il persévérera dans son infamie, et au moins nous ne le verrons point. Fais-lui son paquet, et en route!
La pauvre femme se mit à pleurer. Une mère est toujours mère, souvent même elle a plus de tendresse pour celui qui le mérite le moins. Elle supplia son mari d’essayer encore, de ne point renvoyer leur premier-né, elle promit en son nom qu’il se corrigerait, elle fit valoir sa jeunesse, son étourderie, son ignorance; le père fut inflexible, l’arrêt était prononcé, il fallait qu’il s’exécutât.
Quant au jeune drôle, impassible, l’œil sec, il assistait à ce débat comme s’il y eût été tout à fait étranger. Il désirait au fond de son âme que sa mère eût le dessous, car il désirait vivement se soustraire au joug paternel, et l’idée de voyages lointains, l’idée d’une liberté absolue ne lui déplaisait pas. Il se promettait déjà de ne pas appartenir longtemps au même maître, s’il lui faisait supporter un joug trop pesant, et de courir le monde pour son propre compte, aussitôt que cela lui serait possible.
Jacques Poulailler ne se rendit point aux prières d’Isabeau; il lui ordonna, au contraire, assez durement, d’embrasser son fils, si elle avait le courage de l’aimer encore. Le brick appareillait, il n’y avait pas de temps à perdre, si on voulait profiter de l’occasion; quant à lui, il bénirait Dieu chaque jour d’être délivré d’un pareil misérable, et il se hâterait de l’envoyer à son patron, dans la crainte qu’il ne se dédît, s’il prenait le moindre renseignement.
L’enfant fut arraché des bras de sa mère, à laquelle il ne rendait pas ses caresses, il fut remis aux marins qui l’emmenèrent, avec force recommandations de ne pas le ménager, pour le faire changer de conduite, et le soir même, il quitta pour jamais son pays natal, sans emporter même un regret.
Cette vie aventureuse lui plut pendant quelques mois; tout était nouveau pour lui, tout était plaisir, les périls même souriaient à sa nature hardie; il n’avait pas de plus grande joie que de grimper en haut des mâts, alors que la foudre grondait, alors que la tempête menaçait et que tous les êtres vivants tremblaient au choc des éléments déchaînés. Il les bravait et les regardait en face; on le citait comme le plus téméraire entre tous. Il eût voulu se battre contre l’univers entier, disait-il, il se sentait la force de le vaincre et de le dominer. Son capitaine le regardait comme un vrai chenapan, et disait à ses officiers:
— Cet infâme, qui prétend être le fils du diable, en a, ma foi! la méchanceté.
Et là-dessus les coups de garcette pleuvaient à qui mieux mieux, et Jacques ployait le dos, se laissait battre, et se contentait de dire:
— Tout cela se payera à la fois.
Cette existence dura deux ans. Le navire courut les quatre parties du monde, il relâcha dans les principaux ports et arriva enfin à Southampton en Angleterre, pour se radouber. Le capitaine avait bien vendu ses denrées, il possédait une petite somme bien ronde, qu’il comptait porter à sa famille, ce dont il se réjouissait beaucoup. Poulailler crut le moment arrivé de payer grassement les coups de garcette; il attendit un jour où le commandant était à terre, où l’équipage occupé aux travaux du bord ne songeait point à le surveiller, et, prenant son temps pour agir, il fit sauter la serrure du coffre-fort, s’empara de l’argent, sauta dans un canot, se rendit au rivage et détala.
Il ne manquait pas de bâtiments en partance; le fugitif était trop adroit pour s’y laisser prendre, car on ne manquerait pas de l’y chercher. Il s’arrangea avec le patron d’une barque, se rendant sur les côtes d’Écosse pour y pêcher du saumon, et il était déjà bien loin avant qu’on se fût aperçu de son absence.
Selon les conventions faites, on le débarqua et il s’en alla tout droit à Edimbourg. Muni de son escarcelle, il voulut connaître un peu la vie élégante, et il se fit conduire au meilleur hôtel du plus beau quartier. Entrant avec des airs d’insolence et de hauteur, il demanda un appartement, loua un laquais, se donna pour le fils d’un duc et pair français auquel il inventa un nom, bien entendu, en jetant noblement une guinée sur la table, il commanda un bol de punch, assaisonné de la bonne façon.
L’hôtelier se hâta d’obéir. Un gros homme placé à côté de lui ouvrait des yeux démesurés et ne pouvait en croire ses oreilles. Le fils d’un duc et pair, en semblable équipage, sans suite, à cet âge, il avait dû lui arriver des malheurs affreux. Son cœur s’en émut, et il s’estima trop heureux s’il pouvait être utile à un enfant de si haute naissance.
— Pardon, mylord, mais Votre Seigneurie... Votre Honneur... Votre Grâce...
Comme tous les enfants, Jacques apprenait facilement les langues, on l’aurait cru Anglais, tant il avait l’accent britannique, seulement ses expressions n’étaient pas d’un choix aristocratique, et, tout autre qu’un marchand de sucre et de café, s’en serait promptement aperçu.
Il prit de grands airs et daigna répondre aux questions de son bienveillant voisin. Il avait fait naufrage, ses gens s’étaient noyés, lui seul avait été sauvé par des pêcheurs qui l’avaient recueilli, lui avaient prêté des habits, les siens étant hors de service; heureusement il avait sur lui une assez forte somme; il avait pu récompenser ces braves gens, et il attendait à Edimbourg des nouvelles de sa famille, avant de continuer son voyage.
Le gros homme se sentit touché jusqu’aux larmes; tant de courage, de résolution dans un âge aussi tendre! Il offrit timidement ses services au grand seigneur déguisé, lui dit qu’il serait le plus heureux du monde s’il daignait les accepter. Toute sa maison était à sa disposition, il l’habitait seul et peut-être Sa Seigneurie y serait-elle plus à son aise que dans une auberge ouverte à tous venants.
Sa Seigneurie se hâta d’accepter.
Il fit chère lie chez le bourgeois pendant quinze jours, se faisant présenter les connaissances de son hôte, sa famille, et se posant en grand seigneur complaisant, qui daignait s’abaisser jusqu’à ces petites gens, et recevoir leurs cadeaux. Il se donnait des airs incroyables, que ces marchands prenaient pour des façons de cour, il se moquait d’eux à leur barbe, il les mystifiait, il leur faisait des contes des mille et une nuits, ils ouvraient des yeux et des oreilles démesurés en l’écoutant, le prônaient comme un miracle, l’adoraient en thuriféraires, et le vantaient de tout leur pouvoir. Son amour-propre s’épanouissait et sa bourse également, car il usait de son omnipotence, se faisait prêter des sommes considérables par petites portions; bref il tira la corde jusqu’à ce qu’elle fut tendue au point de casser; alors il disparut un beau matin, et s’en alla faire le duc et pair ailleurs.
Ce moyen lui réussit assez bien pendant deux ou trois ans. Il exploita à peu près toute l’Angleterre, ne forçant pas ses impôts, ne s’attaquant qu’à la classe infime, ce qui prouvait une adresse précoce; il échappa ainsi à la police, que son âge désarmait aussi. Cette vie le lassa enfin; il eut envie de revoir la France, et s’embarqua pour Calais. Pendant la traversée il essuya une tempête, le petit bâtiment fit naufrage, et il mit en action véritable sa fable inventée à Edimbourg. Il eut bien de la peine à sauver sa vie en perdant tout ce qu’il possédait, la bourse même y passa.
En débarquant, ou plutôt en prenant terre, il se trouva sur une falaise, à quelque distance de la ville, libre de se sécher au soleil et ne possédant pas un rouge liard. Il s’assit, assez dégoûté des aventures, et ne prévoyant pas comment il se tirerait de celle-là. Il ne connaissait personne au monde; il n’avait ni protecteurs, ni appuis; il ne savait aucun autre état que ceux de voleur et de mousse; encore ce dernier n’était-il dans ses moyens qu’au point de vue du danger, car pour la manœuvre et le service il n’y entendait rien du tout.
Après quelques instants de réflexions, sa nature insouciante prit le dessus, il se releva et marcha vers la ville en s’écriant:
— A la grâce du diable! il m’a bien conduit jusqu’ici, il ne m’abandonnera pas.
Poulailler avait alors seize ans, il était assez grand pour son âge, très-fort, très-adroit, d’une beauté incontestable et d’une bonne humeur que rien n’altérait. C’était le parti pris de ne reculer devant rien, de ne point s’affliger, de prendre tous les moyens de réussite et de ne point faire trop le fier avec la destinée.
— Ce qu’elle donnera je le prendrai, se dit-il, sauf à mieux me caser quand cela se rencontrera.
De cette manière il n’y a pas de mécomptes possibles.
En approchant des remparts, Jacques entendit le bruit du tambour; il se dirigea de ce côté et aperçut des enfants de son âge, revêtus d’an joli uniforme, étudiant les ra et les fla, sous les ordres d’un caporal dont la canne retombait parfois sur leurs épaules. Un groupe de curieux les entouraient, et parmi eux quelques jolies filles.
— Ces petits tambours sont charmants, dit l’une d’elles, et je voudrais voir mon amoureux ainsi vêtu. Ils ont tout à fait bonne grâce sous cet habit blanc, avec leurs manches galonnées.
— Oui, mais on les bat.
— Ce caporal est un peu brutal peut-être, cependant il ne frappe que les imbéciles; ceux qui savent battre en mesure ne sont pas battus.
— Mademoiselle, dit Jacques, se mêlant effrontément à la conversation, je suis un pauvre marin dont le bâtiment a péri cette nuit sur les rochers par suite de l’orage; je n’ai plus rien à faire, je suis dégoûté de la mer; si je me faisais soldat, croyez-vous que les jolies filles me regarderaient?
— N’en doutez point, mon jeune monsieur, vous êtes bien fait pour cela; vous auriez tout à fait bon air à la tête d’un régiment.
— Eh bien, mademoiselle, cela est décidé, je vais de ce pas m’engager; mais vous m’en récompenserez bien par la permission d’aller vous saluer chez vous, avec mon uniforme.
— Très-volontiers, monsieur, moi et mes camarades nous nous réunissons tous les dimanches pour danser, nous serons bien contentes de vous recevoir, n’en doutez pas.
La connaissance faite, Jacques s’en alla tout droit au caporal, lui conta sa petite histoire, lui montra comme preuve ses habits mouillés, et demanda à faire partie de ses élèves.
Jamais un caporal tambour n’a refusé un joli garçon. A cette époque on n’était pas si difficile qu’aujourd’hui, on n’y regardait pas de bien près avec ceux qui désiraient servir le roi, et on n’avait pas d’ailleurs la rage du papier timbré qui nous possède. Le caporal accepta temporai rement Poulailler, avec la restriction du consentement de ses chefs, et l’aventurier s’en retourna à la ville dans les rangs de ses nouveaux camarades.
En passant auprès de celle qu’il appelait sa marraine, il la salua militairement, d’un air fier, tout en se disant par forme de corollaire:
— Me voilà sûr de ne pas mourir de faim et de ne pas coucher à la belle étoile; Sa Majesté se chargera de ma nourriture et de mon logement; cela me donnera le temps de voir venir.
Le caporal présenta sa recrue à l’officier chargé de recevoir les engagements. On n’eut garde de refuser ce joli garçon, on le revêtit de son uniforme, et, dès le lendemain, il alla à l’école avec les autres en s’excusant de ne point leur payer sa bienvenue. Les malheurs qu’il racontait si bien l’excusaient de reste.
— Vous ne perdrez pas à attendre, leur dit-il, pour péroraison.
Il comptait sur son industrie, déjà très-grande à cette époque, et il ne compta pas en vain. Le dimanche suivant, il se rendit au bal où l’avait invité la jolie fille. Tout en dansant, en folâtrant, en lutinant les donzelles, qui le trouvèrent adorable, il parvint à vider leurs poches et celles de leurs amoureux. Il fit rafle complète si adroitement qu’on ne s’aperçut de rien. Il eut soin de s’éclipser avant le moment des découvertes, pour mettre le magot en sûreté et revint effrontément sans que son absence eût été remarquée.
Lorsque le vol éclata, il cria plus haut que les autres, fit fermer les portes, exigea que tout le monde fût fouillé, lui comme les autres, et vit avec satisfaction qu’il n’avait pas laissé grand’chose à ses dignes amis. En se cotisant, ils ne purent jamais trouver de quoi payer à souper et le traiteur leur fit crédit. Les soupçons tombèrent sur plusieurs chevaliers qui s’étaient retirés de bonne heure; quant à Poulailler, c’était pour tous le parangon de l’honnêteté, et cette société ne pouvait se passer de lui, il en devint le héros. Il eut bientôt autant de maîtresses qu’il en désira et tout alla à merveille tant qu’il fut à Calais, et qu’il se contenta de gains modestes.
Le régiment changea de quartier, on l’envoya dans le Midi. Poulailler quitta ses connaissances utiles avec regret, mais avec l’espoir de s’en créer ailleurs de semblables. Arrivé à Toulouse, il fit promptement des connaissances assorties à ses moyens, sans pour cela négliger les devoirs de son état, qu’il remplissait à la satisfaction générale. Personne ne s’entendait comme lui à donner une aubade; s’il eût voulu rester dans ce noble corps des tambours, il fût parvenu aux plus hauts grades; mais sa fortune le conduisit ailleurs.
Un jour il se promenait, les bras arrondis, se dandinant avec toutes les grâces de sa profession, lorgnant les femmes, coudoyant les hommes, se donnant enfin toute l’importance qu’il pouvait prendre, lorsqu’il aperçut dans le côté le plus écarté de la promenade, les tentes d’une troupe de bohémiens. Ils allaient ainsi par bandes, dans les provinces méridionales surtout. On les surveillait, mais on ne les empêchait pas d’exercer leurs industries, et ils en avaient de plusieurs espèces. La plus lucrative, sans nul doute, après le vol toutefois, était la sorcellerie. En s’adressant à la crédulité, ils étaient sûrs de ne pas partir les mains vides. Chaque compagnie avait un chef, soit roi, soit duc, suivant l’importance de la tribu; son autorité était souveraine, il avait, pour ainsi dire, le droit de vie et de mort sur ses sujets, et il en usait largement, sans que la police se mêlât de ses affaires. Son autorité ne se discutait même pas parmi les bohèmes; ils se fussent tous laissé tuer plutôt que de lui désobéir; ce dévouement était peut-être leur seule vertu.
Lorsque Poulailler s’approcha des tentes, on faisait cercle autour d’une jeune bohémienne, vêtue d’oripeaux brillants, belle comme le jour, et dansant avec une grâce infinie, un tambour de basque à la main. Lorsqu’elle eut fini, elle retourna son tambour, en fit une sébile et s’en alla quêter, en rendant pour chaque pièce de monnaie une révérence et un sourire.
Un vieillard, qui la dévorait des yeux, l’arrêta lorsqu’elle passa devant lui, et lui montrant une demi-pistole:
— Je te donnerai cela, la belle, dit-il, si tu veux me dire ma bonne aventure.
— Très-volontiers, monsieur, répondit l’Égyptienne, ce ne sera pas difficile; donnez-moi votre main.
Il obéit: elle regarda les lignes pendant quelques instants avec soin, sans que son visage présentât la moindre altération.
— Faut-il dire tout haut ce que je vois, monsieur? demanda-t-elle.
— Sans doute, je n’ai point de secrets, je n’en ai pas pour toi surtout, ajouta-t-il à voix basse.
— En êtes-vous bien sûr, monsieur, de ne pas avoir de secrets? Et si je révélais la cachette de votre trésor?
— Mon trésor, mon trésor! je n’ai point de trésor, insolente; ne te moque pas de moi et ne va pas faire croire que je suis riche.
— Vous avez un trésor et vous ne le garderez pas longtemps, répliqua-t-elle avec insouciance; il sera cause de votre mort, souvenez-vous-en et amendez-vous. Ne soyez pas dur au pauvre monde, car cela ne vous servira de rien, vous n’emporterez pas vos écus.
Le vieillard devint pâle; cependant il affecta de rire et se retira sans lui donner la demi-pistole, ajoutant qu’il ne voulait pas payer si cher une semblable prédiction.
— Et que comptiez-vous donc que je vous annoncerais, vieux singe? Je vous ai prédit la mort, n’est-ce pas ce qui vous attend? Aurais-je pu vous parler d’une amoureuse, à votre âge?
Les quolibets de la foule poursuivirent le curieux maladroit, et toutes les mains se tendirent vers la jolie sibylle, qui devinait si justement la vérité. Elle satisfit tous ceux qui la payèrent et profita de sa science pour lancer à droite et à gauche les sarcasmes que sa malice naturelle lui inspira. Parvenue devant le beau tambour, elle leva sur lui ses yeux de velours, et lui demanda s’il ne voulait pas connaître son avenir comme les autres.
Il lui tendit la main comme les autres, elle l’examina longtemps et, pour la première fois, sa physionomie exprima quelque intérêt. Un étonnement très-marqué se peignit sur son visage; il fallait des événements bien extraordinaires pour étonner cette expérience déjà si vieille à dix-neuf ans.
— Monsieur le tambour, lui dit-elle enfin, vous êtes appelé à de hautes destinées, on par lera fort de vous dans le monde, vous y ferez du bruit.
— Oui, avec mes baguettes,
— Ne plaisantez pas, ceci est très-sérieux; vous avez en vous quelque chose qui me force à vous respecter; vous tenez à votre maître, c’est certain.
— Parbleu! c’est mon père.
Il prononça ces mots en riant; ceux qui les entendirent rirent également, excepté la jeune fille, qui fronçait le sourcil, tout en examinant sa main, qu’elle laissa bientôt retomber.
— Je ne puis m’expliquer devant tous ces témoins, ajouta-t-elle, mais si vous voulez revenir ce soir demander Zénaïde, et m’écouter quelques instants, je vous en dirai davantage.
La foule rit encore fort. Elle ne vit dans cette réticence que le prétexte d’un rendez-vous. Poulailler ne manqua pas d’être de cet avis; la bonne opinion qu’il avait de lui-même l’aida à se persuader, et il se retira le chapeau sur l’oreille, la moustache retroussée, le poing sur la hanche, en vrai casseur de cœurs. La bohémienne le suivit des yeux tant qu’elle put l’apercevoir. Pauvre fille! toute dépravée qu’elle fût, on ne peut s’empêcher de la plaindre, en songeant que sa destinée se décidait ce jour-là, par cette rencontre, et quelle destinée!
A l’heure indiquée, Poulailler reparut. Il tourna autour des tentes, sans oser accoster les bohémiens, dont la mine rébarbative ne lui promettait pas un bon accueil. Inaccessible à la peur, il craignait pour son rendez-vous. Zénaïde dépendait peut-être d’un de ces hommes à l’œil sombre, et on pouvait la retenir, si elle était soupçonnée. Il ignorait les mœurs de ce peuple étrange: une bohémienne n’a point de mari, point de père, elle appartient à la tribu; c’est à cette association qu’on peut appliquer cette devise, si souvent en défaut pour celles qui l’ont invoquée:
Tous pour un, un pour tous.
Zénaïde l’aperçut, elle le guettait; elle vint au-devant de lui, sans embarras. Il chercha à l’attirer à l’écart.
— Pourquoi faire? demanda-t-elle naïvement.
— N’avez-vous donc pas un amoureux parmi ces Égyptiens? Ne sera-t-il pas jaloux?
— Jaloux, répliqua la jeune fille en haussant les épaules, il y songe bien! Il faut d’abord apporter au trésor l’argent que nous pourrons gagner, et duper les gentils, c’est notre première pensée. Je vais vous dire votre bonne aventure; vous m’intéressez, et j’ai vu de si bizarres pronostics dans votre main, que je veux la revoir encore; soyez tranquille, on ne s’occupera pas de nous, je fais mon métier.
Elle prit de nouveau sa main et l’examina longuement.
— Je vous l’ai dit, vous êtes appelé à de nombreuses aventures. Vous serez fort riche, vous posséderez beaucoup d’or, mais vous ne serez pas difficile sur les moyens de l’acquérir.
— Vous êtes bien honnête, et vous me jugez d’après vous.
— Je crois vous faire beaucoup d’honneur, reprit fièrement la belle fille. D’ailleurs, je ne me trompe pas, les signes sont certains, votre visage ne peut mentir, et votre main encore moins que votre visage.
Elle lui détailla avec beaucoup de complaisance les lignes prophétiques, lui en montrant les ramifications, et lui en déduisant les conséquences. Il l’écouta et répéta après elle, discuta, raisonna: après les discussions et les raisonnements vinrent les compliments et les douceurs, que l’on ne repoussa pas; les bohémiennes sont peu cruelles, cela est connu. Les regards et les sourires s’échangèrent, puis les demandes, puis les promesses, puis les baisers, tant y a que le soir même Poulailler avait jeté ses baguettes aux orties, et que le lendemain il se réveilla élève sorcier et voleur patenté, par la grâce de Sa Majesté le roi de la tribu, séant en son conseil, vêtu de son manteau rouge.
En une demi-heure on le rendit méconnaissable; son tambour-major lui aurait demandé sa bonne fortune, le prenant pour un Égyptien de la vieille souche. Cependant, pour plus de sûreté, on détala, on prit les chemins de traverse, on passa la nuit dans les bois, ce qui donna à Zénaïde le temps de parfaire l’éducation de son élève. Elle n’y épargna ni soins ni conseils. Quelques jours après, il fit ses premières armes dans un village, où il étonna tout le monde. Les connaisseurs en nécromancie le proclamaient le plus habile de la bande; il n’annonça cependant que des malheurs. Il semblait jouir des frayeurs qu’il inspirait.
— A quoi bon leur annoncer le bien qui les attend? disait-il à ses camarades, il vaut mieux leur laisser le plaisir de la surprise.
La jeune fille sentit, après les premiers instants, qu’elle avait trouvé son maître, et, pour une femme de cette trempe, c’était la plus grande séduction. Les mauvais instincts de Jacques, son énergie, sa force de volonté, sa cruauté même étaient pour elle autant de qualités recommandables; elle le voyait déjà le chef de sa nation; elle sentait qu’il dominait ses compagnons par son intelligence et sa témérité ; de ce jour elle devint son esclave.
Poulailler parcourut avec ses nouveaux amis le Midi de la France. Il changea de nom, bien entendu, et se fit appeler Abenhama. La police ne s’inquiéta pas de son origine. Elle ne s’occupait des bohémiens que pour les surveiller. Quant à leurs noms et à leurs familles, à peine les connaissaient-ils eux-mêmes. Les sentiments de la nature leur sont à peu près inconnus, excepté celui d’un brutal amour, plus semblable à celui des animaux qu’à celui des créatures pensantes, à qui Dieu a donné l’amour, autant et plus peut-être comme un élan de l’âme que comme un besoin du corps.
Zénaïde s’éleva pour Abenhama à une puissance de dévouement, de tendresse qui lui attirèrent la pitié de ses compagnes. Toutes la crurent ensorcelée lorsqu’elles la virent ainsi amoureuse et obéissante; elle, la folle gitana, jusque-là insouciante et légère, elle pleurait souvent, elle qui riait toujours avant d’aimer; elle ne se permettait plus une distraction; elle ne se montrait plus au public; elle ne souffrait plus qu’on lui parlât de sa beauté, elle qui ne vivait jadis que de compliments et de caresses.
Jacques était devenu le plus habile de la troupe; il faisait des exercices prodigieux; sa force et son adresse n’avaient pas de rivales: il dérobait tout, sans être même soupçonné, tant il savait prendre à propos un air honnête, et surtout fuir au moment indispensable.
Il enleva la besace d’un moine quêteur en semblant venir à son aide; il se fit remercier et bénir par le pauvre frère, qui lui donna complaisamment ce qui lui restait, c’est-à-dire un beau chapelet monté en argent, bénit par le pape et garni de reliques. Jacques le vendit le lendemain à une vieille comtesse, en lui faisant croire qu’il l’avait rapporté de Jérusalem. Il lui en fit payer le port en conséquence, sans compter son bichon favori, qu’il lui enleva dextrement, et dont la peau servit de manchon à Zénaïde qui l’écorcha.
Cette douce vie continua près d’un an. Un soir, les principaux de la bande, Abenhama à leur tête, étaient sortis du camp pour une expédition. Zénaïde, assise auprès du foyer à moitié éteint, s’était endormie au bruit d’une chanson murmurée par une mère à son nourrisson. Un grand bruit la réveilla; Jacques parut devant elle les habits en désordre, tout couvert de sang et de fange, l’œil étincelant et terrible:
— Lève-toi et suis-moi, lui dit-il.