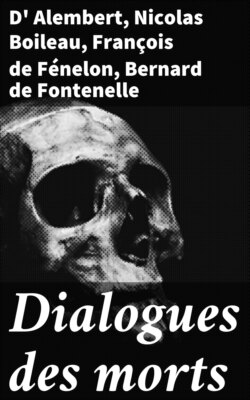Читать книгу Dialogues des morts - D' Alembert - Страница 3
INTRODUCTION.
ОглавлениеLe Dialogue des Morts est celui où les interlocuteurs (ou du moins l’un d’eux ) sont supposés n’être plus de ce monde.
Le dialogue des morts n’est qu’une forme particulière, une variété, si l’on veut, du dialogue ordinaire; mais c’est une variété très-importante, et d’une invention singulièrement heureuse: d’abord parce qu’on peut mettre en présence les personnages des pays et des temps les plus éloignés, ce qui augmente infiniment le nombre des combinaisons que l’on en peut faire; d’un autre côté, toutes les vanités humaines s’anéantissant au moment de la mort, on peut, sans heurter le moins du monde notre croyance, ni manquer à ce qu’on appelle le costume, exprimer sans préparation les idées les plus opposées à celles qui sont généralement reçues.
Fontenelle a compris et signalé cet avantage, dans la lettre qu’il adresse à Lucien, et qui sert de préface à ses dialogues: «J’ai fait, dit-il, moraliser tous mes morts, autrement ce n’eût pas été la peine de les faire parler: des vivants auraient suffi pour dire des choses inutiles. De plus il y a cela de commode, qu’on peut supposer que les morts sont gens de grande réflexion, tant à cause de leur expérience que de leur loisir; et on doit croire, pour leur honneur, qu’ils pensent un peu plus qu’on ne fait d’ordinaire pendant la vie: ils raisonnent mieux que nous des choses d’ici-haut, parce qu’ils les regardent avec plus d’indifférence et de tranquillité; et ils veulent bien en raisonner, parce qu’ils y prennent un reste d’intérêt.... Comme les morts ont bien de l’esprit, ils doivent voir bientôt le bout de toutes les matières. Je croirais même sans peine qu’ils devraient être assez éclairés pour convenir de tout les uns avec les autres, et, par conséquent, pour ne se parler presque jamais: car il semble qu’il n’appartient de disputer qu’à nous autres ignorants, qui ne découvrons pas la vérité; de même qu’il n’appartient qu’à des aveugles, qui ne voient pas le but où ils vont, de s’entre-heurter dans un chemin.»
Ces dernières propositions, vraies sans doute dans l’opinion commune, si elles étaient poussées à leurs dernières conséquences, rendraient tout dialogue des morts impossible. Heureusement notre esprit n’est pas si sévère sur les conditions naturelles d’un art. Il se prête très-volontiers à la supposition que les morts ont encore quelques-unes de nos passions, ou s’intéressent à ce qui se fait ici-haut, comme parle Fontenelle; il admet avec une égale facilité qu’ils ne savent pas absolument le fond des choses, mais qu’ils s’en instruisent successivement, comme nous, par l’expérience; que les opinions qu’ils avaient pendant leur vie ont pu être ainsi profondément modifiées, et par des raisons qui ne leur seraient pas venues pendant qu’ils habitaient cette terre: raisons d’autant plus puissantes qu’elles sont plus vraies philosophiquement, quoique fort éloignées des opinions régnantes.
Le dialogue des morts est donc un cadre merveilleusement trouvé pour l’expression d’idées hardies, neuves, paradoxales, inattendues, et presque toujours satiriques: aussi, divers auteurs en ont-ils, comme nous le dirons, tiré un excellent parti.
Lucien, né à Samosate, en Syrie, vers120de notre ère, est généralement regardé comme l’inventeur du dialogue des morts, parce qu’il est le premier qui se soit appliqué à ce genre de composition.
On trouve bien, et même fort longtemps avant lui, des entretiens qui satisfont matériellement à la condition que nous avons indiquée tout à l’heure. Dans le onzième livre de l’Odyssée, Ulysse fait une évocation pour obtenir une réponse sur sa destinée, et voit successivement apparaître quelques-uns de ceux qu’il a connus autrefois; Elpénor, Anticlée, sa mère, le devin Tirésias, les héros et les héroïnes du temps passé: il en reçoit diverses réponses, ou leur donne les détails qu’ils demandent.
Virgile a imité cette situation dans le sixième livre de son Énéide, quand il fait descendre Énée aux enfers; et quelque temps avant lui, Cicéron avait employé un moyen analogue, modifié d’une manière aussi heureuse que brillante, lorsque, dans ce fragment de la République conservé par Macrobe, il faisait voyager l’âme du jeune Scipion non pas dans les enfers, mais dans le Ciel, où ses ancêtres lui exposaient à la fois le système du monde tel que le concevaient les anciens, et les idées déjà, très-élevées que la philosophie s’était faites de l’immortalité de l’âme.
Toutefois ce ne sont pas là des dialogues des morts comme nous les entendons ordinairement: ce sont des œuvres d’imagination poétique plutôt qu’une satire philosophique; et c’est ce dernier caractère qu’a le plus souvent le genre dont nous parlons.
Mais il y a dans Horace un dialogue bien connu entre Ulysse et Tirésias, où celui-ci explique au roi d’Ithaque que s’il veut être riche quand il sera de retour chez lui, il n’a rien de mieux à faire que de flatter les vieillards riches et sans enfants; qu’ainsi, à farce de bassesses, il pourra se faire coucher sur leurs testaments, et réparer petit à petit le tort que lui a fait la longue guerre de Troie; cette peinture piquante des mœurs des Romains à l’époque d’Auguste, mise dans la bouche d’un devin mort depuis plus de mille ans, et qu’Ulysse interroge dans les enfers, est assurément la matière d’un excellent dialogue des morts.
En remontant même beaucoup plus haut qu’Horace, il y a, dans les Grenouilles d’Aristophane, une scène entière où Eschyle et Euripide se disputent et se reprochent l’un à l’autre les défauts de leur style ou de leur composition, et les deux personnages sont supposés dans les enfers, où Bacchus descend lui-même pour en ramener sur terre le meilleur poëte.
Il n’est donc pas rigoureusement vrai de dire que Lucien soit le créateur de cette espèce d’ouvrage; seulement, comme il est le premier qui en ait fait plusieurs de propos délibéré, c’est à l’occasion des siens que le public a remarqué cette forme assez attentivement pour lui donner un nom particulier; et, comme il arrive toujours, on a regardé comme l’inventeur du genre celui qui, en y excellant, en a le premier signalé l’existence.
Les modernes, et en particulier les Français, ont suivi avec plus ou moins de succès les traces du satirique de Samosate. Boileau est un de ceux qui ont le mieux réussi. Il n’a fait que deux dialogues, dont le second même n’est pas terminé; mais ce sont deux chefs-d’œuvre et par la pensée et par l’expression.
Le premier a pour titre les Héros de roman. L’auteur raconte lui-même dans un discours préliminaire, qu’il était fort jeune quand les romans de la Calprenède, de mademoiselle de Scudéri et de plusieurs autres faisaient le plus d’éclat; qu’il les lisait, comme tout le monde, avec beaucoup d’admiration, et les regardait comme des chefs-d’œuvre de notre langue; mais que ses années s’étant accrues, et la raison lui ayant ouvert les yeux, il reconnut la puérilité de ces ouvrages; si bien que l’esprit satirique commençant à dominer en lui, il ne se donna pas de repos qu’il n’eût fait contre eux un dialogue à la manière de Lucien, où il attaquait leur peu de solidité, leur afféterie précieuse de langage, leurs conversations vagues et frivoles, les portraits avantageux faits à chaque bout de champ de personnes de très-médiocre beauté, et tout ce long verbiage d’amour qui n’a point de fin.
Son dialogue composé en1664, comme on le voit dans deux ou trois notes, récité quelquefois par l’auteur, et publié de mémoire par quelques auditeurs indiscrets, ne fut imprimé de l’aveu de Boileau que beaucoup plus tard, après la mort de mademoiselle de Scudéri et de tous ceux qu’il y critiquait. Il avait eu cette considération pour eux de ne pas livrer au ridicule leurs principaux personnages et quelques modèles de leur style. Mais il ne se montrait pas moins là ce qu’il est partout, un critique d’un goût toujours sûr, aussi sensible à ce qui blesse la pureté du langage qu’à ce qui heurte la raison ou contrarie les convenances, et, par cette ingénieuse satire, il nous apprenait à mépriser les fadaises, qu’on avait admirées si longtemps.
Le second dialogue, comme je l’ai dit, n’est qu’un fragment qui n’a pas même de titre; il est dirigé contre ceux qui font des vers latins. Boileau croit avec beaucoup de raison qu’il est à peu près impossible de montrer dans une langue morte l’imagination et la délicatesse d’expression qui peuvent seules faire vivre les ouvrages.
Cela n’empêche pas sans doute que quelques modernes n’aient réussi à faire des vers latins agréables, qui peuvent même quelquefois être avantageusement employés pour jeter de la variété dans les devoirs donnés aux écoliers. Cela n’empêche pas surtout qu’on n’ait raison d’exercer les jeunes humanistes à ce travail, parce qu’il leur est nécessaire s’ils veulent acquérir de la facilité pour tourner agréablement leurs phrases; s’ils veulent surtout parvenir à sentir les beautés de Virgile, d’Ovide et d’Horace. Mais la condamnation exprimée par Boileau regarde surtout les poëmes de longue haleine, ou les collections de fables, de satires, d’odes ou d’épîtres que nous ont donnés les Ménage, les Santeul, les Duperrier, et plus tard, les Porée et les Desbillons: et l’expérience a prouvé qu’elle était bien juste, puisque l’on ne peut pas citer un seul poëme, écrit en latin par un moderne, qui ait ou mérité ou conservé l’approbation de la postérité.
Les Dialogues des Morts de Fontenelle parurent en1683; ils reçurent un accueil beaucoup plus favorable que tout ce qu’il avait donné auparavant, et commencèrent sa réputation. Ils offrent de la littérature et de la philosophie, mais l’une et l’autre, a-t-on dit avec quelque raison, trop parées des charmes du bel esprit. Toutefois, tel fut le succès de cet ouvrage, que Fontenelle, en donnant la seconde partie, n’osait s’en promettre un semblable, mais déclarait qu’il pourrait en obtenir un beaucoup moindre et être encore fort content.
La recherche et l’abus de l’esprit qu’on a reprochés à l’auteur, se montrent dans son style d’abord, et jusque dans les titres de ses dialogues et les divisions de son livre.
Le style de Fontenelle. est bien connu; je n’en parle en ce moment que pour signaler un singulier travers, bien digne de celui qui disait que s’il avait la main pleine de vérités, il se garderait de l’ouvrir. Fontenelle semble souvent ne faire usage de la parole que pour dissimuler sa pensée. On est obligé de chercher sous ce qu’il dit, ce qu’il a vraiment voulu dire; et il pousse l’abus à ce point que quelques-uns de ses dialogues tendent à prouver précisément leçon traire de l’argument qu’il en a composé lui-même, et que l’on trouvera ici sous les noms des, personnages. Cette réticence perpétuelle, cette prudence méticuleuse qui ne lâche pas un mot sans se réserver la ressource de l’expliquer en divers sens, parait à quelques critiques un caractère précieux du génie de notre auteur. C’est pour noua un véritable défaut, antipathique à l’esprit français, et qui explique, jusqu’à un certain point, sinon l’oufcii, du moins la négligence du public à son égard.
J’ai dit que ses titres étaient singuliers. En effet, les, personnages mis en scène sont presque tous antithétiques; il semble qu’il ne puisse pas faire converser deux individus entre lesquels on n’apercevrait pas tout d’abord une opposition. C’est, par exemple, Milon de Crotone, et le Sybarite Smyndiride; c’est Anacréon et Aristote qui dissertent sur la vraie philosophie; c’est l’empereur Auguste et Pierre Arétin qui s’entretiennent de la louange et de la satire; c’est Sénèque et Scarron qui causent de la vraie philosophie stoïcienne; c’est Agnès. Sorel et Roxelane; c’est Molière et Paracelse, etc.
La division de ces dialogues n’est pas moins singulièrement recherchée; il y en a en tout trente-six, qui se divisent en deux parties égales, de dix-huit chacune; et ces parties sont elles-mêmes divisées en groupes ou sections de six dialogues; savoir: six dialogues entre des anciens, six dialogues entre des anciens et des modernes, et six dialogues entre des modernes. N’est-il pas évident que l’auteur qui se soumet à une symétrie si puérile, parle pour parler, souvent sans avoir rien à dire. Il fait un dialogue non pour énoncer une vérité qu’il croit nouvelle ou une proposition qu’il juge importante; mais pour remplir une case vide. C’est un reproche réel à faire à ces dialogues. Nul n’était plus que Fontenelle en état d’y soulever et d’y traiter des questions graves, et trop souvent elles se réduisent à des paradoxes insoutenables, à des assimilations puériles, ou même à de simples logomachies.
C’est ainsi que son dialogue d’Aristote et Anacréon sur la philosophie, repose tout entier sur l’équivoque du mot philosophe, qui signifie étymologiquement, et voulait dire, en effet, chez les Grecs, amateur de la science, et qui chez nous s’applique souvent à ceux qu’on regarde comme sages, c’est-à-dire qui ont arrangé leur vie de manière à s’y trouver heureux, et à se repentir le moins possible de ce qu’ils ont fait. Anacréon prend le mot philosophe dans ce dernier sens, Aristote le prend dans le premier. Supposez qu’ils aient commencé par définir les termes, le dialogue s’évanouissait aussitôt.
Celui d’Érostrate et Démétrius de Phalère n’est pas plus solide. Érostrate prétend que c’est la vanité qui fait tout faire en ce monde. C’est un paradoxe qui peut jusqu’à un certain peint se soutenir. Mais il ajoute que la vanité qui détruit les choses belles ou utiles, la sienne, par exemple, qui lui a fait incendier le temple d’Éphèse, est aussi louable que celle qui les établit: et Démétrius ne trouve rien à répondre à cette prétention exorbitante, qui supprime ainsi d’un mot l’utilité et le bien-être de l’humanité dans l’appréciation de nos actes.
Dans un autre entretien, Descartes reproche au troisième faux Démétrius d’avoir voulu sottement tromper les Moscovites, et d’avoir couru à sa perte par cette folle ambition. Le faux prince répond à Descartes qu’il a lui-même fait la même chose quand il a annoncé qu’avec sa philosophie il allait tout expliquer dans le monde: et Descartes oppose à cela que les hommes se laisseront à tout jamais tromper par les promesses qui leur seront faites, surtout sur ces matières. D’où le faux Démétrius conclut que s’il revenait au monde, il se ferait philosophe plutôt que de conspirer. Sans doute on pourra toujours tromper les hommes sur les questions de métaphysique, comme sur tout ce qu’ils ne savent pas et comprennent mal; mais est-ce là quelque chose de bien neuf? et l’assimilation entre un philosophe qui trompe les autres en se trompant lui-même, et celui qui les trompe en usurpant un nom qui n’est pas le sien, a-t-elle la moindre apparence de raison? peut-elle être d’aucune utilité?
Il y a donc, en effet, comme je l’ai dit, quelquefois du remplissage dans les dialogues de Fontenelle; et de là vient qu’ils ont été jugés sévèrement par La Harpe, qui n’y voit qu’un babil spirituellement raffiné et qui fatigue le lecteur Il dit encore que cet ouvrage n’est qu’un jeu ou un effort d’esprit; un jeu par la frivolité des résultats, un effort par les rapprochements forcés et la recherche des pensées et du style; qu’il y a au moins autant de pensées subtiles et fausses qu’il y en a de fines ou d’ingénieuses; que trois ou quatre seulement offrent une bonne philosophie, tandis que le plus grand nombre n’est qu’une débauche d’esprit mêlée de saillies heureuses. Tout cela, sans être absolument vrai, a quelque fondement, mais ne saurait détruire le mérite d’originalité ni le talent d’analyser les passions humaines qu’on y a remarqués dès le premier moment, mérites toujours si grands dans les dialogues des morts, que ceux-là ôtés, il ne demeure à peu près rien du tout: et qu’au contraire, l’ouvrage où ils se trouvent sera toujours apprécié des connaisseurs.
Fénelon, chargé en1689de l’éducation du duc de Bourgogne, petit-fils de Louis XIV, a composé pour son élève des dialogues des morts assez nombreux, trop nombreux peut-être, comme on le verra tout à l’heure; il y en a près de quatre-vingts, qui ont été publiés en différents temps. Dès 1700, quatre dialogues avaient paru avec les Aventures d’Aristonous. En1712, année de la mort du duc de Bourgogne, on donna un nouveau recueil de quarante-cinq dialogues, où manquait un de ceux qui avaient été imprimés en 1700. En1718, trois ans après la mort de l’auteur, le chevalier de Ramsay publia une édition fort augmentée; on y trouvait quarante-huit dialogues des morts anciens, et dix-neuf dialogues des modernes. En1730, l’abbé de Moville joignit à sa Vie de Mignard les deux dialogues sur les peintres. Plus tard, le P. de Querbeuf y en joignit trois autres. Enfin on en a retrouvé quelques-uns qui ont été imprimés pour la première fois en1823dans l’édition complète des œuvres de Fénelon. C’est cette édition que nous avons suivie, en ajoutant quelques notes historiques, philosophiques ou grammaticales, quand le sujet nous a paru l’exiger. Nous nous sommes toutefois un peu écartés de notre modèle pour l’ordre des dialogues. En voici la raison. Ces entretiens ont été rangés par les premiers éditeurs à peu près selon l’époque où avaient vécu les personnages. Le seul ordre rationnel serait sans doute de se régler sur l’époque de la mort du dernier des interlocuteurs; car quand on fait converser dans les enfers Solon et Justinien, il est évident qu’un tel entretien ne peut avoir eu lieu avant la mort de cet empereur. Mais comme cela aurait exigé un travail un peu délicat; que quelquefois même, par exemple dans le dialogue de Confucius et Socrate, où il est fait allusion aux relations des voyageurs modernes, il aurait fallu reculer l’époque du dialogue bien plus tard, jusqu’au milieu du xviie siècle: on a suivi une autre règle; on a réuni autant que possible les entretiens auxquels participait le même personnage. Cet ordre que nous avons admis était tout à fait interverti pour les derniers dialogues ajoutés dans l’édition de1823; Louis XI et François Ier y paraissaient après Richelieu et Mazarin. Nous les avons remis à leur place, de même que nous avons placé dans le groupe de dialogues où paraît Socrate, celui où il s’entretient avec Confucius, et qu’on avait mis à tort entre Romulus et Ulysse.
Le recueil de ces Dialogues des Morts, mis depuis longtemps entre les mains des enfants, a une réputation classique. Il ne vaut pas tout à fait sa réputation. On sait que Fénelon composait ses dialogues sur-le-champ, selon les divers besoins de son élève, tantôt pour corriger ce que son naturel avait de défectueux; tantôt pour confirmer en lui ce qu’il y avait de bon et de grand; tantôt, enfin, pour lui insinuer, par des instructions familières, à la portée de son âge, quelques maximes de politique ou de morale. Or, ce n’est pas ainsi, en courantet: selon l’occasion, qu’on peut faire un excellent travail. On a dit que l’auteur, tantôt sublime et grave comme Platon, en avait toute la force et la sagesse; que tantôt, par un badinage ingénieux, il avait la légèreté et la délicatesse de Lucien; que quelquefois simple et naïf, il se proportionne à l’enfance; que d’autres fois, nobles et élevés, ses préceptes sont dignes des plus grands esprits.
Ces éloges sont exagérés. Le style des dialogues de Fénelon est généralement correct et agréable; il est même quelquefois original et plus vigoureux qu’on ne l’aurait attendu du bon archevêque; la morale en est ordinairement bonne; mais la pensée y est faible; ou, pour mieux dire, il y a à peine une pensée. L’auteur n’exprime la plupart du temps que des idées communes. Il sait bien l’histoire, et en rappelle volontiers les détails les moins connus: et néanmoins, si l’on excepte quelques dialogues remarquables, surtout parmi ceux dont les interlocuteurs sont modernes, il juge médiocrement les hommes et les choses; souvent il ne paraît pas avoir une opinion arrêtée sur le point qu’il discute, si bien que le lecteur se trouve à la fin fort embarrassé de conclure avec lui et comme lui.
Ajoutez que quelquefois il laisse échapper des fautes matérielles considérables; des anachronismes, des assertions contrures à la vérité historique, comme l’avait remarqué le cardinal Maury, dans une note sur l’éloge de Fénelon. De plus, ses plans sont d’une monotonie singulière; ses personnages sont presque toujours dans la même situation. Chacun d’eux, voulant s’élever au-dessus de l’autre, vante en conséquence ses actions et déprime celles de son interlocuteur. Enfin, les réponses ne sont pas toujours pertinentes. La conversation saute plutôt qu’elle ne passe d’un sujet à l’autre, et laisse sans explication ou sans réponse des objections qui sembleraient pouvoir devenir très-fortes.
Ce sont là de véritables défauts. Peu sensibles pour les entants, à qui ce recueil est destiné, ils le deviennent pour les lecteurs sérieux; et c’est ce qui fait que les dialogues de Fénelon n’ont obtenu des bons critiques qu’une estime médiocre.
Vauvenargues, né à Aire en1715, et mort en1747, a fait quelques dialogues des mortsqui, sans être absolument au nombre de ses meilleurs ouvrages, ne manquent pourtant pas de mérite, tant l’auteur cherchait toujours à ramener les idées à la vérité et à la modération. Plusieurs d’entre eux ont pour but de faire voir combien sont exagérés la louange ou le blâme qu’il est de mode d’accorder à certaines actions: c’est là un jugement très-philosophique, et qui méritait d’être développé avec un peu plus de variété dans la forme, et dans un style plus nerveux et plus animé.
Voltaire a composé une grande quantité de dialogues; parmi eux il s’en trouve quelques-uns qui sont de véritables dialogues des morts, dans le sens que nous avons donné à ce mot. Il y en a un entre Lucien, Érasme et Rabelais qui est à la fois très-original et très-piquant. Mais les hardiesses que l’auteur se permettait trop souvent contre la religion devront le faire écarter des mains des jeunes gens.
La Toilette de madame de Pompadour, où il fait intervenir Tullie, la fille de Cicéron, est beaucoup plus que le précédent susceptible de se produire dans les livres destinés aux maisons d’éducation. Il a pour objet la vieille question de la suprématie des anciens ou des modernes. Mais le sujet est rajeuni par l’auteur, et traité avec cette justesse d’esprit et cette grâce ingénieuse qu’il mettait dans les moindres choses.
D’Alembert a aussi écrit un dialogue des morts assez curieux entre Descartes et Christine de Suède. Voici à quelle occasion. Le prince royal de Suède, Gustave de Holstein-Hutin, connu plus tard sous le nom de Gustave III, était en France quand le roi de Suède Adolphe-Frédéric mourut subitement le12février1771. Le prince Gustave, devenu roi de Suède par cet événement, n’en reçut la nouvelle que quelques jours après. Il était encore en France, et assistait à la séance de l’Académie française, le jeudi7mars1771. D’Alembert profita habilement de la circonstance. Le cadre du dialogue des morts lui permettait de choisir ses interlocuteurs en toute liberté, et de leur prêter des pensées convenables à ses vues. Il fit donc converser Christine avec son ancien maître, et trouva dans cette disposition le moyen d’adresser des compliments fort agréables au roi voyageur, en même temps qu’il réclamait pour la philosophie et les gens de lettres la protection qui leur est aujourd’hui acquise.
C’est là ce qu’il y a de plus ingénieux dans le dialogue de d’Alembert: du reste on n’y remarquera rien de bien neuf, et qu’on ne trouve dans les autres ouvrages du même auteur, ou dans ceux de presque tous les philosophes contemporains.
M. Fayolle, qu’un goût très-fin et des études variées et profondes rendaient si propre aux recherches et aux découvertes bibliographiques, a publié en1816deux dialogues des morts inédits; le premier est de Rivarol, le second de Grétry. Ce dernier, entre La Fontaine et J.-J. Rousseau, est aussi faible de pensée que de style. Il n’est curieux que parce qu’il est l’ouvrage d’un musicien célèbre, et qu’on aime souvent à voir ce qu’un homme de génie est capable de faire dans un genre qui n’est pas le sien.
Quant à celui de Rivarol, il est plein de cet esprit critique peu profond, mais incisif et souvent original1, qui fit de lui, pendant quelque temps, une sorte d’homme célèbre. Il met en scène Lamotte, Fontenelle et Voltaire, trois hommes distingués entre tous par l’étendue de leurs vues et la finesse de leurs jugements; on pourrait donc croire qu’en effet il va profiter de leur réunion pour discuter quelque question grave. Malheureusement Rivarol n’était pas né pour approfondir les difficultés, dont il réussissait quelquefois à montrer un petit coin sous un jour nouveau. Son dialogue n’est guère qu’une satire contre Fontenelle, assaisonnée d’épigrammes plus ou moins acérées, et quelquefois justes, contre l’Académie française, contre les abus qui se sont glissés dans ce docte corps et dans ceux qui sont établis sur les mêmes bases. Si, au lieu de s’en tenir à une critique générale, exprimée en une douzaine de lignes, et suivie de boutades sans valeur philosophique, il avait insisté, avec tous les développements nécessaires, sur les travaux que l’Académie devrait entreprendre et mener à fin, travaux dont quelques-uns ont été, en effet, indiqués par Boileau, par Voltaire, et d’autres académiciens, combien son dialogue n’eût-il pas eu plus de poids! quel parti n’en eût-on pas pu tirer plus tard! Il n’a aujourd’hui d’autre mérite que de peindre Fontenelle d’une manière ridicule, en le représentant comme un homme engoué des académies, ne pouvant vivre sans elles, ne concevant rien qui soit au-dessus de leurs séances, et réduisant toute la gloire humaine à l’honneur d’en faire partie.
Lemontey a aussi placé une conversation de deux morts dans l’ingénieuse satire qu’il a publiée au commencement de ce siècle, sous le titre de Raison, folie, chacun son mot. C’est le Dialogue entre deux morts qui désirent garder l’anonyme, et que l’auteur ne désigne, en effet, que par les lettres A et B. L’exposition en est vraiment originale. A se trouve tout à coup réveillé dans la fosse où il dormait depuis quelques années par une décharge de mousqueterie tirée au-dessus de sa tête. Son nouveau voisin lui apprend que ce sont des honneurs qu’on rend à son grade, et le dernier adieu qu’il reçoit de ses compagnons d’armes. La conversation s’engage; les deux morts se reconnaissent pour avoir été l’un le fils du seigneur du village, l’autre son maître d’école; et leurs aventures, racontées d’une manière aussi amusante que rapide, et dans ce style correct, élégant et animé qui distinguait Lemontey, tendent de plus à montrer que la paresse et l’insouciance sont bien souvent la cause première et la véritable origine de ce mépris des honneurs et des distinctions dont quelques hommes se font gloire.
Tels sont les principaux ouvrages produits chez nous dans le genre qui nous occupe. Ce genre est aujourd’hui un peu délaissé. Il n’est pas abandonné pour cela, non plus que celui du dialogue philosophique. Et l’on peut être convaincu que, quand il se présentera une question vraiment intéressante à résoudre d’une manière neuve, un préjugé généralement répandu à combattre et à renverser, le dialogue des morts, pour peu qu’il joigne à un bon choix de personnages quelque solidité dans les preuves, et quelque talent dans le style, sera tout à fait propre à mettre en relief la pensée de l’écrivain, et aura le même succès qu’il a eu sous la plume de ceux que nous avons cités.
Après ce coup d’œil rapide sur le caractère et l’histoire du dialogue des morts, nous devons ajouter quelques mots sur la présente édition.
L’Université se fait aujourd’hui un devoir de mettre entre les mains des élèves, dans les différentes classes, des ouvrages français à leur portée, qui puissent à la fois les intéresser, leur former un bon style, et les initier à la connaissance de notre littérature. Elle indique pour la cinquième les Dialogues des morts de Fénelon, d’autant mieux placés dans cette classe qu’on les pourra comparer à ceux de Lucien, qu’on y explique.
Il nous a semblé qu’en reproduisant les dialogues de Fénelon, il convenait d’y en joindre quelques autres qui, dus aussi à d’excellentes plumes, donneraient aux jeunes élèves l’occasion de faire connaissance avec divers écrivains dont la France s’honore à juste titre, et que peut-être ils ne retrouveront pas facilement plus tard. C’est là ce qui nous a décidés à placer après les dialogues indiqués par l’Université, celui de Boileau, celui de d’Alembert, et neuf dialogues de Fontenelle.
L’usage auquel le livre est destiné appelait nécessairement quelques notes grammaticales ou historiques; celles-ci sur les personnages, celles-là sur les tournures ou les expressions illégitimes, douteuses ou tombées en désuétude. Nous avons donné toutes celles qui nous ont paru nécessaires, et laissé de côté celles qui n’auraient rien appris à personne.
Il y a une autre sorte de notes, plus utiles encore, à notre avis, et que nous croyons avoir, les premiers, ajoutés à cet ouvrage. Ce sont des notes de morale critique. Comme nous l’avons dit, le dialogue des morts est essentiellement satirique. Or, c’est le propre de la satire d’énoncer témérairement beaucoup de propositions, qui ne sont vraies que dans un sens restreint, et dans des cas très-rares, ou qui sont même absolument fausses, mais que la rapidité de la conversation ou l’entraînement de la dispute font accepter sans trop de répugnance.
Ces propositions, si l’on n’y prend garde, deviennent pour les jeunes gens, qui les ont goûtées, des principes généraux, propres à leur fausser l’esprit, et à égarer leur sens moral. Nous avons cru qu’il importait, en même temps que ces préceptes absolus se produisent, de montrer en quoi ils s’éloignent de la vérité, de la justice ou du bon sens. C’est le devoir de tout homme qui travaille pour l’enfance de ne laisser jamais sans les expliquer, ou les redresser, les pensées qui seraient de nature à amener plus tard des conséquences fâcheuses.
On ne sera donc pas étonné de voir ici dans les notes, au bas des pages, l’examen ou la réfutation de quelques maximes mauvaises ou susceptibles d’être entendues dans un mauvais sens. Nous avons mieux aimé nous exposer au reproche de minutie ou d’excessive sévérité, que de laisser passer sans aucun blâme des propositions dangereuses.
Il est remarquable que c’est surtout dans Fénelon et dans Fontenelle, deux esprits si différents sous tous les rapports, que nous avons trouvé le plus grand nombre de ces assertions repréhensibles. L’un se laissait aveugler par une admiration idolâtre de l’antiquité, l’autre cédait volontiers à son goût pour le paradoxe et à la manie de tout voir sous deux faces opposées: tandis qu’une raison plus froide et plus terme unie au goût du simple et du naturel, maintenait d’Alembert et surtout Boileau dans cette région sereine où le faux ne saurait parvenir, même à la faveur de la nouveauté.