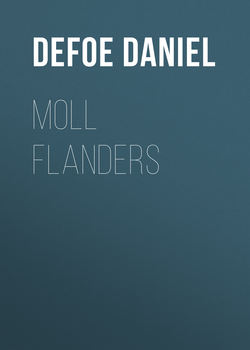Читать книгу Moll Flanders - Даниэль Дефо, Данієль Дефо, Defoe Daniel - Страница 2
MOLL FLANDERS
ОглавлениеMon véritable nom est si bien connu dans les archives ou registres des prisons de Newgate et de Old Bailey et certaines choses de telle importance en dépendent encore, qui sont relatives à ma conduite particulière, qu'il ne faut pas attendre que je fasse mention ici de mon nom ou de l'origine de ma famille; peut-être après ma mort ceci sera mieux connu; à présent il n'y aurait nulle convenance, non, quand même on donnerait pleine et entière rémission, sans exception de personnes ou de crimes.
Il suffira de vous dire que certaines de mes pires camarades, hors d'état de me faire du mal, car elles sont sorties de ce monde par le chemin de l'échelle et de la corde que moi-même j'ai souvent pensé prendre, m'ayant connue par le nom de Moll Flanders, vous me permettrez de passer sous ce nom jusqu'à ce que j'ose avouer tout ensemble qui j'ai été et qui je suis.
On m'a dit que dans une nation voisine, soit en France, soit ailleurs, je n'en sais rien, il y a un ordre du roi, lorsqu'un criminel est condamné ou à mourir ou aux galères ou à être déporté, et qu'il laisse des enfants (qui sont d'ordinaire sans ressource par la confiscation des biens de leurs parents), pour que ces enfants soient immédiatement placés sous la direction du gouvernement et transportés dans un hôpital qu'on nomme Maison des Orphelins, où ils sont élevés, vêtus, nourris, instruits, et au temps de leur sortie entrent en apprentissage ou en service, tellement qu'ils sont capables de gagner leur vie par une conduite honnête et industrieuse.
Si telle eût été la coutume de notre pays, je n'aurais pas été laissée, pauvre fille désolée, sans amis, sans vêtements, sans aide, sans personne pour m'aider, comme fut mon sort; par quoi je fus non seulement exposée à de très grandes détresses, même avant de pouvoir ou comprendre ma situation ou l'amender, mais encore jetée à une vie scandaleuse en elle-même, et qui par son ordinaire cours amène la destruction de l'âme et du corps.
Mais ici le cas fut différent. Ma mère fut convaincue de félonie pour un petit vol à peine digne d'être rapporté: elle avait emprunté trois pièces de fine Hollande à un certain drapier dans Cheapside; les détails en sont trop longs à répéter, et je les ai entendus raconter de tant de façons que je puis à peine dire quel est le récit exact.
Quoiqu'il en soit, ils s'accordent tous en ceci, que ma mère plaida son ventre, qu'on la trouva grosse, et qu'elle eut sept mois de répit; après quoi on la saisit (comme ils disent) du premier jugement; mais elle obtint ensuite la faveur d'être déportée aux plantations, et me laissa, n'étant pas âgée de la moitié d'un an, et en mauvaises mains, comme vous pouvez croire.
Ceci est trop près des premières heures de ma vie pour que je puisse raconter aucune chose de moi, sinon par ouï-dire; il suffira de mentionner que je naquis dans un si malheureux endroit qu'il n'y avait point de paroisse pour y avoir recours afin de me nourrir dans ma petite enfance, et je ne peux pas expliquer le moins du monde comment on me fit vivre; si ce n'est qu'une parente de ma mère (ainsi qu'on me l'a dit) m'emmena avec elle, mais aux frais de qui, ou par l'ordre de qui, c'est ce dont je ne sais rien.
La première chose dont je puisse me souvenir, ou que j'aie pu jamais apprendre sur moi, c'est que j'arrivai à être mêlée dans une bande de ces gens qu'on nomme Bohémiens ou Égyptiens; mais je pense que je restai bien peu de temps parmi eux, car ils ne décolorèrent point ma peau, comme ils le font à tous les enfants qu'ils emmènent, et je ne puis dire comment je vins parmi eux ni comment je les quittai.
Ce fut à Colchester, en Essex, que ces gens m'abandonnèrent; et j'ai dans la tête la notion que c'est moi qui les abandonnai (c'est-à-dire que je me cachai et ne voulus pas aller plus loin avec eux), mais je ne saurais rien affirmer là-dessus. Je me rappelle seulement qu'ayant été prise par des officiers de la paroisse de Colchester, je leur répondis que j'étais venue en ville avec les Égyptiens, mais que je ne voulais pas aller plus loin avec eux, et qu'ainsi ils m'avaient laissée; mais où ils étaient allés, voilà ce que je ne savais pas; car, ayant envoyé des gens par le pays pour s'enquérir, il paraît qu'on ne put les trouver.
J'étais maintenant en point d'être pourvue; car bien que je ne fusse pas légalement à la charge de la paroisse pour telle au telle partie de la ville, pourtant, dès qu'on connut ma situation et qu'on sut que j'étais trop jeune pour travailler, n'ayant pas plus de trois ans d'âge, la pitié émut les magistrats de la ville, et ils décidèrent de me prendre sous leur garde, et je devins à eux tout comme si je fusse née dans la cité.
Dans la provision qu'ils firent pour moi, j'eus la chance d'être mise en nourrice, comme ils disent, chez une bonne femme qui était pauvre, en vérité, mais qui avait connu de meilleurs jours, et qui gagnait petitement sa vie en élevant des enfants tels qu'on me supposait être, et en les entretenant en toutes choses nécessaires jusqu'à l'âge où l'on pensait qu'ils pourraient entrer en service ou gagner leur propre pain.
Cette bonne femme avait aussi une petite école qu'elle tenait pour enseigner aux enfants à lire et à coudre; et ayant, comme j'ai dit, autrefois vécu en bonne façon, elle élevait les enfants avec beaucoup d'art autant qu'avec beaucoup de soin.
Mais, ce qui valait tout le reste, elle les élevait très religieusement aussi, étant elle-même une femme bien sobre et pieuse, secondement bonne ménagère et propre, et troisièmement de façons et mœurs honnêtes. Si bien qu'à ne point parler de la nourriture commune, du rude logement et des vêtements grossiers, nous étions élevés aussi civilement qu'à la classe d'un maître de danse.
Je continuai là jusqu'à l'âge de huit ans, quand je fus terrifiée par la nouvelle que les magistrats (je crois qu'on les nommait ainsi) avaient donné l'ordre de me mettre en service; je ne pouvais faire que bien peu de chose, où qu'on m'envoyât, sinon aller en course, ou servir de souillon à quelque fille de cuisine; et comme on me le répétait souvent, j'en pris une grande frayeur; car j'avais une extrême aversion à entrer en service, comme ils disaient, bien que je fusse si jeune; et je dis à ma nourrice que je croyais pouvoir gagner ma vie sans entrer en service, si elle voulait bien me le permettre; car elle m'avait appris à travailler de mon aiguille et à filer de la grosse laine, qui est la principale industrie de cette ville, et je lui dis que si elle voulait bien me garder, je travaillerais bien fort.
Je lui parlais presque chaque jour de travailler bien fort et, en somme, je ne faisais que travailler et pleurer tout le temps, ce qui affligea tellement l'excellente bonne femme qu'enfin elle se mit à s'inquiéter de moi: car elle m'aimait beaucoup.
Là-dessus, un jour, comme elle entrait dans la chambre où tous les pauvres enfants étaient au travail, elle s'assit juste en face de moi; non pas à sa place habituelle de maîtresse mais comme si elle se disposait à dessein pour m'observer et me regarder travailler; j'étais en train de faire un ouvrage auquel elle m'avait mise, et je me souviens que c'était à marquer des chemises; et après un temps elle commença de me parler:
– Petite sotte, dit-elle, tu es toujours à pleurer (et je pleurais alors), dis-moi pourquoi tu pleures.
– Parce qu'ils vont m'emmener, dis-je, et me mettre en service, et je ne peux pas faire le travail de ménage.
– Eh bien, mon enfant, dit-elle, il est possible que tu ne puisses pas faire le travail de ménage, mais tu l'apprendras plus tard, et on ne te mettra pas au gros ouvrage tout de suite.
– Si, on m'y mettra, dis-je, et si je ne peux pas le faire, on me battra, et les servantes me battront pour me faire faire le gros ouvrage, et je ne suis qu'une petite fille, et je ne peux pas le faire!
Et je me remis à pleurer jusqu'à ne plus pouvoir parler.
Ceci émut ma bonne nourrice maternelle; si bien qu'elle résolut que je n'entrerais pas encore en condition; et elle me dit de ne pas pleurer, et qu'elle parlerait à M. le maire et que je n'entrerais en service que quand je serais plus grande.
Eh bien, ceci ne me satisfit pas; car la seule idée d'entrer en condition était pour moi une chose si terrible que si elle m'avait assuré que je n'y entrerais pas avant l'âge de vingt ans, cela aurait été entièrement pareil pour moi; j'aurais pleuré tout le temps, rien qu'à l'appréhension que la chose finirait par arriver.
Quand elle vit que je n'étais pas apaisée, elle se mit en colère avec moi:
– Et que veux-tu donc de plus, dit-elle, puisque je te dis que tu n'entreras en service que quand tu seras plus grande?
– Oui, dis-je, mais il faudra tout de même que j'y entre, à la fin.
– Mais quoi, dit-elle, est-ce que cette fille est folle? Quoi, tu veux donc être une dame de qualité?
– Oui, dis-je, et je pleurai de tout mon cœur, jusqu'à éclater encore en sanglots.
Ceci fit rire la vieille demoiselle, comme vous pouvez bien penser.
– Eh bien, madame, en vérité, dit-elle, en se moquant de moi, vous voulez donc être une dame de qualité, et comment ferez-vous pour devenir dame de qualité? est-ce avec le bout de vos doigts?
– Oui, dis-je encore innocemment.
– Mais voyons, qu'est-ce que tu peux gagner, dit-elle; qu'est-ce que tu peux gagner par jour en travaillant?
– Six sous, dis-je, quand je file, et huit sous quand je couds du gros linge.
– Hélas! pauvre dame de qualité, dit-elle encore en riant, cela ne te mènera pas loin.
– Cela me suffira, dis-je, si vous voulez bien me laisser vivre avec vous.
Et je parlais d'un si pauvre ton suppliant que j'étreignis le cœur de la bonne femme, comme elle me dit plus tard.
– Mais, dit-elle, cela ne suffira pas à te nourrir et à t'acheter des vêtements; et qui donc achètera des robes pour la petite dame de qualité? dit-elle.
Et elle me souriait tout le temps.
– Alors je travaillerai plus dur, dis-je, et je vous donnerai tout l'argent.
– Mais, mon pauvre enfant, cela ne suffira pas, dit-elle; il y aura à peine de quoi te fournir d'aliments.
– Alors vous ne me donnerez pas d'aliments, dis-je encore, innocemment; mais vous me laisserez vivre avec vous.
– Et tu pourras vivre sans aliments? dit-elle.
– Oui, dis-je encore, comme un enfant, vous pouvez bien penser, et je pleurai encore de tout mon cœur.
Je n'avais aucun calcul en tout ceci; vous pouvez facilement voir que tout était de nature; mais c'était joint à tant d'innocence et à tant de passion qu'en somme la bonne créature maternelle se mit à pleurer aussi, et enfin sanglota aussi fort que moi, et me prit et me mena hors de la salle d'école: «Viens, dit-elle, tu n'iras pas en service, tu vivras avec moi»; et ceci me consola pour le moment.
Là-dessus, elle alla faire visite au maire, mon affaire vint dans la conversation, et ma bonne nourrice raconta à M. le maire toute l'histoire; il en fut si charmé qu'il alla appeler sa femme et ses deux filles pour l'entendre, et ils s'en amusèrent assez entre eux, comme vous pouvez bien penser.
Enfin, une semaine ne s'était pas écoulée, que voici tout à coup madame la femme du maire et ses deux filles qui arrivent à la maison pour voir ma vieille nourrice, et visiter son école et les enfants. Après qu'elles les eurent regardés un peu de temps:
– Eh bien, madame, dit la femme du maire à ma nourrice, et quelle est donc, je vous prie, la petite fille qui veut être dame de qualité?
Je l'entendis et je fus affreusement effrayée, quoique sans savoir pourquoi non plus; mais madame la femme du maire vient jusqu'à moi:
– Eh bien, mademoiselle, dit-elle, et quel ouvrage faites-vous en ce moment?
Le mot mademoiselle était un langage qu'on n'avait guère entendu parler dans notre école, et je m'étonnai de quel triste nom elle m'appelait; néanmoins je me levai, fis une révérence, et elle me prit mon ouvrage dans les mains, le regarda, et dit que c'était très bien; puis elle regarda une de mes mains:
– Ma foi, dit-elle, elle pourra devenir dame de qualité, après tout; elle a une main de dame, je vous assure.
Ceci me fit un immense plaisir; mais madame la femme du maire ne s'en tint pas là, mais elle mit sa main dans sa poche et me donna un shilling, et me recommanda d'être bien attentive à mon ouvrage et d'apprendre à bien travailler, et peut-être je pourrais devenir une dame de qualité, après tout.
Et tout ce temps ma bonne vieille nourrice, et madame la femme du maire et tous les autres gens, ne me comprenaient nullement: car eux voulaient dire une sorte de chose par le mot dame de qualité et moi j'en voulais dire une toute différente; car hélas! tout ce que je comprenais en disant dame de qualité, c'est que je pourrais travailler pour moi et gagner assez pour vivre sans entrer en service; tandis que pour eux cela signifiait vivre dans une grande et haute position et je ne sais quoi.
Eh bien, après que madame la femme du maire fut partie, ses deux filles arrivèrent et demandèrent aussi à voir la dame de qualité, et elles me parlèrent longtemps, et je leur répondis à ma guise innocente; mais toujours lorsqu'elles me demandaient si j'avais résolu de devenir une dame de qualité, je répondais «oui»: enfin elles me demandèrent ce que c'était qu'une dame de qualité. Ceci me troubla fort: toutefois j'expliquai négativement que c'était une personne qui n'entrait pas en service pour faire le ménage; elles en furent extrêmement charmées, et mon petit babillage leur plut et leur sembla assez agréable, et elles me donnèrent aussi de l'argent.
Pour mon argent, je le donnai tout à ma nourrice-maîtresse comme je l'appelais, et lui promis qu'elle aurait tout ce que je gagnerais quand je serais dame de qualité, aussi bien que maintenant; par ceci et d'autres choses que je disais, ma vieille gouvernante commença de comprendre ce que je voulais dire par dame de qualité, et que ce n'était pas plus que d'être capable de gagner mon pain par mon propre travail et enfin elle me demanda si ce n'était pas cela.
Je lui dis que oui, et j'insistai pour lui expliquer que vivre ainsi, c'était être dame de qualité; car, dis-je, il y a une telle, nommant une femme qui raccommodait de la dentelle et lavait les coiffes de dentelle des dames; elle, dis-je, c'est une dame de qualité, et on l'appelle madame.
– Pauvre enfant, dit ma bonne vieille nourrice, tu pourras bientôt être une personne mal famée, et qui a eu deux bâtards.
Je ne compris rien à cela; mais je répondis: «Je suis sûre qu'on l'appelle madame, et elle ne va pas en service, et elle ne fait pas le ménage»; et ainsi je soutins qu'elle était dame de qualité, et que je voulais être dame de qualité, comme elle.
Tout ceci fut répété aux dames, et elles s'en amusèrent et de temps en temps les filles de M. le maire venaient me voir et demandaient où était la petite dame de qualité, ce qui ne me rendait pas peu fière de moi, d'ailleurs j'avais souvent la visite de ces jeunes dames, et elles en amenaient d'autres avec elles; de sorte que par cela je devins connue presque dans toute la ville.
J'avais maintenant près de dix ans et je commençais d'avoir l'air d'une petite femme, car j'étais extrêmement sérieuse, avec de belles manières, et comme j'avais souvent entendu dire aux dames que j'étais jolie, et que je deviendrais extrêmement belle, vous pouvez penser que cela ne me rendait pas peu fière; toutefois cette vanité n'eut pas encore de mauvais effet sur moi; seulement, comme elles me donnaient souvent de l'argent que je donnais à ma vieille nourrice, elle, honnête femme, avait l'intégrité de le dépenser pour moi afin de m'acheter coiffe, linge et gants, et j'allais nettement vêtue; car si je portais des haillons, j'étais toujours très propre, ou je les faisais barboter moi-même dans l'eau, mais, dis-je, ma bonne vieille nourrice, quand on me donnait de l'argent, bien honnêtement le dépensait pour moi, et disait toujours aux dames que ceci ou cela avait été acheté avec leur argent; et ceci faisait qu'elles m'en donnaient davantage; jusqu'enfin je fus tout de bon appelée par les magistrats, pour entrer en service; mais j'étais alors devenue si excellente ouvrière, et les dames étaient si bonnes pour moi, que j'en avais passé le besoin; car je pouvais gagner pour ma nourrice autant qu'il lui fallait pour m'entretenir; de sorte qu'elle leur dit que, s'ils lui permettaient, elle garderait la «dame de qualité» comme elle m'appelait, pour lui servir d'aide et donner leçon aux enfants, ce que j'étais très bien capable de faire; car j'étais très agile au travail, bien que je fusse encore très jeune.
Mais la bonté de ces dames ne s'arrêta pas là, car lorsqu'elles comprirent que je n'étais plus entretenue par la cité, comme auparavant, elles me donnèrent plus souvent de l'argent; et, à mesure que je grandissais, elles m'apportaient de l'ouvrage à faire pour elles: tel que linge à rentoiler, dentelles à réparer, coiffes à façonner, et non seulement me payaient pour mon ouvrage, mais m'apprenaient même à le faire, de sorte que j'étais véritablement une dame de qualité, ainsi que je l'entendais; car avant d'avoir douze ans, non seulement je me suffisais en vêtements et je payais ma nourrice pour m'entretenir, mais encore je mettais de l'argent dans ma poche.
Les dames me donnaient aussi fréquemment de leurs hardes ou de celles de leurs enfants; des bas, des jupons, des habits, les unes telle chose, les autres telle autre, et ma vieille femme soignait tout cela pour moi comme une mère, m'obligeait à raccommoder, et à tourner tout au meilleur usage: car c'était une rare et excellente ménagère.
À la fin, une des dames se prit d'un tel caprice pour moi qu'elle désirait m'avoir chez elle, dans sa maison, pour un mois, dit-elle, afin d'être en compagnie de ses filles.
Vous pensez que cette invitation était excessivement aimable de sa part; toutefois, comme lui dit ma bonne femme, à moins qu'elle se décidât à me garder pour tout de bon, elle ferait à la petite dame de qualité plus de mal que de bien. – «Eh bien, dit la dame, c'est vrai; je la prendrai chez moi seulement pendant une semaine, pour voir comment mes filles et elles s'accordent, et comment son caractère me plaît, et ensuite je vous en dirai plus long; et cependant, s'il vient personne la voir comme d'ordinaire, dites-leur seulement que vous l'avez envoyée en visite à ma maison.»
Ceci était prudemment ménagé, et j'allai faire visite à la dame, où je me plus tellement avec les jeunes demoiselles, et elles si fort avec moi, que j'eus assez à faire pour me séparer d'elles, et elles en furent aussi fâchées que moi-même.
Je les quittai cependant et je vécus presque une année encore avec mon honnête vielle femme; et je commençais maintenant de lui être bien utile; car j'avais presque quatorze ans, j'étais grande pour mon âge, et j'avais déjà l'air d'une petite femme; mais j'avais pris un tel goût de l'air de qualité dont on vivait dans la maison de la dame, que je ne me sentais plus tant à mon aise dans mon ancien logement; et je pensais qu'il était beau d'être vraiment dame de qualité, car j'avais maintenant des notions tout à fait différentes sur les dames de qualité; et comme je pensais qu'il était beau d'être une dame de qualité, ainsi j'aimais être parmi les dames de qualité, et voilà pourquoi je désirais ardemment y retourner.
Quand j'eus environ quatorze ans et trois mois, ma bonne vieille nourrice (ma mère, je devrais l'appeler) tomba malade et mourut. Je me trouvai alors dans une triste condition, en vérité; car ainsi qu'il n'y a pas grand'peine à mettre fin à la famille d'une pauvre personne une fois qu'on les a tous emmenés au cimetière, ainsi la pauvre bonne femme étant enterrée, les enfants de la paroisse furent immédiatement enlevés par les marguilliers; l'école était finie et les externes qui y venaient n'avaient plus qu'à attendre chez eux qu'on les envoyât ailleurs; pour ce qu'elle avait laissé, une fille à elle, femme mariée, arriva et balaya tout; et, comme on emportait les meubles, on ne trouva pas autre chose à me dire que de conseiller par plaisanterie à la petite dame de qualité de s'établir maintenant à son compte, si elle le voulait.
J'étais perdue presque de frayeur, et je ne savais que faire; car j'étais pour ainsi dire mise à la porte dans l'immense monde, et, ce qui était encore pire, la vieille honnête femme avait gardé par devers elle vingt et deux shillings à moi, qui étaient tout l'état que la petite dame de qualité avait au monde; et quand je les demandai à la fille, elle me bouscula et me dit que ce n'étaient point ses affaires.
Il était vrai que la bonne pauvre femme en avait parlé à sa fille, disant que l'argent se trouvait à tel endroit, et que c'était l'argent de l'enfant, et qu'elle m'avait appelée une ou deux fois pour me le donner, mais je ne me trouvais malheureusement pas là, et lorsque je revins, elle était hors la condition de pouvoir en parler; toutefois la fille fut assez honnête ensuite pour me le donner, quoiqu'elle m'eût d'abord à ce sujet traitée si cruellement.
Maintenant j'étais une pauvre dame de qualité, en vérité, et juste cette même nuit j'allais être jetée dans l'immense monde; car la fille avait tout emporté, et je n'avais pas tant qu'un logement pour y aller, ou un bout de pain à manger; mais il semble que quelques-uns des voisins prirent une si grande pitié de moi, qu'ils en informèrent la dame dans la famille de qui j'avais été; et immédiatement elle envoya sa servante pour me chercher; et me voilà partie avec elles, sac et bagages, et avec le cœur joyeux, vous pouvez bien penser; la terreur de ma condition avait fait une telle impression sur moi, que je ne voulais plus être dame de qualité, mais bien volontiers servante, et servante de telle espèce pour laquelle on m'aurait crue bonne.
Mais ma nouvelle généreuse maîtresse avait de meilleures pensées pour moi. Je la nomme généreuse, car autant elle excédait la bonne femme avec qui j'avais vécu avant en tout, qu'en état; je dis en tout, sauf en honnêteté; et pour cela, quoique ceci fût une dame bien exactement juste, cependant je ne dois pas oublier de dire en toutes occasions, que la première, bien que pauvre, était aussi foncièrement honnête qu'il est possible.
Je n'eus pas plus tôt été emmenée par cette bonne dame de qualité, que la première dame, c'est-à-dire madame la femme du maire, envoya ses filles pour prendre soin de moi; et une autre famille qui m'avait remarquée, quand j'étais la petite dame de qualité, me fit chercher, après celle-là, de sorte qu'on faisait grand cas de moi; et elles ne furent pas peu fâchées, surtout madame la femme du maire, que son amie m'eût enlevée à elle; car disait-elle, je lui appartenais par droit, elle ayant été la première qui eût pris garde à moi; mais celles qui me tenaient ne voulaient pas me laisser partir; et, pour moi, je ne pouvais être mieux que là où j'étais.
Là, je continuai jusqu'à ce que j'eusse entre dix-sept et dix-huit ans, et j'y trouvai tous les avantages d'éducation qu'on peut s'imaginer; cette dame avait des maîtres qui venaient pour enseigner à ses filles à danser, à parler français et à écrire, et d'autres pour leur enseigner la musique; et, comme j'étais toujours avec elles, j'apprenais aussi vite qu'elles; et quoique les maîtres ne fussent pas appointés pour m'enseigner, cependant j'apprenais par imitation et questions tout ce qu'elles apprenaient par instruction et direction. Si bien qu'en somme j'appris à danser et à parler français aussi bien qu'aucune d'elles et à chanter beaucoup mieux, car j'avais une meilleure voix qu'aucune d'elles; je ne pouvais pas aussi promptement arriver à jouer du clavecin ou de l'épinette, parce que je n'avais pas d'instruments à moi pour m'y exercer, et que je ne pouvais toucher les leurs que par intervalles, quand elles les laissaient; mais, pourtant, j'appris suffisamment bien, et finalement les jeunes demoiselles eurent deux instruments, c'est-à-dire un clavecin et une épinette aussi, et puis me donnèrent leçon elles-mêmes; mais, pour ce qui est de danser, elles ne pouvaient mais que je n'apprisse les danses de campagne, parce qu'elles avaient toujours besoin de moi pour faire un nombre égal, et, d'autre part, elles mettaient aussi bon cœur à m'apprendre tout ce qu'on leur avait enseigné à elles-mêmes que moi à profiter de leurs leçons.
Par ces moyens j'eus, comme j'ai dit, tous les avantages d'éducation que j'aurais pu avoir, si j'avais été autant demoiselle de qualité que l'étaient celles avec qui je vivais, et, en quelques points, j'avais l'avantage sur mesdemoiselles, bien qu'elles fussent mes supérieures: en ce que tous mes dons étaient de nature et que toutes leurs fortunes n'eussent pu fournir. D'abord j'étais jolie, avec plus d'apparence qu'aucune d'elles; deuxièmement j'étais mieux faite; troisièmement, je chantais mieux, par quoi je veux dire que j'avais une meilleure voix; en quoi vous me permettrez de dire, j'espère, que je ne donne pas mon propre jugement, mais l'opinion de tous ceux qui connaissaient la famille.
J'avais avec tout cela, la commune vanité de mon sexe, en ce qu'étant réellement considérée comme très jolie, ou, si vous voulez, comme une grande beauté, je le savais fort bien, et j'avais une aussi bonne opinion de moi-même qu'homme du monde, et surtout j'aimais à en entendre parler les gens, ce qui arrivait souvent et me donnait une grande satisfaction.
Jusqu'ici mon histoire a été aisée à dire, et dans toute cette partie de ma vie, j'avais non seulement la réputation de vivre dans une très bonne famille, mais aussi la renommée d'une jeune fille bien sobre, modeste et vertueuse, et telle j'avais toujours été; d'ailleurs, je n'avais jamais eu occasion de penser à autre chose, ou de savoir ce qu'était une tentation au vice. Mais ce dont j'étais trop fière fut ma perte. La maîtresse de la maison où j'étais avait deux fils, jeunes gentilshommes de qualité et tenue peu ordinaires, et ce fut mon malheur d'être très bien avec tous deux, mais ils se conduisirent avec moi d'une manière bien différente.
L'aîné, un gentilhomme gai, qui connaissait la ville autant que la campagne, et, bien qu'il eût de légèreté assez pour commettre une mauvaise action, cependant avait trop de jugement pratique pour payer trop cher ses plaisirs; il commença par ce triste piège pour toutes les femmes, c'est-à-dire qu'il prenait garde à toutes occasions combien j'étais jolie, comme il disait, combien agréable, combien mon port était gracieux, et mille autres choses; et il y mettait autant de subtilité que s'il eût eu la même science à prendre une femme au filet qu'une perdrix à l'affût, car il s'arrangeait toujours pour répéter ces compliments à ses sœurs au moment que, bien que je ne fusse pas là, cependant il savait que je n'étais pas assez éloignée pour ne pas être assurée de l'entendre. Ses sœurs lui répondaient doucement: «Chut! frère, elle va t'entendre, elle est dans la chambre d'à côté.» Alors il s'interrompait et parlait à voix basse, prétendant ne l'avoir pas su, et avouait qu'il avait eu tort; puis, feignant de s'oublier, se mettait à parler de nouveau à voix haute, et moi, qui étais si charmée de l'entendre, je n'avais garde de ne point l'écouter à toutes occasions.
Après qu'il eut ainsi amorcé son hameçon et assez aisément trouvé le moyen de placer l'appât sur ma route, il joua à jeu découvert, et un jour, passant par la chambre de sa sœur pendant que j'y étais, il entre avec un air de gaieté:
– Oh! madame Betty, me dit-il, comment allez-vous, madame Betty? Est-ce que les joues ne vous brûlent pas, madame Betty.
Je fis une révérence et me mis à rougir, mais ne répondis rien.
– Pourquoi lui dis-tu cela, mon frère? dit la demoiselle.
– Mais, reprit-il, parce que nous venons de parler d'elle, en bas, cette demi-heure.
– Eh bien, dit sa sœur, vous n'avez pas pu dire de mal d'elle, j'en suis sûre; ainsi, peu importe ce dont vous avez pu parler.
– Non, non, dit-il, nous avons été si loin de dire du mal d'elle, que nous en avons dit infiniment de bien, et beaucoup, beaucoup de belles choses ont été répétées sur Mme Betty, je t'assure, et en particulier que c'est la plus jolie jeune fille de Colchester; et, bref, ils commencent en ville à boire à sa santé.
– Je suis vraiment surprise de ce que tu dis, mon frère, répond la sœur; il ne manque qu'une chose à Betty, mais autant vaudrait qu'il lui manquât tout, car son sexe est en baisse sur le marché au temps présent; et si une jeune femme a beauté, naissance, éducation, esprit, sens, bonne façon et chasteté, et tout a l'extrême, toutefois si elle n'a point d'argent, elle n'est rien; autant vaudrait que tout lui fit défaut: l'argent seul, de nos jours, recommande une femme; les hommes se passent le beau jeu tour à tour.
Son frère cadet, qui était là, s'écria:
– Arrête, ma sœur, tu vas trop vite; je suis une exception à ta règle; je t'assure que si je trouve une femme aussi accomplie, je ne m'inquiéterai guère de l'argent.
– Oh! dit la sœur, mais tu prendras garde alors de ne point te mettre dans l'esprit une qui n'ait pas d'argent.
– Pour cela, tu n'en sais rien non plus, dit le frère.
– Mais pourquoi, ma sœur, dit le frère aîné, pourquoi cette exclamation sur la fortune? Tu n'es pas de celles à qui elle fait défaut, quelles que soient les qualités qui te manquent.
– Je te comprends très bien, mon frère, réplique la dame fort aigrement, tu supposes que j'ai la fortune et que la beauté me manque; mais tel est le temps que la première suffira: je serai donc encore mieux partagée que mes voisines.
– Eh bien, dit le frère cadet, mais tes voisines pourront bien avoir part égale, car beauté ravit un mari parfois en dépit d'argent, et quand la fille se trouve mieux faite que la maîtresse, par chance elle fait un aussi bon marché et monte en carrosse avant l'autre.
Je crus qu'il était temps pour moi de me retirer, et je le fis, mais pas assez loin pour ne pas saisir tout leur discours, où j'entendis abondance de belles choses qu'on disait de moi, ce qui excita ma vanité, mais ne me mit pas en chemin, comme je le découvris bientôt, d'augmenter mon intérêt dans la famille, car la sœur et le frère cadet se querellèrent amèrement là-dessus; et, comme il lui dit, à mon sujet, des choses fort désobligeantes, je pus voir facilement qu'elle en gardait rancune par la conduite qu'elle tint envers moi, et qui fut en vérité bien injuste, car je n'avais jamais eu la moindre pensée de ce qu'elle soupçonnait en ce qui touchait son frère cadet; certainement l'aîné, à sa façon obscure et lointaine, avait dit quantité de choses plaisamment que j'avais la folie de tenir pour sérieuses ou de me flatter de l'espoir de ce que j'aurais dû supposer qu'il n'entendrait jamais.
Il arriva, un jour, qu'il monta tout courant l'escalier vers la chambre où ses sœurs se tenaient d'ordinaire pour coudre, comme il le faisait souvent, et, les appelant de loin avant d'entrer, comme il en avait aussi coutume, moi, étant là, seule, j'allai à la porte et dis:
– Monsieur, ces dames ne sont pas là, elles sont allées se promener au jardin.
Comme je m'avançais pour parler ainsi, il venait d'arriver jusqu'à la porte, et me saisissant dans ses bras, comme c'eût été par chance:
– Oh! madame Betty, dit-il, êtes-vous donc là? C'est encore mieux, je veux vous parler à vous bien plus qu'à elles.
Et puis, me tenant dans ses bras, il me baisa trois ou quatre fois.
Je me débattis pour me dégager, et toutefois je ne le fis que faiblement, et il me tint serrée, et continua de me baiser jusqu'à ce qu'il fût hors d'haleine; et, s'asseyant, il dit:
– Chère Betty, je suis amoureux de vous.
Ses paroles, je dois l'avouer, m'enflammèrent le sang; tous mes esprits volèrent à mon cœur et me mirent assez en désordre. Il répéta ensuite plusieurs fois qu'il était amoureux de moi, et mon cœur disait aussi clairement qu'une voix que j'en étais charmée; oui, et chaque fois qu'il disait: «Je suis amoureux de vous», mes rougeurs répondaient clairement: «Je le voudrais bien, monsieur.» Toutefois, rien d'autre ne se passa alors; ce ne fut qu'une surprise, et je me remis bientôt. Il serait resté plus longtemps avec moi, mais par hasard, il regardai la fenêtre, et vit ses sœurs qui remontaient le jardin. Il prit donc congé, me baisa encore, me dit qu'il était très sérieux, et que j'en entendrais bien promptement davantage. Et le voilà parti infiniment joyeux, et s'il n'y avait eu un malheur en cela, j'aurais été dans le vrai, mais l'erreur était que Mme Betty était sérieuse et que le gentilhomme ne l'était pas.
À partir de ce temps, ma tête courut sur d'étranges choses, et je puis véritablement dire que je n'étais pas moi-même, d'avoir un tel gentilhomme qui me répétait qu'il était amoureux de moi, et que j'étais une si charmante créature, comme il me disait que je l'étais: c'étaient là des choses que je ne savais comment supporter; ma vanité était élevée au dernier degré. Il est vrai que j'avais la tête pleine d'orgueil, mais, ne sachant rien des vices de ce temps, je n'avais pas une pensée sur ma vertu; et si mon jeune maître l'avait proposé à première vue, il eût pu prendre toute liberté qu'il eût cru bonne; mais il ne perçut pas son avantage, ce qui fut mon bonheur à ce moment.
Il ne se passa pas longtemps avant qu'il trouvât l'occasion de me surprendre encore, et presque dans la même posture; en vérité, il y eut plus de dessein de sa part, quoique non de la mienne. Ce fut ainsi: les jeunes dames étaient sorties pour faire des visites avec leur mère; son frère n'était pas en ville, et pour son père, il était à Londres depuis une semaine; il m'avait si bien guettée qu'il savait où j'étais, tandis que moi je ne savais pas tant s'il était à la maison, et il monte vivement l'escalier, et, me voyant au travail, entre droit dans la chambre, où il commença juste comme l'autre fois, me prenant dans ses bras, et me baisant pendant presque un quart d'heure de suite.
C'est dans la chambre de sa plus jeune sœur que j'étais, et comme il n'y avait personne à la maison que la servante au bas de l'escalier, il en fut peut-être plus hardi; bref, il commença d'être pressant avec moi; il est possible qu'il me trouva un peu trop facile, car je ne lui résistai pas tandis qu'il ne faisait que me tenir dans ses bras et me baiser; en vérité, cela me donnait trop de plaisir pour lui résister beaucoup.
Eh bien, fatigués de ce genre de travail, nous nous assîmes, et là il me parla pendant longtemps; me dit qu'il était charmé de moi, qu'il ne pouvait avoir de repos qu'il ne m'eût persuadé qu'il était amoureux de moi, et que si je pouvais l'aimer en retour, et si je voulais le rendre heureux, je lui sauverais la vie, et mille belles choses semblables. Je ne lui répondis que peu, mais découvris aisément que j'étais une sotte et que je ne comprenais pas le moins du monde ce qu'il entendait.
Puis il marcha par la chambre, et, me prenant par la main, je marchai avec lui, et soudain, prenant son avantage, il me jeta sur le lit et m'y baisa très violemment, mais, pour lui faire justice, ne se livra à aucune grossièreté, seulement me baisa pendant très longtemps; après quoi il crut entendre quelqu'un monter dans l'escalier, de sorte qu'il sauta du lit et me souleva, professant infiniment d'amour pour moi, mais me dit que c'était une affection entièrement honorable, et qu'il ne voulait me causer aucun mal, et là-dessus il me mit cinq guinées dans la main et redescendit l'escalier.
Je fus plus confondue de l'argent que je ne l'avais été auparavant de l'amour, et commençai de me sentir si élevée que je savais à peine si je touchais la terre. Ce gentilhomme avait maintenant enflammé son inclination autant que ma vanité, et, comme s'il eût trouvé qu'il avait une occasion et qu'il fût lâché de ne pas la saisir, le voilà qui remonte au bout d'environ une demi-heure, et reprend son travail avec moi, juste comme il avait fait avant, mais avec un peu moins de préparation.
Et d'abord quand il fût entré dans la chambre, il se retourna et ferma la porte.
– Madame Betty, dit-il, je m'étais figuré tout à l'heure que quelqu'un montait dans l'escalier, mais il n'en était rien; toutefois, dit-il, si on me trouve dans la chambre avec vous, on ne me surprendra pas à vous baiser.
Je lui dis que je ne savais pas qui aurait pu monter l'escalier, car je croyais qu'il n'y avait personne à la maison que la cuisinière et l'autre servante et elles ne prenaient jamais cet escalier-là.
– Eh bien, ma mignonne, il vaut mieux s'assurer, en tout cas. – Et puis, s'assied, et nous commençâmes à causer.
Et maintenant, quoique je fusse encore toute en feu de sa première visite, ne pouvant parler que peu, il semblait qu'il me mît les paroles dans la bouche, me disant combien passionnément il m'aimait, et comment il ne pouvait rien avant d'avoir disposition de sa fortune, mais que dans ce temps-là il était bien résolu à me rendre heureuse, et lui-même, c'est-à-dire de m'épouser, et abondance de telles choses, dont moi pauvre sotte je ne comprenais pas le dessein, mais agissais comme s'il n'y eût eu d'autre amour que celui qui tendait au mariage; et s'il eût parlé de l'autre je m'eusse trouvé ni lieu ni pouvoir pour dire non; mais nous n'en étions pas encore venus à ce point-là.
Nous n'étions pas restés assis longtemps qu'il se leva et m'étouffant vraiment la respiration sous ses baisers, me jeta de nouveau sur le lit; mais alors il alla plus loin que la décence ne me permet de rapporter, et il n'aurait pas été en mon pouvoir de lui refuser à ce moment, s'il avait pris plus de privautés qu'il ne fit.
Toutefois, bien qu'il prît ces libertés, il n'alla pas jusqu'à ce qu'on appelle la dernière faveur, laquelle, pour lui rendre justice, il ne tenta point; et ce renoncement volontaire lui servit d'excuse pour toutes ses libertés avec moi en d'autres occasions. Quand ce fut terminé, il ne resta qu'un petit moment, mais me glissa presque une poignée d'or dans la main et me laissa mille prestations de sa passion pour moi, m'assurant qu'il m'aimait au-dessus de toutes les femmes du monde.
Il ne semblera pas étrange que maintenant je commençai de réfléchir; mais, hélas! ce fut avec une réflexion bien peu solide. J'avais un fonds illimité de vanité et d'orgueil, un très petit fonds de vertu. Parfois, certes, je ruminais en moi pour deviner ce que visait mon jeune maître, mais ne pensais à rien qu'aux belles paroles et à l'or; qu'il eût intention de m'épouser ou non me paraissait affaire d'assez petite importance; et je ne pensais pas tant à faire mes conditions pour capituler, jusqu'à ce qu'il me fit une sorte de proposition en forme comme vous allez l'entendre.
Ainsi je m'abandonnai à la ruine sans la moindre inquiétude. Jamais rien ne fut si stupide des deux côtés; si j'avais agi selon la convenance, et résisté comme l'exigeaient l'honneur et la vertu, ou bien il eût renoncé à ses attaques, ne trouvant point lieu d'attendre l'accomplissement de son dessein, ou bien il eût fait de belles et honorables propositions de mariage; dans quel cas on aurait pu le blâmer par aventure mais non moi. Bref, s'il m'eût connue, et combien était aisée à obtenir la bagatelle qu'il voulait, il ne se serait pas troublé davantage la tête, mais m'aurait donné quatre ou cinq guinées et aurait couché avec moi la prochaine fois qu'il serait venu me trouver. D'autre part, si j'avais connu ses pensées et combien dure il supposait que je serais à gagner, j'aurais pu faire mes conditions, et si je n'avais capitulé pour un mariage immédiat, j'aurais pu le faire pour être entretenue jusqu'au mariage, et j'aurais eu ce que j'aurais voulu; car il était riche à l'excès, outre ses espérances; mais j'avais entièrement abandonné de semblables pensées et j'étais occupée seulement de l'orgueil de ma beauté, et de me savoir aimée par un tel gentilhomme; pour l'or, je passais des heures entières à le regarder; je comptais les guinées plus de mille fois par jour. Jamais pauvre vaine créature ne fut si enveloppée par toutes les parties du mensonge que je ne le fus, ne considérant pas ce qui était devant moi, et que la ruine était tout près de ma porte, et, en vérité, je crois que je désirais plutôt cette ruine que je ne m'étudiais à l'éviter.
Néanmoins, pendant ce temps, j'avais assez de ruse pour ne donner lieu le moins du monde à personne de la famille d'imaginer que j'entretinsse la moindre correspondance avec lui. À peine si je le regardais en public ou si je lui répondais, lorsqu'il m'adressait la parole; et cependant malgré tout, nous avions de temps en temps une petite entrevue où nous pouvions placer un mot ou deux, et çà et là un baiser, mais point de belle occasion pour le mal médité; considérant surtout qu'il faisait plus de détours qu'il n'en était besoin, et que la chose lui paraissant difficile, il la rendait telle en réalité.
Mais comme le démon est un tentateur qui ne se lasse point, ainsi ne manque-t-il jamais de trouver l'occasion du crime auquel il invite. Ce fut un soir que j'étais au jardin, avec ses deux jeunes sœurs et lui, qu'il trouva le moyen de me glisser un billet dans la main où il me disait que le lendemain il me demanderait en présence de tout le monde d'aller faire un message pour lui et que je le verrais quelque part sur mon chemin.
En effet, après dîner, il me dit gravement, ses sœurs étant toutes là:
– Madame Betty, j'ai une faveur à vous demander.
– Et laquelle donc? demande la seconde sœur.
– Alors, ma sœur, dit-il très gravement, si tu ne peux te passer de Mme Betty aujourd'hui, tout autre moment sera bon.
Mais si, dirent-elles, elles pouvaient se passer d'elle fort bien, et la sœur lui demanda pardon de sa question.
– Eh bien, mais, dit la sœur aînée, il faut que tu dises à Mme Betty ce que c'est; si c'est quelque affaire privée que nous ne devions pas entendre, tu peux l'appeler dehors: la voilà.
– Comment, ma sœur, dit le gentilhomme très gravement, que veux-tu dire? Je voulais seulement la prier de passer dans High Street (et il tire de sa poche un rabat), dans telle boutique. Et puis il leur raconte une longue histoire sur deux belles cravates de mousseline dont il avait demandé le prix, et qu'il désirait que j'allasse en message acheter un tour de cou, pour ce rabat qu'il montrait, et que si on ne voulait pas prendre le prix que j'offrirais des cravates, que je misse un shilling de plus et marchandasse avec eux; et ensuite il imagina d'autres messages et continua ainsi de me donner prou d'affaires, afin que je fusse bien assurée de demeurer sortie un bon moment.
Quand il m'eût donné mes messages, il leur fit une longue histoire d'une visite qu'il allait rendre dans une famille qu'ils connaissaient tous, et où devaient se trouver tels et tels gentilshommes, et très cérémonieusement pria ses sœurs de l'accompagner, et elles, en semblable cérémonie, lui refusèrent à cause d'une société qui devait venir leur rendre visite cette après-midi; toutes choses, soit dit en passant, qu'il avait imaginées à dessein.
Il avait à peine fini de parler que son laquais entra pour lui dire que le carrosse de sir W… H… venait de s'arrêter devant la porte; il y court et revient aussitôt.
– Hélas! dit-il à haute voix, voilà tout mon plaisir gâté d'un seul coup; sir W… envoie son carrosse pour me ramener: il désire me parler. Il paraît que ce sir W… était un gentilhomme qui vivait à trois lieues de là, à qui il avait parlé à dessein afin qu'il lui prêtât sa voiture pour une affaire particulière et l'avait appointée pour venir le chercher au temps qu'elle arriva, vers trois heures.
Aussitôt il demanda sa meilleure perruque, son chapeau, son épée, et, ordonnant à son laquais d'aller l'excuser à l'autre endroit, – c'est-à-dire qu'il inventa une excuse pour renvoyer son laquais, – il se prépare à monter dans le carrosse. Comme il sortait, il s'arrêta un instant et me parle en grand sérieux de son affaire, et trouve occasion de me dire très doucement:
– Venez me rejoindre, ma chérie, aussitôt que possible.
Je ne dis rien, mais lui fis ma révérence, comme je l'avais faite auparavant, lorsqu'il avait parlé devant tout le monde. Au bout d'un quart d'heure environ, je sortis aussi, sans avoir mis d'autre habit que celui que je portais, sauf que j'avais une coiffe, un masque, un éventail et une paire de gants dans ma poche; si bien qu'il n'y eut pas le moindre soupçon dans la maison. Il m'attendait dans une rue de derrière, près de laquelle il savait que je devais passer, et le cocher savait où il devait toucher, en un certain endroit nommé Mile-End, où vivait un confident à lui, où nous entrâmes, et où se trouvaient toutes les commodités du monde pour faire tout le mal qu'il nous plairait.
Quand nous fumes ensemble, il commença, de me parler très gravement et de me dire qu'il ne m'avait pas amenée là pour me trahir; que la passion qu'il entretenait pour moi ne souffrait pas qu'il me déçût; qu'il était résolu à m'épouser sitôt qu'il disposerait de sa fortune; que cependant, si je voulais accorder sa requête, il m'entretiendrait fort honorablement; et me fit mille protestations de sa sincérité et de l'affection qu'il me portait; et qu'il ne m'abandonnerait jamais, et comme je puis bien dire, fit mille fois plus de préambules qu'il n'en eût eu besoin.
Toutefois, comme il me pressait de parler, je lui dis que je n'avais point de raison de douter de la sincérité de son amour pour moi, après tant de protestations, mais…
Et ici je m'arrêtai, comme si je lui laissais à deviner le reste.
– Mais quoi, ma chérie? dit-il. Je devine ce que vous voulez dire. Et si vous alliez devenir grosse, n'est-ce pas cela? Eh bien, alors, dit-il, j'aurai soin de vous et de vous pourvoir, aussi bien que l'enfant; et afin que vous puissiez voir que je ne plaisante pas, dit-il, voici quelque chose de sérieux pour vous, et là-dessus il tire une bourse de soie avec cent guinées et me la donna; et je vous en donnerai une autre pareille, dit-il, tous les ans jusqu'à ce que je vous épouse.
Ma couleur monta et s'enfuit à la vue de la bourse, et tout ensemble au feu de sa proposition, si bien que je ne pus dire une parole, et il s'en aperçut aisément; de sorte que, glissant la bourse dans mon sein, je ne lui fis plus de résistance, mais lui laissai faire tout ce qui lui plaisait et aussi souvent qu'il lui plut et ainsi je scellai ma propre destruction d'un coup; car de ce jour, étant abandonnée de ma vertu et de ma chasteté, il ne me resta plus rien de valeur pour me recommander ou à la bénédiction de Dieu ou à l'assistance des hommes.
Mais les choses ne se terminèrent pas là. Je retournai en ville, fis les affaires dont il m'avait priée, et fus rentrée avant que personne s'étonnât de ma longue sortie; pour mon gentilhomme, il resta dehors jusque tard dans la nuit, et il n'y eut pas le moindre soupçon dans la famille, soit sur son compte, soit sur le mien.
Nous eûmes ensuite de fréquentes occasions de renouveler notre crime, en particulier à la maison, quand sa mère et les jeunes demoiselles sortaient en visite, ce qu'il guettait si étroitement qu'il n'y manquait jamais; sachant toujours d'avance le moment où elles sortaient, et n'omettait pas alors de me surprendre toute seule et en absolue sûreté; de sorte que nous prîmes notre plein de nos mauvais plaisirs pendant presque la moitié d'une année; et cependant, à ma bien grande satisfaction, je n'étais pas grosse.
Mais avant que cette demi-année fût expirée, son frère cadet, de qui j'ai fait quelque mention, entra au jeu avec moi; et, me trouvant seule au jardin un soir, me commence une histoire de même sorte, fit de bonnes et honnêtes protestations de son amour pour moi, et bref, me propose de m'épouser bellement, en tout honneur.
J'étais maintenant confondue, et poussée à une telle extrémité que je n'en avais jamais connu de semblable, je résistai obstinément à sa proposition et commençai de m'armer d'arguments: je lui exposai l'inégalité de cette alliance, le traitement que je rencontrerais dans sa famille, l'ingratitude que ce serait envers son bon père et sa mère qui m'avaient recueillie dans leur maison avec de si généreuses intentions et lorsque je me trouvais dans une condition si basse; et bref je dis, pour le dissuader, tout ce que je pus imaginer, excepté la vérité, ce qui aurait mis fin à tout, mais dont je n'osais même penser faire mention.
Mais ici survint une circonstance que je n'attendais pas, en vérité, et qui me mit à bout de ressources: car ce jeune gentilhomme, de même qu'il était simple et honnête, ainsi ne prétendait à rien qui ne le fut également; et, connaissant sa propre innocence, il n'était pas si soigneux que l'était son frère de tenir secret dans la maison qu'il eût une douceur pour Mme Betty; et quoiqu'il ne leur fit pas savoir qu'il m'en avait parlé, cependant il en dit assez pour laisser voir à ses sœurs qu'il m'aimait, et sa mère le vit aussi, et quoiqu'elles n'en fissent point semblant à mon égard, cependant elles ne le lui dissimulèrent pas, et aussitôt je trouvai que leur conduite envers moi était changée encore plus qu'auparavant.
Je vis le nuage, quoique sans prévision de l'orage; il était facile de voir, dis-je, que leur conduite était changée et que tous les jours elle devenait pire et pire; jusqu'à ce qu'enfin je fus informée que dans très peu de temps je serais priée de m'en aller.
Je ne fus pas effrayée de la nouvelle, étant pleinement assurée que je serais pourvue, et surtout regardant que j'avais raison, chaque jour d'attendre d'être grosse, et qu'alors je serais obligée de partir sans couleurs aucunes.
Après quelque temps, le gentilhomme cadet saisit une occasion pour me dire que la tendresse qu'il entretenait pour moi s'était ébruitée dans la famille; il ne m'en accusait pas, disait-il, car il savait assez par quel moyen on l'avait su; il me dit que c'étaient ses propres paroles qui en avaient été l'occasion, car il n'avait pas tenu son respect pour moi aussi secret qu'il eût pu, et la raison en était qu'il était au point que, si je voulais consentir à l'accepter, il leur dirait à tous ouvertement qu'il m'aimait et voulait m'épouser; qu'il était vrai que son père et sa mère en pourraient être fâchés et se montrer sévères, mais qu'il était maintenant fort capable de gagner sa vie, ayant profité dans le droit, et qu'il ne craindrait point de m'entretenir, et qu'en somme, comme il croyait que je n'aurais point honte de lui, ainsi était-il résolu à n'avoir point honte de moi, qu'il dédaignait de craindre m'avouer maintenant, moi qu'il avait décidé d'avouer après que je serais sa femme; qu'ainsi je n'avais rien à faire qu'à lui donner ma main, et qu'il répondrait du reste.
J'étais maintenant dans une terrible condition, en vérité, et maintenant je me repentis de cœur de ma facilité avec le frère aîné; non par réflexion de conscience, car j'étais étrangère à ces choses, mais je ne pouvais songer à servir de maîtresse à l'un des frères et de femme à l'autre; il me vint aussi à la pensée que l'aîné m'avait promis de me faire sa femme quand il aurait disposition de sa fortune; mais en un moment je me souvins d'avoir souvent pensé qu'il n'avait jamais plus dit un mot de me prendre pour femme après qu'il m'eût conquise pour maîtresse; et jusqu'ici, en vérité, quoique je dise que j'y pensais souvent, toutefois je n'en prenais pas d'inquiétude car il ne semblait pas le moins du monde perdre de son affection pour moi, non plus que de sa générosité; quoique lui-même eût la discrétion de me recommander de ne point dépenser deux sols en habits, ou faire la moindre parade, parce que nécessairement cela exciterait quelque envie dans la famille, puisque chacun savait que je n'aurais pu obtenir ces choses par moyens ordinaires, sinon par quelque liaison privée dont on m'aurait soupçonnée sur-le-champ.
J'étais donc dans une grande angoisse et ne savais que faire; la principale difficulté était que le frère cadet non seulement m'assiégeait étroitement, mais le laissait voir; il entrait dans la chambre de sa sœur ou dans la chambre de sa mère, s'asseyait, et me disait mille choses aimables, en face d'elles; si bien que toute la maison en parlait, et que sa mère l'en blâma, et que leur conduite envers moi parut toute changée: bref, sa mère avait laissé tomber quelques paroles par où il était facile de comprendre qu'elle voulait me faire quitter la famille, c'est-à-dire, en français, me jeter à la porte.
Or, j'étais sûre que ceci ne pouvait être un secret pour son frère; seulement il pouvait penser (car personne n'y songeait encore) que son frère cadet ne m'avait fait aucune proposition; mais de même que je voyais facilement que les choses iraient plus loin, ainsi vis-je pareillement qu'il y avait nécessité absolue de lui en parler ou qu'il m'en parlât, mais je ne savais pas si je devais m'ouvrir à lui la première ou bien attendre qu'il commençât.
Après sérieuse considération, car, en vérité, je commençais maintenant d'abord à considérer les choses très sérieusement, je résolus de lui en parler la première, et il ne se passa pas longtemps avant que j'en eusse l'occasion, car précisément le jour suivant son frère alla à Londres en affaires, et la famille étant sortie en visite, comme il arrivait avant, il vint, selon sa coutume, passer une heure ou deux avec Mme Betty.
Quand il se fut assis un moment, il vit facilement qu'il y avait un changement dans mon visage, que je n'étais pas si libre avec lui et si gaie que de coutume, et surtout que je venais de pleurer; il ne fut pas long à le remarquer, et me demanda très tendrement ce qu'il y avait et si quelque chose me tourmentait. J'aurais bien remis la confidence, si j'avais pu, mais je ne pouvais plus dissimuler; et après m'être fait longuement importuner pour me laisser tirer ce que je désirais si ardemment révéler, je lui dis qu'il était vrai qu'une chose me tourmentait, et une chose de nature telle que je pouvais à peine la lui cacher, et que pourtant je ne pouvais savoir comment la lui dire; que c'était une chose qui non seulement me surprenait, mais m'embarrassait fortement, et que je ne savais quelle décision prendre, à moins qu'il voulût me conseiller. Il me répondit avec une grande tendresse que, quelle que fut la confidence, je ne devais m'inquiéter de rien, parce qu'il me protégerait de tout le monde.
Je commençai à tirer de loin, et lui dis que je craignais que mesdames eussent obtenu quelque secrète information de notre liaison; car il était facile de voir que leur conduite était bien changée à mon égard, et maintenant les choses en étaient venues au point qu'elles me trouvaient souvent en faute et parfois me querellaient tout de bon, quoique je n'y donnasse pas la moindre occasion; qu'au lieu que j'avais toujours couché d'ordinaire avec la sœur aînée, on m'avait mise naguère à coucher toute seule ou avec une des servantes, et que je les avais surprises plusieurs fois à parler très cruellement de moi; mais que ce qui confirmait le tout était qu'une des servantes m'avait rapporté qu'elle avait entendu dire que je devais être mise à la porte, et qu'il ne valait rien pour la famille que je demeurasse plus longtemps dans la maison.
Il sourit en m'entendant, et je lui demandai comment il pouvait prendre cela si légèrement, quand il devait bien savoir que si nous étions découverts, j'étais perdue et que cela lui ferait du tort, bien qu'il n'en dût pas être ruiné, comme moi. Je lui reprochai vivement de ressembler au reste de son sexe, qui, ayant à merci la réputation d'une femme, en font souvent leur jouet ou au moins la considèrent comme une babiole, et comptent la ruine de celles dont ils ont fait leur volonté comme une chose de nulle valeur.
Il vit que je m'échauffais et que j'étais sérieuse, et il changea de style sur-le-champ; il me dit qu'il était fâché que j'eusse une telle pensée sur lui; qu'il ne m'en avait jamais donné la moindre occasion, mais s'était montré aussi soucieux de ma réputation que de la sienne propre; qu'il était certain que notre liaison avait été gouvernée avec tant d'adresse que pas une créature de la famille ne faisait tant que de la soupçonner; que s'il avait souri quand je lui avais dit mes pensées, c'était à cause de l'assurance qu'il venait de recevoir qu'on n'avait même pas une lueur sur notre entente, et que lorsqu'il me dirait les raisons qu'il avait de se sentir en sécurité, je sourirais comme lui, car il était très certain qu'elles me donneraient pleine satisfaction.
– Voilà un mystère que je ne saurais entendre, dis-je, ou comment pourrais-je être satisfaite d'être jetée à la porte? Car si notre liaison n'a pas été découverte, je ne sais ce que j'ai fait d'autre pour changer les visages que tournent vers moi tous ceux de la famille, qui jadis me traitaient avec autant de tendresse que si j'eusse été une de leurs enfants.
– Mais vois-tu, mon enfant, dit-il: qu'ils sont inquiets à ton sujet, c'est parfaitement vrai, mais qu'ils aient le moindre soupçon du cas tel qu'il est, en ce qui nous concerne, toi et moi, c'est si loin d'être vrai qu'ils soupçonnent mon frère Robin, et, en somme, ils sont pleinement persuadés qu'il te fait la cour; oui-dà, et c'est ce sot lui-même qui le leur a mis dans la tête, car il ne cesse de babiller là-dessus et de se rendre ridicule. J'avoue que je pense qu'il a grand tort d'agir ainsi, puisqu'il ne saurait ne pas voir que cela les vexe et les rend désobligeants pour toi; mais c'est une satisfaction pour moi, à cause de l'assurance que j'en tire qu'ils ne me soupçonnent en rien, et j'espère que tu en seras satisfaite aussi.
– Et je le suis bien, dis-je, en une manière, mais qui ne touche nullement ma position, et ce n'est pas là la chose principale qui me tourmente, quoique j'en aie été bien inquiète aussi.
– Et qu'est-ce donc alors? dit-il.
Là-dessus j'éclatai en larmes, et ne pus rien lui dire du tout; il s'efforça de m'apaiser de son mieux, mais commença enfin de me presser très fort de lui dire ce qu'il y avait; enfin, je répondis que je croyais de mon devoir de le lui dire, et qu'il avait quelque droit de le savoir, outre que j'avais besoin de son conseil, car j'étais dans un tel embarras que je ne savais comment faire, et alors je lui racontai toute l'affaire: je lui dis avec quelle imprudence s'était conduit son frère, en rendant la chose si publique, car s'il l'avait gardée secrète j'aurais pu le refuser avec fermeté sans en donner aucune raison, et, avec le temps, il aurait cessé ses sollicitations; mais qu'il avait eu la vanité, d'abord de se persuader que je ne le refuserais pas, et qu'il avait pris la liberté, ensuite, de parler de son dessein à la maison entière.
Je lui dis à quel point je lui avais résisté, et combien…ses offres étaient honorables et sincères.
– Mais, dis-je, ma situation va être doublement difficile, car elles m'en veulent maintenant, parce qu'il désire m'avoir; mais elles m'en voudront davantage quand elles verront que je l'ai refusé, et elles diront bientôt: «Il doit y avoir quelque chose d'autre là-dedans», et que je suis déjà mariée à quelqu'un d'autre, sans quoi je ne refuserais jamais une alliance si au-dessus de moi que celle-ci.
Ce discours le surprit vraiment beaucoup; il me dit que j'étais arrivée, en effet, à un point critique, et qu'il ne voyait pas comment je pourrais me tirer d'embarras; mais qu'il y réfléchirait et qu'il me ferait savoir à notre prochaine entrevue à quelle résolution il s'était arrêté; cependant il me pria de ne pas donner mon consentement à son frère, ni de lui opposer un refus net, mais de le tenir en suspens.
Je parus sursauter à ces mots «ne pas donner mon consentement»; je lui dis qu'il savait fort bien que je n'avais pas de consentement à donner, qu'il s'était engagé à m'épouser, et que moi, par là même, j'étais engagée à lui, qu'il m'avait toujours dit que j'étais sa femme, et que je me considérais en effet comme telle, aussi bien que si la cérémonie en eût été passée, et que c'était sa propre bouche qui m'en donnait droit, puisqu'il m'avait toujours persuadée de me nommer sa femme.
– Voyons, ma chérie, dit-il, ne t'inquiète pas de cela maintenant; si je ne suis pas ton mari, je ferai tout l'office d'un mari, et que ces choses ne te tourmentent point maintenant, mais laisse-moi examiner un peu plus avant cette affaire et je pourrai t'en dire davantage à notre prochaine entrevue.
Ainsi il m'apaisa du mieux qu'il put, mais je le trouvai très songeur, et quoiqu'il se montrât très tendre et me baisât mille fois et davantage, je crois, et me donnât de l'argent aussi, cependant il ne fit rien de plus pendant tout le temps que nous demeurâmes ensemble, qui fut plus de deux heures, dont je m'étonnai fort, regardant sa coutume et l'occasion.
Son frère ne revint pas de Londres avant cinq ou six jours, et il se passa deux jours encore avant qu'il eut l'occasion de lui parler; mais alors, le tirant à part, il lui parla très secrètement là-dessus, et le même soir trouva moyen (car nous eûmes une longue conférence) de me répéter tout leur discours qui, autant que je me le rappelle, fut environ comme suit.
Il lui dit qu'il avait ouï d'étranges nouvelles de lui depuis son départ et, en particulier qu'il faisait l'amour à Mme Betty.
– Eh bien, dit son frère avec un peu d'humeur, et puis quoi? Cela regarde-t-il quelqu'un?
– Voyons, lui dit son frère, ne te fâche pas, Robin, je ne prétends nullement m'en mêler, mais je trouve qu'elles s'en inquiètent, et qu'elles ont à ce sujet maltraité la pauvre fille, ce qui me peine autant que si c'était moi-même.
– Que veux-tu dire par ELLES? dit Robin.
– Je veux dire ma mère et les filles, dit le frère aîné. Mais écoute, reprend-il, est-ce sérieux? aimes-tu vraiment la fille?
– Eh bien, alors, dit Robin, je te parlerai librement: je l'aime au-dessus de toutes les femmes du monde, et je l'aurai, en dépit de ce qu'elles pourront faire ou dire; j'ai confiance que la fille ne me refusera point.
Je fus percée au cœur à ces paroles, car bien qu'il fût de toute raison de penser que je ne le refuserais pas, cependant, je savais, en ma conscience, qu'il le fallait, et je voyais ma ruine dans cette obligation; mais je savais qu'il était de mon intérêt de parler autrement à ce moment, et j'interrompis donc son histoire en ces termes:
– Oui-dà, dis-je, pense-t-il que je ne le refuserai point? il verra bien que je le refuserai tout de même.
– Bien, ma chérie, dit-il, mais permets-moi de te rapporter toute l'histoire, telle qu'elle se passa entre nous, puis tu diras ce que tu voudras.
Là-dessus il continua et me dit qu'il avait ainsi répondu:
– Mais, mon frère, tu sais qu'elle n'a rien, et tu pourrais prétendre à différentes dames qui ont de belles fortunes.
– Peu m'importe, dit Robin, j'aime la fille, et je ne chercherai jamais à flatter ma bourse, en me mariant, aux dépens de ma fantaisie.
– Ainsi, ma chérie, ajoute-t-il, il n'y a rien à lui opposer.
– Si, si, dis-je, je saurai bien quoi lui opposer. J'ai appris à dire non, maintenant, quoique je ne l'eusse pas appris autrefois; si le plus grand seigneur du pays m'offrait le mariage maintenant, je pourrais répondre non de très bon cœur.
– Voyons, mais, ma chérie, dit-il, que peux-tu lui répondre? Tu sais fort bien, ainsi que tu le disais l'autre jour qu'il te fera je ne sais combien de questions là-dessus et toute la maison s'étonnera de ce que cela peut bien signifier.
– Comment? dis-je en souriant, je peux leur fermer la bouche à tous, d'un seul coup, en lui disant, ainsi qu'à eux, que je suis déjà mariée à son frère aîné.
Il sourit un peu, lui aussi, sur cette parole, mais je pus voir qu'elle le surprenait, et il ne put dissimuler le désordre où elle le jeta; toutefois il répliqua:
– Oui bien, dit-il, et quoique cela puisse être vrai, en un sens, cependant je suppose que tu ne fais que plaisanter en parlant de donner une telle réponse, qui pourrait ne pas être convenable pour plus d'une raison.
– Non, non, dis-je gaiement, je ne suis pas si ardente à laisser échapper ce secret sans votre consentement.
– Mais que pourras-tu leur répondre alors, dit-il, quand ils te trouveront déterminée contre une alliance qui serait apparemment si fort à ton avantage?
– Comment, lui dis-je, serai-je en défaut? En premier lieu je ne suis point forcée de leur donner de raisons et d'autre part je puis leur dire que je suis mariée déjà, et m'en tenir là; et ce sera un arrêt net pour lui aussi, car il ne saurait avoir de raisons pour faire une seule question ensuite.
– Oui, dit-il, mais toute la maison te tourmentera là-dessus, et si tu refuses absolument de rien leur dire, ils en seront désobligés et pourront en outre en prendre du soupçon.
– Alors, dis-je, que puis-je faire? Que voudriez-vous que je fisse? J'étais assez en peine avant, comme je vous ai dit; et je vous ai fait connaître les détails afin d'avoir votre avis.
– Ma chérie, dit-il, j'y ai beaucoup réfléchi, sois-en sûre; et quoiqu'il y ait en mon conseil bien des mortifications pour moi, et qu'il risque d'abord de te paraître étrange, cependant, toutes choses considérées, je ne vois pas de meilleure solution pour toi que de le laisser aller; et si tu le trouves sincère et sérieux, de l'épouser.
Je lui jetai un regard plein d'horreur sur ces paroles, et, devenant pâle comme la mort, fus sur le point de tomber évanouie de la chaise où j'étais assise, quand, avec un tressaut: «Ma chérie, dit-il tout haut, qu'as-tu? qu'y a-t-il? où vas-tu?» et mille autres choses pareilles, et, me secouant et m'appelant tour à tour, il me ramena un peu à moi, quoiqu'il se passât un bon moment avant que je retrouvasse pleinement mes sens, et je ne fus pas capable de parler pendant plusieurs minutes.
Quand je fus pleinement remise, il commença de nouveau:
– Ma chérie, dit-il, il faudrait y songer bien sérieusement; tu peux assez clairement voir quelle est l'attitude de la famille dans le cas présent et qu'ils seraient tous enragés si j'étais en cause, au lieu que ce fût mon frère, et, à ce que je puis voir du moins, ce serait ma ruine et la tienne tout ensemble.
– Oui-dà! criai-je, parlant encore avec colère; et toutes vos protestations et vos vœux doivent-ils être ébranlés par le déplaisir de la famille? Ne vous l'ai-je pas toujours objecté, et vous le traitiez légèrement, comme étant au-dessous de vous, et de peu d'importance; et en est-ce venu là, maintenant? Est-ce là votre foi et votre honneur, votre amour et la fermeté de vos promesses?
Il continua à demeurer parfaitement calme, malgré tous mes reproches, et je ne les lui épargnais nullement; mais il répondit enfin:
– Ma chérie, je n'ai pas manqué encore à une seule promesse; je t'ai dit que je t'épouserais quand j'entrerais en héritage; mais tu vois que mon père est un homme vigoureux, de forte santé et qui peut vivre encore ses trente ans, et n'être pas plus vieux en somme que plusieurs qui sont autour de nous en ville; et tu ne m'as jamais demandé de t'épouser plus tôt, parce que tu savais que cela pourrait être ma ruine; et pour le reste, je ne t'ai failli en rien.
Je ne pouvais nier un mot de ce qu'il disait:
– Mais comment alors, dis-je, pouvez-vous me persuader de faire un pas si horrible et de vous abandonner, puisque vous ne m'avez pas abandonnée? N'accorderez-vous pas qu'il y ait de mon côté un peu d'affection et d'amour, quand il y en a tant eu du vôtre? Ne vous ai-je pas fait des retours? N'ai-je donné aucun témoignage de ma sincérité et de ma passion? Est-ce que le sacrifice que je vous ai fait de mon honneur et de ma chasteté n'est pas une preuve de ce que je suis attachée à vous par des liens trop forts pour les briser?
– Mais ici, ma chérie, dit-il, tu pourras entrer dans une position sûre, et paraître avec honneur, et la mémoire de ce que nous avons fait peut être drapée d'un éternel silence, comme si rien n'en eût jamais été; tu conserveras toujours ma sincère affection, mais en toute honnêteté et parfaite justice envers mon frère; tu seras ma chère sœur, comme tu es maintenant ma chère…
Et là il s'arrêta.
– Votre chère catin, dis-je; c'était ce que vous vouliez dire et vous auriez aussi bien pu le dire; mais je vous comprends; pourtant je vous prie de vous souvenir des longs discours dont vous m'entreteniez, et des longues heures de peine que vous vous êtes donnée pour me persuader de me regarder comme une honnête femme; que j'étais votre femme en intention, et que c'était un mariage aussi effectif qui avait été passé entre nous, que si nous eussions été publiquement mariés par le ministre de la paroisse; vous savez que ce sont là vos propres paroles.
Je trouvai que c'était là le serrer d'un peu trop près; mais j'adoucis les choses dans ce qui suit; il demeura comme une souche pendant un moment, et je continuai ainsi:
– Vous ne pouvez pas, dis-je, sans la plus extrême injustice, penser que j'aie cédé à toute ces persuasions sans un amour qui ne pouvait être mis en doute, qui ne pouvait être ébranlé par rien de ce qui eût pu survenir; si vous avez sur moi des pensées si peu honorables, je suis forcée de vous demander quel fondement je vous ai donné à une telle persuasion. Si jadis j'ai cédé aux importunités de mon inclination, et si j'ai été engagée à croire que je suis vraiment votre femme, donnerai-je maintenant le démenti à tous ces arguments, et prendrai-je le nom de catin ou de maîtresse, qui est la même chose? Et allez-vous me transférer à votre frère? Pouvez-vous transférer mon affection? Pouvez-vous m'ordonner de cesser de vous aimer et m'ordonner de l'aimer? Est-il en mon pouvoir, croyez-vous, de faire un tel changement sur commande? Allez, monsieur, dis-je, soyez persuadé que c'est une chose impossible, et, quel que puisse être le changement de votre part, que je resterai toujours fidèle; et j'aime encore bien mieux, puisque nous en sommes venus à une si malheureuse conjoncture, être votre catin que la femme de votre frère.
Il parut satisfait et touché par l'impression de ce dernier discours, et me dit qu'il restait là où il s'était tenu avant; qu'il ne m'avait été infidèle en aucune promesse qu'il m'eût faite encore, mais que tant de choses terribles s'offraient à sa vue en cette affaire, qu'il avait songé à l'autre comme un remède; mais qu'il pensait bien qu'elle ne marquerait pas une entière séparation entre nous, que nous pourrions, au contraire, nous aimer en amis tout le reste de nos jours, et peut-être avec plus de satisfaction qu'il n'était possible en la situation où nous étions présentement; qu'il se faisait fort de dire que je ne pouvais rien appréhender de sa part sur la découverte d'un secret qui ne pourrait que nous réduire à rien, s'il paraissait au jour; enfin qu'il n'avait qu'une seule question à me faire, et qui pourrait s'opposer à son dessein, et que s'il obtenait une réponse à cette question, il ne pouvait que penser encore que c'était pour moi la seule décision possible.
Je devinai sa question sur-le-champ, à savoir si je n'étais pas grosse. Pour ce qui était de cela, lui dis-je, il n'avait besoin d'avoir cure, car je n'étais pas grosse.
– Eh bien, alors, ma chérie, dit-il, nous n'avons pas le temps de causer plus longtemps maintenant; réfléchis; pour moi, je ne puis qu'être encore d'opinion que ce sera pour toi le meilleur parti à prendre.
Et là-dessus, il prit congé, et d'autant plus à la hâte que sa mère et ses sœurs sonnaient à la grande porte dans le moment qu'il s'était levé pour partir.
Il me laissa dans la plus extrême confusion de pensée; et il s'en aperçut aisément le lendemain et tout le reste de la semaine, mais ne trouva pas l'occasion de me joindre jusqu'au dimanche d'après, qu'étant indisposée, je n'allai pas à l'église, et lui, imaginant quelque excuse, resta à la maison.
Et maintenant il me tenait encore une fois pendant une heure et demie toute seule, et nous retombâmes tout du long dans les mêmes arguments; enfin je lui demandai avec chaleur quelle opinion il devait avoir de ma pudeur, s'il pouvait supposer que j'entretinsse seulement l'idée de coucher avec deux frères, et lui assurai que c'était une chose impossible; j'ajoutais que s'il me disait même qu'il ne me reverrait jamais (et rien que la mort ne pourrait m'être plus terrible), pourtant je ne pourrais jamais entretenir une pensée si peu honorable pour moi et si vile pour lui; et qu'ainsi je le suppliais, s'il lui restait pour moi un grain de respect ou d'affection, qu'il ne m'en parlât plus ou qu'il tirât son épée pour me tuer.
Il parut surpris de mon obstination, comme il la nomma; me dit que j'étais cruelle envers moi-même, cruelle envers lui tout ensemble; que c'était pour nous deux une crise inattendue, mais qu'il ne voyait pas d'autre moyen de nous sauver de la ruine, d'où il lui paraissait encore plus cruel; mais que s'il ne devait plus m'en parler, il ajouta avec une froideur inusitée qu'il ne connaissait rien d'autre dont nous eussions à causer, et ainsi se leva pour prendre congé; je me levai aussi, apparemment avec la même indifférence, mais quand il vint me donner ce qui semblait un baiser d'adieu, j'éclatai dans une telle passion de larmes, que bien que j'eusse voulu parler, je ne le pus, et lui pressant seulement la main, parus lui donner l'adieu, mais pleurai violemment. Il en fut sensiblement ému, se rassit, et me dit nombre de choses tendres, mais me pressa encore sur la nécessité de ce qu'il avait proposé, affirmant toujours que si je refusais, il continuerait néanmoins à m'entretenir du nécessaire, mais me laissant clairement voir qu'il me refuserait le point principal, oui, même comme maîtresse; se faisant un point d'honneur de ne pas coucher avec la femme qui, autant qu'il en pouvait savoir, pourrait un jour ou l'autre venir à être la femme de son frère.
La simple perte que j'en faisais comme galant n'était pas tant mon affliction que la perte de sa personne, que j'aimais en vérité à la folie, et la perte de toutes les espérances que j'entretenais, et sur lesquelles j'avais tout fondé, de l'avoir un jour pour mari; ces choses m'accablèrent l'esprit au point qu'en somme les agonies de ma pensée me jetèrent en une grosse fièvre, et il se passa longtemps que personne dans la famille n'attendait plus de me voir vivre.
J'étais réduite bien bas en vérité, et j'avais souvent le délire; mais rien n'était si imminent pour moi que la crainte où j'étais de dire dans mes rêveries quelque chose qui pût lui porter préjudice. J'étais aussi tourmentée dans mon esprit par le désir de le voir, et lui tout autant par celui de me voir, car il m'aimait réellement avec la plus extrême passion; mais cela ne put se faire; il n'y eut pas le moindre moyen d'exprimer ce désir d'un côté ou de l'autre. Ce fut près de cinq semaines que je gardai le lit; et quoique la violence de ma fièvre se fût apaisée au bout de trois semaines, cependant elle revint par plusieurs fois; et les médecins dirent à deux ou trois reprises qu'il ne pouvaient plus rien faire pour moi, et qu'il fallait laisser agir la nature et la maladie; au bout de cinq semaines, je me trouvai mieux, mais si faible, si changée, et je me remettais si lentement que les médecins craignirent que je n'entrasse en maladie de langueur; et ce qui fut mon plus grand ennui, ils exprimèrent l'avis que mon esprit était accablé, que quelque chose me tourmentait, et qu'en somme j'étais amoureuse. Là-dessus toute la maison se mit à me presser de dire si j'étais amoureuse ou non, et de qui; mais, comme bien je pouvais, je niai que je fusse amoureuse de personne.
Ils eurent à cette occasion une picoterie sur mon propos un jour pendant qu'ils étaient à table, qui pensa mettre toute la famille en tumulte. Ils se trouvaient être tous à table, à l'exception du père; pour moi, j'étais malade, et dans ma chambre; au commencement de la conversation, la vieille dame qui m'avait envoyé d'un plat à manger, pria sa servante de monter me demander si j'en voulais davantage; mais la servante redescendit lui dire que je n'avais pas mangé la moitié de ce qu'elle m'avait envoyé déjà.
– Hélas! dit la vieille dame, la pauvre fille! Je crains bien qu'elle ne se remette jamais.
– Mais, dit le frère aîné, comment Mme Betty pourrait-elle se remettre, puisqu'on dit qu'elle est amoureuse?
– Je n'en crois rien, dit la vieille dame.
– Pour moi, dit la sœur aînée, je ne sais qu'en dire; on a fait un tel vacarme sur ce qu'elle était si jolie et si charmante, et je ne sais quoi, et tout cela devant elle, que la tête de la péronnelle, je crois, en a été tournée, et qui sait de quoi elle peut être possédée après de telles façons? pour ma part, je ne sais qu'en penser.
– Pourtant, ma sœur, il faut reconnaître qu'elle est très jolie, dit le frère aîné.
– Oui certes, et infiniment plus jolie que toi, ma sœur, dit Robin, et voilà ce qui te mortifie.
– Bon, bon, là n'est pas la question, dit sa sœur; la fille n'est pas laide, et elle le sait bien; on n'a pas besoin de le lui répéter pour la rendre vaniteuse.
– Nous ne disons pas qu'elle est vaniteuse, repart le frère aîné, mais qu'elle est amoureuse; peut-être qu'elle est amoureuse de soi-même: il paraît que mes sœurs ont cette opinion.
– Je voudrais bien qu'elle fût amoureuse de moi, dit Robin, je la tuerais vite de peine.
– Que veux-tu dire par là, fils? dit la vieille dame; comment peux-tu parler ainsi?
– Mais, madame, dit encore Robin fort honnêtement, pensez-vous que je laisserais la pauvre fille mourir d'amour, et pour moi, qu'elle a si près de sa main pour le prendre?
– Fi, mon frère, dit la sœur puînée, comment peux-tu parler ainsi? Voudrais-tu donc prendre une créature qui ne possède pas quatre sous vaillants au monde?
– De grâce, mon enfant, dit Robin, la beauté est une dot et la bonne humeur en plus est une double dot; je te souhaiterais pour la tienne le demi-fonds qu'elle a des deux.
De sorte qu'il lui ferma la bouche du coup.
– Je découvre, dit la sœur aînée, que si Betty n'est pas amoureuse, mon frère l'est; je m'étonne qu'il ne s'en soit pas ouvert à Betty: je gage qu'elle ne dira pas NON.
– Celles qui cèdent quand elles sont priées, dit Robin, sont à un pas devant celles qui ne sont jamais priées de céder, et à deux pas devant celles qui cèdent avant que d'être priées, et voilà une réponse pour toi, ma sœur.
Ceci enflamma la sœur, et elle s'enleva de colère et dit que les choses en étaient venues à un point tel qu'il était temps que la donzelle (c'était moi) fût mise hors de la famille, et qu'excepté qu'elle n'était point en état d'être jetée à la porte, elle espérait que son père et sa mère n'y manqueraient pas, sitôt qu'on pourrait la transporter.
Robin répliqua que c'était l'affaire du maître et de la maîtresse de la maison, qui n'avaient pas de leçons à recevoir d'une personne d'aussi peu de jugement que sa sœur aînée.
Tout cela courut beaucoup plus loin: la sœur gronda, Robin moqua et railla, mais la pauvre Betty y perdit extrêmement de terrain dans la famille. On me le raconta et je pleurai de tout cœur, et la vieille dame monta me voir, quelqu'un lui ayant dit à quel point je m'en tourmentais. Je me plaignis à elle qu'il était bien dur que les docteurs donnassent sur moi un tel jugement pour lequel ils n'avaient point de cause, et que c'était encore plus dur si on considérait la situation où je me trouvais dans la famille; que j'espérais n'avoir rien fait pour diminuer son estime pour moi ou donner aucune occasion à ce chamaillis entre ses fils et ses filles, et que j'avais plus grand besoin de penser à ma bière que d'être en amour, et la suppliai de ne pas me laisser souffrir en son opinion pour les erreurs de quiconque, excepté les miennes.
Elle fut sensible à la justesse de ce que je disais, mais me dit que puisqu'il y avait eu une telle clameur entre eux, et que son fils cadet jacassait de ce train, elle me priait d'avoir assez confiance en elle pour lui répondre bien sincèrement à une seule question. Je lui dis que je le ferais et avec la plus extrême simplicité et sincérité. Eh bien, alors, la question était: Y avait-il eu quelque chose entre son fils Robert et moi? Je lui dis avec toutes les protestations de sincérité que je pus faire et bien pouvais-je les faire, qu'il n'y avait rien et qu'il n'y avait jamais rien eu; je lui dis que M. Robert avait plaisanté et jacassé, comme elle savait que c'était sa manière, et que j'avais toujours pris ses paroles à la façon que je supposais qu'il les entendait, pour un étrange discours en l'air sans aucune signification, et lui assurai qu'il n'avait pas passé la moindre syllabe de ce qu'elle voulait dire entre nous, et que ceux qui l'avaient insinué m'avaient fait beaucoup de tort à moi et n'avaient rendu aucun service à M. Robert.
La vieille dame fût pleinement satisfaite et me baisa, me consola et me parla gaiement, me recommanda d'avoir bien soin de ma santé et de ne me laisser manquer de rien, et ainsi prit congé; mais quand elle redescendit, elle trouva le frère avec ses sœurs aux prises; elles étaient irritées jusqu'à la fureur, parce qu'il leur reprochait d'être vilaines, de n'avoir jamais eu de galants, de n'avoir jamais été priées d'amour, et d'avoir l'effronterie presque de le faire les premières, et mille choses semblables; il leur opposait, en raillant, Mme Betty, comme elle était jolie, comme elle avait bon caractère, comme elle chantait mieux qu'elles deux et dansait mieux, et combien elle était mieux faite, en quoi faisant il n'omettait pas de chose déplaisante qui pût les vexer. La vieille dame descendit au beau milieu de la querelle et, pour l'arrêter, leur dit la conversation qu'elle avait eue avec moi et comment j'avais répondu qu'il n'y avait rien entre M. Robert et moi.
– Elle a tort là-dessus, dit Robin, car s'il n'y avait pas tant de choses entre nous, nous serions plus près l'un de l'autre que nous ne le sommes; je lui ai dit que je l'aimais extraordinairement, dit-il, mais je n'ai jamais pu faire croire à la friponne que je parlais sérieusement.
– Et je ne sais comment tu l'aurais pu, dit sa mère, il n'y a pas de personne de bon sens qui puisse te croire sérieux de parler ainsi à une pauvre fille dont tu connais si bien la position. Mais, de grâce, mon fils, ajoute-t-elle, puisque tu nous dis que tu n'as pu lui faire croire que tu parlais sérieusement, qu'en devons-nous croire, nous? Car tu cours tellement à l'aventure dans tes discours, que personne ne sait si tu es sérieux ou si tu plaisantes; mais puisque je découvre que la fille, de ton propre aveu, a répondu sincèrement, je voudrais que tu le fisses aussi, en me disant sérieusement pour que je sois fixée: Y a-t-il quelque chose là-dessous ou non? Es-tu sérieux ou non? Es-tu égaré, en vérité, ou non? C'est une question grave, et je voudrais bien que nous fussions satisfaites sur ce point.
– Par ma foi, madame, dit Robin, il ne sert de rien dorer la chose ou d'en faire plus de mensonges: je suis sérieux autant qu'un homme qui s'en va se faire pendre. Si Mme Betty voulait dire qu'elle m'aime et qu'elle veut bien m'épouser, je la prendrais demain matin à jeun, et je dirais: «Je la tiens», au lieu de manger mon déjeuner.
– Alors, dit la mère, j'ai un fils de perdu – et elle le dit d'un ton bien lugubre, comme une qui en fût très affligée.
– J'espère que non, madame, dit Robin: il n'y a pas d'homme perdu si une honnête femme le retrouve.
– Mais, mon enfant, dit la vieille dame, c'est une mendiante!
– Mais alors, madame, elle a d'autant plus besoin de charité, dit Robin; je l'ôterai de dessus les bras de la paroisse, et elle et moi nous irons mendier ensemble.
– C'est mal de plaisanter avec ces choses, dit la mère.
– Je ne plaidante pas, madame, dit Robin: nous viendrons implorer votre pardon, madame, et votre bénédiction, madame, et celle de mon père.
– Tout ceci est hors de propos, fils, dit la mère; si tu es sérieux, tu es perdu.
– J'ai bien peur que non, dit-il, car j'ai vraiment peur qu'elle ne veuille pas me prendre; après toutes les criailleries de mes sœurs, je crois que je ne parviendrai jamais à l'y persuader.
– Voilà bien d'une belle histoire, elle n'est pas déjà partie si loin; Mme Betty n'est point une sotte, dit la plus jeune sœur, penses-tu qu'elle a appris à dire NON mieux que le reste du monde?
– Non, madame Bel-Esprit, dit Robin, en effet, Mme Betty n'est point une sotte, mais Mme Betty peut être engagée d'une autre manière, et alors quoi?
– Pour cela, dit la sœur aînée, nous ne pouvons rien en dire, mais à qui donc serait-elle engagée? Elle ne sort jamais; il faut bien que ce soit entre vous.
– Je n'ai rien à répondre là-dessus, dit Robin, j'ai été suffisamment examiné; voici mon frère, s'il faut bien que ce soit entre nous, entreprenez-le à son tour.
Ceci piqua le frère aîné au vif, et il en conclut que Robin avait découvert quelque chose, toutefois il se garda de paraître troublé:
– De grâce, dit-il, ne va donc pas faire passer tes histoires à mon compte; je ne trafique pas de ces sortes de marchandises; je n'ai rien à dire à aucune Mme Betty dans la paroisse.
Et, là-dessus, il se leva et décampa.
– Non, dit la sœur aînée, je me fais forte de répondre pour mon frère, il connaît mieux le monde.
Ainsi se termina ce discours, qui laissait le frère aîné confondu; il conclut que son frère avait tout entièrement découvert, et se mit à douter si j'y avais ou non pris part; mais, malgré toute sa subtilité, il ne put parvenir à me joindre; enfin, il tomba dans un tel embarras, qu'il en pensa désespérer et résolut qu'il me verrait quoiqu'il en advînt. En effet, il s'y prit de façon qu'un jour, après dîner, guettant sa sœur aînée jusqu'à ce qu'il la vît monter l'escalier, il court après elle.
– Écoute, ma sœur, dit-il, où donc est cette femme malade? Est-ce qu'on ne peut pas la voir?
– Si, dit la sœur, je crois que oui; mais laisse-moi d'abord entrer un instant, et puis je te le dirai.
Ainsi elle courut jusqu'à ma porte et m'avertit, puis elle lui cria:
– Mon frère, dit-elle, tu peux rentrer s'il te plaît.
Si bien qu'il entra, semblant perdu dans la même sorte de fantaisie:
– Eh bien, dit-il à la porte, en entrant, où est donc cette personne malade qui est amoureuse? Comment vous trouvez-vous, madame Betty?
J'aurais voulu me lever de ma chaise, mais j'étais si faible que je ne le pus pendant un bon moment; et il le vit bien, et sa sœur aussi, et elle dit:
– Allons, n'essayez pas de vous lever, mon frère ne désire aucune espèce de cérémonie, surtout maintenant que vous êtes si faible.
– Non, non, madame Betty, je vous en prie, restez assise tranquillement, dit-il, – et puis s'assied sur une chaise, droit en face de moi, où il parut être extraordinairement gai.
Il nous tint une quantité de discours vagues, à sa sœur et à moi; parfois à propos d'une chose, parfois à propos d'une autre, à seule fin de l'amuser, et puis de temps en temps revenait à la vieille histoire.
– Pauvre madame Betty, dit-il, c'est une triste chose que d'être amoureuse; voyez, cela vous a bien tristement affaiblie.
Enfin je parlai un peu.
– Je suis heureuse de vous voir si gai, monsieur, dis-je, mais je crois que le docteur aurait pu trouver mieux à faire que de s'amuser aux dépens de ses patients; si je n'avais eu d'autre maladie, je me serais trop bien souvenue du proverbe pour avoir souffert qu'il me rendît visite.
– Quel proverbe? dit-il; quoi?
Quand amour est en l'âme,
Le docteur est un âne.
Est-ce que c'est celui-là, madame Betty?
Je souris et ne dis rien.
– Oui-dà! dit-il, je crois que l'effet a bien prouvé que la cause est d'amour; car il semble que le docteur vous ait rendu bien peu de service; vous vous remettez très lentement, je soupçonne quelque chose là-dessous, madame; je soupçonne que vous soyez malade du mal des incurables.
Je souris et dis: «Non, vraiment, monsieur, ce n'est point du tout ma maladie.»
Nous eûmes abondance de tels discours, et parfois d'autres qui n'avaient pas plus de signification; d'aventure il me demanda de leur chanter une chanson; sur quoi je souris et dis que mes jours de chansons étaient passés. Enfin il me demanda si je voulais qu'il me jouât de la flûte; sa sœur dit qu'elle croyait que ma tête ne pourrait le supporter; je m'inclinai et dis:
– Je vous prie, madame, ne vous y opposez pas; j'aime beaucoup la flûte.
Alors sa sœur dit: «Eh bien, joue alors, mon frère.» Sur quoi il tira de sa poche la clef de son cabinet:
– Chère sœur, dit-il, je suis bien paresseux; je te prie d'aller jusque-là me chercher ma flûte; elle est dans tel tiroir (nommant un endroit où il était sûr qu'elle n'était point, afin qu'elle pût mettre un peu de temps à la recherche).
Sitôt qu'elle fut partie, il me raconta toute l'histoire du discours de son frère à mon sujet, et de son inquiétude qui était la cause de l'invention qu'il avait faite de cette visite. Je l'assurai que je n'avais jamais ouvert la bouche, soit à son frère, soit à personne d'autre; je lui dis l'horrible perplexité où j'étais; que mon amour pour lui, et la proposition qu'il m'avait faite d'oublier cette affection et de la transporter sur un autre, m'avaient abattue; et que j'avais mille fois souhaité de mourir plutôt que de guérir et d'avoir à lutter avec les mêmes circonstances qu'avant; j'ajoutai que je prévoyais qu'aussitôt remise je devrais quitter la famille, et que, pour ce qui était d'épouser son frère, j'en abhorrais la pensée, après ce qui s'était passé entre nous, et qu'il pouvait demeurer persuadé que je ne reverrais jamais son frère à ce sujet. Que s'il voulait briser tous ses vœux et ses serments et ses engagements envers moi, que cela fut entre sa conscience et lui-même; mais il ne serait jamais capable de dire que moi, qu'il avait persuadée de se nommer sa femme, et qui lui avais donné la liberté de faire usage de moi comme d'une femme, je ne lui avais pas été fidèle comme doit l'être une femme, quoi qu'il pût être envers moi.
Il allait répondre et avait dit qu'il était fâché de ne pouvoir me persuader, et il allait en dire davantage, mais il entendit sa sœur qui revenait, et je l'entendis aussi bien; et pourtant je m'arrachai ces quelques mots en réponse, qu'on ne pourrait jamais me persuader d'aimer un frère et d'épouser l'autre. Il secoua la tête et dit: «Alors je suis perdu.» Et sur ce point sa sœur entra dans la chambre et lui dit qu'elle ne pouvait trouver la flûte. «Eh bien, dit-il gaiement, cette paresse ne sert de rien», puis se lève et s'en va lui-même pour la chercher, mais revient aussi les mains vides, non qu'il n'eût pu la trouver, mais il n'avait nulle envie de jouer; et d'ailleurs le message qu'il avait donné à sa sœur avait trouvé son objet d'autre manière; car il désirait seulement me parler, ce qu'il avait fait, quoique non pas grandement à sa satisfaction.
Il se passa, peu de semaines après, que je pus aller et venir dans la maison, comme avant, et commençai à me sentir plus forte; mais je continuai d'être mélancolique et renfermée, ce qui surprit toute la famille, excepté celui qui en savait la raison; toutefois ce fut longtemps avant qu'il y prît garde, et moi, aussi répugnante à parler que lui, je me conduisis avec tout autant de respect, mais jamais ne proposai de dire un mot en particulier en quelque manière que ce fût; et ce manège dura seize ou dix-sept semaines; de sorte qu'attendant chaque jour d'être renvoyée de la famille, par suite du déplaisir qu'ils avaient pris sur un autre chef en quoi je n'avais point de faute, je n'attendais rien de plus de ce gentilhomme, après tous ses vœux solennels, que ma perte et mon abandon.
À la fin je fis moi-même à la famille une ouverture au sujet de mon départ; car un jour que la vieille dame me parlait sérieusement de ma position et de la pesanteur que la maladie avait laissée sur mes esprits:
– Je crains, Betty, me dit la vieille dame, que ce que je vous ai confié au sujet de mon fils n'ait eu sur vous quelque influence et que vous ne soyez mélancolique à son propos; voulez-vous, je vous prie, me dire ce qu'il en est, si toutefois ce n'est point trop de liberté? car pour Robin, il ne fait que se moquer et plaisanter quand je lui en parle.
– Mais, en vérité, madame, dis-je, l'affaire en est où je ne voudrais pas qu'elle fût, et je serai entièrement sincère avec vous, quoi qu'il m'en advienne. Monsieur Robert m'a plusieurs fois proposé le mariage, ce que je n'avais aucune raison d'attendre, regardant ma pauvre condition; mais je lui ai toujours résisté, et cela peut-être avec des termes plus positifs qu'il ne me convenait, eu égard au respect que je devrais avoir pour toute branche de votre famille; mais, dis-je, madame, je n'aurais jamais pu oublier à ce point les obligations que je vous ai, et à toute votre maison, et souffrir de consentir à une chose que je savais devoir vous être nécessairement fort désobligeante, et je lui ai dit positivement que jamais je n'entretiendrais une pensée de cette sorte, à moins d'avoir votre consentement, et aussi celui de son père, à qui j'étais liée par tant d'invincibles obligations.
– Et ceci est-il possible, madame Betty? dit la vieille dame. Alors vous avez été bien plus juste envers nous que nous ne l'avons été pour vous; car nous vous avons tous regardée comme une espèce de piège dressé contre mon fils; et j'avais à vous faire une proposition au sujet de votre départ, qui était causé par cette crainte; mais je n'en avais pas fait encore mention, parce que je redoutais de trop vous affliger et de vous abattre de nouveau; car nous avons encore de l'estime pour vous, quoique non pas au point de la laisser tourner à la ruine de mon fils; mais s'il en est comme vous dites, nous vous avons tous fait grand tort.
– Pour ce qui est de la vérité de ce que j'avance, madame, dis-je, je vous en remets à votre fils lui-même: s'il veut me faire quelque justice, il vous dira l'histoire tout justement comme je l'ai dite.
Voilà la vieille dame partie chez ses filles, et leur raconte toute l'histoire justement comme je la lui avais dite, et vous pensez bien qu'elles en furent surprises comme je croyais qu'elles le seraient; l'une dit qu'elle ne l'aurait jamais cru; l'autre, que Robin était un sot; une autre dit qu'elle n'en croyait pas un mot, et qu'elle gagerait que Robin raconterait l'histoire d'autre façon; mais la vieille dame, résolue à aller au fond des choses, avant que je pusse avoir la moindre occasion de faire connaître à son fils ce qui s'était passé, résolut aussi de parler à son fils sur-le-champ, et le fit chercher, car il n'était allé qu'à la maison d'un avocat, en ville, et, sur le message, revint aussitôt.
Dès qu'il arriva, car elles étaient toutes ensemble:
– Assieds-toi, Robin, dit la vieille dame, il faut que je cause un peu avec toi.
– De tout mon cœur, madame, dit Robin, l'air très gai; j'espère qu'il s'agit d'une honnête femme pour moi, car je suis bien en peine là-dessus.
– Comment cela peut-il être? dit sa mère: n'as-tu pas dit que tu étais résolu à prendre Mme Betty?
– Tout juste, madame, dit Robin, mais il y a quelqu'un qui interdit les bans.
– Interdit les bans? qui cela peut-il être?
– Point d'autre que Mme Betty elle-même, dit Robin.
– Comment, dit sa mère, lui as-tu donc posé la question?
– Oui vraiment, madame, dit Robin, je l'ai attaquée en forme cinq fois depuis qu'elle a été malade, et j'ai été repoussé; la friponne est si ferme qu'elle ne veut ni capituler ni céder à aucuns termes, sinon tels que je ne puis effectivement accorder.
– Explique-toi, dit la mère, car je suis surprise, je ne te comprends pas; j'espère que tu ne parles pas sérieusement.
– Mais, madame, dit-il, le cas est assez clair en ce qui me concerne: il s'explique de lui-même; elle ne veut pas de moi – voilà ce qu'elle dit – n'est-ce pas assez clair? Je crois que c'est clair, vraiment, et suffisamment pénible aussi.
– Oui, mais, dit la mère, tu parles de conditions que tu ne peux accorder; quoi? Veut-elle un contrat? Ce que tu lui apporteras doit être selon sa dot; qu'est-ce qu'elle t'apporte?
– Oh! pour la fortune, dit Robin, elle est assez riche; je suis satisfait sur ce point; mais c'est moi qui ne suis pas capable d'accomplir ses conditions, et elle est décidée de ne pas me prendre avant qu'elles soient remplies.
Ici les sœurs interrompirent.
– Madame, dit la sœur puînée, il est impossible d'être sérieux avec lui; il ne répondra jamais directement à rien; vous feriez mieux de le laisser en repos, et de n'en plus parler; vous savez assez comment disposer d'elle pour la mettre hors de son chemin.
Robin fut un peu échauffé par l'impertinence de sa sœur, mais il la joignit en un moment.
– Il y a deux sortes de personnes, madame, dit-il, en se tournant vers sa mère, avec lesquelles il est impossible de discuter: c'est une sage et une sotte; il est un peu dur pour moi d'avoir à lutter à la fois contre les deux.
La plus jeune sœur s'entremit ensuite.
– Nous devons être bien sottes, en effet, dit-elle, dans l'opinion de mon frère, pour qu'il pense nous faire croire qu'il a sérieusement demandé à Mme Betty de l'épouser et qu'elle l'a refusé.
– «Tu répondras, et tu ne répondras point», a dit Salomon, répliqua son frère; quand ton frère a dit qu'il ne lui avait pas demandé moins de cinq fois, et qu'elle l'avait fermement refusé, il me semble qu'une plus jeune sœur n'a pas à douter de sa véracité, quand sa mère ne l'a point fait.
– C'est que ma mère, vois-tu, n'a pas bien compris, dit la seconde sœur.
– Il y a quelque différence, dit Robin, entre demander une explication et me dire qu'elle ne me croit pas.
– Eh bien, mais, fils, dit la vieille dame, si tu es disposé à nous laisser pénétrer dans ce mystère, quelles étaient donc ces conditions si dures?
– Oui, madame, dit Robin, je l'eusse fait dès longtemps, si ces fâcheuses ici ne m'avaient harcelé par manière d'interruption. Les conditions sont que je vous amène, vous et mon père, à y consentir, sans quoi elle proteste qu'elle ne me verra plus jamais à ce propos; et ce sont des conditions, comme je l'ai dit, que je suppose que je ne pourrai jamais remplir; j'espère que mes ardentes sœurs sont satisfaites maintenant, et qu'elles vont un peu rougir.
Cette réponse fut surprenante pour elles toutes, quoique moins pour la mère, à cause de ce que je lui avais dit; pour les filles, elles demeurèrent muettes longtemps; mais la mère dit, avec quelque passion:
– Eh bien, j'avais déjà entendu ceci, mais je ne pouvais le croire; mais s'il en est ainsi, nous avons toutes fait tort à Betty, et elle s'est conduite mieux que je ne l'espérais.
– Oui, vraiment, dit la sœur aînée, s'il en est ainsi, elle a fort bien agi, en vérité.
– Il faut bien avouer, dit la mère, que ce n'est point sa faute à elle s'il a été assez sot pour se le mettre dans l'esprit; mais de lui avoir rendu une telle réponse montre plus de respect pour nous que je ne saurais l'exprimer; j'en estimerai la fille davantage, tant que je la connaîtrai.
– Mais non pas moi, dit Robin, à moins que vous donniez votre consentement.
– Pour cela, j'y réfléchirai encore, dit la mère; je t'assure que, s'il n'y avait pas bien d'autres objections, la conduite qu'elle a eue m'amènerait fort loin sur le chemin du consentement.
– Je voudrais bien qu'elle vous amenât jusqu'au bout, dit Robin: si vous aviez autant souci de me rendre heureux que de me rendre riche, vous consentiriez bientôt.
– Mais voyons, Robin, dit la mère encore, es-tu réellement sérieux? as-tu vraiment envie de l'avoir?
– Réellement, madame, dit Robin, je trouve dur que vous me questionniez encore sur ce chapitre; je ne dis pas que je l'aurai: comment pourrais-je me résoudre là-dessus puisque vous voyez bien que je ne pourrai l'avoir sans votre consentement? mais je dis ceci, et je suis sérieux, que je ne prendrai personne d'autre, si je me puis aider: «Betty ou personne», – voilà ma devise! et le choix entre les deux est aux soins de votre cœur, madame, pourvu seulement que mes sœurs ici, qui ont si bon naturel, ne prennent point part au vote.
Tout ceci était affreux pour moi, car la mère commençait à céder, et Robin la serrait de près. D'autre part, elle tint conseil avec son fils aîné, et il usa de tous les arguments du monde pour lui persuader de consentir, alléguant l'amour passionné que son frère me portait, et le généreux respect que j'avais montré pour la famille en refusant mes avantages sur un délicat point d'honneur, et mille choses semblables. Et quant au père, c'était un homme tout tracassé par les affaires publiques, occupé à faire valoir son argent, bien rarement chez lui, fort soucieux de ses affaires, et qui laissait toutes ces choses aux soins de sa femme.
Vous pouvez facilement penser que le secret étant, comme ils croyaient, découvert, il n'était plus si difficile ni si dangereux pour le frère aîné, que personne ne soupçonnait de rien, d'avoir accès plus libre jusqu'à moi; oui, et même sa mère lui proposa de causer avec Mme Betty, ce qui était justement ce qu'il désirait:
– Il se peut, fils, dit-elle, que tu aies plus de clartés en cette affaire que je n'en ai, et tu jugeras si elle a montré la résolution que dit Robin, ou non.
Il ne pouvait rien souhaiter de mieux, et, feignant de céder au désir de sa mère, elle m'amena vers lui dans la propre chambre où elle couchait, me dit que son fils avait affaire avec moi à sa requête, puis nous laissa ensemble, et il ferma la porte sur elle.
Il revint vers moi, me prit dans ses bras et me baisa très tendrement, mais me dit que les choses en étaient venues à leur crise, et que j'avais pouvoir de me rendre heureuse ou infortunée ma vie durant; que si je ne pouvais m'accorder à son désir, nous serions tous deux perdus. Puis il me dit toute l'histoire passée entre Robin, comme il l'appelait, sa mère, ses sœurs et lui-même.
– Et maintenant, ma chère enfant, dit-il, considérez ce que ce serait que d'épouser un gentilhomme de bonne famille, de belle fortune, avec le consentement de toute la maison, pour jouir de tout ce que le monde vous peut offrir; imaginez, d'autre part, que vous serez plongée dans la noire condition d'une femme qui a perdu sa bonne renommée; et quoique je resterai votre ami privé tant que je vivrai, toutefois, ainsi que je serais toujours soupçonné, ainsi craindrez-vous de me voir, et moi de vous reconnaître.
Il ne me laissa pas le temps de répondre, mais poursuivit ainsi:
– Ce qui s'est passé entre nous, mon enfant, tant que nous serons d'accord, peut être enterré et oublié; je resterai toujours votre ami sincère, sans nulle inclination à une intimité plus voisine quand vous deviendrez ma sœur; je vous supplie d'y réfléchir et de ne point vous opposer vous-même à votre salut et à votre prospérité: et, afin de vous assurer de ma sincérité, ajoute-t-il, je vous offre ici cinq cents livres en manière d'excuse pour les libertés que j'ai prises avec vous, et que nous regarderons, si vous voulez, comme quelques folies de nos vies passées dont il faut espérer que nous pourrons nous repentir.
Je ne puis pas dire qu'aucune de ces paroles m'eût assez émue pour me donner une pensée décisive, jusqu'enfin il me dit très clairement que si je refusais, il avait le regret d'ajouter qu'il ne saurait continuer avec moi sur le même pied qu'auparavant; que bien qu'il m'aimât autant que jamais, et que je lui donnasse tout l'agrément du monde, le sentiment de la vertu ne l'avait pas abandonné au point qu'il souffrît de coucher avec une femme à qui son frère faisait sa cour pour l'épouser; que s'il prenait congé de moi sur un refus, quoi qu'il pût faire pour ne me laisser manquer de rien, s'étant engagé d'abord à m'entretenir, pourtant je ne devais point être surprise s'il était forcé de me dire qu'il ne pouvait se permettre de me revoir, et qu'en vérité je ne pouvais l'espérer.
J'écoutai cette dernière partie avec quelques signes de surprise et de trouble, et je me retins à grand'peine de pâmer, car vraiment je l'aimais jusqu'à l'extravagance; mais il vit mon trouble, et m'engagea à réfléchir sérieusement, m'assura que c'était la seule manière de préserver notre mutuelle affection; que dans cette situation nous pourrions nous aimer en amis, avec la plus extrême passion, et avec un amour d'une parfaite pureté, libres de nos justes remords, libres des soupçons d'autres personnes; qu'il me serait toujours reconnaissant du bonheur qu'il me devait; qu'il serait mon débiteur tant qu'il vivrait, et qu'il payerait sa dette tant qu'il lui resterait le souffle.
Ainsi, il m'amena, en somme, à une espèce d'hésitation, où je me représentais tous les dangers avec des figures vives, encore forcées par mon imagination; je me voyais jetée seule dans l'immensité du monde, pauvre fille perdue, car je n'étais rien de moins, et peut-être que je serais exposée comme telle; avec bien peu d'argent pour me maintenir, sans ami, sans connaissance au monde entier, sinon en cette ville où je ne pouvais prétendre rester. Tout cela me terrifiait au dernier point, et il prenait garde à toutes occasions de me peindre ces choses avec les plus sinistres couleurs; d'autre part, il ne manquait pas de me mettre devant les yeux la vie facile et prospère que j'allais mener.
Il répondit à toutes les objections que je pouvais faire, et qui étaient tirées de son affection et de ses anciennes promesses, en me montrant la nécessité où nous étions de prendre d'autres mesures; et, quant à ses serments de mariage, le cours naturel des choses, dit-il, y avait mis fin par la grande probabilité qu'il y avait que je serais la femme de son frère avant le temps auquel se rapportaient toutes ses promesses.
Ainsi, en somme, je puis le dire, il me raisonna contre toute raison et conquit tous mes arguments, et je commençai à apercevoir le danger où j'étais et où je n'avais pas songé d'abord, qui était d'être laissée là par les deux frères, et abandonnée seule au monde pour trouver le moyen de vivre.
Ceci et sa persuasion m'arrachèrent enfin mon consentement, quoique avec tant de répugnance qu'il était bien facile de voir que j'irais à l'église comme l'ours au poteau; j'avais aussi quelques petites craintes que mon nouvel époux, pour qui, d'ailleurs, je n'avais pas la moindre affection, fût assez clairvoyant pour me demander des comptes à notre première rencontre au lit; mais soit qu'il l'eût fait à dessein ou non, je n'en sais rien, son frère aîné eut soin de le bien faire boire avant qu'il s'allât coucher, de sorte que j'eus le plaisir d'avoir un homme ivre pour compagnon de lit la première nuit. Comment il s'y prit, je n'en sais rien, mais je fus persuadée qu'il l'avait fait à dessein, afin que son frère ne pût avoir nulle notion de la différence qu'il y a entre une pucelle et une femme mariée; et, en effet, jamais il n'eut aucun doute là-dessus ou ne s'inquiéta l'esprit à tel sujet.
Il faut qu'ici je revienne un peu en arrière, à l'endroit où j'ai interrompu. Le frère aîné étant venu à bout de moi, son premier soin fut d'entreprendre sa mère; et il ne cessa qu'il ne l'eût amenée à se soumettre, passive au point de n'informer le père qu'au moyen de lettres écrites par la poste; si bien qu'elle consentit à notre mariage secret et se chargea d'arranger l'affaire ensuite avec le père.
Puis il cajola son frère, et lui persuada qu'il lui avait rendu un inestimable service, se vanta d'avoir obtenu le consentement de sa mère, ce qui était vrai, mais n'avait point été fait pour le servir, mais pour se servir soi-même; mais il le pipa ainsi avec diligence, et eut tout le renom d'un ami fidèle pour s'être débarrassé de sa maîtresse en la mettant dans les bras de son frère pour en faire sa femme. Si naturellement les hommes renient l'honneur, la justice et jusqu'à la religion, pour obtenir de la sécurité!
Il me faut revenir maintenant au frère Robin, comme nous l'appelions toujours, et qui, ayant obtenu le consentement de sa mère, vint à moi tout gonflé de la nouvelle, et m'en dit l'histoire avec une sincérité si visible que je dois avouer que je fus affligée de servir d'instrument à décevoir un si honnête gentilhomme; mais il n'y avait point de remède, il voulait me prendre, et je n'étais pas obligée de lui dire que j'étais la maîtresse de son frère, quoique je n'eusse eu d'autre moyen de l'écarter; de sorte que je m'accommodai peu à peu, et voilà que nous fûmes mariés.
La pudeur s'oppose à ce que je révèle les secrets du lit nuptial; mais rien ne pouvait être si approprié à ma situation que de trouver un mari qui eût la tête si brouillée en se mettant au lit, qu'il ne put se souvenir le matin s'il avait eu commerce avec moi ou non; et je fus obligée de le lui affirmer, quoiqu'il n'en fut rien, afin d'être assurée qu'il ne s'inquiéterait d'aucune chose.
Il n'entre guère dans le dessein de cette histoire de vous instruire plus à point sur cette famille et sur moi-même, pendant les cinq années que je vécus avec ce mari, sinon de remarquer que de lui j'eus deux enfants, et qu'il mourut au bout des cinq ans; il avait vraiment été un très bon mari pour moi, et nous avions vécu très agréablement ensemble; mais comme il n'avait pas reçu grand'chose de sa famille, et que dans le peu de temps qu'il vécut il n'avait pas acquis grand état, ma situation n'était pas belle, et ce mariage ne me profita guère. Il est vrai que j'avais conservé les billets du frère aîné où il s'engageait à me payer 500£ pour mon consentement à épouser son frère; et ces papiers, joints à ce que j'avais mis de côté sur l'argent qu'il m'avait donné autrefois, et environ autant qui me venait de mon mari, me laissèrent veuve avec près de 1 200£ en poche.
Mes deux enfants me furent heureusement ôtés de dessus les bras par le père et la mère de mon mari; et c'est le plus clair de ce qu'ils eurent de Mme Betty.
J'avoue que je n'éprouvai pas le chagrin qu'il convenait de la mort de mon mari; et je ne puis dire que je l'aie jamais aimé comme j'aurais dû le faire, ou que je répondis à la tendresse qu'il montra pour moi; car c'était l'homme le plus délicat, le plus doux et de meilleure humeur qu'une femme pût souhaiter; mais son frère, qui était si continuellement devant mes yeux, au moins pendant notre séjour à la campagne, était pour moi un appât éternel; et jamais je ne fus au lit avec mon mari, que je ne me désirasse dans les bras de son frère; et bien que le frère ne fît jamais montre d'une affection de cette nature après notre mariage, mais se conduisît justement à la manière d'un frère, toutefois il me fut impossible d'avoir les mêmes sentiments à son égard; en somme, il ne se passait pas de jour où je ne commisse avec lui adultère et inceste dans mes désirs, qui, sans doute, étaient aussi criminels que des actes.
Avant que mon mari mourût, son frère aîné se maria, et comme à cette époque nous avions quitté la ville pour habiter Londres, la vieille dame nous écrivit pour nous prier aux noces; mon mari y alla, mais je feignis d'être indisposée, et ainsi je pus rester à la maison; car, en somme, je n'aurais pu supporter de le voir donné à une autre femme, quoique sachant bien que jamais plus je ne l'aurais à moi.
J'étais maintenant, comme je l'avais été jadis, laissée libre au monde, et, étant encore jeune et jolie, comme tout le monde me le disait (et je le pensais bien, je vous affirme), avec une suffisante fortune en poche, je ne m'estimais pas à une médiocre valeur; plusieurs marchands fort importants me faisaient la cour, et surtout un marchand de toiles, qui se montrait très ardent, et chez qui j'avais pris logement après la mort de mon mari, sa sœur étant de mes amies; là, j'eus toute liberté et occasion d'être gaie et de paraître dans la société que je pouvais désirer, n'y ayant chose en vie plus folle et plus gaie que la sœur de mon hôte, et non tant maîtresse de sa vertu que je le pensais d'abord; elle me fit entrer dans un monde de société extravagante, et même emmena chez elle différentes personnes, à qui il ne lui déplaisait pas de se montrer obligeante, pour voir sa jolie veuve. Or, ainsi que la renommée et les sots composent une assemblée, je fus ici merveilleusement adulée; j'eus abondance d'admirateurs, et de ceux qui se nomment amants; mais dans l'ensemble je ne reçus pas une honnête proposition; quant au dessein qu'ils entretenaient tous, je l'entendais trop bien pour me laisser attirer dans des pièges de ce genre. Le cas était changé pour moi. J'avais de l'argent dans ma poche, et n'avais rien à leur dire. J'avais été prise une fois à cette piperie nommée amour, mais le jeu était fini; j'étais résolue maintenant à ce qu'on m'épousât, sinon rien, et à être bien mariée ou point du tout.
J'aimais, en vérité, la société d'hommes enjoués et de gens d'esprit, et je me laissais souvent divertir par eux, de même que je m'entretenais avec les autres; mais je trouvai, par juste observation, que les hommes les plus brillants apportaient le message le plus terne, je veux dire le plus terne pour ce que je visais; et, d'autre part, ceux qui venaient avec les plus brillantes propositions étaient des plus ternes et déplaisants qui fussent au monde.
Je n'étais point si répugnante à un marchand, mais alors je voulais avoir un marchand, par ma foi, qui eût du gentilhomme, et que lorsqu'il prendrait l'envie à mon mari de me mener à la cour ou au théâtre, il sût porter l'épée, et prendre son air de gentilhomme tout comme un autre, et non pas sembler d'un croquant qui garde à son justaucorps la marque des cordons de tablier ou la marque de son chapeau à la perruque, portant son métier au visage, comme si on l'eût pendu à son épée, au lieu de la lui attacher.
Eh bien, je trouvai enfin cette créature amphibie, cette chose de terre et d'eau qu'on nomme gentilhomme marchand; et comme juste punition de ma folie, je fus prise au piège que je m'étais pour ainsi dire tendu.
C'était aussi un drapier, car bien que ma camarade m'eût volontiers entreprise à propos de son frère, il se trouva, quand nous en vînmes au point, que c'était pour lui servir de maîtresse, et je restais fidèle à cette règle qu'une femme ne doit jamais se laisser entretenir comme maîtresse, si elle a assez d'argent pour se faire épouser.
Ainsi ma vanité, non mes principes, mon argent, non ma vertu, me maintenaient dans l'honnêteté, quoique l'issue montra que j'eusse bien mieux fait de me laisser vendre par ma camarade à son frère que de m'être vendue à un marchand qui était bélître, gentilhomme, boutiquier et mendiant tout ensemble.
Mais je fus précipitée par le caprice que j'avais d'épouser un gentilhomme à me ruiner de la manière la plus grossière que femme au monde; car mon nouveau mari, découvrant d'un coup une masse d'argent, tomba dans des dépenses si extravagantes, que tout ce que j'avais, joint à ce qu'il avait, n'y eût point tenu plus d'un an.
Il eut infiniment de goût pour moi pendant environ le quart d'une année, et le profit que j'en tirai fut d'avoir le plaisir de voir dépenser pour moi une bonne partie de mon argent.
– Allons, mon cœur, me dit-il une fois, voulez-vous venir faire un tour à la campagne pendant huit jours?
– Eh, mon ami, dis-je, où donc voulez-vous aller?
– Peu m'importe où, dit-il, mais j'ai l'envie de me pousser de la qualité pendant une semaine; nous irons à Oxford, dit-il.
– Et comment irons-nous? dis-je; je ne sais point monter à cheval, et c'est trop loin pour un carrosse.
– Trop loin! dit-il – nul endroit n'est trop loin pour un carrosse à six chevaux. Si je vous emmène, je veux que vous voyagiez en duchesse.
– Hum! dis-je, mon ami, c'est une folie; mais puisque vous en avez l'envie, je ne dis plus rien.
Eh bien, le jour fut fixé; nous eûmes un riche carrosse, d'excellents chevaux, cocher, postillon, et deux laquais en très belles livrées, un gentilhomme à cheval, et un page, avec une plume au chapeau, sur un autre cheval; tout le domestique lui donnait du Monseigneur, et moi, j'étais Sa Grandeur la Comtesse; et ainsi nous fîmes le voyage d'Oxford, et ce fut une excursion charmante; car pour lui rendre son dû, il n'y avait pas de mendiant au monde qui sût mieux que mon mari trancher du seigneur. Nous visitâmes toutes les curiosités d'Oxford et nous parlâmes à deux ou trois maîtres des collèges de l'intention où nous étions d'envoyer à l'Université un neveu qui avait été laissé aux soins de Sa Seigneurie, en leur assurant qu'ils seraient désignés comme tuteurs; nous nous divertîmes à berner divers pauvres écoliers de l'espoir de devenir pour le moins chapelains de Sa Seigneurie et de porter l'échappe; et ayant ainsi vécu en qualité pour ce qui était au moins de la dépense, nous nous dirigeâmes vers Northampton, et en somme nous rentrâmes au bout de douze jours, la chanson nous ayant coûté 93£.
La vanité est la plus parfaite qualité d'un fat; mon mari avait cette excellence de n'attacher aucune valeur à l'argent. Comme son histoire, ainsi que vous pouvez bien penser, est de très petit poids, il suffira de vous dire qu'au bout de deux ans et quart il fit banqueroute, fut envoyé dans une maison de sergent, ayant été arrêté sur un procès trop gros pour qu'il pût donner caution; de sorte qu'il m'envoya chercher pour venir le voir.
Ce ne fut pas une surprise pour moi, car j'avais prévu depuis quelque temps que tout s'en irait à vau-l'eau, et j'avais pris garde de mettre en réserve, autant que possible, quelque chose pour moi; mais lorsqu'il me fit demander, il se conduisit bien mieux que je n'espérais, me dit tout net qu'il avait agi en sot et s'était laissé prendre où il eût pu faire résistance; qu'il prévoyait maintenant qu'il ne pourrait plus parvenir à rien; que par ainsi il me priait de rentrer et d'emporter dans la nuit tout ce que j'avais de valeurs dans la maison, pour le mettre en sûreté; et ensuite il me dit que si je pouvais emporter du magasin 100 ou 200£ de marchandises, je devais le faire.
– Seulement, dit-il, ne m'en faites rien savoir; ne me dites pas ce que vous prenez, où vous l'emportez; car pour moi, dit-il, je suis résolu à me tirer de cette maison et à m'en aller; et si vous n'entendez jamais plus parler de moi, mon amour, je vous souhaite du bonheur; Je suis fâché du tort que je vous ai fait.
Il ajouta quelques choses très gracieuses pour moi, comme je m'en allais; car je vous ai dit que c'était un gentilhomme, et ce fut tout le bénéfice que j'en eus, en ce qu'il me traita fort galamment, jusqu'à la fin, sinon qu'il dépensa tout ce que j'avais et me laissa le soin de dérober à ses créanciers de quoi manger.
Néanmoins je fis ce qu'il m'avait dit, comme bien vous pouvez penser; et ayant ainsi pris congé de lui, je ne le revis plus jamais; car il trouva moyen de s'évader hors de la maison du baillif cette nuit ou la suivante; comment, je ne le sus point, car je ne parvins à apprendre autre chose, sinon qu'il rentra chez lui à environ trois heures du matin, fit transporter le reste de ses marchandises à la Monnaie, et fermer la boutique; et, ayant levé l'argent qu'il put, il passa en France, d'où je reçus deux ou trois lettres de lui, point davantage. Je ne le vis pas quand il rentra, car m'ayant donné les instructions que j'ai dites, et moi ayant employé mon temps de mon mieux, je n'avais point d'affaire de retourner à la maison, ne sachant si je n'y serais arrêtée par les créanciers; car une commission de banqueroute ayant été établie peu à après, on aurait pu m'arrêter par ordre des commissaires. Mais mon mari s'étant désespérément échappé de chez le baillif, en se laissant tomber presque du haut de la maison sur le haut d'un autre bâtiment d'où il avait sauté et qui avait presque deux étages, en quoi il manqua de bien peu se casser le cou, il rentra et emmena ses marchandises avant que les créanciers pussent venir saisir, c'est-à-dire, avant qu'ils eussent obtenu la commission à temps pour envoyer les officiers prendre possession.
Mon mari fut si honnête envers moi, car je répète encore qu'il tenait beaucoup du gentilhomme, que dans la première lettre qu'il m'écrivit, il me fit savoir où il avait engagé vingt pièces de fine Hollande pour 30£ qui valaient plus de 90£ et joignit la reconnaissance pour aller les reprendre en payant l'argent, ce que je fis; et en bon temps j'en tirai plus de 100£, ayant eu loisir pour les détailler et les vendre à des familles privées, selon l'occasion.
Néanmoins, ceci compris et ce que j'avais mis en réserve auparavant, je trouvai, tout compte fait, que mon cas était bien changé et ma fortune extrêmement diminuée; car avec la toile de Hollande et un paquet de mousselines fines que j'avais emporté auparavant, quelque argenterie et d'autres choses, je me trouvai pouvoir à peine disposer de 500£, et ma condition était très singulière, car bien que je n'eusse pas d'enfant (j'en avais eu un de mon gentilhomme drapier, mais il était enterré), cependant j'étais une veuve fée, j'avais un mari, et point de mari, et je ne pouvais prétendre me remarier, quoique sachant assez que mon mari ne reverrait jamais l'Angleterre, dût-il vivre cinquante ans. Ainsi, dis-je, j'étais enclose de mariage, quelle que fût l'offre qu'on me fit; et je n'avais point d'ami pour me conseiller, dans la condition où j'étais, du moins à qui je pusse confier le secret de mes affaires; car si les commissaires eussent été informés de l'endroit où j'étais, ils m'eussent fait saisir et emporter tout ce que j'avais mis de côté.
Dans ces appréhensions, la première chose que je fis fut de disparaître entièrement du cercle de mes connaissances et de prendre un autre nom. Je le fis effectivement, et me rendis également à la Monnaie, où je pris logement en un endroit très secret, m'habillai de vêtements de veuve, et pris le nom de Mme Flanders.
J'y fis la connaissance d'une bonne et modeste sorte de femme, qui était veuve aussi, comme moi, mais en meilleure condition; son mari avait été capitaine de vaisseau, et ayant eu le malheur de subir un naufrage à son retour des Indes occidentales, fut si affligé de sa perte, que bien qu'il eût la vie sauve, son cœur se brisa et il mourut de douleur; sa veuve, étant poursuivie par les créanciers, fut forcée de chercher abri à la Monnaie. Elle eut bientôt réparé ses affaires avec l'aide de ses amis, et reprit sa liberté; et trouvant que j'était là plutôt afin de vivre cachée que pour échapper à des poursuites, elle m'invita à rentrer avec elle dans sa maison jusqu'à ce que j'eusse quelque vue pour m'établir dans le monde à ma volonté; d'ailleurs me disant qu'il y avait dix chances contre une pour que quelque bon capitaine de vaisseau se prît de caprice pour moi et me fît la cour en la partie de la ville où elle habitait.
J'acceptai son offre et je restai avec elle la moitié d'une année; j'y serais restée plus longtemps si dans l'intervalle ce qu'elle me proposait ne lui était survenu, c'est-à-dire qu'elle se maria, et fort à son avantage. Mais si d'autres fortunes étaient en croissance, la mienne semblait décliner, et je ne trouvais rien sinon deux ou trois bossemans et gens de cette espèce. Pour les commandants, ils étaient d'ordinaire de deux catégories: 1° tels qui, étant en bonnes affaires, c'est-à-dire, ayant un bon vaisseau, ne se décidaient qu'à un mariage avantageux; 2° tels qui, étant hors d'emploi, cherchaient une femme pour obtenir un vaisseau, je veux dire: 1° une femme qui, ayant de l'argent, leur permit d'acheter et tenir bonne part d'un vaisseau, pour encourager les partenaires, ou 2° une femme qui, si elle n'avait pas d'argent, avait du moins des amis qui s'occupaient de navigation et pouvait aider ainsi à placer un jeune homme dans un bon vaisseau. Mais je n'étais dans aucun des deux cas et j'avais l'apparence de devoir rester longtemps en panne.
Ma situation n'était pas de médiocre délicatesse. La condition où j'étais faisait que l'offre d'un bon mari m'était la chose la plus nécessaire du monde; mais je vis bientôt que la bonne manière n'était pas de se prodiguer trop facilement; on découvrit bientôt que la veuve n'avait pas de fortune, et ceci dit, on avait dit de moi tout le mal possible, bien que je fusse parfaitement élevée, bien faite, spirituelle, réservée et agréable, toutes qualités dont je m'étais parée, à bon droit ou non, ce n'est point l'affaire; mais je dis que tout cela n'était de rien sans le billon. Pour parler tout net, la veuve, disait-on, n'avait point d'argent!
Je résolus donc qu'il était nécessaire de changer de condition, et de paraître différemment en quelque autre lieu, et même de passer sous un autre nom, si j'en trouvais l'occasion.
Je communiquai mes réflexions à mon intime amie qui avait épousé un capitaine, je ne fis point de scrupule de lui exposer ma condition toute nue; mes fonds étaient bas, car je n'avais guère tiré que 540£ de la clôture de ma dernière affaire, et j'avais dépensé un peu là-dessus; néanmoins il me restait environ 400£, un grand nombre de robes très riches, une montre en or et quelques bijoux, quoique point d'extraordinaire valeur, enfin près de 30 ou 40£ de toiles dont je n'avais point disposé.
Ma chère et fidèle amie, la femme du capitaine, m'était fermement attachée, et sachant ma condition, elle me fit fréquemment des cadeaux selon que de l'argent lui venait dans les mains, et tels qu'ils représentaient un entretien complet; si bien que je ne dépensai pas de mon argent. Enfin elle me mit un projet dans la tête et me dit que si je voulais me laisser gouverner par elle, j'obtiendrais certainement un mari riche sans lui laisser lieu de me reprocher mon manque de fortune; je lui dis que je m'abandonnais entièrement à sa direction, et que je n'aurais ni langue pour parler, ni pieds pour marcher en cette affaire, qu'elle ne m'eût instruite, persuadée que j'étais qu'elle me tirerait de toute difficulté où elle m'entraînerait, ce qu'elle promit.
Le premier pas qu'elle me fit faire fut de lui donner le nom de cousine et d'aller dans la maison d'une de ses parentes à la campagne, qu'elle m'indiqua, et où elle amena son mari pour me rendre visite, où, m'appelant «sa chère cousine», elle arrangea les choses de telle sorte qu'elle et son mari tout ensemble m'invitèrent très passionnément à venir en ville demeurer avec eux, car ils vivaient maintenant en un autre endroit qu'auparavant. En second lieu elle dit à son mari que j'avais au moins 1 500£ de fortune et que j'étais assurée d'en avoir bien davantage.
Il suffisait d'en dire autant à son mari; je n'avais point à agir sur ma part, mais à me tenir coite, et attendre l'événement, car soudain le bruit courut dans tout le voisinage que la jeune veuve chez le capitaine était une fortune, qu'elle avait au moins 1 500£ et peut-être bien davantage, et que c'était le capitaine qui le disait; et si on interrogeait aucunement le capitaine à mon sujet, il ne se faisait point scrupule de l'affirmer quoiqu'il ne sût pas un mot de plus sur l'affaire que sa femme ne lui avait dit; en quoi il n'entendait malice aucune, car il croyait réellement qu'il en était ainsi. Avec cette réputation de fortune, je me trouvai bientôt comblée d'assez d'admirateurs où j'avais mon choix d'hommes; et moi, ayant à jouer un jeu subtil, il ne me restait plus rien à faire qu'à trier parmi eux tous le plus propre à mon dessein; c'est-à-dire l'homme qui semblerait le plus disposé à s'en tenir au ouï-dire sur ma fortune et à ne pas s'enquérir trop avant des détails: sinon je ne parvenais à rien, car ma condition n'admettait nulle investigation trop stricte.
Je marquai mon homme sans grande difficulté par le jugement que je fis de sa façon de me courtiser; je l'avais laissé s'enfoncer dans ses protestations qu'il m'aimait le mieux du monde, et que si je voulais le rendre heureux, il serait satisfait de tout; choses qui, je le savais, étaient fondées sur la supposition que j'étais très riche, quoique je n'en eusse soufflé mot.
Ceci était mon homme, mais il fallait le sonder à fond; c'est là qu'était mon salut, car s'il me faisait faux bond, je savais que j'étais perdue aussi sûrement qu'il était perdu s'il me prenait; et si je n'élevais quelque scrupule sur sa fortune, il risquait d'en élever sur la mienne; si bien que d'abord je feignis à toutes occasions de douter de sa sincérité et lui dis que peut-être il ne me courtisait que pour ma fortune, il me ferma la bouche là-dessus avec la tempête des protestations que j'ai dites mais je feignais de douter encore.
Un matin, il ôte un diamant de son doigt, et écrit ces mots sur le verre du châssis de ma chambre:
C'est vous que j'aime et rien que vous.
Je lus, et le priai de me prêter la bague, avec laquelle j'écrivis au-dessous:
En amour vous le dites tous.
Il reprend sa bague et écrit de nouveau:
La vertu seule est une dot.
Je la lui redemandai et j'écrivis au-dessous:
L'argent fait la vertu plutôt.
Il devint rouge comme le feu, de se sentir piqué si juste, et avec une sorte de fureur, il jura de me vaincre et écrivit encore:
J'ai mépris pour l'or, et vous aime.
J'aventurai tout sur mon dernier coup de dés en poésie, comme vous verrez, car j'écrivis hardiment sous son vers:
Je suis pauvre et n'ai que moi-même.
C'était là une triste vérité pour moi; Je ne puis dire s'il me crut ou non; je supposais alors qu'il ne me croyait point. Quoi qu'il en fût, il vola vers moi, me prit dans ses bras et me baisant ardemment et avec une passion inimaginable, il me tint serrée, tandis qu'il demandait plume et encre, m'affirmant qu'il ne pouvait plus avoir la patience d'écrire laborieusement sur cette vitre; puis tirant un morceau de papier, il écrivit encore:
Soyez mienne en tout dénuement.
Je pris sa plume et répondis sur-le-champ:
Au for, vous pensez: Elle ment.
Il me dit que c'étaient là des paroles cruelles, parce qu'elles n'étaient pas justes, et que je l'obligeais à me démentir, ce qui s'accordait mal avec la politesse, et que puisque je l'avais insensiblement engagé dans ce badinage poétique, il me suppliait de ne pas le contraindre à l'interrompre; si bien qu'il écrivit:
Que d'amour seul soient nos débats!
J'écrivis au-dessous:
Elle aime assez, qui ne hait pas.
Il considéra ce vers comme une faveur, et mit bas les armes, c'est-à-dire la plume; je dis qu'il le considéra comme une faveur, et c'en était une bien grande, s'il avait tout su; pourtant il le prit comme je l'entendais, c'est-à-dire que j'étais encline à continuer notre fleuretage, comme en vérité j'avais bonne raison de l'être, car c'était l'homme de meilleure humeur et la plus gaie, que j'aie jamais rencontré, et je réfléchissais souvent qu'il était doublement criminel de décevoir un homme qui semblait sincère; mais la nécessité qui me pressait à un établissement qui convint à ma condition m'y obligeait par autorité; et certainement son affection pour moi et la douceur de son humeur, quelque haut qu'elles parlassent contre le mauvais usage que j'en voulais faire, me persuadaient fortement qu'il subirait son désappointement avec plus de mansuétude que quelque forcené tout en feu qui n'eût eu pour le recommander que les passions qui servent à rendre une femme malheureuse. D'ailleurs, bien que j'eusse si souvent plaisanté avec lui (comme il le supposait) au sujet de ma pauvreté, cependant quand il découvrit qu'elle était véritable, il s'était fermé la route des objections, regardant que, soit qu'il eût plaisanté, soit qu'il eût parlé sérieusement, il avait déclaré qu'il me prenait sans se soucier de ma dot et que, soit que j'eusse plaisanté, soit que j'eusse parlé sérieusement, j'avais déclaré que j'étais très pauvre, de sorte qu'en un mot, je le tenais des deux côtés; et quoiqu'il pût dire ensuite qu'il avait été déçu il ne pourrait jamais dire que c'était moi qui l'avais déçu.
Il me poursuivit de près ensuite, et comme je vis qu'il n'y avait point besoin de craindre de le perdre, je jouai le rôle d'indifférente plus longtemps que la prudence ne m'eût autrement dicté; mais je considérai combien cette réserve et cette indifférence me donneraient d'avantage sur lui lorsque j'en viendrais à lui avouer ma condition, et j'en usai avec d'autant plus de prudence, que je trouvai qu'il concluait de là ou que j'avais plus d'argent, ou que j'avais plus de jugement, ou que je n'étais point d'humeur aventureuse.
Je pris un jour la liberté de lui dire qu'il était vrai que j'avais reçu de lui une galanterie d'amant, puisqu'il me prenait sans nulle enquête sur ma fortune, et que je lui retournai le compliment en m'inquiétant de la sienne plus que de raison, mais que j'espérais qu'il me permettrait quelques questions auxquelles il répondrait ou non suivant ses convenances; l'une de ces questions se rapportait à la manière dont nous vivrions et au lieu que nous habiterions, parce que j'avais entendu dire qu'il possédait une grande plantation en Virginie, et je lui dis que je ne me souciais guère d'être déportée.
Il commença dès ce discours à m'ouvrir bien volontiers toutes ses affaires et à me dire de manière franche et ouverte toute sa condition, par où je connus qu'il pouvait faire bonne figure dans le monde, mais qu'une grande partie de ses biens se composait de trois plantations qu'il avait en Virginie, qui lui rapporteraient un fort bon revenu d'environ 300£ par an, mais qui, s'il les exploitait lui-même, lui en rapportaient quatre fois plus, «Très bien, me dis-je, alors tu m'emmèneras là-bas aussitôt qu'il te plaira mais je me garderai bien de te le dire d'avance.»
Je le plaisantai sur la figure qu'il ferait en Virginie, mais je le trouvai prêt à faire tout ce que je désirerais, de sorte que je changeai de chanson; je lui dis que j'avais de fortes raisons de ne point désirer aller vivre là-bas, parce que, si ses plantations y valaient autant qu'il disait, je n'avais pas une fortune qui pût s'accorder à un gentilhomme ayant 1 200£ de revenu comme il me disait que serait son état.
Il me répondit qu'il ne me demandait pas quelle était ma fortune; qu'il m'avait dit d'abord qu'il n'en ferait rien, et qu'il tiendrait sa parole; mais que, quelle qu'elle fût, il ne me demanderait jamais d'aller en Virginie avec lui, ou qu'il n'y irait sans moi, à moins que je m'y décidasse librement.
Tout cela, comme vous pouvez bien penser, était justement conforme à mes souhaits, et en vérité rien n'eût pu survenir de plus parfaitement agréable; je continuai jusque-là à jouer cette sorte d'indifférence dont il s'étonnait souvent; et si j'avais avoué sincèrement que ma grande fortune ne s'élevait pas en tout à 400£ quand il en attendait 1 500£, pourtant je suis persuadée que je l'avais si fermement agrippé et si longtemps tenu en haleine, qu'il m'aurait prise sous les pires conditions; et il est hors de doute que la surprise fut moins grande pour lui quand il apprit la vérité qu'elle n'eut été autrement; car n'ayant pas le moindre blâme à jeter sur moi, qui avais gardé un air d'indifférence jusqu'au bout, il ne put dire une parole, sinon qu'en vérité il pensait qu'il y en aurait eu davantage; mais que quand même il y en eût moins, il ne se repentait pas de son affaire, seulement qu'il n'aurait pas le moyen de m'entretenir aussi bien qu'il l'eût désiré.
Bref, nous fûmes mariés, et moi, pour ma part, très bien mariée, car c'était l'homme de meilleure humeur qu'une femme ait eu, mais sa condition n'était pas si bonne que je le supposais, ainsi que d'autre part il ne l'avait pas améliorée autant qu'il l'espérait.
Quand nous fûmes mariés, je fus subtilement poussée à lui apporter le petit fonds que j'avais et à lui faire voir qu'il n'y en avait point davantage; mais ce fut une nécessité, de sorte que je choisis l'occasion, un jour que nous étions seuls, pour lui en parler brièvement:
– Mon ami, lui dis-je, voilà quinze jours que nous sommes mariés, n'est-il pas temps que vous sachiez si vous avez épousé une femme qui a quelque chose ou qui n'a rien.
– Ce sera au moment que vous voudrez, mon cœur, dit-il; pour moi, mon désir est satisfait, puisque j'ai la femme que j'aime; je ne vous ai pas beaucoup tourmentée, dit-il, par mes questions là-dessus.
– C'est vrai, dis-je, mais je trouve une grande difficulté dont je puis à peine me tirer.
– Et laquelle, mon cœur? dit-il.
– Eh bien, dis-je, voilà; c'est un peu dur pour moi, et c'est plus dur pour vous: on m'a rapporté que le capitaine X… (le mari de mon amie) vous a dit que j'étais bien plus riche que je n'ai jamais prétendu l'être, et je vous assure bien qu'il n'a pas ainsi parlé à ma requête.
– Bon, dit-il, il est possible, que le capitaine X… m'en ait parlé, mais quoi? Si vous n'avez pas autant qu'il m'a dit, que la faute en retombe sur lui; mais vous ne m'avez jamais dit ce que vous aviez, de sorte que je n'aurais pas de raison de vous blâmer, quand bien même vous n'auriez rien du tout.
– Voilà qui est si juste, dis-je, et si généreux, que je suis doublement affligée d'avoir si peu de chose.
– Moins vous avez, ma chérie, dit-il, pire pour nous deux; mais j'espère que vous ne vous affligez point de crainte que je perde ma tendresse pour vous, parce que vous n'avez pas de dot; non, non, si vous n'avez rien, dites-le moi tout net; je pourrai peut-être dire au capitaine qu'il m'a dupé, mais jamais je ne pourrai vous accuser, car ne m'avez-vous pas fait entendre que vous étiez pauvre? et c'est là ce que j'aurais dû prévoir.
– Eh bien, dis-je, mon ami, je suis bien heureuse de n'avoir pas été mêlée dans cette tromperie avant le mariage; si désormais je vous trompe, ce ne sera point pour le pire; je suis pauvre, il est vrai, mais point pauvre à ne posséder rien.
Et là, je tirai quelques billets de banque et lui donnai environ 160£.
– Voilà quoique chose, mon ami, dis-je, et ce n'est peut-être pas tout.
Je l'avais amené si près de n'attendre rien, par ce que j'avais dit auparavant, que l'argent, bien que la somme fût petite en elle-même, parut doublement bienvenue. Il avoua que c'était plus qu'il n'espérait, et qu'il n'avait point douté, par le discours que je lui avais tenu, que mes beaux habits, ma montre d'or et un ou deux anneaux à diamants faisaient toute ma fortune.
Je le laissai se réjouir des 160£ pendant deux ou trois jours, et puis, étant sortie ce jour-là, comme si je fusse allée les chercher, je lui rapportai à la maison encore 100£ en or, en lui disant: «Voilà encore un peu plus de dot pour vous,» et, en somme, au bout de la semaine je lui apportai 180£ de plus et environ 60£ de toiles, que je feignis d'avoir été forcée de prendre avec les 100£ en or que je lui avais données en concordat d'une dette de 600£ dont je n'aurais tiré guère plus de cinq shillings pour la livre, ayant été encore la mieux partagée.
– Et maintenant, mon ami, lui dis-je, je suis bien fâchée de vous avouer que je vous ai donné toute ma fortune.
J'ajoutai que si la personne qui avait mes 600£ ne m'eût pas jouée, j'en eusse facilement valu mille pour lui, mais que, la chose étant ainsi, j'avais été sincère et ne m'étais rien réservé pour moi-même, et s'il y en avait eu davantage, je lui aurais tout donné.
Il fut si obligé par mes façons et si charmé de la somme, car il avait été plein de l'affreuse frayeur qu'il n'y eut rien, qu'il accepta avec mille remerciements. Et ainsi je me tirai de la fraude que j'avais faite, en passant pour avoir une fortune sans avoir d'argent, et en pipant un homme au mariage par cet appât, chose que d'ailleurs je tiens pour une des plus dangereuses où une femme puisse s'engager, et où elle s'expose aux plus grands hasards d'être maltraitée par son mari.
Mon mari, pour lui donner son dû, était un homme d'infiniment de bonne humeur, mais ce n'était point un sot, et, trouvant que son revenu ne s'accordait pas à la manière de vivre qu'il eût entendu, si je lui eusse apporté ce qu'il espérait, désappointé d'ailleurs par le profit annuel de ses plantations en Virginie, il me découvrit maintes fois son inclination à passer en Virginie pour vivre sur ses terres, et souvent me peignait de belles couleurs la façon dont on vivait là-bas, combien tout était à bon marché, abondant, délicieux, et mille choses pareilles.
J'en vins bientôt à comprendre ce qu'il voulait dire, et je le repris bien simplement un matin, en lui disant qu'il me paraissait que ses terres ne rendaient presque rien à cause de la distance, en comparaison du revenu qu'elles auraient s'il y demeurait, et que je voyais bien qu'il avait le désir d'aller y vivre; que je sentais vivement qu'il avait été désappointé en épousant sa femme, et que je ne pouvais faire moins, par manière d'amende honorable, que de lui dire que j'étais prête à partir avec lui pour la Virginie afin d'y vivre.
Il me dit mille choses charmantes au sujet de la grâce que je mettais à lui faire cette proposition. Il me dit que, bien qu'il eût été désappointé par ses espérances de fortune, il n'avait pas été désappointé par sa femme, et que j'étais pour lui tout ce que peut être une femme, mais que cette offre était plus charmante qu'il n'était capable d'exprimer.
Pour couper court, nous nous décidâmes à partir. Il me dit qu'il avait là-bas une très bonne maison, bien garnie, où vivait sa mère, avec une sœur, qui étaient tous les parents qu'il avait; et qu'aussitôt son arrivée, elles iraient habiter une autre maison qui appartenait à sa mère sa vie durant, et qui lui reviendrait, à lui, plus tard, de sorte que j'aurais toute la maison à moi, et je trouvai tout justement comme il disait.
Nous mîmes à bord du vaisseau, où nous nous embarquâmes, une grande quantité de bons meubles pour notre maison, avec des provisions de linge et autres nécessités, et une bonne cargaison de vente, et nous voilà partis.
Je ne rendrai point compte de la manière de notre voyage, qui fut longue et pleine de dangers, mais serait hors propos; je ne tins pas de journal, ni mon mari; tout ce que je puis dire, c'est qu'après un terrible passage, deux fois épouvantés par d'affreuses tempêtes, et une fois par une chose encore plus terrible, je veux dire un pirate, qui nous aborda et nous ôta presque toutes nos provisions et, ce qui aurait été le comble de mon malheur, ils m'avaient pris mon mari, mais par supplications se laissèrent fléchir et le rendirent; je dis, après toutes ces choses terribles, nous arrivâmes à la rivière d'York, en Virginie, et, venant à notre plantation, nous fûmes reçus par la mère de mon mari avec toute la tendresse et l'affection qu'on peut s'imaginer.
Nous vécûmes là tous ensemble: ma belle-mère, sur ma demande, continuant à habiter dans la maison, car c'était une trop bonne mère pour qu'on se séparât d'elle; et mon mari d'abord resta le même; et je me croyais la créature la plus heureuse qui fût en vie, quand un événement étrange et surprenant mit fin à toute cette félicité en un moment et rendit ma condition la plus incommode du monde.
Ma mère était une vieille femme extraordinairement gaie et pleine de bonne humeur, je puis bien dire vieille, car son fils avait plus de trente ans; elle était de bonne compagnie, dis-je, agréable, et m'entretenait en privé d'abondance d'histoires pour me divertir, autant sur la contrée où nous étions que sur les habitants.
Et, entre autres, elle me disait souvent comment la plus grande partie de ceux qui vivaient dans cette colonie y étaient venus d'Angleterre dans une condition fort basse, et qu'en général il y avait deux classes: en premier lieu, tels qui étaient transportés par des maîtres de vaisseau pour être vendus comme serviteurs; ou, en second lieu, tels qui sont déportés après avoir été reconnus coupables de crimes qui méritent la mort.
– Quand ils arrivent ici, dit-elle, nous ne faisons pas de différence: les planteurs les achètent, et ils vont travailler tous ensemble aux champs jusqu'à ce que leur temps soit fini; quand il est expiré, dit-elle, on leur donne des encouragements à seule fin qu'ils plantent eux-mêmes, car le gouvernement leur alloue un certain nombre d'acres de terre, et ils se mettent au travail pour déblayer et défricher le terrain, puis pour le planter de tabac et de blé, à leur propre usage; et comme les marchands leur confient outils et le nécessaire sur le crédit de leur récolte, avant qu'elle soit poussée, ils plantent chaque année un peu plus que l'année d'auparavant, et ainsi achètent ce qu'ils veulent avec la moisson qu'ils ont en perspective. Et voilà comment, mon enfant, dit-elle, maint gibier de Newgate devient un personnage considérable; et nous avons, continua-t-elle, plusieurs juges de paix, officiers des milices et magistrats des cités qui ont eu la main marquée au fer rouge.
Elle allait continuer cette partie de son histoire, quand le propre rôle qu'elle y jouait l'interrompit; et, avec une confiance pleine de bonne humeur, elle me dit qu'elle-même faisait partie de la seconde classe d'habitants, qu'elle avait été embarquée ouvertement, s'étant aventurée trop loin dans un cas particulier, d'où elle était devenue criminelle.