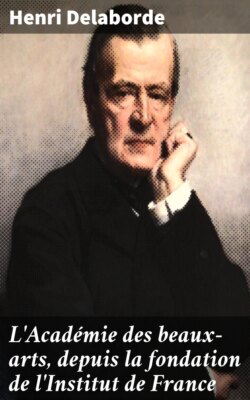Читать книгу L'Académie des beaux-arts, depuis la fondation de l'Institut de France - Delaborde Henri - Страница 6
LA CLASSE DE LA LITTÉRATURE ET DES BEAUX-ARTS AU TEMPS DU DIRECTOIRE.
ОглавлениеOrganisation de la classe. — Quatre sections seulement y sont réservées aux artistes. — Inconvénients de la mesure par laquelle des comédiens sont appelés à faire partie d’une de ces sections. — Premiers membres de la troisième classe choisis parmi les artistes. — Première séance publique de l’Institut. — Rétablissement des concours pour les Grands Prix de Rome. — Fête pour célébrer l’arrivée à Paris des monuments de l’art recueillis en Italie. — La Commission d’Égypte et l’Institut du Caire.
Une des préoccupations principales des fondateurs de l’Institut avait été de ne point paraître, par cette création, s’en tenir à une innovation de surface et se proposer au fond le simple rétablissement, sous un autre nom, des anciennes académies. De là, malgré ce qu’une pareille répartition pouvait avoir en soi d’arbitraire, malgré le pêle-mêle qui devait nécessairement en résulter, la division en trois classes seulement du corps appelé à remplacer les cinq académies détruites(); de là en particulier, dans la troisième classe, dite de la Littérature et des Beaux-Arts, le rapprochement passablement forcé d’hommes et de talents séparés en réalité par la diversité des origines, des situations et des travaux.
Aux termes mêmes du décret qui organisait l’Institut, cette troisième classe se subdivisait en huit sections, dont quatre étaient réservées à des érudits et à des écrivains de différents genres, et quatre à des artistes proprement dits. Contrairement à l’esprit dans lequel avaient été constituées les deux premières classes, — comprenant exclusivement, l’une les représentants les plus accrédités des sciences physiques et mathématiques, l’autre des hommes éminents dans l’ordre des sciences morales et politiques, — la troisième classe de l’Institut avait donc un caractère mixte, une double physionomie qui faisait d’elle une sorte de Janus personnifiant, suivant le côté d’où on l’envisageait, tantôt les lettres, tantôt les arts.
Il eût été, à ce qu’il semble, aussi naturel qu’équitable de distribuer dans deux séries distinctes les éléments confondus ici, et d’isoler le groupe des écrivains de celui des artistes, comme on traçait ailleurs une ligne de démarcation précise entre le domaine des sciences exactes et le champ des études philosophiques; mais en procédant ainsi, on se fût sans doute attiré le reproche qu’on craignait par-dessus tout d’encourir, le reproche de complaisance secrète pour les souvenirs du passé. Faire dans l’institution nouvelle une place à part, si légitime qu’elle fût, à un certain nombre d’hommes de lettres qu’il eût bien fallu, bon gré, mal gré, aller rechercher parmi les membres de la ci-devant Académie française, c’eût été en réalité rendre la vie à la plus impopulaire des compagnies qu’on venait de supprimer, à celle qui, dans les assemblées politiques comme au dehors, avait eu le privilège de susciter les récriminations les plus ardentes. Pour sauver au moins les apparences, on prit le parti de disséminer un peu partout ceux des membres de l’Institut qui avaient appartenu à l’Académie française ou qui auraient mérité de lui appartenir. Plusieurs entrèrent dans la seconde classe, les uns, comme Gaillard, en qualité d’historiens, les autres, comme Bernardin de Saint-Pierre, à titre de moralistes. Restaient des poètes et des auteurs dramatiques, Delille et Ducis par exemple, d’autres encore que leur brillante réputation acquise sous l’ancien régime et un passé académique plus ou moins long désignaient d’avance aux choix de ceux qui seraient chargés de recruter le personnel du nouvel Institut. On jugea prudent de les reléguer dans la troisième classe et d’y créer pour eux, aussi bien que pour quelques survivants de l’Académie des inscriptions, ces quatre sections dont nous avons parlé et que l’on constitua sous les chefs de: Grammaire, Langues anciennes, Poésie, Antiquités et Monuments. Chacune d’elles comprenait six membres, sans compter un nombre égal d’associés non résidants, en sorte que, dans la composition primitive de l’Institut, vingt-quatre places seulement étaient accordées aux représentants en France des lettres savantes à tous les degrés ou de la littérature d’imagination sous toutes ses formes. Encore arriva-t-il plus d’une fois durant cette première période que, pour introduire dans les rangs des membres de la troisième classe un écrivain plus ou moins renommé, on ne se fit pas scrupule de l’attacher à une section sans correspondance directe avec les œuvres auxquelles il avait dû sa réputation. C’est ainsi qu’un des anciens lieutenants de Voltaire et des Encyclopédistes, Marmontel, fut appelé à faire partie de la section de «Grammaire» comme associé non résidant, et qu’un professeur de rhétorique sorti de la congrégation de l’Oratoire pour devenir, il est vrai, un révolutionnaire fougueux, Leblanc de Guillet, fut élu dans la section de «Poésie».
Des anomalies de cette espèce devaient plus difficilement se produire dans le classement des artistes qui formaient les quatre autres sections. On avait bien pu, à la rigueur, transformer, pour les besoins de la cause, l’auteur de Bélisaire et des Incas en grammairien et l’auteur des Mémoires du comte de Guines en poète: mais quel prétexte aurait-on pris pour ranger Houdon, par exemple, parmi les peintres ou David parmi les sculpteurs? Il ne fallut pas moins, comme on le verra plus loin, que la suppression au bout de quelques années d’une des subdivisions primitives, — celle de la «Déclamation », — pour que les membres évincés fussent parqués tant bien que mal dans une des sections qu’on jugeait bon de maintenir ou, tout aussi arbitrairement d’ailleurs, dans une de celles qu’on venait de créer.
L’idée qu’on avait eue à l’origine d’appeler des comédiens à faire partie de l’Institut était d’ailleurs une idée fausse, périlleuse même jusqu’à un certain point pour la dignité du nouveau corps. Elle pouvait avoir son explication, sinon son excuse, dans l’importance exagérée que, depuis la seconde moitié du dix-huitième siècle, on avait pris l’habitude d’attribuer aux choses et aux gens de théâtre; mais elle n’en tendait pas moins à dénaturer le caractère et à compromettre l’unité de la fondation que l’on substituait au régime des anciennes académies; elle introduisait une confusion aussi contraire à l’esprit de cette fondation même que fâcheuse pour les élus dans la pratique. Il n’y avait, en effet, il ne pouvait y avoir qu’un semblant d’égalité ou, si l’on veut, qu’une confraternité factice entre des hommes qui devaient leur notoriété, les uns à des œuvres tirées de leur propre fonds, — que ces œuvres fussent des tableaux, des sculptures, des compositions musicales ou des poèmes, — les autres à leur simple talent d’interprètes. Pourquoi s’en tenir d’ailleurs dans la désignation des éligibles à une classe spéciale d’acteurs, à ceux qui, aux termes des statuts, représentaient l’ «art de la déclamation» ? Puisqu’on admettait des acteurs comiques ou des tragédiens à siéger auprès des auteurs dramatiques, il aurait fallu, en vertu du même principe, que des chanteurs eussent leur place à côté des compositeurs de musique, et qu’Elleviou, par exemple, pût devenir un jour le confrère de Méhul, comme Molé l’était déjà de Marie-Joseph Chénier et de Collin d’Harleville.
Au reste, quels qu’eussent été sous les règnes de Louis XV et de Louis XVI le crédit extérieur et les faveurs accordés, jusque dans les plus hautes régions de la cour, à des acteurs, la profession que ceux-ci exerçaient n’en était pas moins restée en dehors des conditions ordinaires de la vie sociale et, même aux yeux des patrons les plus accommodants en apparence, en dehors des garanties ou des lois protectrices des autres citoyens. Des gentilshommes de la chambre du roi, tels que le maréchal de Richelieu ou le duc d’Aumont, pouvaient bien, à l’occasion, admettre dans leur familiarité des «marquis» ou des «valets» de la Comédie française; mais ils ne se faisaient pas faute, dans un moment de mauvaise humeur, d’envoyer sans plus de façons leurs clients au For-l’Évêque, comme ils étaient les premiers sans doute à trouver tout naturel que, dans un procès qui l’intéressait, Lekain ne fût pas reçu à témoigner en justice. Il pouvait arriver aussi que quelques grandes dames s’abandonnassent publiquement à leur passion pour des acteurs, et que deux d’entre elles poussassent un jour l’effronterie jusqu’à se disputer dans un duel le cœur de Chassé, de l’Opéra; mais aucune de ces hardies pécheresses aurait-elle, en cas de veuvage, consenti à racheter par un mariage la faute commise et à prendre le nom de celui qui en avait été le complice?
La contradiction était donc flagrante entre la bienveillance excessive avec laquelle des acteurs se voyaient accueillis dans les salons ou dans les boudoirs et, — sans parler des rigueurs canoniques, — l’indignité légale, l’espèce d’infamie civile qui s’attachait à leur état. Toutefois, affaire de mode ou non, engouement involontaire ou bravade, la partialité des gens de cour pour la personne des gens de théâtre s’était, dans tout le cours du dix-huitième siècle, manifestée avec assez d’éclat pour que la vanité de ceux qui en étaient l’objet y trouvât largement son compte. Aussi se donnait-elle carrière sans mesure ni scrupule d’aucune sorte. Tenus, il est vrai, à l’écart par la bourgeoisie, qui, comme l’écrivait J.-J. Rousseau, «craignait de fréquenter ces mêmes hommes qu’on voyait tous les jours à la table des grands», les acteurs se vengeaient de cette exclusion par l’impertinence de leurs dédains pour «les petites gens» et par la fatuité naïve avec laquelle ils s’exhaussaient au rang des seigneurs, dont ils parodiaient les coutumes ou dont ils invoquaient au besoin les traditions. N’est-ce pas un d’entre eux, le danseur de l’Opéra Vestris, qui disait à son fils, en le réprimandant sur ses prodigalités: «Souvenez-vous, Auguste, que je ne veux pas de Guéménée dans ma famille»? Un autre, le comédien Dallainville, frère de Molé, ne trouvait-il pas tout naturel, quand celui-ci vint à mourir, de réclamer un deuil public, comme le deuil qu’eût prescrit naguère la perte d’un prince du sang, — sauf cette différence pourtant qu’il se serait contenté d’un simple crêpe au bras de chacun des spectateurs réunis, à un jour donné, dans les divers théâtres()?
Tout en faisant des acteurs des citoyens comme les autres, tout en mettant un terme, en ce qui concernait les conditions légales de leur existence, aux rigueurs exceptionnelles ou aux injustices qui depuis si longtemps pesaient sur eux, la Révolution ne les avait pas pour cela corrigés de leurs prétentions à constituer une sorte d’aristocratie. L’admission de quelques-uns d’entre eux à l’Institut n’était certes pas un fait propre à dissiper leurs illusions sur ce point. Elle semblait, au contraire, consacrer pour les acteurs le droit de se regarder comme les égaux en importance et en mérite des écrivains et des artistes les plus éminents. Il y avait là en réalité de la part du législateur une exagération de bon vouloir et, de plus, une inconséquence, puisque, tandis qu’il accordait ainsi droit de cité à ces traducteurs de la pensée d’autrui, il le refusait aux graveurs, c’est-à-dire en arguant apparemment contre ceux-ci de l’insuffisance, au point de vue de l’invention personnelle, de titres qu’il considérait comme parfaitement valables chez ceux-là.
Nulle place en effet dans la troisième classe de l’Institut primitif pour les successeurs de Nanteuil, de Gérard Audran, de tant d’autres encore qui avaient assuré à notre école de gravure le premier rang parmi les écoles modernes; nulle récompense pour eux des efforts qu’ils poursuivaient, les uns, comme Tardieu, avec le pieux respect des traditions léguées par les maîtres du dix-septième siècle, les autres, comme Bervic, avec une habileté technique nouvelle à certains égards. Ce ne fut qu’au bout de plusieurs années qu’on sentit la nécessité de combler cette lacune, et que l’art de la gravure en taille-douce et l’art, aussi mal à propos écarté d’abord, de la gravure en médailles, commencèrent d’avoir leurs représentants à l’Institut. Jusqu’au jour (1803) où fut prise cette mesure de stricte justice, la part faite aux artistes dans la composition de la troisième classe se borna aux vingt-quatre places que contenaient les quatre sections de Peinture, de Sculpture, d’Architecture, de Musique et de Déclamation. Reste à savoir comment on entendait procéder au recrutement des membres qui devaient occuper ces vingt-quatre places, et de quels éléments on se servit à l’origine pour constituer le corps électoral.
Le décret qui organisait l’Institut avait été, nous l’avons dit, rendu en vue de rattacher les unes aux autres toutes les puissances de la pensée humaine, de faire des hommes voués avec le plus de succès aux différents travaux de l’intelligence les membres d’une seule famille, fortement unie par la dignité des titres et l’élévation des principes, et, dans la pratique, par l’égalité des privilèges. Au lieu des anciennes académies, qui n’agissaient et ne pouvaient agir qu’isolément, il y avait désormais un ensemble d’académies diversement occupées, mais soumises sous le même toit à la même discipline, intéressées à la défense de la même cause, statuant sur toutes les questions avec la même autorité légale, sinon avec la même compétence, — ou plutôt il y avait, sous une dénomination nouvelle, une académie unique divisée en trois classes pour la facilité du travail ou pour la préparation des affaires à régler en commun.
L’élection par l’Institut tout entier des membres de chaque classe, au fur et à mesure des vacances qui viendraient à se produire, était une des prescriptions réglementaires les plus propres à confirmer pour l’avenir cette unité dans l’exercice des fonctions et des prérogatives dont on avait posé le principe comme une base fondamentale. Nous ne reviendrons pas sur les inconvénients ou sur les périls inhérents au mode de scrutin adopté, sur la difficulté, pour la plupart des votants, de se décider en pleine connaissance de cause, soit que les savants ou les littérateurs eussent à choisir l’architecte ou le sculpteur le plus digne de leurs suffrages, soit que, à leur tour, les artistes fussent appelés à apprécier les mérites spéciaux d’un astronome ou d’un orientaliste, d’un jurisconsulte ou d’un physicien. Nous nous bornerons à faire remarquer que, pour les premières nominations du moins, la procédure réglée par les statuts ne pouvait naturellement pas être suivie, puisque les électeurs futurs étaient encore eux-mêmes à l’état d’éligibles. Aussi, pour mettre en train les choses, le Directoire exécutif prit-il le parti de créer, par deux arrêtés successifs en date du 20 novembre et du 6 décembre 1795, quarante-huit membres fondateurs qui devaient, une fois nommés, en élire quarante-huit autres: après quoi ces quatre-vingt-seize membres auraient à désigner d’un commun accord ceux qui, dans les diverses classes, compléteraient le personnel de l’Institut. La troisième classe pour sa part reçut du gouvernement l’ordre de se constituer avec les seize membres qu’il venait de nommer et dont les artistes formaient la moitié. Ces huit artistes hors concours dès le début, ces huit «anciens», comme on les aurait appelés un siècle et demi auparavant, étaient: dans la section de peinture, David et Van Spaendonck; dans la section de sculpture, Houdon et Pajou; dans celle d’architecture, Gondoin et de Wailly; enfin dans la section de musique et de déclamation, Méhul et Molé.
Sauf les deux derniers, qui ne pouvaient avoir aucun précédent académique, puisque les arts qu’ils représentaient l’un et l’autre étaient pour la première fois admis à partager les privilèges officiels exclusivement réservés jusqu’alors aux arts du dessin, tous les artistes choisis par le Directoire avaient appartenu soit à l’Académie royale de peinture, soit à l’Académie d’architecture. D’ailleurs, à l’exception de Van Spaendonck, que son agréable talent comme peintre de fleurs n’élevait pas en réalité au niveau des maîtres dont on semblait ainsi le proclamer l’égal, tous s’imposaient aux préférences des chefs de l’Etat par la notoriété de leurs noms et de leurs œuvres. Quelques souvenirs, par exemple, que l’on dût garder, dans le monde des Thermidoriens aussi bien que dans l’ancien monde académique, du rôle joué par David durant les années précédentes, et quelques ressentiments que ces souvenirs justifiassent, on ne pouvait méconnaître, même avant l’apparition du tableau des Sabines(), la haute valeur personnelle du peintre des Horaces, de Brutus et de la Mort de Socrate, encore moins l’influence toute-puissante qu’il exerçait sur la jeune école, tant par ses exemples que par ses leçons. Il était donc tout naturel que son nom figurât un des premiers sur la liste des artistes destinés à former le noyau des diverses sections de la troisième classe, et que, malgré la défaite du parti politique qui l’avait compté parmi les siens, l’ex-député de Paris conservât aux yeux de tous le prestige qu’il s’était acquis par son talent.
David, au reste, dès le lendemain du 9 thermidor, n’avait-il pas, à la tribune de la Convention comme dans ses écrits, publiquement désavoué les opinions qu’il avait affichées et la conduite qu’il avait tenue pendant la Terreur? Outre le discours par lequel, dans la séance du 13 thermidor, il adjurait ses collègues de croire que «personne ne pouvait l’inculper plus que lui-même», les lettres adressées par lui, après son incarcération au Luxembourg, tantôt à Boissy d’Anglas pour maudire «les fripons qui l’avaient précipité dans l’abîme», tantôt à la Convention pour expliquer comment «son patriotisme avait pu se laisser égarer par les fausses vertus et les sentiments hypocrites de Robespierre», bien d’autres pièces encore prouvent de reste que, longtemps avant le jour où il entrait à l’Institut, David, sincèrement converti ou non, n’hésitait point à renier son passé politique. Et quant à ses récentes invectives contre les académiciens et les corps académiques, quels qu’ils fussent, elles lui inspiraient apparemment le même repentir ou, tout au moins, le même besoin dans le présent de les faire oublier, puisque, lors de la fondation de l’Institut, il acceptait sans nulle difficulté la place qu’on lui offrait d’y occuper, et qu’il participait ainsi pour son propre compte à la restauration indirecte de ce qu’il avait, plus que personne, contribué naguère à renverser.
Les deux sculpteurs nommés par le Directoire en même temps que David n’avaient pas, eux, de pareils antécédents à démentir. Ils avaient traversé les années qui venaient de s’écouler, aussi étrangers l’un que l’autre aux passions et aux excès révolutionnaires; ils avaient été parfois menacés d’en devenir les victimes, témoin le jour où, dépossédé d’ailleurs par la Révolution d’une fortune laborieusement acquise, Pajou fut accusé de conspirer avec les «aristocrates», parce qu’il avait été jadis garde des antiques du cabinet du roi et qu’il avait sculpté les bustes de nombreux personnages de la cour. Houdon de son côté était, vers la même époque, incriminé d’incivisme, parce qu’on avait découvert dans son atelier une statue de sainte exécutée par lui. De là une dénonciation en règle, bientôt suivie d’une perquisition domiciliaire. Sans la présence d’esprit de sa femme, seule au logis quand Barère, escorté de quelques clubistes du quartier, vint pour constater le fait, l’illustre sculpteur aurait été sans doute rejoindre ou précéder dans les prisons, et peut-être sur l’échafaud, André Chénier, Lavoisier, tant d’autres martyrs encore de la dignité de leurs talents ou de leur vie. Madame Houdon s’empressa sans le moindre trouble de mettre sous les yeux de ses sinistres visiteurs la statue réputée séditieuse, et, profitant de ce que celle-ci n’était accompagnée d’aucun attribut mystique, d’aucun accessoire particulièrement significatif, elle la leur présenta résolument comme une image de la Philosophie, caractérisée, ainsi qu’ils le pouvaient voir, par la gravité de l’expression et par la majesté de l’attitude. Barère et les siens se le tinrent pour dit; si bien qu’ils ne songèrent plus qu’aux moyens d’attirer la lumière sur une œuvre aussi respectueuse des droits de la raison humaine, aussi directement appropriée aux exigences actuelles et aux progrès de l’esprit public. Par leurs soins, la sainte débaptisée sortit, au bout de quelques jours, de l’atelier de l’artiste pour aller prendre une place d’honneur dans le vestibule de la salle des séances de la Convention.
Est-il besoin d’ailleurs de rappeler les ouvrages auxquels Houdon devait l’honneur d’être choisi le premier parmi les sculpteurs, pour siéger dans la troisième classe de l’Institut? Qui ne connaît sa statue en bronze de Diane, aujourd’hui au musée du Louvre, sa Frileuse que tant d’exemplaires en plâtre, tant de répétitions de toutes les grandeurs et en toutes matières ont depuis si longtemps popularisée, — ses beaux bustes, entre beaucoup d’autres, de Molière et de J.-J. Rousseau, de Diderot et de Franklin, — enfin et surtout cette admirable statue de Voltaire assis, le chef-d’œuvre de la sculpture de portrait dans l’école française moderne et peut-être dans les écoles de tous les pays? Houdon, né en 1741, avait dépassé l’âge de cinquante ans quand il fut nommé membre de l’Institut. Pendant les trente-trois années qui s’écoulèrent encore entre la date de cette nomination et celle de sa mort, il ne cessa d’être pour tous ses confrères l’objet d’une vénération d’autant plus affectueuse que l’extrême droiture du caractère s’unissait chez lui à l’élévation du talent; et lorsque, vers la fin, l’affaiblissement graduel de ses forces physiques eut amené l’anéantissement presque complet de ses facultés intellectuelles, chacun à l’Académie n’en continua pas moins de reconnaître et d’honorer pieusement dans ce vieillard, qui semblait ainsi se survivre à lui-même, une des gloires les plus pures et les mieux assurées de notre art national().
Moins éclatants, quoique plus nombreux encore en raison de l’âge même du sculpteur entré dans la carrière plus de dix ans avant Houdon, les titres de Pajou étaient cependant assez sérieux pour légitimer la place que lui assignait, à la tête de la troisième classe, l’arrêté du Directoire exécutif. Il suffira de citer, parmi près de deux cents ouvrages dus au ciseau du fécond et très habile artiste, le charmant buste de Madame Dubarry, dont le seul tort est d’atténuer à force de grâce, d’abolir presque des souvenirs ignominieux et, par la chasteté même de l’art avec lequel il est traité, de relever à nos yeux et en quelque sorte de purifier la mémoire souillée du modèle, — les bustes de Buffon et de l’académicienne Madame Guyard exposés présentement, comme celui que nous venons de mentionner, dans une salle du musée du Louvre, — la statue de Turenne, pour la décoration de l’École militaire, et les statues de Bossuet et de Descartes, qui ornent aujourd’hui la salle des séances publiques de l’Institut.
De Wailly et Gondoin, appelés les premiers à faire partie de la section d’architecture dans la troisième classe, ont beaucoup perdu, de nos jours, de l’importance qu’on leur reconnaissait au moment où ils furent choisis. Il ne suit pas de là toutefois qu’en préférant à d’autres l’architecte du Théâtre de l’Odéon et l’architecte de l’École de médecine, à Paris, on commît sciemment une injustice ou, involontairement, une méprise. Sans doute trois architectes, dont les noms sont restés à bon droit célèbres, venaient, dans la seconde moitié du dix-huitième siècle, d’honorer l’école française avec une force de talent supérieure; mais de ces trois grands artistes celui qui avait édifié à Paris l’Ecole militaire, les monuments de la place Louis XV et, au palais de Versailles, la salle de spectacle, Gabriel, n’existait plus en 1795; le second, à qui l’on doit le théâtre de Bordeaux, — le plus beau des théâtres construits en France avant notre siècle, — Louis, achevait alors, au milieu des agitations et des embarras de toutes sortes, une vie rendue de plus en plus difficile par l’insociabilité d’un caractère orgueilleux à l’excès(), malveillant en général pour autrui et particulièrement incapable de se plier aux exigences de la confraternité académique. C’était là ce qui, à deux reprises, en 1767 et en 1780, avait fait fermer à Louis les portes de l’ancienne Académie d’architecture; il est plus que probable que les mêmes motifs empêchèrent qu’on songeât à lui, lors de la formation de l’Institut.
Quant à Antoine, qui devait d’ailleurs être élu trois ans plus tard dans cette troisième classe où il peut paraître surprenant qu’il ne soit pas entré dès le premier jour, la rare habileté dont il avait fait preuve dans la construction de l’Hôtel des monnaies, à Paris, lui avait valu la direction d’une entreprise analogue à Berne, sans compter d’autres travaux importants à exécuter dans la même ville. En outre, Antoine avait été chargé de construire pour le prince de Salm un palais à Salm-Kyrburg. Obligé, en raison de ces travaux, de séjourner plus ou moins souvent hors de France, il perdait forcément l’avantage que pouvait procurer à ses confrères la continuité de leur résidence à Paris. Gondoin et de Wailly, en réalité, bénéficiaient donc assez largement des circonstances, mais on ne saurait pour cela voir dans leur nomination, à l’époque où elle était faite, que le résultat d’une faveur.
Ce n’était pas non plus à la faveur seule que Méhul, — le plus jeune de beaucoup des membres fondateurs de la troisième classe(), — devait d’être choisi avant des vétérans illustres de la musique tels que Gossec et Grétry. A cette époque, il est vrai, Méhul n’avait écrit encore ni Joseph, ni l’Ouverture du jeune Henri, ni l’Irato, c’est-à-dire les œuvres qui en réalité ont le plus contribué à sa gloire; mais il avait fait représenter déjà Euphrosine et Coradin en 1790, Stratonice en 1792, et l’opinion exprimée plus tard par Grétry lui-même sur le premier de ces deux ouvrages ne suffirait-elle pas pour expliquer, sinon pour justifier, la préférence accordée tout d’abord à son jeune rival? «Le duo d’Euphrosine et Coradin, dit l’auteur de Richard Cœur de lion dans ses Essais sur la musique, est peut-être le plus beau morceau d’effet qui existe. Je n’excepte même pas les beaux morceaux de Gluck... Ce duo vous agite pendant toute sa durée; l’explosion qui est à la fin semble ouvrir le crâne des spectateurs avec la voûte du théâtre.» De plus, le célèbre Chant du départ, et d’autres hymnes patriotiques dont plusieurs ont mérité de survivre aux circonstances qui les avaient inspirés, venaient d’acquérir au nom de Méhul une popularité d’autant plus grande qu’elle était indépendante des animosités aveugles et des passions démagogiques.
Enfin, Molé, dont le nom se trouvait à côté de celui de Méhul sur la première liste des membres de la troisième classe, Molé, déjà sexagénaire à cette époque, était, de l’aveu de tous, le meilleur acteur de la Comédie française, où il avait débuté en 1754 et où il n’avait cessé depuis lors de tenir brillamment les premiers emplois. Une fois le principe admis de l’admission des comédiens à l’Institut, il n’y avait donc que justice à y appeler Molé avant tout autre de ses camarades, comme, un siècle plus tôt, on eût sans doute choisi Baron.
Avec les huit littérateurs ou érudits appartenant comme eux à la troisième classe et les trente-deux membres choisis par le Directoire pour former les éléments des deux autres, les huit artistes dont nous venons de rappeler les noms avaient la mission de compléter, par des membres élus en dehors de toute intervention gouvernementale, chacune des sections dont la classe se composait. Ces élections, auxquelles il fut immédiatement procédé, ne se firent pas toutefois suivant les formes adoptées pour les élections postérieures. Elles eurent lieu directement, au scrutin de liste et à la majorité des suffrages, tandis que, à partir de 1796, les élections, tout en continuant de dépendre des votes de l’Institut tout entier, se firent non plus au hasard de ses propres prédilections ou de ses inspirations spontanées, mais, ce qui semble plus sage, sur la présentation d’une liste de candidats formée par la classe même où une place était devenue vacante . Le principe qu’avaient établi les statuts d’une égalité absolue entre les membres des diverses classes n’en demeurait pas moins respecté dans la pratique, mais du moins une certaine garantie était offerte contre les erreurs pouvant résulter de l’incompétence personnelle ou des entraînements fortuits: garantie insuffisante sans doute, puisqu’il arriva plus d’une fois à l’ensemble de l’Institut de ne tenir nul compte de l’ordre dans lequel les propositions lui étaient soumises, et de se prononcer un peu capricieusement en faveur du candidat qui, aux yeux des premiers juges, — les seuls tout à fait compétents en réalité, — avait paru le moins digne; mais, néanmoins, garantie plus sérieuse que la liberté originairement laissée à tous les membres de l’Institut d’agir en matière d’élections à leurs propres risques, c’est-à-dire sans avoir reçu les avis qui eussent pu le plus sûrement les éclairer et influer le plus utilement sur leurs décisions.
Cependant, quelques inconvénients, quelques dangers même que comportât en soi la procédure suivie, dans les derniers mois de l’année 1795, pour compléter le chiffre de cent quarante-quatre auquel devait s’élever le nombre total des membres résidants(), les nominations qu’elle amena étaient de nature à donner au nouveau corps un éclat et une autorité au-dessus de toute contestation. Sans parler des savants illustres ayant appartenu à l’ancienne Académie des sciences qui, comme Fourcroy et de Jussieu, venaient rejoindre dans la première classe leurs confrères d’un autre temps, les Laplace et les Monge, les Guyton de Morveau et les Berthollet, ni des représentants de la science sociale et de la législation, de l’économie politique et de la morale, appelés à siéger dans la seconde classe à côté de Daunou, de Sieyès et de Bernardin de Saint-Pierre, — on ne trouverait guère, en parcourant la liste des peintres et des sculpteurs, des architectes et des musiciens choisis à cette époque, à regretter l’omission de quelque nom plus digne d’y figurer que celui de tel des nouveaux élus. Si certains artistes que de brillants antécédents semblaient désigner aux suffrages de leurs confrères, si Doyen par exemple, — le peintre de cette Peste des Ardents qui devait, quelques années plus tard, inspirer à Gros, de son propre aveu, l’admirable tableau des Pestiférés de Jaffa, — si Antoine, l’architecte de l’Hôtel des monnaies, et un ou deux autres encore ne se trouvèrent pas compris dans le nombre des premiers membres de l’Institut, de pareilles exclusions ne sauraient être imputées à l’oubli, encore moins à un parti pris d’injustice; elles s’expliquent tout naturellement par l’obligation, que les intéressés n’auraient pu remplir alors, de résider à Paris . Il fallait donc s’en tenir au choix d’artistes satisfaisant à cette condition expresse, mais il suffit de se rappeler les noms de ceux qui furent élus pour reconnaître qu’ils avaient bien d’autres titres à la haute distinction qu’on leur accordait. C’étaient, pour n’en citer que quelques-uns: Vien, le précurseur convaincu, sinon très hardi, de la réforme que son élève David poursuivait, depuis plus de dix ans déjà, avec une force de volonté et une rigueur intraitables; Regnault, à qui son tableau de l’Education d’Achille avait valu, dès 1783, une célébrité presque égale à celle qu’allait conquérir deux ans plus tard le peintre des Horaces; Roland, le plus habile sculpteur de l’époque après Houdon et Pajou, de qui il avait été l’élève; Peyre, architecte savant, homme de caractère et de courage qui, entre autres services rendus à la cause de l’art, avait, sous le règne de la Terreur, sauvé d’une destruction certaine les statues antiques du palais de Fontainebleau, en les signalant à la horde venue pour les briser comme des images, — y compris même celles des empereurs romains, — consacrées à la mémoire des républicains par excellence des anciens âges. C’étaient enfin Grétry, depuis bien des années en possession de sa gloire, et Gossec, le créateur en France de la symphonie instrumentale, à une époque où Haydn lui-même n’avait encore produit dans son pays aucun de ses chefs-d’œuvre .
L’ensemble du personnel de l’Institut se trouvait donc constitué avant la fin de l’année 1795. Restait maintenant pour ceux qui le composaient à entrer réellement en fonction, à faire publiquement acte de vie, et, pour commencer, à tenir sous les yeux de tous une séance générale dans laquelle les attributions de l’Institut seraient, une fois pour toutes, exposées, ses travaux à venir ou déjà en train promis à une publicité prochaine. Cette séance solennelle pourtant ne pouvait avoir lieu qu’après que les mesures de réglementation et de discipline intérieures auraient été discutées dans le sein des trois classes et approuvées ensuite par qui de droit. Aussi se mit-on immédiatement à l’oeuvre, en vue de ces résultats préalables. Le projet de règlement fut promptement terminé. Préparé par une commission mixte de douze membres, où la première classe avait pour représentants Laplace, Fourcroy, Lacépède et Borda, la seconde Daunou, Sieyès, Delisle de Sales et Grégoire, la troisième enfin trois écrivains ou érudits, Chénier, Villar, Mongez, et un seul artiste, l’architecte Boullée, — ce projet dont l’Institut avait approuvé la rédaction le 15 janvier 1796 était, le 21 du même mois, porté au conseil des Cinq-Cents et, un peu plus tard, au conseil des Anciens. Bientôt les deux assemblées législatives nommaient à leur tour, pour l’examen des propositions qui leur étaient soumises, deux commissions composées de membres appartenant déjà pour la plupart à l’Institut, et dont les rapporteurs, Lakanal et Muraire, conclurent à l’adoption sans réserve d’aucune sorte. Bref, le conseil des Anciens statuant en dernier ressort approuvait, le 4 avril 1796, le projet élaboré par l’Institut et lui donnait ainsi le caractère d’une loi de l’État.
Le tout, il est vrai, ne s’était pas opéré sans quelque emphase de part et d’autre dans les formes, sans quelques-unes de ces exagérations de langage rendues presque obligatoires par les usages et les goûts du temps; mais, en constatant le fait, on a le devoir de reconnaître, sous ce style et ces habitudes déclamatoires, un fond de zèle sincère et de juste fierté patriotique, un vif sentiment de la grandeur inhérente à l’institution nationale qu’on venait de créer. Quand Lacépède, portant la parole au nom de ses confrères, présentait au conseil des Cinq-Cents le règlement qu’il avait contribué à établir, il pouvait bien terminer sa harangue par ces mots, assez hors de place sans doute, puisqu’ici la forme du gouvernement n’était nullement en cause, «nous jurons haine à la royauté » ; mais il avait auparavant, et avec plus d’à-propos, parlé de la reconnaissance due à ceux qui, par la création de l’Institut, «installaient la fraternité entre les différentes familles des sciences et des arts». Et si de son côté le président de l’Assemblée, Treilhard, — un futur comte de l’Empire d’ailleurs, comme Lacépède lui-même, — se hâtait un peu trop de prédire dans sa réponse que le serment prêté par Lacépède et par d’autres républicains aussi fragiles «comprimerait à jamais les partisans de la monarchie», il n’en était pas moins autorisé à se féliciter hautement des grandes œuvres récemment faites ou entreprises. «Cette constitution méditée au sein des orages, disait-il, les encouragements donnés aux sciences et aux arts au milieu du chaos de la plus profonde révolution, ces découvertes utiles qui dans le court intervalle de quelques mois nous ont fait franchir l’espace de plusieurs siècles, tout annonce à l’univers que les fondateurs de la République, en assurant l’édifice constitutionnel, n’ont pas néanmoins négligé les sciences et les lettres. Pour eux, la République a été assise sur deux bases indestructibles, la victoire et la loi: une troisième reste encore, l’instruction publique; ils vous délèguent le soin de la poser...»
Les progrès de l’instruction publique et le «perfectionnement des arts et des sciences», tel était en effet, aux termes mêmes de la loi organique de l’Institut, l’objet des efforts imposés au corps tout entier. C’est ce que Daunou sut faire ressortir avec autant de clarté que de force dans le discours qu’il avait été chargé de prononcer le jour de cette première séance publique dont nous parlions tout à l’heure: séance imposante par le caractère élevé du programme que l’orateur avait à développer, par le nombre des assistants et par la majesté architectonique du lieu où ils étaient réunis; enfin et surtout par la valeur personnelle et l’indépendance légale de ces hommes — savants, littérateurs ou artistes, — auxquels, suivant la fière parole de Daunou, le gouvernement «avait le droit de demander des travaux sans avoir le pouvoir de leur commander des opinions». Et Daunou ajoutait, pour achever de définir le rôle assigné à ses confrères et pour expliquer la fermeté studieuse de leur zèle, au lendemain des terribles commotions politiques que le pays avait subies: «Nous gardons l’émotion de la bataille avec cette espèce d’héroïsme sauvage qu’elle fait naître dans les âmes; et maintenant, en pleine possession de la liberté, la République nous appelle pour rassembler et raccorder toutes les branches de l’instruction, reculer les limites des connaissances, en rendre les éléments moins obscurs et plus accessibles, provoquer les efforts des talents, récompenser leurs succès, recevoir, renvoyer, répandre toutes les lumières de la pensée, tous les trésors du génie. Tels sont les devoirs que la loi impose à l’Institut.» Enfin, l’organisation intérieure de l’Institut et les motifs qui l’avaient déterminée étaient ainsi exposés dans ce grave et substantiel discours: «En divisant l’Institut national en classes et en sections particulières, on n’a pas prétendu offrir un système rigoureusement analytique de toutes les connaissances humaines, mais seulement réunir d’une manière plus spéciale les hommes qui, dans l’état présent des sciences et des arts, ayant un plus grand nombre d’idées et de méthodes communes, parlant en quelque sorte la même langue, peuvent avoir entre eux des communications plus habituelles et plus immédiatement utiles. L’Institut n’en conserve pas moins l’unité qui le caractérise; ce sont ses travaux qui sont divisés plutôt que ses membres, et cette répartition qui distribue et ne sépare pas, qui ordonne tout et n’isole rien, n’est qu’un principe d’harmonie et un moyen d’activité.»
Étrange contraste d’ailleurs! La salle du Louvre où cette fête si pleine de promesses réunissait, le 4 avril 1796 , l’élite de la nation, avait été dans les deux siècles précédents le théâtre de quelques-unes des scènes les plus lugubres de notre histoire. C’était dans cette même salle des Cariatides que, presque au lendemain du jour où elle y avait rassemblé la cour pour célébrer les noces de sa fille et du roi de Navarre, Catherine de Médicis tenait conseil avec les Guise et préparait la Saint-Barthélemy; c’était là que, dix-neuf ans plus tard, le duc de Mayenne, pour venger la mort du président Brisson, faisait pendre aux barreaux des fenêtres quatre des plus fougueux partisans des Seize; c’était là enfin, dans la tribune que soutiennent les cariatides sculptées par Jean Goujon, que le corps de Henri IV, après le tragique événement de la rue de la Ferronnerie, avait été déposé, tandis qu’on allait porter à la reine la funeste nouvelle.
Il est assez probable toutefois que, à l’exception peut-être de Marie-Joseph Chénier, auteur du drame de Charles IX, représenté quelques années auparavant, personne dans l’assemblée n’avait l’imagination hantée par ce passé sinistre: pas plus que, dans un tout autre ordre de souvenirs, on n’était disposé à se rappeler les représentations données en 1658 par la troupe de Molière au lieu même où l’on se trouvait maintenant. La grandeur de l’événement présent suffisait de reste pour occuper la pensée de chacun, et d’ailleurs la transformation qu’on avait fait subir à la salle pour l’approprier à sa nouvelle destination ne permettait guère même aux regards d’être indifférents ou distraits.
Décorée pour la circonstance des statues d’illustres personnages français empruntées à divers monuments et dont quelques-unes, — les statues de Sully, de Descartes et de Bossuet entre autres, — ont été depuis lors transportées au palais qu’occupe actuellement l’Institut , couverte depuis la base des murs jusqu’aux voûtes des plus belles tapisseries des Gobelins et de trophées des drapeaux récemment conquis par les soldats de Valmy et de Jemmapes, de Hontdschoot et de Fleurus, la salle des Cariatides présentait, dans cette éloquente parure, un aspect bien différent de celui qu’elle gardait depuis la fin du règne de Louis XIV. Elle n’avait plus été, à partir de cette époque, qu’un magasin de hasard où l’on entassait pêle-mêle des fragments antiques, des plâtres, des objets mobiliers de toute espèce; elle devenait maintenant le sanctuaire du génie national personnifié dans ses représentants les plus glorieux, et pour donner une sanction officielle à cette prise de possession par l’Institut du local qui lui était livré, tous les membres du Directoire en grand costume, tous les ministres, accompagnés du corps diplomatique, étaient venus assister à la séance d’installation. Une estampe de l’époque nous a conservé la physionomie de cette scène où, malgré les habits d’une magnificence théâtrale et les chapeaux plus empanachés que de raison des directeurs, malgré ces contrefaçons de l’antique, à la fois fastueuses et maigres, que David avait mises à la mode jusque dans la forme des sièges et l’ajustement des draperies de tenture, tout respirait une gravité conforme au caractère moral de l’assemblée et aux idées qu’elle représentait.
La première séance publique de l’Institut ne dura pas moins de quatre heures. Outre le discours de Daunou, dont nous avons rapporté quelques passages, et ceux de Letourneur, président du Directoire, de Dussaulx, président de l’Institut, on y entendit la lecture de neuf mémoires sur des questions spéciales, rédigés par des délégués des deux premières classes; un à-propos en vers, la Grande Famille réunie, par Collin d’Harleville; une autre pièce de vers par Andrieux, et une ode de Lebrun sur l’Enthousiasme. Enfin, Vauquelin termina la séance par des expériences «sur les détonations du muriate suroxygéné de potasse, lorsqu’il subit une pression ou un choc», sorte de commentaire en action d’un travail sur ce sujet que Fourcroy venait de lire.
Dans tout cela, on le voit, la part de la troisième classe avait été absolument nulle pour les quatre sections réservées dans cette classe aux artistes, puisque aucun de ceux-ci n’avait pris la parole. Les séances publiques, qui se succédèrent de trimestre en trimestre dans le cours de la même année et jusqu’à la fin de l’année suivante, n’apportèrent aucun changement à cet état de choses. Chaque fois le programme demeura aussi chargé quant au nombre des communications scientifiques, philosophiques ou littéraires, aussi vide d’enseignements concernant l’art proprement dit. Rien de plus explicable sans doute, étant donné la répugnance en général des artistes à se servir, pour traduire leur pensée, d’autres intermédiaires que leurs instruments ordinaires de travail; mais en réalité rien de plus préjudiciable aux intérêts intellectuels d’un public réduit par là à s’accommoder d’instructions ou d’avis sans correspondance avec ses aspirations, encore moins avec ses habitudes. Quelles qu’eussent pu être les imperfections de la forme littéraire, n’aurait-on pas été par exemple plus heureux d’entendre Grétry parler de son art que de se sentir initié, par les dissertations de certains savants, à des secrets de physiologie chimique ou médicale divulgués au moins inopportunément dans un pareil milieu ? La longueur démesurée des séances publiques d’une part, de l’autre la nature de bon nombre des travaux dont il était donné communication, ne tardèrent pas à refroidir le zèle, sinon des auteurs de ces travaux eux-mêmes, au moins de ceux qui étaient appelés à les connaître. On commençait au dehors à se désintéresser de ce qui avait été d’abord accueilli avec un empressement unanime: il était temps de prendre des mesures, et c’est ce qui fut fait, pour que l’opinion déjà sur la pente de l’indifférence ne glissât pas jusqu’au détachement formel.
Cependant un événement politique renouvelé du régime de la Terreur et qui nous apparaît aujourd’hui comme la préface, sinon comme la justification anticipée, du 18 brumaire, le coup d’État de fructidor 1797 allait, en frappant entre autres victimes cinq membres de l’Institut, porter une cruelle atteinte à l’indépendance de ce grand corps, si hautement proclamée, l’année précédente, par ceux-là mêmes qui la sacrifiaient maintenant. Bien plus, parmi les proscripteurs, il s’en trouvait un, La Réveillère-Lépeaux, qui appartenait à l’Institut; de sorte qu’en mettant hors la loi ses collègues du Directoire, Carnot et Barthélemy, il supprimait aussi en eux deux de ses confrères, comme il se débarrassait sans plus de façon de trois autres, en prononçant la déchéance de Pastoret, de l’abbé Sicard et de Fontanes. Ces deux derniers faisaient partie de la classe de la littérature et des beaux-arts, et l’on ne devine guère les prétextes que les auteurs du coup d’État purent invoquer pour traiter en conspirateurs le vénérable instituteur des sourds-muets et un poète d’inclinations aussi peu agressives que le chantre du Verger. Quoi qu’il en soit, Fontanes et l’abbé Sicard ayant été rayés de la liste des membres de la troisième classe, on procéda presque aussitôt à leur remplacement, tandis que dans la première classe le général Bonaparte prenait possession du fauteuil d’où Carnot venait d’être chassé , et que dans la seconde classe Champagne et Lescallier devenaient les successeurs de Pastoret et de Barthélemy.
Peut-être sera-t-il permis de dire qu’en consentant à remplacer des confrères dépouillés de leur titre contre toute justice et tout droit, l’Institut ne laissait pas, au moins en apparence, d’accepter le fait accompli un peu facilement et un peu vite; peut-être, sans recourir à des protestations bruyantes, sans tenter des efforts de résistance inutiles d’avance dans les circonstances où l’on se trouvait, lui eût-il été possible, au nom de cette solidarité même établie par la loi organique, de témoigner quelque chose du sentiment de l’injure reçue et de prendre une autre attitude que celle d’une résignation toute passive. Sans doute, quand de nouvelles vacances viendront plus tard à se produire dans les classes décimées en 1797, l’Institut rouvrira ses rangs à ceux que le triste pouvoir d’alors avait proscrits; les quatre premières années du dix-neuvième siècle ne se seront pas écoulées encore que tous, sauf Barthélemy, auront été réélus par leurs anciens confrères ou réintégrés par arrêtés du gouvernement; mais au moment où l’iniquité était commise, fallait-il donc la subir sans donner même un signe de désapprobation, sans essayer, par quelque rappel, si réservé qu’il fût dans les termes, aux règlements et à la loi, de prévenir au moins le retour de pareilles violences? Cette docilité si générale et si prompte créait en réalité un dangereux précédent. Qui sait si le gouvernement de la Restauration n’en gardait pas le souvenir lorsque, à près de vingt ans d’intervalle, il entreprenait à son tour de sévir dans le sein de l’Institut contre d’autres ennemis ou d’autres suspects? Peut-être les ministres de Louis XVIII auraient-ils hésité à exclure de leurs académies respectives David, Monge, Grégoire et plusieurs autres, si la mesure prise autrefois par le Directoire avait rencontré chez les confrères des hommes qu’elle frappait moins d’empressement à se soumettre ou moins de disposition à se taire.
Aucun des artistes appartenant à la troisième classe n’avait été, nous l’avons dit, atteint par le coup d’État de fructidor. Les quatre sections formant la seconde moitié de cette classe demeuraient donc, quant au personnel qu’elles comprenaient, dans le même état qu’à l’origine; mais, en dehors de leur participation obligatoire aux travaux, aux élections, aux tâches, de quelque nature qu’elles fussent, imposées à l’ensemble de l’Institut, elles n’avaient eu jusqu’alors pour leur propre compte ni une existence fort remplie, ni des moyens d’influence fort directs. L’unité d’action en toutes choses dont on avait entendu faire la condition essentielle et comme la raison d’être de l’Institut, était un principe si littéralement observé qu’on avait été jusqu’à établir que les jeunes artistes à envoyer chaque année à Rome seraient désignés, non par leurs juges naturels les peintres, les sculpteurs et les architectes de la troisième classe, ni même sur les propositions de ceux-ci, mais par l’Institut en corps, statuant dans la plénitude de son pouvoir et suivant ses inspirations propres. A la différence près de la situation sociale des juges et des garanties que pouvaient offrir leurs caractères personnels, c’était au fond retomber dans l’erreur commise en 1793; c’était reconstituer avec d’autres éléments le jury des arts, sorti de l’imagination révolutionnaire de David et ayant fonctionné un moment de la manière que l’on sait.
On ne tarda pas heureusement à revenir sur cette imprudente décision. Lorsque, par une lettre en date du 4 mai 1796, le ministre de l’intérieur Benezech eut informé l’Institut que les concours aux prix de Rome, suspendus depuis trois ans, allaient être repris l’année suivante pour se succéder désormais sans interruption, on comprit que le mieux serait de laisser aux artistes seuls le soin d’apprécier les mérites relatifs des concurrents et de prononcer un jugement qu’il n’y aurait plus ensuite pour l’ensemble de l’Institut qu’à ratifier de confiance.
Quelque bonne volonté qu’on y mit pourtant, tout d’abord n’alla pas de soi. Il fallait, pour ce qui concernait les prix de Rome et le séjour en Italie des lauréats, compter avec les événements tragiques qui venaient de se produire de l’autre côté des monts, avec le meurtre du secrétaire de la légation de France, Bassville, assassiné en plein Corso par la populace romaine; avec les périls qu’avaient courus le directeur et les treize pensionnaires de l’Académie, — Girodet entre autres et le sculpteur Lemot, — obligés, à la veille d’une invasion de leur palais, d’aller chercher un refuge à Naples. Le Directoire exécutif avait bien pu, dès l’année 1795, décréter le rétablissement des fonctions de directeur de l’Académie de France à Rome, supprimées trois ans auparavant par la Convention ; il avait bien pu nommer Suvée à cette place de directeur vacante depuis la révocation de Ménageot en 1792: le tout n’en restait pas moins lettre morte. Suvée, dans l’attente d’un moment propice, continuait de séjourner à Paris, où il devait même forcément s’attarder jusqu’au commencement de 1801, et, de leur côté, les jeunes artistes auxquels le prix de Rome était décerné ne pouvaient profiter des avantages que cette récompense semblait leur assurer. C’est ainsi qu’un des lauréats du concours de 1797, Guérin, le futur peintre de Clytemnestre et de Didon, dut se résigner à ajourner indéfiniment son départ pour l’Italie et à remplir ses obligations de pensionnaire en exécutant à Paris les tableaux qui, dans d’autres circonstances, eussent constitué ses envois de Rome. Bien lui en prit d’ailleurs, puisqu’il dut à l’un de ces envois sur place le plus éclatant succès que, dans tout le cours de sa carrière, il lui ait été donné d’obtenir. L’apparition au Salon de 1799 de son Marcus Sextus, aujourd’hui au musée du Louvre, et qu’il peignit lorsqu’il n’était encore âgé que de vingt-cinq ans, produisit dans le public une sensation telle, elle procura du jour au lendemain au nom du jeune peintre une popularité si grande qu’on trouverait difficilement, même dans l’histoire des artistes le plus promptement arrivés à la gloire, l’équivalent d’un triomphe aussi universel et aussi rapide.
Peut-être, quelle qu’en soit au fond la très sérieuse valeur, le tableau de Guérin ne semble-t-il, à l’heure présente, justifier qu’incomplètement les applaudissements enthousiastes qui l’ont autrefois accueilli; peut-être les allusions qu’impliquait cette scène antique au retour récent des émigrés français dans leur pays, n’ont-elles plus pour nous toute l’éloquence qu’on leur prêtait à la fin du dix-huitième siècle. Enfin, si le fait très exceptionnel d’un talent formé à une autre école que celle de David put, au moment où il se produisit, ajouter à l’étonnement du public et l’intéresser d’autant plus à la cause de ce talent, une pareille curiosité historique ne saurait à beaucoup près exercer la même influence sur l’opinion de ceux qui, en face de l’œuvre de Guérin, cherchent, à plus de quatre-vingts ans d’intervalle, à s’en expliquer le succès. Quoi qu’il en soit, Guérin eut le rare mérite de ne se laisser ni étourdir par le bruit fait autour de son nom, ni détourner des efforts qu’il s’était promis de poursuivre par l’orgueil d’avoir du premier coup si pleinement réussi. Le peintre acclamé de tous, depuis les membres de l’Institut eux-mêmes jusqu’aux élèves des ateliers, l’auteur de ce tableau publiquement couronné dès les premiers jours de l’exposition, n’eut garde de se croire pour cela passé maître. Aussitôt que les circonstances politiques le permirent, il s’empressa de réclamer le privilège que lui conférait son titre de «Grand Prix» pour aller en Italie compléter ses études, comme si l’épreuve dont il venait de sortir vainqueur, et vainqueur avec tant d’éclat, n’eût été pour lui qu’un modeste début ou un simple encouragement à mieux faire .
Tandis que, de 1796 à 1800, le directeur in partibus et les pensionnaires théoriques pour ainsi dire de l’Académie de France à Rome attendaient à Paris que les armes françaises eussent achevé en Italie de leur déblayer le terrain, et que les traités successifs de Tolentino et de Campo-Formio eussent eu pour conséquence certaine une paix générale et durable, les routes conduisant d’Italie en France étaient activement utilisées; elles se couvraient de chariots chargés d’objets d’art de tous genres, dont le jeune général Bonaparte venait de dépouiller les villes qu’il avait soumises, pour en enrichir la capitale de son pays. Marbres antiques, tableaux des plus grands maîtres de la Renaissance, médailles et pierres gravées, tapisseries à sujets et manuscrits à miniatures, — tout avait été impitoyablement enlevé ; et pendant que cet inestimable butin était dirigé vers Paris, à un autre bout de la France nos frontières allaient s’ouvrir pour livrer passage aux caisses dans lesquelles étaient renfermés, avec la même destination, les plus précieux tableaux de la Belgique et de la Hollande. Bientôt le tout affluait au Louvre, trop petit pour contenir ces innombrables richesses, ou du moins pour leur assurer des places également en lumière et en vue. Il fallut se résigner à l’obligation de faire un choix entre tant de chefs-d’œuvre, et se contenter, faute d’espace, d’exposer seulement les plus universellement renommés; mais, avant de les installer sous le toit qui devait désormais les abriter, on résolut de les promener solennellement dans Paris, tant pour éblouir les regards de la foule par l’éclat d’une fête que pour avoir raison des objections qu’avait soulevées, même dans le monde des artistes, la première annonce des projets de spoliation.
La question en effet avait été, dès l’année 1796, publiquement discutée, tant au point de vue des intérêts de l’art qu’au point de vue des principes généraux et de la morale politique. Dans une brochure intitulée: Lettres sur le préjudice qu’occasionnerait aux arts et à la science le déplacement des monuments de l’art de l’Italie, Quatremère de Quincy s’était efforcé de plaider une double cause: celle des anciens maîtres dont les œuvres perdraient certainement une partie de leur éloquence et de leur féconde influence en apparaissant hors de leur milieu naturel, — et celle des peintres français eux-mêmes qui, une fois en possession de ces monuments de l’art italien, ne seraient en mesure d’en étudier et d’en comprendre que la lettre. «C’est une folie, écrivait-il, de s’imaginer qu’on puisse jamais, par des échantillons réunis dans un magasin de toutes les écoles de peinture, produire l’effet que produisent ces écoles dans leur pays.» Et ailleurs: «Ces statues antiques, ces peintures ainsi dépaysées, arrachées à toutes les comparaisons qui en rehaussent la beauté, perdront sous un ciel étranger la vertu instructive que les artistes allaient chercher en Italie... C’est avec vérité qu’on peut dire que le pays fait partie du muséum de Rome. Que dis-je? Le pays est lui-même le muséum.» L’énergique protestation de Quatremère de Ouincy se terminait par ces mots: «Si l’exemple une fois donné de la violation du dépôt commun vient à être suivi par toutes les puissances, voisines ou éloignées, que les hasards de la guerre ou les révolutions politiques rendraient maîtresses de l’Italie; si les richesses de l’art et de la science ne sont plus qu’un butin dont tout conquérant pourra faire sa proie,... de quel danger, je vous le demande, ne seraient pas pour la science et pour l’art les conséquences de cette manière de procéder nouvelle? »
Les journalistes, de leur côté, — ceux du moins qui n’étaient pas aux gages du Directoire, — soutenaient la même thèse, et quelquefois dans un langage plus irrité encore. Un d’entre eux, rédacteur du Journal littéraire, allait jusqu’à dire: «Quel autre qu’un barbare peut applaudir à la spoliation qu’on veut accomplir?» Enfin, huit membres de la troisième classe de l’Institut, — les peintres Vien, David et Vincent, les sculpteurs Pajou, Roland, Dejoux, Julien, et l’architecte Dufourny, — signaient, avec quarante-trois autres artistes diversement notables, une pétition au Directoire exécutif , dans laquelle ils exprimaient la crainte «que l’enthousiasme pour les productions du génie n’égarât sur les véritables intérêts des arts même leurs amis les plus ardents» Aussi conjuraient-ils le Directoire de «juger avec maturité cette importante question de savoir s’il serait utile à la France, s’il serait avantageux aux arts et aux artistes en général de déplacer de Rome les monuments de l’antiquité et les chefs-d’œuvre de peinture et de sculpture qui composent les galeries et les musées de cette capitale des arts». Et, pressentant sans doute que la question serait résolue par le Directoire dans le sens de ce «déplacement», les pétitionnaires demandaient qu’au moins, avant de rien enlever, «on chargeât de faire un rapport général sur cet objet une commission formée d’un certain nombre d’artistes et de gens de lettres choisis par l’Institut national, en partie dans son sein, en partie au dehors».
Les choses n’en suivirent pas moins leur cours comme le général Bonaparte et le Directoire l’avaient originairement entendu. On réfuta tant bien que mal les objections de Quatremère et de ses adhérents dans des articles de journaux concluant, suivant l’usage, «au nom de l’immense majorité du public», à l’exécution immédiate d’une mesure qui devait «faire de Paris le muséum universel de la France et de l’Europe». La pétition des artistes membres de l’Institut et de leurs confrères du dehors demeura sans réponse; on s’arrangea pour qu’une contre-pétition tendant au transport dans notre pays des œuvres en cause pût au besoin être opposée au vœu des réclamants, et des commissaires nommés sous sa seule responsabilité par le Directoire reçurent l’ordre de procéder en Italie, aussi rapidement que possible, à l’emballage et à l’expédition des objets destinés au musée du Louvre ou aux grands établissements scientifiques de Paris; après quoi l’on s’occupa des préparatifs de la fête dont nous avons parlé. On comptait, nous l’avons dit aussi, sui la grandeur du spectacle pour enflammer l’orgueil patriotique de la foule et pour subjuguer de haute lutte l’imagination de ceux-là mêmes qui avaient d’abord résisté, au nom du droit et de la raison.
Le double résultat que l’on se proposait d’atteindre fut effectivement obtenu. Ce fut avec un enthousiasme unanime que les Parisiens de toutes les classes virent passer devant eux la longue série de ces incomparables dépouilles, et les artistes à leur tour, — ceux qui s’étaient montrés jusqu’alors les plus récalcitrants, aussi bien que les autres, — n’eurent plus, en face de ce qui leur était livré, que le sentiment passionné et, en quelque sorte, l’enivrement de la possession. Ainsi s’explique l’apparent démenti résultant de la présence à cette fête de l’Institut tout entier, c’est-à-dire y compris les membres de la troisième classe qui, avec Vien et David, avaient protesté d’avance contre le fait maintenant accompli. Tous les hommes d’ailleurs appartenant, à un titre quelconque, au monde des sciences, des lettres ou des arts, avaient été invités à prendre place dans le cortège qui devait parcourir d’un bout à l’autre les boulevards pour se rendre au Champ de Mars, où l’attendraient les ministres et les membres de l’Institut; tous, depuis les hauts fonctionnaires de l’enseignement et les administrateurs des musées jusqu’aux étudiants du quartier latin, jusqu’aux élèves de l’École des beaux-arts et du Conservatoire, avaient été appelés à l’honneur de participer, non pas à ce que l’on appelait, avec autant de niaiserie que d’emphase, «l’installation sur une terre libre des monuments arrachés à l’asservissement », mais aux hommages que commandaient tant de glorieux chefs-d’œuvre.
Le jour venu, 9 thermidor an VI (27 juillet 1798), chacun était à son poste sur le quai voisin du Jardin des plantes, choisi comme lieu de rendez-vous, parce que c’était là qu’avaient été débarqués les Chevaux colossaux de Venise et les autres monuments trop volumineux pour être expédiés d’Italie par la voie de terre . Bientôt le cortège se mit en mouvement; il était partagé en trois grandes divisions, accompagnées chacune de détachements de cavalerie et de corps de musique militaire.
En avant de la première division, comprenant six chars chargés de minéraux, de pétrifications de Vérone, de végétaux de toute espèce, palmiers, cactus, etc., marchaient les professeurs du Muséum d’histoire naturelle; ces six premiers chars étaient suivis de quatre autres supportant, comme dans les anciens triomphes romains, des cages où l’on voyait des lions et des lionnes d’Afrique, d’autres animaux féroces, suivis eux-mêmes encore de chameaux et de dromadaires qu’avait fournis la forêt du Gombo, près de Pise.
Sur la bannière flottant en tête de la seconde division on lisait: «Livres, manuscrits, médailles, musique, caractères d’imprimerie de langues orientales» ; le tout remplissant six chars qu’accompagnaient les professeurs du Collège de France, les professeurs de l’École polytechnique et les élèves de cette école, les gardes des archives et des bibliothèques publiques, en un mot le personnel complet des établissements scientifiques, précédant les délégués des étudiants, des correcteurs d’imprimerie, des éditeurs et des libraires.
Enfin les administrateurs et les divers fonctionnaires du Musée central des arts, du Musée spécial de l’École française, du Musée des monuments français, les professeurs des écoles de peinture, de sculpture et d’architecture entourés de leurs élèves, marchaient aux premiers rangs de la troisième division, composée de vingt-neuf chars sur lesquels apparaissaient, au milieu de trophées symboliques, de drapeaux et de guirlandes , les principales œuvres de la peinture et de la sculpture enlevées à l’Italie. C’étaient d’abord deux chars portant les quatre célèbres Chevaux de bronze, pris à Venise ainsi que le Lion de Saint-Marc, et qui devaient, sous l’empire, orner, celui-ci une fontaine au centre de l’esplanade des Invalides, ceux-là l’arc de triomphe de la place du Carrousel. Puis, sur les chars suivants, se dressaient les statues antiques les plus renommées dont, par un euphémisme officieux, on se vantait d’avoir obtenu du gouvernement pontifical «la cession» : l’Apollon du Belvédère et le Laocoon, le Gladiateur mourant et le Discobole, vingt autres marbres admirables encore. Enfin, pour clore ce long défilé de chefs-d’œuvre, la Vierge de Foligno et la Transfiguration de Raphaël, des tableaux de Titien, du Corrège, de Paul Véronèse, achevaient d’étonner les regards des uns, de saisir et d’émouvoir l’intelligence des autres, d’inspirer à tous la même fierté en face de ces témoignages matériels des récentes victoires de la France.
Qui eût dit alors que tant de trésors, dont nous nous croyions à jamais les possesseurs, ne seraient entre nos mains qu’un dépôt qu’il nous faudrait rendre à courte échéance; qu’avant vingt ans nous serions obligés de livrer, à notre tour, ce qui était devenu notre bien; qu’en un mot, on invoquerait contre nous ces mêmes droits de la force dont nous avions au moins imprudemment usé ? Sans doute, — nous aurons l’occasion de revenir plus tard sur ce sujet, — les restitutions opérées en 1815 ne furent pas seulement les résultats de la violence, et, pas plus que la Messénienne irritée de Casimir Delavigne, les vers railleurs de Béranger ne sauraient aujourd’hui donner le change sur les vrais caractères du prétendu «vol fait par des rois» ; mais on comprend de reste qu’au moment où ils s’accomplirent, les recouvrements dont il s’agit durent paraître des déprédations, et que, à l’exemple de leur confrère Denon, les membres de l’Institut, autrefois hostiles aux projets du Directoire, n’aient plus ressenti que l’amertume de l’humiliation imposée à la patrie. — Mais revenons aux heures où l’on n’en est encore qu’à l’orgueil du triomphe et à la joie sans préoccupation qu’inspire l’éclat du spectacle présent.
Lorsque, après avoir traversé Paris dans l’ordre que nous avons indiqué, le cortège fut arrivé au Champ de Mars, «tous les chars, dit un témoin de la scène , se rangèrent dans l’arène sur trois lignes, ceux qui les avaient accompagnés formant un demi-cercle devant la statue de la Liberté. Les artistes du Conservatoire exécutèrent le Poème séculaire, d’Horace, mis en musique par Philidor; puis une Ode de Lebrun, musique de Lesueur; après quoi les commissaires envoyés en Italie se sont avancés vers l’autel de la Patrie, et ont remis au ministre de l’intérieur, entouré des membres de l’Institut, la liste des objets qu’ils avaient recueillis...»
«Le lendemain, 10 thermidor, à trois heures, les autorités constituées et les ambassadeurs se sont réunis dans la Maison du Champ de Mars . Le Directoire exécutif s’y est rendu accompagné des ministres. A quatre heures, le Directoire et le cortège ont été de la Maison du Champ de Mars à l’autel de la Patrie, au son de la musique militaire. Les chars attelés étaient rangés dans le Cirque. Le Directoire et tout le cortège ayant pris place, le Conservatoire a exécuté une symphonie et ensuite l’Invocation à la Liberté. Puis le ministre de l’intérieur a présenté au Directoire les commissaires d’Italie, et les monuments recueillis par eux. Le président a remis à chacun de ces commissaires une médaille sur laquelle était gravée une figure de la France et, de l’autre côté, cette légende: «Les sciences et les arts reconnaissants.» Ensuite, un aérostat orné de guirlandes et de drapeaux tricolores s’est élevé dans les airs. Au moment où le Directoire a levé la séance, le Conservatoire de musique a exécuté le Chant du départ. Le soir, on a renouvelé l’illumination de la veille, et il y a eu dans le cirque des orchestres pour les danses.»
Sauf ces danses et ces lampions, assez hors de place, à ce qu’il semble, dans le voisinage des monuments les plus sévères de la science et des plus nobles œuvres de l’art, le programme de la fête célébrée les 9 et 10 thermidor avait été réglé de manière à donner à cette solennité publique plus de sérieux et de dignité que n’en avaient eu les représentations en plein air organisées, quelques années auparavant, tantôt au bénéfice de la Nature régénérée) tantôt comme témoignage de bienveillance pour l’idée d’un Être suprême. Aussi, en participant à cette fête où il ne s’agissait plus d’aller, comme autrefois, boire, avec plus ou moins de componction, l’eau qui jaillissait des mamelles d’une statue de la Nature, ou d’assister à l’embrasement de mannequins figurant le «monstre de l’athéisme» et ses «acolytes ordinaires», — y compris, on ne sait trop pourquoi, la fausse simplicité, — les membres de l’Institut ne descendaient pas au rôle de comparses dans une comédie révolutionnaire. Ils exerçaient tout naturellement la haute fonction qui leur appartenait.
Tandis que les membres de l’Institut faisant partie de la troisième classe s’associaient ainsi, dans nos murs, à une manifestation toute à la gloire de l’art antique et de l’art italien, un certain nombre de leurs confrères de la première classe travaillaient, loin de la France, à ouvrir une voie nouvelle aux études scientifiques. La commission d’Egypte, sous la direction de Monge et de Berthollet, préparait les Mémoires dont la publication par les soins du général Bonaparte révélait au monde savant, dès le commencement de l’année 1800 , les premiers secrets arrachés à la terre et aux monuments des Pharaons. Elle recueillait les éléments du grand ouvrage qui, sous le titre de Description de l’Égypte, devait, en attendant les découvertes décisives de Champollion et les travaux complémentaires de ses successeurs, mettre sous les yeux du public un ensemble de renseignements aussi précieux qu’imprévus sur l’«état ancien» et sur l’«état moderne» du pays qu’elle avait reçu la mission d’explorer. Enfin, une sorte d’annexe de l’Institut de France, l’Institut du Caire, fondé le 20 août 1798, réunissait des savants, des lettrés, des artistes, les uns déjà membres de l’Institut national, les autres simplement attachés à la commission qui avait suivi l’armée, tous soumis à la même obligation de communiquer régulièrement leurs travaux à leurs confrères de France et de répondre, par l’envoi de mémoires développés, aux questions que ceux-ci jugeraient à propos de leur adresser sur quelque point d’histoire, de science ou d’archéologie.
Les deux premières classes de l’Institut national s’empressèrent d’user du droit qui leur était ainsi conféré. Une correspondance active s’établit entre les commissaires désignés par ces deux classes et les membres de l’Institut du Caire appartenant aux sections de physique et d’économie politique ; il ne paraît pas toutefois que les membres de la troisième classe aient été animés du même zèle, ni stimulés par la même curiosité. Ils avaient bien chargé trois d’entre eux, antiquaires ou orientalistes de profession, — Dupuis, Mongez et Langlès, — de demander des informations sur quelques problèmes d’archéologie ou de linguistique; mais ils semblaient par là s’être désintéressés des questions relatives à l’art proprement dit, ou tout au moins avoir, volontairement ou non, laissé de ce côté péricliter leurs privilèges. Rien de plus explicable, d’ailleurs, que ce rôle un peu effacé des artistes membres de la troisième classe dans tout ce qui concerne à cette époque l’action extérieure et, à l’intérieur, les occupations réglementaires de l’Institut. Mal préparés, sinon étrangers, par la nature même de leurs études et de leurs occupations habituelles, à la plupart des affaires qu’il s’agissait de régler en commun; perdus pour ainsi dire, en raison de leur petit nombre, au milieu d’une foule de savants, de philosophes, d’hommes politiques dont ils n’étaient en mesure ni de discuter à bon escient les opinions, ni même de parler couramment la langue, — ils leur abandonnaient le soin d’engager et de poursuivre toutes les entreprises, de tout diriger, de statuer sur tout, et se contentaient le plus ordinairement, à l’heure des votes, d’accepter de confiance des décisions qu’ils étaient censés devoir contrôler.
Le moment était proche, heureusement, où cette situation toute dépendante allait changer; où, grâce à une répartition moins arbitraire des éléments et des forces qu’on avait d’abord confondus, les diverses fractions de l’Institut acquerraient, sans préjudice pour l’ensemble, l’homogénéité qui manquait plus ou moins à chacune d’elles; où la troisième classe, enfin, exclusivement composée d’artistes, aurait désormais son caractère bien particulier et sa physionomie bien nette.