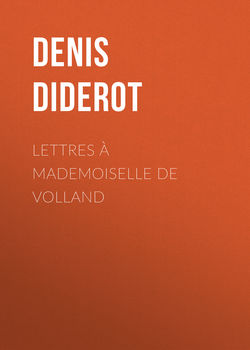Читать книгу Lettres à Mademoiselle de Volland - Дени Дидро, Дені Дідро, Denis Diderot - Страница 12
LETTRES À SOPHIE VOLLAND
XI
ОглавлениеÀ Langres, le 12 août 1759.
Voici sur quoi j'ai fondé la paix domestique. Il m'a semblé que ma sœur était un peu fatiguée de l'administration des affaires, et qu'elle s'était fait des principes d'économie qui n'étaient point ceux de l'abbé. L'abbé veut jouir; sa sœur veut se mettre à l'abri de tout événement. L'abbé aime la compagnie, telle quelle, et la table; ma sœur se plaît avec peu de monde, et veut être honorable à propos et sans profusion. L'abbé, dans ses tournées ecclésiastiques, a fait des connaissances de toute couleur et de toute espèce, qui en useront avec lui comme il en usait avec elles. Ma sœur pressent que la maison va devenir un hospice; elle craint de supporter le poids des soins domestiques, de perdre son repos, de dissiper son revenu, et de voir circuler toute l'année autour d'elle des visages inconnus et déplaisants. C'est un plaisir que de l'entendre peindre tous ces gens-là, qu'elle n'a jamais vus qu'en imagination, et rendre leurs conversations comme elles lui viennent. Un des coins de son caractère, c'est d'être gaie dans sa mauvaise humeur, et de faire rire quand elle se tâche. Quand elle a dit, et qu'on a ri, elle croit avoir cause gagnée, et la voilà contente. Qu'ai-je fait? J'ai commencé par désabuser l'abbé d'une jalousie préconçue, je ne sais sur quoi ni comment, que ma sœur m'était plus chère que lui. J'ai tâché de lui faire entendre que je l'aimerais cent fois plus encore qu'il ne le supposait, qu'il y aurait une chose que j'aimerais davantage, c'est la justice. J'ai ménagé sa délicatesse, j'ai prévu et évité tout ce qui pourrait lui donner de l'ombrage; je me suis assuré de son âme, ensuite j'ai travaillé. Ma sœur avait une amie peu riche; je lui ai persuadé de la prendre avec elle; l'abbé y a consenti; elle est à présent installée; c'est elle qui fait aller la maison, et ma sœur n'a plus de souci que celui qu'elle veut bien prendre. Il leur en coûte la pension d'une petite nièce de cette amie qui demeurait avec sa tante, et qu'il a fallu placer en lieu convenable et sûr; mais qu'est-ce que cela? Rien. Il s'agissait d'arranger la dépense commune de manière que l'abbé dépensât tant qu'il lui plairait, que sa sœur économisât à sa fantaisie, et que l'un ne parût point à charge à l'autre. J'ai proposé à l'abbé d'accepter une pension de sa sœur: ils y ont consenti l'un et l'autre; j'ai fixé la pension, et tout est fini. Des trois maisons que nous avions, nous sommes convenus d'en vendre une; des deux qui restent, l'une à la ville, l'autre à la campagne, ils occuperont la première, elle leur appartiendra; ils m'en rembourseront le tiers. Celle de la campagne sera commune aux trois enfants. C'est le cellier de nos vendanges et le grenier de nos moissons. On a fait du reste trois lots. Ils m'ont offert le premier, le plus avantageux sans doute; je ne suis pas intéressé, mais j'aime les procédés honnêtes, et je ne saurais vous dire combien le leur m'a touché. Ils ont tiré les deux autres au sort. Au reste, ces partages moins réels que simulés ne sont que des précautions raisonnables contre les inconvénients à venir. Les revenus continueront à se percevoir en masse; mon frère et ma sœur géreront, et tous les ans on m'enverra ma portion forte ou faible, selon les années bonnes ou mauvaises. Nous serons les uns envers les autres garants des événements; la grêle tombera également sur tous; nous profilerons ou nous souffrirons ensemble; nos biens sont séparés; chacun a le sien; nous nous sommes associés contre les événements. Ah! cher père! si votre âme errait entre vos enfants, qu'elle serait contente d'eux! Tout cela s'est fait en un quart d'heure, et d'une manière si douce, si tranquille, si honnête, que vous en auriez pleuré de joie toutes deux. Je n'ai pas voulu entendre parler du mobilier; ma sœur et l'abbé le partageront. Mais je soupçonne qu'ils ont en lié mon lot au prorata. Tout est bien de ma part et de la leur. On a vendu des effets inutiles; des créanciers se sont acquittés, d'autres s'acquitteront dans la suite. Il y a des rentes échues; il y a une bourse commune qui se grossit de jour en jour; quand elle renfermera ce qui nous est dû, on l'ouvrira, et nous partagerons après que les dernières volontés de mon père seront accomplies. Il y a beaucoup d'autres petits détails où vous reconnaîtriez le même esprit, et dont je vous entretiendrais s'ils m'étaient présents; ils vous intéresseraient, puisque vous m'aimez. On vient de m'apporter l'acte de partage: c'est un homme d'honneur qui l'adressé. Nous le transcrirons, nous le signerons, nous nous embrasserons, et nous nous dirons adieu.
Je crains d'avance ce moment; mon frère et ma sœur le craignent aussi. Il était fixé à lundi; mais ils m'ont demandé quelques jours de plus; comment les refuser? Ils ne me reverront peut-être de longtemps. Pourvu que madame votre mère me pardonne ce délai! Je l'espère. L'abbé voulait m'entraîner à son prieuré. Un ami qui habite les forêts en était sorti pour me voir. Je lui avais promis une visite; mais l'abbé s'est départi de son envie, et je manquerai de parole à l'ami. Je regrette un jour qui me tient éloigné de vous. Je regrette aussi cette lettre qui m'attend à présent à Isle; elle est entre les mains de madame votre mère; elle y restera trop de temps. Je redoute le moment où elle me la remettra. Comment me l'offrira-t-elle? comment la recevrai-je? Nous serons troublés tous les deux; elle verra mon trouble; je devinerai le sien; nous garderons le silence, ou, si nous parlons, je sens que je bégayerai, et je n'aime pas à bégayer. Vous croyez que j'aurais le courage de demander une plume et de l'encre pour vous écrire? vous me connaissez bien!
Les habitants de ce pays ont beaucoup d'esprit, trop de vivacité, une inconstance de girouettes; cela vient, je crois, des vicissitudes de leur atmosphère qui passe en vingt-quatre heures du froid au chaud, du calme à l'orage, du serein au pluvieux. Il est impossible que ces effets ne se fessent sentir sur eux, et que leurs âmes soient quelque temps de suite dans une même assiette. Elles s'accoutument ainsi, dès la plus tendre enfance, à tourner à tout vent. La tête d'un Langrois est sur ses épaules comme un coq d'église au haut d'un clocher: elle n'est jamais fixe dans un point; et si elle revient à celui qu'elle a quitté, ce n'est pas pour s'y arrêter. Avec une rapidité surprenante dans les mouvements, dans les désirs, dans les projets, dans les fantaisies, dans les idées, ils ont le parler lent. Pour moi, je suis de mon pays; seulement le séjour de la capitale et l'application assidue m'ont un peu corrigé. Je suis constant dans mes goûts; ce qui m'a plus une fois me plaît toujours, parce que mon choix est toujours motivé: que je haïsse ou que j'aime, je sais pourquoi. Il est vrai que je suis porté naturellement à négliger les défauts et à m'enthousiasmer des qualités. Je suis plus affecté des charmes de la vertu que de la difformité du vice; je me détourne doucement des méchants, et je vole au-devant des bons. S'il y a dans un ouvrage, dans un caractère, dans un tableau, dans une statue, un bel endroit, c'est là que mes yeux s'arrêtent; je ne vois que cela; je ne me souviens que de cela; le reste est presque oublié. Que deviens-je lorsque tout est beau? Vous le savez, vous, ma Sophie, vous le savez, vous, mon amie; un tout est beau, lorsqu'il est un; en ce sens Cromwell est beau, et Scipion aussi, et Médée, et Aria, et César, et Brutus. Voilà un petit bout de philosophie qui m'est échappé; ce sera le texte d'une de vos causeries sur le banc du Palais-Royal. Adieu, mon amie; dans huit jours d'ici j'y serai, je l'espère. Je ne vous écrirai pas que je vous aime; je vous le dirai, je vous le jurerai, vous le verrez, et vous serez heureuse et je le serai aussi; et la chère sœur ne le sera-t-elle pas?