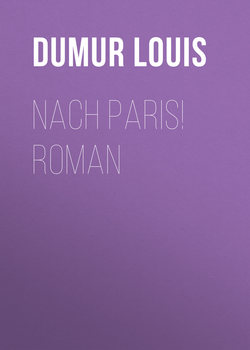Читать книгу Nach Paris! Roman - Dumur Louis - Страница 5
IV
Оглавление– Où diable sommes-nous? s'écriait, vingt-six heures plus tard, l'élégant lieutenant von Bückling en promenant son monocle ahuri et son oeil mal éveillé sur un paysage qu'il ne connaissait pas.
Le train s'était arrêté le long d'un interminable quai de débarquement, au milieu d'un plexus de voies de garage et de rampes de chargement. De droite et de gauche, au delà des lignes, se dessinaient dans le fin brouillard de l'aurore des toits de baraquements et des silhouettes de tentes. Une colline estompait au loin sa forme indécise qu'égratignait le coup d'ongle d'un clocher.
– Où diable sommes-nous?
Actifs, nerveux ou bouffis de sommeil, officiers et sous officiers dégringolaient des wagons, se concertaient hâtivement avant de procéder au débarquement du bataillon. Sur le quai, jambes écartées, la badine à la main et le cigare à la bouche, le lieutenant colonel Preuss et le feldwebel Schlapps nous attendaient, avec un petit sourire satisfait dans les volutes de leur fumée, comme pour nous dire: – Vous allez voir quels beaux cantonnements nous vous avons préparés!
Mais ce qu'il fallut voir, surtout, ce fut la rencontre de Schlapps et du capitaine Kaiserkopf. Elle fut touchante. On eût cru que les deux hommes allaient s'embrasser.
– Ah! cochon de feldwebel! s'écriait jovialement Kaiserkopf, tu m'as bien manqué depuis huit jours que tu es loin!
– Ne m'en parlez pas, capitaine! S'il n'y avait pas eu tant à faire, j'aurais crevé d'ennui par ici. Pas une femme dans ce nom de Dieu de pays!
– Mais où diable sommes-nous? continuait à demander le lieutenant von Bückling, battant d'un talon énervé l'asphalte du quai.
Schimmel, qui semblait s'y reconnaître, répondit, après avoir identifié ce qui était visible du paysage:
– Ce doit être le camp d'Elsenborn.
La brume légère se déchira comme une gaze au vif coup de ciseaux d'un soleil rayonnant. Les plans s'éclairèrent et les lieux se précisèrent. Partout, entre les horizons de sapins, surgissaient de longues constructions basses au toit de zinc. Çà et là, des édifices plus hauts, une maison à deux étages, la tourelle d'un observatoire, arrêtaient le regard. Des drapeaux flottaient hissés à des mâts.
Extrait de son train, le bataillon se dirigea avec armes et bagages sur ses cantonnements.
Le camp grouillait d'une vie intense et mystérieuse. De toutes ses ruelles et de tous ses carrefours, par les trous de toutes ses tentes et les portes de toutes ses baraques sortaient des myriades de soldats gris, qui s'agitaient, circulaient, couraient portés sur leurs deux pattes, se croisaient en tous sens, leur grosse tête ronde dominée par la corne pointue de leur casque ou l'antenne de leur fusil. Il y en avait de toutes les sortes: les plus nombreux, les fantassins de la ligne, fourmis guerrières, aux boutons jaunes, aux parements rouges, à la longue baïonnette aiguë comme une tarière; puis les gros scarabées de l'artillerie, avec leur casque à boule, leur col noir, leurs pattes d'épaules à grenade et leur baïonnette courte; les pionniers, piocheurs et fouilleurs, tout bossus de leur sac chargé d'outils; les chasseurs, verdâtres comme des sauterelles, avec leurs passeports vert clair et leur singulier shako à forme acridienne; les hussards, au dolman étroit articulé de brandebourgs; les uhlans à chapska plate comme un dos de punaise; les infirmiers, les brancardiers, les télégraphistes et les aérostiers, le bâton d'Esculape à la manche ou la lettre à l'épaule, porteurs de civières ou tendeurs de fils, et les grands cuirassiers haut bottés, membrus et coléoptériques, semblables aux gros oryctes boursouflés, la corne au nez et le cuir aux pattes, zigzaguant partout lourdement, l'air ahuri sous leur énorme casque.
Si le silence était prescrit dans la caserne de Magdebourg, la fourmilière d'Elsenborn échappait à cette contrainte. Entourée d'un large désert de forêts de sapins, nulle oreille indiscrète n'en pouvait surprendre l'extraordinaire bruissement, nul œil n'en pouvait soupçonner l'invraisemblable rassemblement. Aussi tout le camp retentissait-il d'un immense bourdonnement qui devait couvrir plusieurs kilomètres à la ronde. Les stridences des cornets, la sibilation des fifres, l'ardente crécelle des tambours menaient un vacarme incessant. Au milieu des résonances des cuivres, du tintement des cymbales, des lourdes décharges des caisses, les musiques de régiment s'évertuaient à battre l'air de leurs éclats. Des galopades de chevaux pétillaient. Des trains ronflaient comme de faux bourdons. Des automobiles vrombissaient. Libérée, l'innombrable voix des troupes se répandait en sonorités surprenantes, vibrait, crépitait, grinçait, grésillait, crissait, cliquetait, chantait, s'égosillait. Des frémissements d'élytres, des claquements d'ailes, des frottements d'articles battaient de tous côtés, comme si l'énorme amas ravageur s'apprêtait à prendre subitement son vol pour aller s'abattre quelque part au loin.
Le lieutenant-colonel Preuss et le feldwebel Schlapps avaient raison d'être fiers de leurs préparatifs. Nos cantonnements étaient excellents. Les soldats occupaient de vastes dortoirs, frais et propres entre leurs parois de sapin; les officiers avaient chacun deux chambres étroites, l'une avec le lit de sangle, l'autre meublée d'une table et de deux chaises; le colonel von Steinitz disposait pour lui seul et ses ordonnances d'une petite maison isolée. Il y avait des cuisines, des boulangeries, un casino pour les officiers, un petit théâtre pour les soldats, le tout également en bois. Le temps était superbe, il faisait très chaud; après la buée trouble de la caserne de Magdebourg, nous respirions avec délice le plein air libre du camp, chargé des aromes de l'été et du souffle vivifiant des forêts.
Un jour, deux jours passèrent. Des troupes partaient, d'autres arrivaient. Le long des voies qui ceignaient le camp, c'était un continuel mouvement de trains regorgeant d'hommes. On voyait, le jour, leurs anneaux onduler comme des serpents et l'on entendait, la nuit, leurs sifflements. Un troisième jour s'écoula: c'était le premier août. N'eût été l'incertitude où nous étions de ce qui se préparait, le séjour d'Elsenborn ne nous eût pas paru désagréable. De modestes exercices occupaient une partie de notre temps et maintenaient les troupes en haleine sans les fatiguer. Kasper, mon exempt, me rendait les plus grands services et me déchargeait de toutes les basses besognes du sous-officier. J'en profitais pour fréquenter les officiers. J'écoutais leurs conversations, j'observais leurs caractères, j'enregistrais leurs opinions; j'essayais de me faire une idée juste sur les graves événements qui s'élaboraient. Mais, pour le moment, l'atmosphère d'attente où nous nous trouvions énervait et déconcertait les esprits. Nous ne savions rien. De rares journaux filtrant de Malmédy avec un jour de retard ou apportés par les survenants passaient de mains en mains. Nous apprenions ainsi que les premières hostilités avaient éclaté entre Autrichiens et Serbes, que l'Allemagne venait de demander des explications à la Russie sur la mobilisation de ses troupes, que l'état de danger de guerre avait été déclaré. Les bruits les plus étranges couraient. On assurait que la France effrayée allait rompre son alliance avec la Russie, que la révolution grondait à Paris, que le Président de la République avait été assassiné.
– En tout cas, disait Schimmel, les Français doivent être à l'heure actuelle dans une belle peur. Je les connais. Ce sont des pacifistes à trois poils. Ils ne marcheront pas.
– Ce que je voudrais savoir, moi, faisait Kœnig, c'est où l'on va nous envoyer. Il me semble que nous sommes bien au nord.
Cette observation requit tout notre intérêt quand nous apprîmes du major von Nippenburg qu'il y avait des troupes plus au nord encore. Il s'en concentrait à Eupen, à Aix-la-Chapelle, et jusqu'à Rheydt et Crefeld.
– Il faut être prêt à tout, expliquait-il mystérieusement.
Mais, à part ce renseignement accessoire et en dépit de ses airs entendus, le major von Nippenburg ne paraissait pas en savoir beaucoup plus long que nous. Comme nous, il attendait des ordres. Le colonel von Steinitz était-il mieux informé? C'est possible, mais personne n'eût osé l'interroger. Il se cantonnait dans une réserve hautaine, dont il ne se départait qu'à l'égard du joli lieutenant von Bückling. Mais la faveur marquée qu'il lui témoignait ne procédait pas de sympathies d'ordre militaire et les confidences dont il l'honorait n'avaient rien de stratégique.