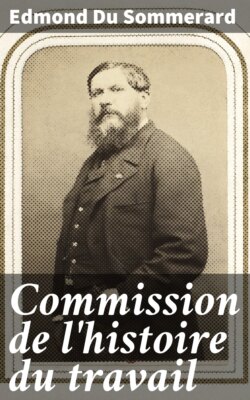Читать книгу Commission de l'histoire du travail - Edmond Du Sommerard - Страница 4
ORGANISATION DE L’EXPOSITION DE L’HISTOIRE DU TRAVAIL.
ОглавлениеLa Commission impériale, en décidant, par arrêté du ministre d’État, son vice-président, en date du 8 janvier 1866, qu’une galerie spéciale serait réservée, au Champ-de-Mars, pour l’installation d’une exposition rétrospective qu’elle désignait d’avance sous le titre d’Histoire du Travail, n’a pas cédé, ainsi que quelques personnes ont paru le supposer dans le principe, à la pensée, bien légitime du reste, de donner une attraction de plus à l’Exposition universelle de 1867. Le but qu’elle se proposait était d’un caractère plus élevé, et nous le trouvons défini en quelques mots dans l’exposé sommaire qui précède l’arrêté constituant la Commission de l’Histoire du Travail:
«Faciliter, pour la pratique des arts et l’étude de leur histoire,
«la comparaison des produits du travail de l’homme aux di-
« verses époques et chez les différents peuples; fournir aux
«producteurs de toute sorte des modèles à imiter, et signaler
«à l’attention publique les personnes qui conservent les œu-
« vres remarquables des temps passés.» Tel était le programme tracé dès le premier jour à la Commission de l’Histoire du Travail, chargée, sous la présidence du comte de Nicuwerkerke, surintendant des Beaux-Arts, d’organiser et de mener à bonne fin l’exposition nouvelle à laquelle chacune des nations représentées au Champ-de-Mars allait être appelée à apporter son concours.
L’étude des temps anciens est devenue de nos jours, pour ainsi dire, un besoin général, et il est peu de personnes qui ne s’y associent d’une manière plus ou moins directe. L’indifférence dont nos antiquités nationales, celles des premiers temps de la monarchie, du moyen âge et des règnes qui l’ont suivi, étaient l’objet de la part du plus grand nombre, il y a un demi-siècle à peine, a fait place au respect le plus sincère pour les souvenirs du passé et à la recherche passionnée des œuvres d’art produites par les âges qui nous ont précédés. Cette réaction salutaire vers les époques principales de l’art et de l’industrie de nos pères s’est accomplie successivement de période en période, en commençant par le moyen âge et la renaissance, et en se terminant aujourd’hui par les œuvres primitives des temps les plus reculés, après avoir successivement remis en lumière les beaux ouvrages du XIIIe, du XIVe et du XVe siècle, ceux des règnes de François Ier et de Henri II, les éclatants produits du siècle de Louis XIV et des deux dernières périodes antérieures à la Révolution; si bien que, au temps où nous sommes, en dehors de nos collections publiques, de nos musées et de nos bibliothèques, les galeries particulières qui n’étaient qu’une rare exception au commencement de ce siècle, sont nombreuses autant que leurs éléments sont variés, et que les richesses qu’elles renferment forment un puissant appoint pour l’histoire de l’art et de l’industrie de nos aïeux.
L’exposition de l’Histoire du Travail n’était pas sans précédents; déjà à Londres en 1862, pendant la dernière exposition universelle, l’administration du Kensington Museum réunissait, dans les bâtiments dont elle a la disposition, une brillante collection de monuments de toute nature et d’objets de toute provenance appartenant aux siècles passés. Ces monuments, confiés par leurs propriétaires, venaient s’ajouter à ceux que renfermaient les galeries du musée et formaient un ensemble fort remarquable, malgré l’absence de méthode dans le classement et la confusion des nationalités. En 1865, à Paris, un premier essai du même genre était tenté par une réunion d’artistes et d’industriels éminents dont les efforts ont été couronnés par un succès justement mérité. L’exposition rétrospective de l’Union des Beaux-Arts appliqués à l’Industrie, dirigée par M. Guichard, l’actif président de cette association, avec le concours de ses collègues qui n’avaient reculé devant aucun sacrifice pour mener à bonne fin l’œuvre entreprise, avait reçu du public l’accueil le plus sympathique. Mais cette fois, au palais des Champs-Élysées, comme en 1862, au Kensington Museum, l’exposition rétrospective embrassait les objets d’art de tous les siècles et de toutes les contrées, sans distinction d’origine, d’époque et de provenance; et néanmoins, les richesses qu’elle présentait et dont la plupart, conservées dans les galeries particulières, étaient ignorées du public, ont été, nous le répétons, l’objet d’une faveur toute spéciale. Le résultat obtenu par l’Union centrale, résultat sans précédent chez nous, a été aussi complet que possible, et nous sommes heureux de pouvoir en rendre, une fois de plus, le sincère témoignage au comité organisateur de cette excellente institution.
L’exposition de l’Histoire du Travail de 1867, partant d’un point de départ tout autre, avait pour première base le principe absolu des divisions de nationalités adoptées pour les industries modernes; la galerie qui lui était affectée devait bien recevoir les produits de tous les pays et les œuvres appartenant aux différentes contrées depuis les temps les plus reculés jusqu’à la fin du dix-huitième siècle, mais aux termes du règlement, les objets se rattachant à l’industrie de chaque nation devaient être placés dans une portion distincte de cette galerie et disposés de manière à caractériser les époques principales de l’histoire de chaque peuple.
La Commission chargée de la section de l’Histoire du Travail avait dès lors une double tâche à remplir: elle devait d’abord faire appel à toutes les puissances étrangères pour les convier à prendre part à cette exposition dont l’intérêt ne pouvait que s’accroitre par la comparaison des produits exposés, en raison directe du nombre des contrées qui y seraient représentées; elle avait en outre à arrêter les bases d’une classification générale qui pût s’appliquer à chaque pays, tout en laissant aux Commissions étrangères le soin d’organiser leur participation à l’œuvre commune. Quant à la section française, le but que la Commission se proposait d’atteindre, et qui se trouve exactement défini dans une de ses circulaires, était d’organiser cette exposition de manière à faire connaître par la vue des monuments qu’elles nous ont laissés, les époques principales de l’art et de l’industrie de nos pères, de donner l’idée exacte de l’importance de nos arts industriels à toutes les périodes de notre histoire; elle voulait faire saisir en outre par un classement méthodique la succession chronologique des progrès, des transformations el même des défaillances du travail national.
Ce classement, adopté pour la section française en même temps qu’il était indiqué comme pouvant servir de base à toutes les contrées étrangères, divisait la galerie de l’Histoire du Travail en dix époques bien tranchées. Ces divisions sont les suivantes:
1° La Gaule avant l’emploi des métaux; — Comprenant les ustensiles d’os et de pierre, avec les ossements des animaux aujourd’hui disparus du sol de la France, mais trouvés avec ces objets et pouvant indiquer la période à laquelle ceux-ci appartiennent; — 2° La Gaule indépendante; — Armes et ustensiles de bronze, de pierre; objets de terre cuite; — 3° La Gaule pendant la domination romaine; — Bronzes, armes, monnaies gauloises, orfèvrerie, bijoux, poteries rouges et noires, émaux incrustés, etc.; — 4° Les Francs jusqu’au sacre de Charlemagne (800); — Bronzes, monnaies, orfèvrerie, bijoux, armes, poteries, manuscrits, chartes, etc.; — 5° Les Carlovingiens, du commencement du IXe à la fin du XIe siècle; — Sculpture, ivoires, bronzes, monnaies, sceaux, orfévrerie, bijoux, armes, manuscrits, chartes, etc.; — 6° Le Moyen Age, du commencement du XIIe siècle au règne de Louis XI, inclusivement (1483); — Statuaire, sculpture en ivoire, bois, meubles, bronzes, monnaies, sceaux, orfèvrerie, bijoux, armes et armures, manuscrits, miniatures, émaux incrustés et champlevés, poteries, tapisseries, tissus, broderies, vêtements, etc.; — 7° La Renaissance, depuis Charles VIII jusqu’à Henri IV (1610); — Comprenant, comme la période précédente, les produits de la sculpture, ceux de l’orfévrerie, de l’armurerie et de la coutellerie; puis les émaux peints, les faïences vernissées, celles dites de Henri II, les ouvrages de Bernard Palissy et de ses continuateurs, les verreries, les tapisseries, les tissus, les broderies, les reliures, etc.; — 8° Les règnes de Louis XIII et de Louis XIV, de 1610 à 1715, dans lesquels se trouvent, outre les produits des siècles précédents ci-dessus désignés, les ameublements en bois sculpté et doré, les marqueteries rehaussées de bronzes, les faïences de Nevers et de Rouen, ainsi que les porcelaines de Rouen et de Saint-Cloud; — 9° Le règne de Louis XV, de 1715 à 1775, présentant, outre tous les objets énumérés ci-dessus, les vernis Martin, les porcelaines de Chantilly, de Mennecy, de Vincennes et de Sèvres; les faïences de Moustiers, de Marseille, de l’Alsace, de la Lorraine, de la Picardie, etc.; — 10° Le règne de Louis XVI et la Révolution française, de l’année 1775 à 1800.
L’appel adressé par la Commission à toutes les contrées étrangères a reçu l’accueil le plus sympathique, et, sauf de rares exceptions, déterminées par des causes toutes spéciales, la plupart des pays de l’Europe ont pris place à l’exposition de l’Histoire du Travail; l’Angleterre, l’Autriche, les Principautés Roumaines, le Portugal, les Pays-Bas, la Russie, la Suède et la Norwége ont envoyé de nombreuses et intéressantes collections classées avec méthode; d’autres pays de l’Europe, tels que l’Italie, la Bavière, le Wurtemberg, la Suisse, le Danemark, les États-Pontificaux, ont exposé, les uns des séries entières, les autres quelques ouvrages détachés; les Républiques américaines ont fait elles-mêmes acte de présence, et enfin l’Égypte a envoyé ses trésors du musée de Boulaq, déjà exposés en partie à Londres en 1862, et qui se retrouvent aujourd’hui dans le petit temple de Philœ, copie réduite de l’original et que le gouvernement égyptien a fait construire à leur intention dans le parc du Champ-de-Mars.
Lors de l’exposition rétrospective ouverte à Londres en 1862, la grande cour du Kensington Museum renfermait non-seulement les objets confiés par les principaux collectionneurs du Royaume-Uni et par les trésors des corporations et des compagnies, mais elle comprenait en outre un nombre considérable d’œuvres d’art de toute nature empruntées aux musées de l’État, aux bibliothèques publiques, aux palais de la Reine. Il ne pouvait en être ainsi en France, en vertu de la loi qui régit nos établissements publics et assure la conservation de nos collections nationales en interdisant la sortie des richesses qu’elles renferment.
Le concours des musées du Louvre, de ceux de l’Hôtel de Cluny, de Saint-Thomas d’Aquin, du cabinet des Médailles et Antiques, des Bibliothèques impériales et nationales eût considérablement simplifié les opérations de la Commission de l’Histoire du Travail, comme nous le disions dans une récente notice sur le même sujet; mais en dehors des règlements qu’elle avait pour première mission de faire respecter, il y avait un puissant intérêt à conserver leur physionomie complète et intégrale à nos collections publiques, à nos musées, à nos bibliothèques, au moment où Paris devenait le centre sur lequel l’Europe entière allait se trouver appelée par l’Exposition universelle de 1867. La galerie de l’Histoire du Travail français devait donc, tout en ne comprenant que des objets d’origine nationale, se composer uniquement d’œuvres extraites des collections particulières de Paris, des départements, quelquefois même de l’étranger, des musées municipaux et des trésors des églises, à l’exclusion absolue des produits appartenant à l’État aussi bien qu’à la Couronne.
L’appel adressé par la Commission et par les correspondants qu’elle s’était constitués dans les départements, à nos plus célèbres collectionneurs, au haut clergé de France, aux administrations municipales, a rencontré de toute part l’accueil le plus bienveillant et le plus actif. Et cependant, il ne s’agissait plus d’obtenir, comme antérieurement, des collections entières, dont l’exhibition fait toujours honneur à l’amateur érudit qui a mis tous ses soins à en opérer la laborieuse réunion; il fallait faire choix de certains objets désignés comme étant d’origine française, les détacher des collections auxquelles ils appartiennent, des œuvres de provenance étrangère qui les entourent, et les faire rentrer, suivant la date qui leur était assignée, dans les exigences du classement général. Ainsi, comme l’annonçait la Commission, non-seulement elle ne pouvait admettre dans la section française que les ouvrages se rattachant à l’art et à l’industrie des populations qui ont vécu sur le sol de la France, mais aucune collection de nature, de nationalité et d’âges différents ne pouvait motiver une exposition particulière; chaque pièce devait être classée à son rang, suivant le système adopté, tout en portant le nom de son propriétaire, français ou étranger.
Malgré ces conditions imposées par la nature même de l’exposition, l’empressement des principaux amateurs des œuvres d’art des temps anciens à répondre à l’appel qui leur était adressé a dépassé toute attente; le concours du clergé de France, celui des administrations municipales, a été pour ainsi dire unanime, et l’espoir qu’exprimait la Commission dans sa première circulaire, que tous tiendraient à honneur de concourir à cette manifestation nouvelle de la gloire traditionnelle de notre pays dans les arts, s’est promptement réalisé.
En présence des envois considérables faits de tous les points du pays, un sérieux contrôle et un choix sévère devenaient indispensables, et un Jury spécial fut constitué afin de procéder à l’examen de toutes les œuvres destinées à la section française. Ce Jury composé des collectionneurs les plus éminents de Paris et des départements, dont les noms vont se retrouver fréquemment dans ce rapport, ainsi que des savants chargés de la direction de nos musées et de la conservation de nos bibliothèques et de nos collections publiques, était divisé en cinq sections présidées chacune par un des membres de la Commission de l’Histoire du Travail, et avait pour mission de renvoyer aux contrées auxquelles elles revenaient les pièces reconnues comme étant d’origine étrangère, en mettant de côté toute œuvre indigne de figurer dans une collection destinée à retracer à l’aide des monuments les mieux choisis l’histoire de nos arts industriels à ses diverses époques.
La Commission impériale avait d’ailleurs pris à sa charge les frais de transport, aller et retour, dans les départements, ainsi que toutes les dépenses d’installation, d’arrangement et de réexpédition, en acceptant d’avance la responsabilité de chacun des objets confiés à la Commission de l’Histoire du Travail pour la valeur dont cette dernière aurait agréé la déclaration préalable.
Nous avons dit que, en dehors des collections particulières dont les propriétaires ont gracieusement consenti à se dessaisir en partie pendant près de neuf mois, les cathédrales et les églises de France avaient bien voulu ouvrir leurs trésors, en même temps que les principales villes de l’empire mettaient à la disposition de la Commission tous les objets précieux, d’origine nationale, renfermés dans leurs musées et dans leurs bibliothèques. Ajoutons que bien des collectionneurs étrangers, en tête desquels nous citerons un des princes les plus éclairés de l’Allemagne, n’ont pas hésité, sans même y avoir été conviés, à envoyer à la Commission de l’Histoire du Travail des suites complètes de précieux ouvrages français réunis par leurs soins, montrant ainsi leur sympathie pour l’œuvre entreprise et l’intérêt qu’ils attachaient à son heureuse réussite. Le nombre des collections dont les envois figurent dans la section française atteint le chiffre de cinq cent trente-deux, tant galeries particulières que musées municipaux, trésors d’églises, sociétés archéologiques, bibliothèques; et le catalogue ne comprend pas moins de sept mille numéros dont la plupart se rattachent à des séries tout entières d’objets réunis sous le même chiffre. Les précautions les plus minutieuses devaient présider à la réception de toutes ces richesses ainsi qu’à leur installation et à la rédaction des inventaires. Tous ces travaux ont été exécutés en temps utile, et dès le 1er avril, jour de l’inauguration de l’Exposition universelle, la Commission de l’Histoire du Travail ouvrait au public les galeries de la section française, complétement installées pour la plupart, constituant dans leur ensemble la collection nationale par excellence, collection dont l’étude ne saurait être sans effet pour le développement des arts industriels de notre temps.
Nous voudrions pouvoir examiner un à un chacun des objets confiés à nos soins; mais un pareil travail dépasserait de beaucoup les limites imposées à ce rapport; nous nous bornerons donc à présenter d’une manière aussi succincte que possible les œuvres les plus importantes qui représentent l’art de chacune des grandes époques, en suivant l’ordre du classement général et en insistant sur les ouvrages qui les caractérisent d’une manière plus spéciale; ce sera signaler en même temps, en les mettant de nouveau sous les yeux du public, les noms des collectionneurs à la bienveillance desquels sont dus les résultats obtenus, ceux des membres du haut clergé français qui nous ont prêté un si efficace et si précieux concours, ceux, enfin, de nos zélés correspondants et des savants chargés de la conservation des collections municipales dans nos départements, dont l’empressement à seconder l’œuvre entreprise par la Commission n’a pas peu contribué à en déterminer le succès.