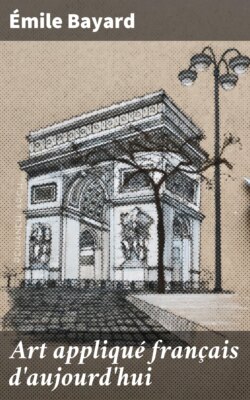Читать книгу Art appliqué français d'aujourd'hui - Emile Bayard - Страница 4
Les Arts du Bois: Le Meuble et la Sculpture sur Bois.
ОглавлениеLes styles du passé sont la cristallisation des expressions et sentiments d’autrefois. Logiquement s’impose, ainsi, la réalisation d’un art représentatif de notre esprit, de notre goût modernes ().
Pour ne point périr, le génie doit céder, dans l’atmosphère des idées autres, adverses ou rénovées, à l’impulsion des artistes et des artisans qui, à l’exemple des saisons, diversifient dans l’œuvre l’agrément de la vie.
Le printemps défie l’hiver par son attrait, et l’hiver succède harmonieusement à l’automne comme l’été au printemps.
Malgré que l’esthétique du corps humain, — aussi loin que l’on se réfère à un art, — n’ait point changé, il n’en apparaît pas moins que les époques différentes, que les caprices du goût et de la mode ont singulièrement modifié son aspect sur le fond où il se meut.
Suivant la coquetterie de l’heure, un visage renouvelle sa grâce, se métamorphose, et, non seulement par l’artifice de la chevelure, mais encore à l’aide des subterfuges de la toilette, du costume au maquillage, de la mouche du XVIIIe siècle au fond de teint bistre dont s’ambre le masque féminin de ce début du XXe siècle.
J.-E. RUHLMANN. — Meuble d’encoignure.
J.-E. RUHLMANN. — Chambre à coucher.
Aussi bien, le décor obéit à la plastique humaine pour servir sa fantaisie et varier sa beauté. La forme, même, s’identifie à l’individu. On dit: les bras, le dos, les pieds d’un fauteuil; le ventre d’une commode. La vision de la jambe humaine, imposée par l’usage de la botte collante, inspira les formes «à mollet» résumées par le balustre renflé du XVIIe siècle.
Pareillement, au gré d’une jupe ample, les balcons en fer forgé du XVIIIe siècle s’évaseront tandis qu’auparavant les bras des fauteuils se sacrifiaient à l’épanouissement des vertugadins.
Le vaste fauteuil de Louis XIV, au siège rigide, aux larges ramages, s’oppose symboliquement à la bergère menue et douillette, à fleurettes, de Mme du Barry. L’un chante la majesté de l’Homme, l’autre la grâce de la Femme: la pensée de deux siècles différents.
Le bois, les tissus, les proportions, volumes et confort, soumis à l’esprit d’un temps et leur reflet.
Combien d’autres exemples de la forme ordonnée par chaque époque pourraient suivre! Ce n’est pas à Riesener, ébéniste de Louis XVI, a-t-on justement observé, que Napoléon 1er commanda l’armoire à bijoux de Marie-Louise, mais à Jacob Desmalter, son propre ébéniste, suivant en cela la logique des monarques devanciers. Et il ne faut pas sourire d’un Roi-Soleil méprisant, au bénéfice de l’art auquel il présidait, les œuvres de l’art ogival dues au goût «sauvage» de ses «grossiers aïeux», car, plus dangereusement pour le renouvellement du génie créateur, La Bruyère, après s’être réjoui avec son roi de l’abandon de l’ordre gothique «que la barbarie avait introduit pour les palais et les temples», prononça, en se déjugeant, que l’ «on ne saurait rencontrer le parfait, et s’il se peut, surpasser les Anciens, que par leur imitation ».
Les vers de Corneille, d’ailleurs, furent bien traités de «visigoths», et tout ce qui ne se réclamait pas de l’Antiquité latine ou de la Renaissance d’Italie était alors, «à quelques degrés du pays des Hurons».
J.-E. RUHLMANN. — Meubles pour un studio (M. Molinié, arch.).
En vérité, un Louis-le-Grand qualifiant de «magots» les personnages peints par David Téniers, exprimait un dédain autrement fécond que cette admiration routinière et, malgré toute sa prétention, la Révolution décrétant «monuments d’esclavage» ceux qui avaient précédé ses jours de liberté, ne rendit pas moins service à l’essor d’une architecture nouvelle.
Louis David contre François Boucher, Eugène Delacroix contre M. Ingres, les «impressionnistes» contre les «académistes», confirment la règle d’une noble émulation inventive.
On sait l’aventure significative de cette somptueuse décoration de Le Brun découverte derrière l’ancien escalier des Ambassadeurs et que Mme de Pompadour, jugeant démodée, avait démolie, en 1749, à cinquante ans de distance, sans préjudice d’une belle grille en fer forgé, noyée dans une maçonnerie, sans même avoir été déposée!
Or, voilà l’évolution rationnelle de l’art, sa tradition même et sa félicité, puisque c’est grâce à son orgueil que la beauté se renouvelle pour enrichir, toujours davantage, le trésor du génie.
Le règne léger et brillant de François 1er fit la Renaissance dont le fils de Henri IV, au front taciturne, calma la dorure éclatante, et ce style pesant et triste de Louis XIII s’étoffa au contraire, magnifiquement, sous Louis XIV, pour s’amenuiser ensuite, dans un sourire, au XVIIIe siècle.
Toutefois, si, à l’image des débordements de la Régence et de Louis XV, les axes du meuble et des décorations intérieures chavirent, la ligne se raidira avec Louis XVI dans une gracilité où il entre quelque émoi dont la grisaille et quelque hautaine mélancolie évoquent le pressentiment de la Révolution.
Or, cette réaction latente et fatale à travers les manifestations opposées ou contradictoires d’idéal humain, nous a valu le souvenir cher d’un passé de chefs-d’œuvre divers confié dévotement à la garde de la tradition, mouvante et non stagnante, pour qu’elle la poursuive.
J.-E. RUHLMANN. — Coiffeuse.
Au bout des années, l’expérience radote. Après avoir donné ses fruits, l’arbre refleurit. Comment résister à la poussée de sève, au flux tumultueux des idées neuves, au concept d’un cerveau affranchi, mais mûri, de la pensée somptueuse d’hier!
La routine doit taire ses étonnements et sa médisance au spectacle des prémices qui brusquent ses habitudes et violent le dogme caduc. Et, c’est contre cette prévention ignorante et coupable (car elle paralyserait l’essor inventif) qu’il faut protester, en faisant la preuve par des exemples choisis, des conquêtes imposantes de nos artistes et artisans dans le domaine d’un style voué à la figuration de notre temps.
Point donc de beauté définitive; le «perpétuel devenir» dont parle Platon, indique l’état de la nature inconstante, toujours invariablement attirante. Les styles classiques du mobilier témoignent, par leur caractère dissemblable, de ce mouvement perpétuel, et le meuble moderne se flatte, esthétiquement et techniquement, de démontrer à l’opinion conservatrice qu’il n’est pas de passé souverain.
Point de type éternel, mais des formules de chefs-d’œuvre vénérables résumant des étapes d’admiration.
Hélas! la nouveauté apparaît le plus souvent agressive, et chaque mobilier reçut à ses débuts, l’anathème. Témoin, parmi plusieurs autres, cette plaisante appréciation de Rœderer sur les meubles parfaits, pourtant, que Georges Jacob et son fils François Jacob-Desmalter créèrent après l’expédition d’Égypte: «On n’est pas assis, on n’est plus reposé. Pas un siège chaud, fauteuil ou canapé, dont le bois ne soit à découvert ou à vive arête. Si je m’appuie, je presse un dos de bois; si je veux m’accouder je presse deux bras de bois; si je me remue, je rencontre des angles qui me coupent les bras et les hanches. Il faut mille précautions pour ne pas être meurtri par le plus tranquille usage de ces meubles. Dieu préserve aujourd’hui de la tentation de se jeter dans un fauteuil; on risquerait de se briser!»
L. SUE et A. MARE. — Table. (Éditée par la «Compagnie des Arts Français».)
L. SUE et A. MARE. — Chaises. (Éditées par la «Compagnie des Arts Français»).
L. SUE et A. MARE. — Coiffeuse. (Editée par la «Compagnie des Arts Français»)
Actuellement, pour nous en tenir au mobilier, l’intarissable antiquaire tend à perdre son sceptre, et la religion des styles d’hier, dégénérés dans la copie et le pastiche, usés dans la pacotille et le commun, déconcerte, à la longue, ses fanatiques convertis à la logique d’une beauté neuve, adaptée à notre atmosphère ni plus ni moins que la tradition elle-même. Si les couleurs tendres s’accordaient, sous Louis le Bien-Aimé, avec les mignardises, si les gris de la fin du règne de Louis XVI s’harmonisaient avec le front soucieux d’une dynastie condamnée, place désormais aux tonalités hardies, aux acidités, aux crudités curieusement orchestrées! La musique des couleurs répond à celle des sons dans l’altération savante. La souple ligne du meuble s’accommode maintenant de la tache rude et franche que les tentures, coussins, etc. répercutent.
Nous sommes de notre temps, enfin!
Seule, hier, une aristocratie d’idéal, académiquement borné, représentait le Grand Art. Comme si les chefs-d’œuvre des artisans du moyen âge relevaient d’un art mineur! Comme si le petit maître Jean-Honoré Fragonard ne se haussait point à la taille des plus grands maîtres de tous les temps! Comme si, enfin, il existait une hiérarchie dans la beauté !
Aujourd’hui, l’école d’art se doit de poursuivre la tradition française du métier embelli, de la vision à nouveau recréée dans tout et pour tous. Elle concourra seulement ainsi, à l’accroissement de notre patrimoine national, à la sauvegarde de la réputation mondiale de notre goût, à la richesse productive de la France.
Avant d’atteindre à sa perfection actuelle, le meuble moderne connut, dès son avènement, l’excentricité qui marque brutalement chaque rupture. Le courage de rompre engendre ces débordements initiaux; il dépasse d’abord la mesure dans l’enthousiasme de la foi et pour mieux persuader de son originalité réactive.
Le snobisme marche volontiers, d’autre part, en tête de l’innovation et, s’il se rencontre avec la logique dans la haine de la banalité, une sage mise au point résulte des efforts désordonnés, des admirations factices et de la rationalité même, harmonisées, puis béatifiées.
L. SUE et A. MARE. — Lit. (Édité par la» Compagnie des Arts Français».)
Ainsi de toutes les révolutions. On lutte aveuglément, d’abord, et l’on s’explique après la bataille. Des idées fécondes naissent alors, sur des ruines. L’accord s’échafaude sur un principe et l’œuvre sereine s’impose finalement à l’unanimité.
Toutefois, en ce qui concerne notre objet, la tradition faussée, dénaturée, fut cause de la rupture.
Sans nous arrêter aux meubles «symboliques», issus de la Révolution sur les cendres de notre glorieux mobilier antérieur, voici Napoléon 1er qui remmailla la chaîne brisée des styles du passé. Son improvisation spirituelle sur le thème gréco-romain (dont le moindre défaut fut la transposition, au mépris de la matière, du métal et de la pierre dans le bois; du trépied grec à la chaise curule reproduits en acajou!) devait être suivie de la pauvreté mobilière des Restaurations bourgeoises.
Le gothique «cathédrale», l’inspiration «étrusque» sévirent, et le Louis-Philippe échoua entre ces écueils, dépouillé des précieux ornements de l’Empire premier, en conservant platement les formes héritées de l’antique. Puis, au second Empire, un style «Fourdinois» avec un «Louis XVI impératrice» représentent le pastiche, le faux luxe et le clinquant.
Si l’on ajoute à ces idéals abâtardis les dégénérescences économiques qui suivirent, toute la vulgarité, toute la camelote où les chefs-d’œuvre mobiliers du passé achevèrent de se déshonorer, on saisit le mérite des premiers artistes qui, au nom de la tradition du goût français, découvrirent un coin de ciel à l’inspiration défaillante.
Le Lorrain Emile Gallé, à l’Exposition universelle de Paris, en 1889, fut le triomphateur de l’idée nouvelle et, à ses côtés, l’école de Nancy tout entière.
Emile Gallé «demande aux motifs d’ornementation de devenir les emblèmes de la matière ou d’annoncer la destination de l’ouvrage. Sur les flancs et les dessus de ses tables, de ses commodes, ce ne sont que fleurs, plantes, oiseaux ou papillons figurés dans le vrai de leur allure, de leur couleur et jetés en toute liberté, le plus simplement du monde...»
Et voici, au surplus, les principes du maître français, digne émule des Ruskin et des William Morris, en Angleterre: «1° Un meuble doit être fait pour servir, une chaise n’est point créée pour s’exhiber, mais pour procurer repos et assiette à une humanité qui a reins, jambes et dos; 2° il faut que la construction réponde à la destination de l’œuvre, au matériel d’exécution, et qu’elle soit aussi simple, aussi logique que possible; 3° que cette construction saine ne soit masquée par rien et qu’elle reste bien évidente; 4° le décor de l’œuvre peut s’inspirer des formes de la flore et quelquefois de la faune. Et ne dites pas que la nature offre des assemblages sans variété; tout se renouvelle sans cesse par la force des choses; il ne suffit que d’observer, de raisonner, d’adapter...»
CLÉMENT MÈRE. — Meuble de fumeur (ébène, cuir et ivoire).
Au meuble «vivant» créé par un Gallé, extrêmement végétal et échevelé, succéda une ornementation graphique où la forme stylisée, en «coup de fouet», «os de mouton» et autres dénominations peu avantageuses, consacra un «modern-style» aussi éphémère que déconcertant. Puis vint, après celle des sculpteurs, l’ère des coloristes non moins excessive.
A cette heure de fièvre et de gestation, toujours admirable, les meubles peints tentèrent une harmonie de palette en contradiction encore avec la forme impérative et l’utilité rationnelle, inséparables du meuble, petit monument d’architecture. Puis, une étape où le mobilier cédait au chiffon, à tout l’attrait accessoire et contingent, dans la disposition artiste des draperies et coussins, dans le prisme de la lumière savante et du bric-à-brac «amusant», s’enregistre.
Il était temps que le bois retournât à l’établi comme le marteau à l’enclume, c’est-à-dire que l’art revînt au spécialiste. Et, du coup, les principes traditionnels ramenèrent l’outil égaré au respect de la matière qui commande et de sa destination qui doit régir le chef-d’œuvre dans l’harmonie de la forme et du décor avec la dimension.
Il s’avère ainsi, de nos jours, après les louables tâtonnements du début, un résultat d’originalité normale d’autant séduisant que les aises sont favorisées différemment qu’hier sans molester le geste, sans irriter la vue, en flattant au contraire la forme et la couleur dans le charme d’un accord où l’étonnement initial succombe à l’émoi satisfait.
CLÉMENT MÈRE. — Guéridon (bois de rose, bronze et ivoire).
FRANCIS JOURDAIN. — Studio.
FRANCIS JOURDAIN. — Chambre d enfant.
L’invention moderne ne le cède en rien au grand passé et, quant à la technique, dont, après Louis-Philippe, l’altération manifeste accéléra la décadence du meuble esthétiquement diminué, elle a reconquis aujourd’hui sa supériorité.
La sculpture, sobrement admise dans le concert des reliefs et des masses, judicieusement dosés et à leur place, distribue les creux et les bosses là où la main ne peut être contrariée. La satisfaction de la vue passe judicieusement après celle des besoins servis. Les fines moulures ne jouent pas moins spirituellement avec la lumière, distinguant des profils, calmant des arêtes au profit des volumes. Le choix du bois, son essence, inspirant le genre du meuble, sa destination masculine ou féminine, et non seulement par la couleur mais par la proportion; la virilité se reflétant en propre dans la structure solide, dans la silhouette et la proportion massives du meuble, alors que la grâce se réclame de l’élégance et de la légèreté.
«... Il faut dans une chambre d’homme cette sobriété d’ornement, cette certitude des lignes qui font le cadre où se plaît une intelligence volontaire. Les meubles doivent affirmer la logique de leur plan et leur utilité...»
Ici, un retour au meuble symbolique, non plus dans la fièvre révolutionnaire, mais dans l’adaptation calmement pensée et mûrie, conforme au caractère de l’individu comme à son propre confort.
Ainsi: «...le dossier bas (des sièges d’une salle à manger) prêtera-t-il aux convives une attitude dégagée, en laissant paraître la chute des épaules, qu’engoncerait le haut dossier d’une chaise Louis XIII, et la courbe affinée à sa pointe, qui s’ouvre en avant pour l’accueil, accompagnera harmonieusement les lignes du corps... «
«Quand j’ai le plaisir de guider quelque artiste dans le palais de Fontainebleau, dit son éminent conservateur, M. Georges d’Esparbès, je ne manque jamais de lui faire remarquer ces fauteuils centenaires de l’Empire, dont les sièges sont fanés, vieillis, mais dont les dossiers montrent leur étoffe toujours intacte, parce que le dos et les épaules des hommes énergiques qui s’y sont assis ne les ont même pas effleurés... Méditez devant un siège de cette époque. Il a beau être somptueux, fait pour durer toujours, il évoque l’expectative, l’attente, une possession provisoire. Ensuite, regardez les nôtres: ils sont ceux de gens veules, sans énergie. Notre fauteuil moelleux «où demeure l’impression du corps», c’est le fauteuil de l’indifférence. Le siège Empire, c’est la silhouette de l’anxiété.»
MAURICE DUFRÈNE. — Bibliothèque. (Éditée par «La Maîtrise». )
Il n’empêche que l’intérêt du lit de camp s’efface devant le confort de la couche tendre et souple que nos jours ont réalisé, au surplus, esthétique.
Point d’armoire démesurément haute, dans une chambre de femme; cette faute d’appropriation ne sera pas renouvelée par le «meublier» moderne, qui s’ingénie, au contraire, à mettre l’utilité à la portée du geste, féminin en l’occurrence.
La «féminité » des lignes courbes, de «meubles de sycomore gris, d’aspect satiné et soyeux..., s’enlevant sur une tenture où les gris et les roses se nuancent dans un reflet nacré, «un lustre de perles, des verreries de toilette tracées d’émail blanc, ajoutant au charme d’une chambre de femme leur délicatesse...» s’oppose ainsi à la chambre mâle précédente, «définie en verticales et en horizontales sévères».
Et le volumineux fauteuil que Molière, singulièrement, vouait aux «commodités de la conversation», reléguant au musée son importance inconfortable, son emphase surhumaine, ne saurait surprendre notre masculinité réduite.
Il eût été irraisonnable, d’ailleurs, de perpétuer ce modèle de majesté dans l’exiguïté de nos appartements modernes et surtout dans ceux de la femme. Aussi bien, la chaise moderne a répudié les gracilités tortueuses; elle s’énonce sans heurt et reçoit le corps simplement, sans trop céder à l’attrait du décor dont l’excès souvent, autrefois, subordonnait le but.
MAURICE DUFRÈNE. — Chambre d’enfant. (Éditée par la «Maîtrise»).
Les meubles classiques, malgré leur auréole, ne sont point impeccables; ils accusent leurs défauts d’une époque à l’autre, car chaque époque possède sa perfection qui n’est point celle de l’autre, et le mauvais goût, selon Gustave Flaubert, c’est invariablement le goût de l’époque précédente...
L’hygiène et les besoins nouveaux, si développés de nos jours, ont renouvelé les formes et les dispositions de l’architecture, le meuble moderne devait donc modeler les siennes sur sa grande sœur, en réalisant la sobriété dans un accord de netteté et de beauté strictes.
Au surplus, des exigences sont nées des pièces et des meubles que le passé ignora. La chambre de l’enfant comme le bureau d’affaires, le boudoir comme la salle de bains, ont élargi leur importance. Des meubles, en outre, se sont associés à des cloisonnages pour accentuer la commodité à proximité du geste. Des divans-bibliothèques, des tables de chevet-lit, parmi tant d’autres expressions conjuguées, comblèrent la satisfaction pratique à laquelle le meuble obéit initialement. Néanmoins, la tendance à apparenter excessivement le mobilier à des ordonnances architecturales telles que: lambris, plafonnages, alcôves, cheminées, tendit quelque temps son piège à l’invention subtile.
Le meuble est un; s’il concourt à un ensemble il doit pouvoir s’en détacher et valoir essentiellement. On transgressa cette loi. D’autre part, «un lit est un lit et non point un poème», déclare judicieusement M. Maurice Dufrène; «il ne faut pas faire de littérature en édifiant un petit banc», et M. Georges Auriol appuie spirituellement cette opinion: «... c’est par sélection qu’une salière peut devenir l’hôtesse d’un musée; mais, premièrement, elle doit contenir du sel. Et, quel que soit le raffinement qui aura présidé à sa fabrication, elle ne sera digne du musée, même un siècle après sa naissance, que si elle a fidèlement (et gauloisement) rempli son rôle de salière...»
La matière commande et inspire différemment; les essences du bois, l’aspect naturel des fibres, les nodosités, jouent leur rôle impératif de couleur et de dessin; «... elles s’unissent dans des marqueteries pareilles à des soieries brodées». La solidité, d’autre part, conseille la construction comme le poids oriente vers la destination. Le plateau convexe d’une table ne représente point une originalité, mais une erreur, et de même l’instabilité d’un vase incapable de recevoir une fleur ou de contenir de l’eau.
MAURICE DUFÈRENE. — Chambre à coucher; (Éditée par la «Maîtrise».)
PAUL FOLLOT.] — Meubles de chambre à coucher. (Édités par «Pomone»).
PAUL FOLLOT. — Cabinet de travail. (Edité par "Pomone".) Meubles en palissandre, marquetés d’ébène, poirier, buis et étain.
Un meuble volant, lourdement conçu en fer forgé, accuse une contradiction.
L’esthétique ne vaut qu’en raison des services rendus.
Et le luminaire électrique, le téléphone, les perfectionnements du chauffage, etc., n’ont pas moins contribué à une ambiance caractéristique où les adaptations du passé apparaissent dépaysées ou choquantes.
Entendez chanter la couleur aux accents d’une lumière inconnue de nos pères! Voyez combien notre propre geste a ordonné de formes qu’ils ignoraient aussi, sous l’empire de la trouvaille incessante! La matière s’infléchira autrement qu’hier, c’est la norme. Elle s’ornera d’autre manière aussi puisqu’elle s’éclaire différemment.
Rien de plus misérable que l’étalage d’un mobilier en plein air! Aucun luxe ne résiste à cette exposition crue; tous les déménagements révèlent ce pitoyable. Le jardin réclame des meubles de jardin, et, à l’intérieur, la lumière électrique violente nos coins et recoins au point qu’il serait fâcheux de méconnaître l’intérêt d’une judicieuse disposition constructive et ornementale où les reliefs ne seraient point conviés, avec l’ombre mystérieuse, à l’agrément de la forme.
En vérité, pour revenir à l’erreur des adaptations d’hier à aujourd’hui, la «salamandre»... Louis XV, l’ascenseur... Louis XIII, le radiateur... romain, complétés par la vision d’une Parisienne du XXe siècle assise dans une bergère... Louis XVI, confondent l’entendement!
Une peinture moderne sertie dans un cadre Renaissance n’étonne pas moins qu’un lustre appendu au plafond, — on ne sait par quel miracle! — en plein milieu d’un ciel, ou que l’imitation, en porcelaine, d’une bougie coiffée d’une ampoule électrique! Et, pareillement, une lampe de mosquée convertie à la lumière électrique et accrochée, pour comble! sous quelque rosace Louis XIII, constitue un barbarisme auquel un violon de faïence (fût-elle de Xevers) et un plat incapable de rien contenir (genre Bernard Palissy) n’échappent pas, et point davantage un paravent... ajouré (on en a vu en dentelle!) par où filtrent les courants d’air...
M. GALLEREY. — Coin d’un salon.
Si le progrès en art est inexistant, puisque les chefs-d’œuvre demeurent éternellement admirables, on n’en pourrait dire autant de la science dont les perfectionnements, ceux du machinisme entre autres, ne sauraient être dédaignés dans une société moderne. Or, ces progrès engendrent des techniques nouvelles; ils ont leur répercussion esthétique.
Ce n’est point l’abondance de la sculpture qui donne la forme, c’est l’équilibre d’une silhouette agréablement massée. La parure des placages, point davantage, ne réussira à faire sourire un corps maussade. Notre piano droit, — est-ce pour la raison que sa perfection instrumentale remonte déjà à nombre d’années? — en fournit la preuve. Aucune décoration n’a guère pu corriger sa ligne comme impérieusement laide. En revanche, la voiture automobile a rompu décidément avec le souvenir du cheval, longtemps inséparable de sa carrosserie.
La fonction crée l’organe et l’organe la forme, au point que l’avion ressemblera toujours davantage (en s’éloignant de l’oiseau comme l’automobile du cheval) à un fuselage dominé esthétiquement par un moteur, et n’y a-t-il point lieu d’estimer que le piano droit ne résiste à la forme que sous le joug impératif du clavier et de la table d’harmonie?
A la répercussion esthétique répond une autre différenciation en faveur du mobilier de notre temps: l’emploi des matériaux nouveaux.
Dans cet ordre d’idées, il faut enregistrer des modes de débiter le bois tel que le sciage en spirales, qui offre des déroulements précieux pour un placage d’une seule venue, sans joints ni assemblages, permettant des panneaux de 4 ou 5 mètres de largeur. Des bois exotiques, coloniaux, au surplus, dont nos meubles modernes ne sont pas moins friands que ceux du passé, des essences inédites, encore, ajoutent à un effet propre pour renforcer celui de la forme différenciée.
A ces apports neufs s’ajoute, dans l’ornementation, l’emploi de matières originalement associées: corne, céramique, cuir, galuchat, faïence, bronze, etc., conviés au décor, enfin libéré des moulures grecques et de tout l’attirail d’une mythologie usée.
M. GALLEREY. Salle à manger-bibliothèque.
Même, la richesse du meuble moderne ne proviendra point exclusivement de la matière rare et de la parure luxueuse; le meuble moderne mettra quelque coquetterie à ennoblir, sinon à produire tout de go, un bois vulgaire. Des fibres communes seront injectées de couleur ou vernies, et leur artificieuse beauté offrira toujours une illusion supérieure au mensonge de la matière avilie pour le plaisir de flatter richement et à bas prix.
L’art moderne sait profiter de la rusticité comme du luxe; il recherche les contrastes à son profit, dans la sincérité des matériaux sollicités, et la nudité d’un bois de chêne aime à parader de sa technique robuste.
La flore et la faune aidant qui, sous l’ingéniosité de nos artisans affranchis du passé mais instruits par lui, forts de l’expérience d’hier respectueusement assimilée mais non point tyrannique, participent à une «stylisation» nouvelle.
Meubles peints à bon escient, — non plus peinturlurés comme au début, — meubles non plus symboliques ni «couleur d’âme», mais se réclamant de l’ébénisterie, au même titre que ceux du XVIIIe siècle, où le rouge, le vert, le gris, le blanc accompagnaient harmonieusement la technique du bois.
«... Meubles de boudoir, secrétaires, coiffeuses, petits sièges aimables, raffinés, en bois des îles, amarante ou courbaril, ou bien laqués suivant la mode, bleu lapis, noir, rouge, chinois, qu’on veut jolis comme des bibelots!»
Il faudrait dire encore l’ingéniosité de la fermeture du meuble moderne, dont les moulures parfois défendent le secret; le fonctionnement, souvent aussi imprévu que docile, de ces tiroirs et portes manœuvrés à l’aide d’anneaux et de boutons non moins agréables à la vue qu’à l’effort. «Un perce-neige devient un gland de tiroir, une pensée sert à végétaliser une clef de vitrine...»
Quelle horreur du convenu, au surplus, dans ces plaques et entrées de serrures que la camelote, hier encore, prodiguait à tort et à travers, d’après l’exemple altéré dans la fonte ou l’estampage grossier!
M. GALLEREY. — Salle à manger.
Quel sentiment! Quelles intelligences différentes président maintenant à cette technique sous l’empire des mœurs qui nous agitent et nous commandent diversement!
Par la seule ligne, dans l’unique distribution des volumes et de leur équilibre, le meuble moderne a su rivaliser avec ses aînés, de forme et d’attrait. La preuve en est que, mêlé aux styles du passé, il se joint à leur beauté sans être disparate, parce qu’il a retrouvé la tradition noble dans la voie matérielle autant que dans la vertu artistique.
FERNAND NATHAN. Coin d’un salon
P.-P. MONTAGNAC. — Fauteuils-bergère et bibliothèque (palissandre).
Aux modèles de la vie, stérilisés par la torture séculaire, il oppose la verve rafraîchie par la copie naturelle. L’artiste moderne est retourné boire à la source de l’inspiration tarie par l’effort humain, et sa jeunesse en beauté, au lieu de détonner dans un cercle de maturité vénérable, s’harmonise avec hier qu’elle ne diminue ni n’écrase, mais qu’elle vivifie.
C’est-à-dire que la foi sincère du présent exalte le pur génie d’autrefois, dont l’idéal fut le même que le nôtre, mais que les époques sans flamme ont maltraité parce qu’elles avaient perdu la tradition.
Maltraité, précisément, avec cette inconscience dont le bureau de M. de Vergennes, ministre de Louis XVI, donne typiquement la mesure. Ce bureau, moderne en son temps, qu’un récent ministre de la République eut le bon sens de reléguer au Louvre pour concevoir, ensuite, la fâcheuse idée de le remplacer... par une copie!
Mais là ne se bornèrent point les avatars de cette copie. On ne craignit pas de l’adapter, au mépris de ses proportions, à... l’échelle de ses différents titulaires dont les genoux marquèrent ainsi, tour à tour, au Ministère, la hausse et la baisse!
Sans commentaires..., mais, en revanche, il nous faut constater des initiatives officielles qui amendent les précédentes. C’est ainsi que nous devons à M. Léon Bérard, lorsqu’il fut sous-secrétaire d’État des Beaux-Arts, l’intérêt moderne du salon d’attente de la rue de Valois, et, d’autre part, le cabinet du Président du Conseil municipal de Paris est entièrement conçu au goût de notre temps. Je me garderais d’oublier, enfin, l’aménagement du Palais de Justice de Rennes, non moins «à la page» du progrès.
D’autres exemples suivent et suivront, sinon de la transformation totale, de la modification, du moins, de notre décor administratif autant que de celui de notre apparat. La réforme vient d’en haut, et la qualité esthétique des fêtes de la Victoire apporte déjà l’heureux présage d’une pompe originalement républicaine.
En vérité, le velours rouge à crépine d’or de nos estrades, le tapis vert et le cartonnier administrativement classiques ont fait leur temps. Ils appartiennent à un rond-de-cuir aussi caduc que celui que M. Georges Courteline se plut à nous représenter avec des manches de lustrine...
P.-P. MONTAGNAC. — Bureau en palissandre et Tapis au point noué.
Et déjà, des roses éclosent dans le lycée morne d’antan, et déjà la cour enfantine chante à l’unisson d’une architecture fraîche. C’est la nature célébrée par un art jeune; c’est un rayon de soleil violant le musée-cimetière; c’est la boutique de l’antiquaire dévastée par l’ouragan du génie nouveau; c’est Joseph Prud’homme enfin, bousculé parmi les fleurs artificielles qui hantent et son logis et son esprit paradoxal comme elles décorent, en tapisserie, ses pantoufles.
Le seul reproche à adresser au meuble moderne (comme à l’art appliqué tout entier) serait son individualisme. Mais déjà l’enseignement officiel remédie professionnellement à l’écueil de l’œuvre isolée, exclusive et rare.
BENEDICTUS. — Fauteuil, bergère et chaise (bois laqué, réchampi d’argent,
orné de tapisseries d’Aubusson; «Aux Fabriques d’Aubusson»).
L’Ecole Boulle, entre autres, a récemment démontré l’excellence de ses directives dans la voie d’une expression déterminée par des lois esthétiques et techniques générales. De l’effort unanime (et non privé), vulgarisé, exécuté en série, naîtra le meuble sain et sincère que notre démocratie réclame.
Et pourtant, rien n’ébranle cette théorie de la vulgarisation mobilière comme l’exemple du passé ! Car le style partit de la cour, du château d’où rayonna le modèle rare, la précieuse beauté...
A. FRECHET. — Salle à manger, palissandre et noyer: décor et bronzes de Paul Malclès (E. Vérot. Éditeur).
Aujourd’hui, l’industrie du faubourg Saint-Antoine tend, elle-même, sous de courageux et avisés auspices, à renier son passé d’admiration rétrograde et traîtresse. Le Grand magasin, avec Primavera (atelier d’art précurseur, inauguré en 1913, au «Printemps», sous la direction de M. René Guilleré), La Maîtrise (aux «Galeries Lafayette»), Pomone (au «Bon Marché ») et le «Studium-Louvre», dans l’ordre de création, emboîte exemplairement le pas; il devait cette revanche à la masse longtemps contaminée, détournée par lui, économiquement, du vrai luxe, de la vérité. L’étalage, dans la rue, éclaire davantage sur l’art toujours en éveil que le musée où dorment les chefs-d’œuvre; on saisit, dès lors, l’importance de son rôle et de son enseignement.
ERIC BAGGE. — Canapé.
E. LE BOURGEOIS. — Groupe de lions, bois sculpte.
Il importe enfin, suivant la forte pensée du comte de Laborde, que «l’art donne la main à l’industrie, non pas comme à une esclave qu’on relève de sa déchéance, mais comme à l’épouse qu’on est fier d’avoir à ses côtés.»
Mais, que voici donc, pour finir, un mauvais son de cloche! Écoutons plutôt M. Francis Jourdain: «Il ne s’agit plus aujourd’hui de meubler le logis mais de le démeubler. Les mobiliers à destination spéciale ne sont qu’un pis aller... l’ameublement de demain ne comportera ni buffets, ni armoires, qui l’encombraient sans raison, ni cheminées, de venues inutiles, et que les architectes continuent à prévoir, au point d’en construire de fausses...
CH. HAIRON. — Panneau en bois sculpté et doré.
CH. HAIRON. — Panneau en bois sculpté et doré.
D’ailleurs, la conception du lit de nos pères déjà fait faillite, tandis que la cheminée persévère, en dépit du radiateur, tout comme les appareils d’éclairage au gaz hantent encore la forme, sinon la disposition de notre luminaire électrique et nous avons vu que, longtemps, la carrosserie de la voiture automobile ne put s’affranchir de l’idée du cheval.
RAYMOND BIGOT. — Aigle royal, chêne sculpté.
Quant à la disparition de nos meubles ancestraux, voici qui eût sans doute laissé Goethe indifférent. «J’en userai peu ou pas du tout, disait un jour le poète en montrant un fauteuil qu’on lui avait acheté. Je m’assieds toujours sur ma vieille chaise de bois à laquelle j’ai fait ajouter, depuis quelques semaines seulement, un dossier pour appuyer ma tête. Un entourage de meubles commodes et artistement travaillés arrête court ma pensée et me plonge dans un état de bien-être passif. Si l’on n’y a été habitué dès sa jeunesse, les appartements somptueux et les ameublements de luxe ne conviennent qu’aux gens qui n’ont et ne se soucient d’avoir aucune idée...»
RAYMOND BIGOT. — Dossier de chaise, en bois de merisier sculpté.
(Appartient à M. Déchelette).
RAYMOND BIGOT. — Dossier de chaise, en bois de merisier sculpté.
(Appartient à M. Déchelette).
Sans adopter, toutefois entièrement, les prophéties de M. F. Jourdain, et en contradiction formelle avec l’auteur de Faust, il nous faut avouer que le goût moderne pour la simplicité, pour les larges baies et les surfaces nues, présage bien des sacrifices. Déjà le tableau a disparu de la muraille ou du panneau, déjà un ascenseur desservant chaque pièce d’un hôtel s’est substitué, — plutôt exceptionnellement encore, — à l’escalier, et l’on peut présumer, pour le moins, que le progrès ou le caprice nous prépare des meubles inédits (les inventions et découvertes du téléphone, du phonographe, de la T. S. F. réclament aujourd’hui des dispositifs, une présentation et un aménagement qui s’imposent à l’architecture comme au meuble), tandis qu’il supprimera ou transformera nombre de commodités mobilières que notre heure juge indispensables.
RAYMOND BIGOT. — Cortège de dindons, bas-relief noyer sculpté.
En attendant, MM. J. Ruhlmann, L. Süe et A. Mare, Clément Mère, L. Jallot, Francis Jourdain, Maurice Dufrène, Paul Follot, M. Gallerey, P. Selmersheim, H. Rapin, F. Nathan, A. Groult, P. Montagnac, Dominique, Pierre Chareau, René Joubert, P. Huillard, Benedictus, René Prou, A. Fréchet, Eric Bagge, Djo-Bourgeois, Mesdames Chauchet-Guilleré et Renaudot, s’imposent parmi nos meilleurs «meubliers» modernes, dans le sillon des précurseurs comme E. Gallé, Bellery-Desfontaines, E. Gaillard, H. Guimard, L. Sorel, Th. Lambert, Plumet, etc. La richesse d’un ameublement de Ruhlmann côtoyant, sans lui nuire, la simplicité de celui d’un Gallerey; la ligne architecturale passant toujours avant l’agrément ornemental (à l’avantage de l’étude architecturale sur celle du peintre), la grâce du décor et sa ressource ne donnant jamais le change à la pureté de la forme.
Deux mots maintenant sur la sculpture sur bois moderne.
M. E. Le Bourgeois, dont le nom fait autorité en cette matière, notamment, a préconisé les avantages de l’outillage mécanique dans les arts appliqués d’aujourd’hui, et l’emploi de la machine pour le travail du bois: «...la machine tournera avec nous ou sans nous. Si elle tourne sans nous, nous aurons failli au programme moderne...»
Et, partant de cette conception guidée par un talent et un goût remarquables, M. Le Bourgeois a réussi une expression singulièrement personnelle, une synthèse décorative des plus caractéristiques. «Que voyons-nous quand nous examinons une belle sculpture? Une succession de plans en profondeur réunis par des surfaces intermédiaires. Ces surfaces ne peuvent être que planes, convexes ou concaves, autrement dit, chanfreins, arrondis ou gouges.» L’excellent artiste, dans une conférence duquel nous empruntons, en arrive ainsi à une définition de la méthode de travail qu’il présente à ses auditeurs, définition peut-être tendancieuse mais, en tout cas, parfaitement descriptive de sa propre élocution de sculpteur sur bois: superposition de plans réunis par un chanfrein, un arrondi ou une gouge.
Après avoir admiré avec étonnement la naïveté vraie, la sincérité, l’expression sans archaïsme d’un sculpteur de nos jours, — M. Le Bourgeois en l’occurrence, — retrouvant les raffinements d’un bon imagier d’il y a six ou sept siècles, M. Gabriel Mourey énumère dans l’œuvre de l’artiste «... cette série de poteaux: le chat qui fait le gros dos, la cigogne, le singe, l’enfant emmaillotté, dont la plus grande partie a été exécutée au tour afin de laisser, par plus de simplification dans l’ensemble, tout l’intérêt au visage même du bambin, et aussi, — ce qui montre l’ingéniosité technique de M. Le Bourgeois, — comme une indication de ce qu’il serait possible de réaliser en utilisant dans la sculpture sur bois l’emploi du tour et de la toupie...» (ART ET DÉCORATION.)
Sans dépendre d’une formule, l’art de M. E. Le Bourgeois, solidement établi dans la masse, d’après le caractère du modèle, spirituellement conçu par volumes et équilibré par grands plans, a, semble-t-il, dirigé la décoration comme la statuaire décorative sur bois (sur ivoire et sur pierre) vers son point de réalisation moderne la plus typique. Il suffira de se reporter à nos gravures pour approfondir cette manière dans le sillon de laquelle l’artiste a fait école.
M. Ch. Hairon, notamment, s’avère un disciple distingué du maître auquel nous juxtaposerons, pour la science et l’art du bois différemment affrontés, M. Raymond Bigot. Dans l’ivoire comme dans la corne, la nacre et la pierre, à travers naturellement des techniques connexes ou différentes, l’élan est donné de ce parti d’épannelage ornemental, qui porte la marque de notre époque en donnant satisfaction à l’œil autant qu’aux besoins de l’accessoire, à l’art comme à l’industrie.
Nous laisserons maintenant la parole à des œuvres. Elles sont éloquentes et marquées au coin de notre race.
La pureté du goût dans le charme de l’invention, la solidité inséparable de la légèreté, la caresse des yeux jointe à la flatterie de la main chantent, à l’unisson, la gratitude du confort basé sur l’orgueil de la matière. Vertus héritées d’un passé dont notre sol embaume essentiellement et sur lesquelles nous aurons l’occasion de revenir au cours de notre travail.
E. LE BOURGEOIS. — Chien pekinoir, bois sculpté.
(Appartient à M. J. Rouché).