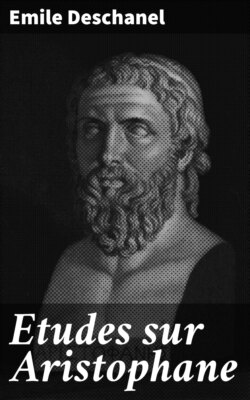Читать книгу Etudes sur Aristophane - Emile Deschanel - Страница 270
На сайте Литреса книга снята с продажи.
LES NUÉES.
ОглавлениеTable des matières
Voici une des œuvres les plus fantastiques dans la forme, mais les plus sérieuses au fond, et aussi, disons-le tout d'abord, la plus injuste et la plus odieuse parmi toutes celles d'Aristophane.
Ce sont, comme le titre l'indique, des Nuées, personnages parlants et chantants, qui forment le chœur de la pièce. En réalité, il s'agit de l'éducation publique, c'est la querelle du passé et de l'avenir, des idées anciennes et des idées nouvelles, de la religion et de la philosophie. «Ici s'agitent, dit le chœur des Nuées, ici s'agitent les destinées de la philosophie[51].»
Cette comédie est donc en effet la plus grave de toutes les discussions sociales; mais, au premier coup d'œil, c'est une bouffonnerie encore plus fantastique, s'il est possible, que celle qu'on vient de parcourir.
Dans cette pièce, Aristophane, emporté par la peur des nouvelles idées, calomnie leur représentant le plus illustre et le plus pur, l'un des hommes les plus divins qui aient jamais existé sur la terre. On voit là un esprit affolé par la crainte, comme certaines gens qu'épouvante aujourd'hui le nom seul de socialisme, et qui, le plus naturellement du monde, calomnient et frappent leurs adversaires sans les comprendre, sans leur permettre même de définir ce nom.
Singulier moment dans l'histoire d'une civilisation que celui où le régime ancien ayant fait son temps, le régime futur se cherche encore; où traditions, mœurs, religion, tout s'écroule; où la société se décompose et semble ne contenir que des forces désorganisées; où l'esprit nouveau, esprit destructeur, curieux, téméraire, envahit tout; où l'on se sent glisser sur une pente sans savoir où l'on va; où le flot des idées révolutionnaires grossit, se précipite, entraîne tout. Alors, comme les caractères des hommes sont différents, et que, dans toutes les sociétés humaines, sous les formes quelconques de gouvernement, l'éternel problème à résoudre est celui de la conciliation de l'ordre et de la liberté, mais que, s'il faut faire pencher la balance dans un sens ou dans un autre, les uns préfèrent l'excès de l'ordre, les autres celui de la liberté, il se forme deux grands partis: d'un côté, ceux qui pensent que la sagesse ordonne de creuser un lit au torrent, afin d'en gouverner le cours; que les idées dites révolutionnaires seront simplement évolutionnaires si l'on ne gêne pas cette évolution; de l'autre, ceux qui sont d'avis de barrer le courant et de le contenir. Ceux-ci se croient les plus prudents et en réalité sont les plus téméraires. Ils se donnent le titre de conservateurs, et perdraient tout, si leur dessein réussissait. Ils se roidissent et se fâchent contre le mouvement irrésistible; ils protestent au nom du passé, et jettent à ce monde qui gravite vers de nouvelles destinées d'inutiles admonestations. Tel fut le rôle d'Aristophane. Il mit, certes, dans cette entreprise cent fois plus d'esprit et d'ardeur qu'il n'en aurait fallu pour réussir, s'il était donné à un homme d'arrêter le cours de l'humanité et les progrès de la raison. Il devait échouer, il échoua.
Essayons toutefois de pénétrer dans les idées de ce poëte, de les comprendre et de les expliquer, sans les justifier.
La crise qui travaillait le siècle d'Aristophane était, à la vérité, le commencement d'une ère nouvelle pour l'esprit humain, mais aussi faisait redouter, par ses profonds ébranlements, une décadence plus ou moins rapide pour la nation grecque, et d'abord pour la puissance d'Athènes. Le poëte Athénien fut plus frappé des dangers probables de sa patrie que des progrès possibles de l'humanité.
Socrate avait des sentiments plus étendus. Comme on lui demandait quelle était sa patrie,—«Toute la Terre,» répondit-il, donnant à entendre qu'il se considérait comme citoyen de tous les lieux où il y a des hommes[52], des êtres pensants. «Avant lui déjà, l'esprit philosophique avait franchi les bornes de la cité. Anaxagore fut citoyen de la Terre plutôt que de Clazomène; Pythagore, dit-on, ne fit aucune différence entre les Grecs et les barbares dans l'organisation de la société; il embrassait la nature entière dans son amour. Démocrite s'était proclamé citoyen du monde. Toutefois cette profession de sentiments cosmopolites avait été moins une doctrine que l'indifférence d'un sage pour les intérêts journaliers de la politique. La pensée de Pythagore, plus haute et plus pure, inspira peut-être Socrate, qui le premier sut concilier rationnellement les devoirs du citoyen avec ceux de l'homme[53]. Le grand Athénien, en s'élevant au-dessus du patriotisme jaloux qui régnait chez les Grecs, ne se séparait pas de la cité où le hasard l'avait fait naître; il l'aimait avec tendresse, et, tout en estimant les institutions de Lycurgue supérieures à celles de Solon[54], il manifesta toujours une prédilection particulière pour sa patrie. S'il ne montait pas à la tribune pour entretenir le peuple des intérêts du jour, s'il n'était pas, à proprement parler, un homme politique, sa vocation n'avait pas de moindres avantages pour l'État. «Il s'occupait de persuader à tous, jeunes et vieux, que les soins du corps et l'acquisition des richesses ne devaient point passer avant le perfectionnement moral, que la vertu ne vient pas des richesses, mais que tous les vrais biens viennent aux hommes de la vertu[55].»
* * * * *
Socialement Aristophane était l'adversaire de Socrate, quoiqu'ils appartinssent à peu près au même parti politique. «La politique des Socratiques à Athènes, dit M. Havet, comme en France la philosophie du dix-huitième siècle, était en opposition avec l'ordre établi; mais il y avait cette différence considérable, que la philosophie française s'appuyait sur l'esprit de la démocratie, tandis que la philosophie athénienne était anti-démocratique, comme paraît déjà l'avoir été la philosophie pythagoricienne, dont elle recueillait les traditions. C'est que les philosophes, impatients du mal et ne pouvant manquer de l'apercevoir autour d'eux, ne sachant où trouver le mieux qu'ils conçoivent, et poussés pourtant, par un instinct naturel, à le placer quelque part, l'attachent volontiers à ce qui se présente comme le contraire de ce qu'ils connaissent. Les Pythagoriciens voyaient la multitude régner, par ses chefs populaires ou tyrans, dans les cités d'Italie; les Socratiques la voyaient régner par elle-même dans Athènes. Les uns et les autres désavouèrent également la démocratie, ou du moins ce qu'on appelait de ce nom, car, on le sait, il n'y avait là qu'une apparence[56]…» Toutefois, comme le remarque encore M. Havet, «on pourrait dire qu'en vain leurs systèmes étaient aristocratiques, leur instinct ne l'était pas. Ils ne s'y sont pas trompés, ceux qui ont condamné Socrate. Leur indépendance à l'égard des traditions religieuses suffit pour montrer qu'ils ne sont pas véritablement du côté du passé, même lorsqu'il le semble, même lorsqu'ils le croient. Et, à ce seul signe, l'esprit moderne reconnaît en eux des frères. Par là leur philosophie est encore aujourd'hui toute vivante, leur action se perpétue; elle ne sera à son terme que le jour où le fantôme des superstitions, dissipé enfin à la lumière qu'ils ont les premiers allumée, aura cessé de peser sur l'humanité, réveillée pour jamais d'un lourd sommeil. Je ne doute pas, quant à moi, que l'impatience que leur causait l'obstination aveugle des croyances populaires n'ait été pour beaucoup dans la défiance que la multitude leur inspirait. Un sentiment pareil arrachait à Voltaire des cris de colère contre la foule, qu'il croyait vouée à l'erreur et au fanatisme pour toujours. Rien n'indispose autant à l'égard du grand nombre les esprits distingués et les cœurs ardents que de le voir se trahir lui-même et prêter sa force à ce qui l'accable[57].»
Mais, si Socrate, du côté politique, se rapprochait d'Aristophane, il le dépassait de bien loin par les vues sociales, par l'esprit philosophique. Nous avons remarqué qu'Aristophane, dans son extrême amour de l'ordre, confond avec les démagogues la démocratie elle-même; ainsi, dans sa haine des nouveautés (pour parler comme Bossuet, esprit analogue sous ce rapport), il confond la philosophie avec les sophistes. Attaché aux institutions anciennes, qui avaient encore pour elles la consécration de l'expérience et qui avaient eu longtemps celle de la gloire, il emploie à défendre l'héritage du passé, en un mot à conserver, toute la verve et la malice que Voltaire et Beaumarchais emploieront à démolir. Il ne fait point, il ne veut point faire de distinction entre la libre pensée et l'athéisme, ni même entre les génies courageux qui élaborent les problèmes sociaux, les doctrines de l'avenir, et les charlatans, rhéteurs et sophistes, qui, discutant toutes les théories avec une égale éloquence et une égale incrédulité, les brisent les unes contre les autres, renversant tout et n'édifiant rien. Peu s'en faut que, par réaction, il n'invente déjà ce paradoxe où Jean-Jacques Rousseau encore inconnu cherchera le bruit et la gloire et faussera son génie dès le début, à savoir que les sciences, les lettres, les arts et la philosophie, servent plutôt à corrompre les hommes qu'à les rendre meilleurs. Bref, Aristophane est conservateur et fébrile réactionnaire enragé. L'analyse de cette comédie montrera que le mot n'est pas très-fort.
* * * * *
Quoi qu'en dise le proverbe arabe: «La parole est d'argent, et le silence est d'or,» il peut être vrai dans la vie privée, il est faux dans la vie publique. La parole, même avec ses abus et ses excès, vaut mieux que le silence. La parole, c'est la liberté, la vie; le silence, c'est la compression, la mort; c'est tout au moins, la léthargie. En voulez-vous une preuve entre mille? «Une des premières mesures de l'oligarchie des Trente fut de défendre, par une loi expresse, tout enseignement de l'art de parler. Aristophane raille les Athéniens pour leur amour de la parole et de la controverse, comme si cette passion avait affaibli leur énergie militaire; mais, à ce moment, sans aucun doute, ce reproche n'était pas vrai, et il ne devint vrai, même en partie, qu'après les malheurs écrasants qui marquèrent la fin de la guerre du Péloponnèse. Pendant le cours de cette guerre, une action insouciante et énergique fut le trait caractéristique d'Athènes, même à un plus haut degré que l'éloquence ou la discussion politique,—bien qu'avant le temps de Démosthène il se fût opéré un changement considérable[58].»
Dans la vie des Athéniens telle qu'elle était constituée, «l'habileté de la parole était nécessaire non-seulement à ceux qui avaient dessein de prendre une part marquante dans la politique, mais encore aux simples citoyens pour défendre leurs droits et repousser des accusations dans une cour de justice. C'était un talent de la plus grande utilité pratique, même indépendamment de tout dessein ambitieux, à peine inférieur à l'usage des armes ou à l'habitude du gymnase. En conséquence les maîtres de grammaire et de rhétorique, et les compositeurs de discours écrits que d'autres devaient prononcer, commencèrent à se multiplier et à acquérir une importance sans exemple[59].» C'est dans ce moment-là qu'Aristophane composa la comédie des Nuées. En voici l'analyse.
* * * * *
Strepsiade, homme simple et peu éclairé a fait la sottise, que feront après lui beaucoup d'autres et Georges Dandin, de prendre pour femme, lui paysan, une personne de qualité, dépensière, frivole et ardente au plaisir. Il en a eu un fils. Quand ce fils vint au monde, la noble épouse et le pauvre mari se querellèrent au sujet du nom qu'il convenait de lui donner. Elle y voulait de la chevalerie: c'était Xant_ippe_, Char_ippe_, Call_ippide_[60]. Lui, voulait qu'on l'appelât tout bonnement comme son grand-père, _Phid_onide, nom fleurant l'économie. Enfin, après une longue dispute, on prit un moyen terme et on appela l'enfant Phidippide[61].
Or Phidippide, devenu grand, tient plus de sa mère que de son père, et justifie moins la première moitié de son nom que la seconde: il aime les chevaux, les chiens, le jeu, les paris, les combats de coqs. Son malheureux père en est désolé, et ruiné.
C'est dans son lit, en se lamentant et en se défendant contre les puces, que Strepsiade nous apprend sa déplorable histoire, tandis que son coquin de fils rêve, à côté de lui, de courses et de chars. Cela fait encore une exposition jolie, et une mise en scène curieuse: le théâtre, par un décor combiné, moins simple que les procédés ordinaires décrits par Schlegel, devait représenter d'un côté l'intérieur de la maison de Strepsiade, de l'autre l'intérieur de l'école de Socrate; au milieu, une place ou une rue.
Strepsiade, donc, est couché dans un lit, son fils dans un autre. Autour d'eux, des esclaves dorment par terre. Il fait nuit.
STREPSIADE, couché, et gémissant.
Oh! io, io ioïe! grands dieux! que les nuits sont longues! Le jour ne viendra donc jamais? Depuis longtemps j'ai entendu le chant du coq, et mes esclaves ronflent encore! Ah! jadis ce n'eût pas été ainsi! Maudite guerre! m'as tu fait assez de mal! je ne puis même plus châtier mes esclaves!—Et cet honnête fils que j'ai là ne s'éveille pas davantage: il pète, enveloppé dans ses cinq couvertures!—Allons! essayons encore de dormir et renfonçons-nous dans le lit.—Dormir? Eh! comment, malheureux? dévoré par la dépense, l'écurie et les dettes, à cause de ce beau fils! Lui, avec ses cheveux flottants, il monte à cheval ou en char, et ne rêve que chevaux; et moi je meurs lorsque la lune ramène le jour des échéances!—Hé! esclave! allume la lampe, et apporte-moi mon registre: que je récapitule à qui je dois, et que je calcule les intérêts.—Voyons: douze mines à Pasias? Ah! c'était pour payer ce cheval pur-sang! Hélas! plût au ciel qu'un bon coup de pierre, auparavant, eût fait couler ce sang!
PHIDIPPIDE, rêvant.
Philon, tu triches! tu dois aller droit devant toi!