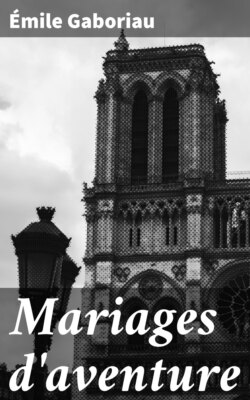Читать книгу Mariages d'aventure - Emile Gaboriau - Страница 5
II
ОглавлениеMalheureusement l’avis de Lorilleux fut aussi l’avis de M. Divorne le père, avoué licencié près le tribunal de première instance de Lannion (Côtes-du-Nord).
La nouvelle de cette démission intempestive le frappa comme un coup de foudre; il fut atteint au cœur. C’en était fait de ses plus chers désirs, des projets qu’en bon père de famille il avait bâtis sur la tête de ce fils unique.
Voir Pascal, l’héritier de sa fortune et de son nom, ingénieur à Lannion, se promener par les rues avec ce fils, superbe sous l’uniforme brodé, épée au côté, claque sur la tête, tel avait été le rêve de sa vie, et voilà que, par un incompréhensible caprice, il s’évanouissait au moment de devenir une réalité. M. Divorne disait «caprice,» parce que Pascal annonçait purement et simplement qu’il se retirait, sans explication aucune, sans excuse.
On eût été furieux à moins. L’avoué ne se fit pas faute de se mettre en colère. Il envoya à Pascal sa malédiction. Il y avait certes de quoi justifier vingt malédictions.
Cependant, le premier étourdissement passé, le père malheureux essaya de réfléchir. Peut-être eût-il dû commencer par là. Il se demanda jusqu’à quel point un jeune homme de vingt-quatre ans qu’on a réussi à faire admettre à l’École polytechnique d’abord, à l’École des ponts et chaussées ensuite, dont l’éducation représente un capital de plus de trente mille francs, a le droit de donner sa démission sans le consentement de ses parents ou de ses tuteurs. En avait-il vraiment le droit?
L’avoué essaya d’en douter. Il consulta. Hélas! il dut se rendre à l’évidence, et c’est avec une profonde amertume qu’il reconnut une lacune dans la loi. Il maudit le législateur et l’accusa d’imprévoyance, lui, l’interprète, l’admirateur passionné des décrets et ordonnances.
Puis, comme s’il eût été besoin d’aviver sa douleur et d’attiser sa colère, il ne rencontrait dans les rues de Lannion que des figures dolentes; on semblait s’être donné le mot. C’est qu’en moins de rien, la nouvelle avait fait le tour de la ville. Le soir même on en parla en dix endroits différents.
On plaignait le père, on condamnait le fils sans appel.
De ce jour, Pascal fut un homme toisé. Ses compatriotes décidèrent que c’était un garçon perdu, qui n’arriverait jamais à rien, et qui certes finirait mal. Un avoué était bien malheureux d’avoir un fils semblable qui le déshonorerait peut-être quelque jour.
Quelqu’un avança même que M. Divorne avait en deux jours vieilli de dix ans. Encore un peu on eût affirmé que ses cheveux avaient blanchi dans une nuit; on cite des exemples de ce miracle, après d’épouvantables catastrophes.
Bref, Pascal eût ruiné sa famille, fait des faux, mérité le bagne, qu’il n’eût guère été plus honni; tant est grande l’aménité des âmes charitables de province.
Madame Divorne reçut vingt visites dans la semaine; jamais elle n’avait eu tant d’amies. Toutes les femmes qui la connaissaient un peu trouvèrent un bon prétexte pour venir savoir au juste ce qui en était, s’assurer par elles-mêmes de la vérité, et retourner un peu le poignard dans la blessure, si blessure il y avait.
Il faut dire que, tout en condamnant le fils, en compatissant à la douleur du père, on trouvait généralement que cette punition frappait juste. L’avoué avait toujours été heureux, et le bonheur est un tort qui se pardonne difficilement dans les petites villes de province. Le succès de l’un est pour tous une cruelle injure. La jalousie dort au fond de tous les cœurs. Que de haines sourdes et envenimées qui n’ont pas eu d’autre point de départ!
Plus que tout autre M. Divorne était envié. On l’avait connu pauvre, et il était riche. On se souvenait de sa veste de ratine lorsqu’il était petit clerc chez son prédécesseur, et il avait une des plus jolies maisons de la ville. Ah! il avait fait de bonnes affaires.
—Quelle chance il a! disaient ceux qu’une prudence imbécile ou qu’une notoire incapacité attachaient à une immuable médiocrité, quelle chance il a!
Un petit héritage lui avait permis de faire quelques études, la dot de sa femme lui avait payé sa charge d’avoué, et depuis il avait toujours prospéré. Ses économies avaient fait la boule de neige.
Et que de pères il avait humiliés jadis, en comparant leurs fils au sien! Avait-il assez fait parade de la satisfaction que lui donnait cet enfant qui tous les ans revenait chargé de couronnes et n’avait que des boules blanches à ses examens! Et, plus tard, avait-il chanté assez haut ses espérances!
Ce qui arrivait était donc une punition méritée, une preuve qu’il faut se défier de ces collégiens modèles, de ces jeunes gens de tant d’esprit: ils croient à leur supériorité, ils veulent faire autrement que n’ont fait leurs pères, et tournent mal. Il y a longtemps qu’on l’a dit, l’esprit est immoral.
Ainsi, pendant quinze jours, tous les gens qui abordaient l’avoué, ravis au fond de l’âme, croyaient de bon goût de mettre leur visage au diapason supposé de la douleur paternelle. Au palais, il recevait des compliments quotidiens de condoléance; au cercle, des poignées de main de consolation.
Son irritation s’accroissait d’autant, il n’était pas loin de croire que Pascal avait commis un crime. Il rentrait chez lui plus furieux que jamais, et, faute de mieux, il s’en prenait à sa femme dont la faiblesse maternelle, aveugle et imprudente, comme on sait, avait causé tout le mal.
Cependant, à force d’envisager la situation, de l’étudier, M. Divorne finit par se persuader que le mal n’était pas irréparable.
Il songeait sérieusement à écrire au ministre de l’intérieur, à faire le voyage de Paris pour solliciter une audience, lorsque Pascal, un beau soir, tomba comme une bombe dans la maison paternelle. Il arrivait par la voiture qui fait le service entre Rennes et Brest.
Certes, on ne l’attendait guère! Josette, la vieille bonne, qui était allée ouvrir en grondant contre l’impertinent qui se permettait de sonner si fort à pareille heure, faillit tomber à la renverse en reconnaissant son jeune maître. Car elle le reconnut du premier coup, ainsi qu’elle s’en vantait plus tard, bien qu’il fût terriblement changé, et «grandi et renforci,» depuis trois ans passés qu’elle ne l’avait vu.
Elle poussa un cri de joie, de surprise, et, lâchant la chandelle, s’élança dans les escaliers en appelant à elle tout le monde, comme si le feu eût été à la maison.
Pascal, pendant ce temps, avait fermé la porte et s’avançait à tâtons.
—C’est moi, criait-il en riant, c’est moi, n’ayez pas peur.
Aux cris perçants de Josette, la porte du salon s’était ouverte.
—Eh bien! qu’est-ce, qu’est-ce donc? demandait l’avoué surpris de ce désordre.
Josette, tout émue, n’était pas près de recouvrer la parole. Mais déjà madame Divorne avait reconnu la voix de son fils et se précipitait à sa rencontre. Et l’avoué répétait encore: «Qu’est-ce, qu’est-ce?» que déjà Pascal était dans les bras de sa mère qui pleurait de bonheur, tout en le serrant à l’étouffer sur son cœur.
Par lui, par ce fils chéri, elle avait bien souffert depuis quinze jours; mais sa présence seule était une justification complète, une compensation plus que suffisante. Il parut, et tout fut pardonné, ou plutôt oublié.
Quant à M. Divorne, il crut de sa dignité de rester impassible. Pouvait-il faire moins pour le principe d’autorité paternelle? Il réussit, ma foi, à dominer son émotion, non sans peine, non sans une légère grimace qui dissimulait une larme. Mais enfin il demeura convenablement froid et sévère, et sa figure exprima le mécontentement, même en embrassant ce fils, autrefois sa joie et son orgueil.
Par exemple, c’est tout ce qu’il put prendre sur lui. A l’étreinte de son fils, il sentit que sa colère se fondait comme les neiges aux brises d’avril. L’attendrissement le gagnait. «Il ne voulut pas donner sa faiblesse en spectacle,» et, prétextant une affaire urgente,—une affaire urgente à Lannion, à neuf heures du soir!—il sortit précipitamment, en se mouchant plus fort que de raison.
L’enfant prodigue était revenu, et le père, comme celui de l’Ecriture, n’avait pas ordonné de tuer le veau gras pour fêter le retour. Il est vrai que le père de l’Ecriture n’était pas un avoué au tribunal de première instance.
Pascal resta donc seul avec sa mère. Il fallait s’occuper de faire souper le voyageur.
Il avait l’appétit d’un homme qui depuis deux jours vit d’à-comptes dérobés à la hâte aux buffets des chemins de fer, c’est-à-dire que, n’ayant pas voulu s’étouffer, il mourait de faim. Josette s’empressait de dresser la table devant la cheminée. Elle allait, venait, du salon à la cuisine, de la cuisine au salon, perdant la tête, faisant dix tours pour un; de temps à autre elle essuyait une larme ou cassait une assiette, preuves manifestes de son émotion.
Madame Divorne s’était assise vis-à-vis de son fils qui dévorait. Elle était en extase, elle l’admirait, elle eût voulu pouvoir rester ainsi des années. Mais une explication était imminente entre Pascal et son père, cette explication pouvait être orageuse. Ne fallait-il pas prévenir Pascal, obtenir de lui quelque concession? Elle voulait s’interposer, au risque d’attirer sur elle le poids de deux colères.
—Ton père est bien irrité, méchant enfant, dit-elle; tu nous donnes, tu lui donnes du moins bien des tourments.
—Mais non, chère mère, je t’assure; va, sois tranquille, ce ne sera rien.
—Au moins fallait-il le prévenir, lui demander conseil.
—Certain d’avance d’un refus! Quelle folie! j’aurais passé outre: juge alors.
—Au moins promets-moi d’être raisonnable s’il te gronde, de ne pas te mettre en colère.
—Je te le promets; mais tu verras comme j’ai eu raison.
—Ah! je le souhaite, murmura tristement madame Divorne.
Pascal l’embrassa, et sa cause fut gagnée. Désormais elle était prête à se ranger du côté de son fils, sûre qu’il ne pouvait avoir tort.
Voilà pourtant comme toutes les mères sont difficiles à convaincre! Ah! elles ne se paient pas de mauvaises raisons!
Il paraît que l’avoué ne recouvra pas son courage en route. Lorsqu’il revint, l’affaire urgente terminée, sa figure était loin d’avoir gagné en sévérité. Il ne fut question de rien. Il causa fort amicalement avec son fils. Il rit, plaisanta, mais de la démission, pas un mot.
Il n’en fut pas question davantage le lendemain, ni les jours suivants. Dieu sait pourtant qu’on ne se faisait pas faute de lui demander partout où il paraissait:
—Votre fils est donc ici? Eh bien?...
Le bruit de ce retour s’était en effet répandu très vite. On avait vu le facteur entrer chez l’avoué avec une malle et un carton à chapeau: les visites assiégèrent la maison. Mais madame Divorne défendit sa porte. Elle s’est fait ce jour-là des ennemis qui ne lui ont pas encore pardonné.
Une fois, Pascal s’avisa de sortir. Il n’avait pas fait cent pas dans la rue que cinq personnes déjà, dont deux qu’il ne connaissait guère et une qu’il ne connaissait pas du tout, étaient venues lui serrer la main et lui demander hypocritement des nouvelles de l’École des ponts et chaussées.
Il rentra tout courant, maudissant ses compatriotes, et se jurant bien de ne plus mettre le nez dehors.
Les jours se passaient, et M. Divorne semblait avoir complétement oublié ses griefs contre son fils. Vingt fois celui-ci, que cet état d’incertitude tourmentait, serait allé au-devant de l’explication qu’il était venu chercher; sa mère le retint toujours.
—Attends, lui disait-elle. Je connais ton père, il est très long à prendre un parti. Il réfléchit depuis ton arrivée. Lorsque sa décision sera bien arrêtée, il t’en fera part, sois tranquille.
Un matin, en effet, après déjeuner, lorsque la nappe fut ôtée, l’avoué, d’un air grave, pria son fils de lui prêter toute son attention.
—Allons, pensa Pascal, le moment est venu.
M. Divorne était prolixe d’ordinaire, on le lui reprochait au palais; mais jamais, comme en cette circonstance solennelle, il n’abusa du don précieux de la parole.
L’exorde de son discours fut une sorte d’invocation à l’amour paternel. Qui mieux que lui en avait compris les devoirs? Il en faisait son fils juge: avait-il assez donné de preuves de son affection? Et quelle avait été sa récompense?
Puis il passa à l’énumération des soucis sans nombre que donnent les enfants. Rien ne fut oublié, ni les inquiétudes de la première dentition, ni un voyage en poste à Paris, à une époque où Pascal avait été malade. Ce fut le premier point.
Le second traita des sacrifices pécuniaires. Ce fut le plus long. L’avoué calcula, chiffra tout ce qu’il avait déboursé,—à une paire de souliers près,—pour donner à son fils les bienfaits de cette éducation qui lui avait manqué à lui-même.
Enfin, comme de juste, dans une troisième partie, il aborda le chapitre des compensations: il tint compte des satisfactions de tout genre qu’il devait à Pascal. Elles étaient nombreuses, il n’en omit pas une seule.
En un mot, ce discours fut comme la lecture du grand-livre en partie double de la paternité, avec ses chagrins, ses pertes d’une part, ses joies, ses bénéfices de l’autre. Jusqu’alors, M. Divorne le constatait, la balance était en faveur de son fils, et lui, le père, se reconnaissait débiteur.
—Et maintenant, ajouta-t-il en manière de conclusion, j’espère, Pascal, que tu ne voudras pas changer cet état de choses. Tu as dû réfléchir depuis que tu es ici, tu dois regretter d’avoir si follement brisé ta carrière. Reviens sur ta décision, adresse-toi au ministre, il ne te refusera pas ta réintégration, et je suis prêt à te pardonner le vif chagrin que tu m’as causé.
L’effet produit fut loin d’être celui qu’attendait M. Divorne. Pascal garda quelques instants le silence, comme s’il eût rassemblé toutes ses forces. On eût pu croire qu’il hésitait à répondre. Enfin, d’une voix ferme:
—Mon père, dit-il, ce que vous désirez est impossible. Ma demande, croyez-le, serait repoussée; d’ailleurs, je ne saurais me décider à la faire.
—Fort bien, reprit l’avoué de l’air le plus mécontent; il est si facile aujourd’hui de se faire une position. Sans doute, vous avez trouvé mieux?
—Sinon mieux, au moins plus à mon goût. Vous devez penser que j’ai réfléchi avant d’agir. Quant à mes intentions, je suis venu ici précisément pour vous en faire part. C’était d’autant plus nécessaire, que j’aurai besoin de vous.
—C’est vraiment fort heureux. Je comprends alors que tu aies songé à moi. Et en quoi pourrai-je t’être utile?
—Avant de rien entreprendre, il est nécessaire que je me procure des fonds, et j’ai compté...
—Ah! nous y voici donc, dit l’avoué d’un ton goguenard; il te faut des fonds... Mais il me semble qu’avant de quitter une position toute faite, tu devais t’assurer de ma bonne volonté. Si je te refusais... et certes, je refuserai...
—Mais, mon père, reprit Pascal avec un peu d’impatience, il me semble qu’il y a dix ans à peu près une de mes tantes m’a laissé par son testament une quarantaine de mille francs.
Une vieille plaideuse de soixante ans, à peu près certaine du gain d’un de ses procès, serait venue dire à l’avoué: «—J’y renonce,» elle l’eût certes moins surpris qu’il ne le fut aux paroles de son fils.
—C’est-à-dire que tu me demandes des comptes, prononça-t-il avec amertume. Ah! c’est une surprise cruelle.
Pascal eut beau se défendre, le coup était porté. Il essaya d’expliquer ses projets à venir, il voulut se justifier, faire connaître l’emploi de l’argent qu’il demandait, M. Divorne se refusa même à l’écouter.
—Eh! que m’importe, disait-il, je ne veux rien savoir.
En effet, il était bien loin de la discussion présente. Il avait oublié jusqu’à la démission; il ne songeait plus qu’au moyen de sauver cet argent que Pascal, il devait bien se le dire, était en droit de réclamer.
Il cherchait quelque moyen pour donner le moins possible, convaincu qu’un si jeune homme ne pouvait faire qu’un détestable usage d’une somme aussi forte.
—Voyons, Pascal, dit-il enfin, je comprends que tu aies besoin d’argent. Cependant, tu pouvais t’y prendre d’une autre façon pour m’en demander. Suis-je donc un père ridicule? T’en ai-je jamais refusé? Tu n’as pas abusé, je le reconnais. Mais voici cinq ans que tu travailles beaucoup, peut-être désires-tu te distraire, faire un voyage...
—Mais non, mon père, si vous me laissiez parler, je vous...
—Tais-toi, écoute: tu as sans doute des dettes. Eh! mon Dieu! tous les jeunes gens en ont...
—Je ne dois pas un sou.
—Mais écoute-moi donc, je ne te demande rien. Sois franc, tu as besoin de cinq mille francs?
—Mon cher père...
—Il te faut davantage... soit, tu auras dix mille francs.
Et l’avoué, se levant, comme pour annoncer que la discussion était close, se dirigea vers la porte. Pascal comprit qu’il fallait en finir.
—Mon père, dit-il, j’ai besoin de tout ou de rien.
—Rien alors, répondit M. Divorne d’un ton menaçant, en revenant sur ses pas; rien. Crois-tu que je vais, jeune insensé, te laisser dissiper ta petite fortune?
—Cet argent m’est nécessaire, pourtant, indispensable.
—Ah! c’est indispensable; soit. Ta tante t’a laissé une ferme, une ferme que je te rendrai en bon état, avec un bail avantageux. Soit, reprends tes biens et arrange-toi. Qu’en feras-tu?
—Je les vendrai.
—Et tu crois que cela te donnera de l’argent du jour au lendemain? Il faut attendre une occasion, chercher un acquéreur, poser des affiches...
—Je chercherai, je poserai des affiches.
—Mais tu n’y penses pas, malheureux! et que dirait-on à Lannion, si on te voyait vendre seulement un franc de terre! Sais-tu ce qu’on dirait?
—Eh! que m’importe! s’écria Pascal avec vivacité. Je vais commander les affiches de ce pas.
M. Divorne connaissait son fils. Il comprit que sa détermination était prise.
—Arrêtez, dit-il, je veux vous éviter cette honte. Je trouverai l’argent, dussé-je faire un sacrifice.
Pascal, qui regrettait de s’être un instant laissé emporter, voulut prendre les mains de son père; mais il le repoussa.
—Epargnez-vous d’inutiles protestations, fit-il; et il ajouta d’un air d’ironie: Vous voudrez bien, je l’espère, m’accorder huit jours.
Et il sortit en fermant la porte avec violence.
Pendant cette discussion, madame Divorne n’avait pas prononcé une parole; elle pleurait. Pascal, que la colère paternelle avait affermi dans sa résolution, se sentit faible devant les larmes de sa mère.
Il s’agenouilla près d’elle, et lui prenant les mains:
—Mère, dit-il, chère mère, un mot, dis un mot, et je renonce à mes projets, et j’essaie de retirer ma démission.
Un éclair de joie brilla dans les yeux de madame Divorne, éclair de triomphe aussi. Comme son fils l’aimait! que ne lui sacrifiait-il pas, lui si ferme tout à l’heure!
—Non, mon Pascal, non, suis tes inspirations, j’ai confiance, moi.
—Chère mère, au moins faut-il que tu saches...
—Rien, je ne veux rien savoir. Je te le répète, j’ai confiance; comprendrais-je, d’ailleurs?
Et comme il s’obstinait, elle lui ferma la bouche de ses deux mains.
La maison fut bien triste pendant les jours qui suivirent. L’avoué était sombre et ne disait mot. On ne le voyait qu’aux heures des repas; le reste du temps il s’enfermait dans son cabinet. Madame Divorne se cachait pour pleurer.
Pascal n’avait pas idée d’un tel supplice. Il aurait donné deux ans de sa vie pour pouvoir partir. Si encore il avait pu causer de ses projets, étaler ses plans. Mais non, il fit près de son père deux ou trois tentatives inutiles, et sa mère lui répondait toujours: «—J’ai confiance,» sans vouloir lui laisser dire une parole.
Enfin, le jour indiqué, M. Divorne conduisit son fils dans son cabinet.
—Voici, dit-il, en lui montrant une liasse d’actes, vos comptes de tutelle. Voyez si j’ai administré vos biens en bon père de famille. Lisez, et donnez-moi quittance.
Pascal prit une plume.
—Non, lisez, insista l’avoué.
Et comme le jeune homme s’y refusait, il prit les actes, et lui-même lut à haute voix, insistant sur certains détails, et de temps à autre s’arrêtant pour demander:
—Êtes-vous satisfait de ma gestion?
Les actes étaient longs. Pascal se mourait d’impatience, lorsqu’enfin cette lecture, véritable supplice qui dura près de trois heures, fut terminée.
—Maintenant, dit le père, voici votre argent. Il vous revient, comme vous avez pu vous en convaincre, quarante-trois mille sept cent cinquante-six francs soixante centimes. Comptez si tout y est.
Pascal mit les billets et l’argent dans sa poche; son père l’arrêta:
—Non, comptez, vous dis-je, j’y tiens.
Il fallut obéir.
—Nous sommes quittes, n’est-ce pas? dit alors l’avoué. Quand partirez-vous?
—Mais le plus tôt possible, dès demain, si je puis avoir une place dans la voiture... On m’attend à Paris.
—En effet, vous auriez tort de vous faire attendre.
—Cependant, mon père, je ne voudrais pas nous quitter ainsi; vous êtes injuste à mon égard, et je...
—Chansons que tout cela! fit l’avoué avec impatience; laissez-moi, j’ai à travailler.
Le lendemain matin, à neuf heures, le garçon des messageries vint avertir Pascal qu’on attelait les chevaux à la diligence, et qu’il n’avait que le temps de se rendre au bureau.
Les adieux furent pénibles. Madame Divorne sanglotait. A la voir étreindre son fils, on aurait pu croire qu’elle l’embrassait pour la dernière fois. Pascal n’était guère moins ému que sa mère; à peine s’il pouvait retenir ses larmes; il lui eût été impossible de prononcer une parole.
C’est en cette circonstance que M. Divorne montra bien quelle était la force de son caractère et l’énergie de sa volonté,—une volonté de fer.—Non-seulement il ne voulut pas embrasser son fils, mais encore il refusa de lui donner la main. Il affecta même un ton railleur et dégagé.
—Souvenez-vous, dit-il à son fils, que vous portez avec vous toute votre fortune. Lorsqu’elle sera dissipée, ce qui, je présume, ne sera pas long, vous me ferez sans doute l’honneur de recourir à moi; je vais toujours faire préparer votre chambre.
Pascal se rendit seul à la diligence. Les gens de Lannion en conclurent qu’il venait d’être chassé par son père.