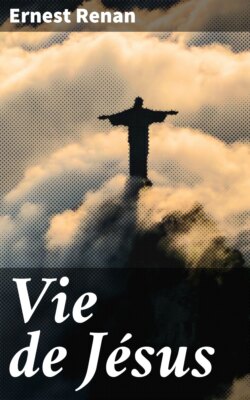Читать книгу Vie de Jésus - Ernest Renan - Страница 13
ОглавлениеPlusieurs regretteront peut-être le tour biographique qu'a ainsi pris mon ouvrage. Quand je conçus pour la première fois une histoire des origines du christianisme, ce que je voulais faire, c'était bien, en effet, une histoire de doctrines, où les hommes n'auraient eu presque aucune part. Jésus eût à peine été nommé; on se fût surtout attaché à montrer comment les idées qui se sont produites sous son nom germèrent et couvrirent le monde. Mais j'ai compris depuis que l'histoire n'est pas un simple jeu d'abstractions, que les hommes y sont plus que les doctrines. Ce n'est pas une certaine théorie sur la justification et la rédemption qui a fait la réforme: c'est Luther, c'est Calvin. Le parsisme, l'hellénisme, le judaïsme auraient pu se combiner sous toutes les formes; les doctrines de la résurrection et du Verbe auraient pu se développer durant des siècles sans produire ce fait fécond, unique, grandiose, qui s'appelle le christianisme. Ce fait est l'œuvre de Jésus, de saint Paul, de saint Jean. Faire l'histoire de Jésus, de saint Paul, de saint Jean, c'est faire l'histoire des origines du christianisme. Les mouvements antérieurs n'appartiennent à notre sujet qu'en ce qu'ils servent à expliquer ces hommes extraordinaires, lesquels ne peuvent naturellement avoir été sans lien avec ce qui les a précédés.
Dans un tel effort pour faire revivre les hautes âmes du passé, une part de divination et de conjecture doit être permise. Une grande vie est un tout organique qui ne peut se rendre par la simple agglomération de petits faits. Il faut qu'un sentiment profond embrasse l'ensemble et en fasse l'unité. La raison d'art en pareil sujet est un bon guide; le tact exquis d'un Goethe trouverait à s'y appliquer. La condition essentielle des créations de l'art est de former un système vivant dont toutes les parties s'appellent et se commandent. Dans les histoires du genre de celle-ci, le grand signe qu'on tient le vrai est d'avoir réussi à combiner les textes d'une façon qui constitue un récit logique, vraisemblable, où rien ne détonne. Les lois intimes de la vie, de la marche des produits organiques, de la dégradation des nuances, doivent être à chaque instant consultées; car ce qu'il s'agit de retrouver ici, ce n'est pas la circonstance matérielle, impossible à contrôler, c'est l'âme même de l'histoire; ce qu'il faut rechercher, ce n'est pas la petite certitude des minuties, c'est la justesse du sentiment général, la vérité de la couleur. Chaque trait qui sort des règles de la narration classique doit avertir de prendre garde; car le fait qu'il s'agit de raconter a été vivant, naturel, harmonieux. Si on ne réussit pas à le rendre tel par le récit, c'est que sûrement on n'est pas arrivé à le bien voir. Supposons qu'en restaurant la Minerve de Phidias selon les textes, on produisît un ensemble sec, heurté, artificiel; que faudrait-il en conclure? Une seule chose: c'est que les textes ont besoin de l'interprétation du goût, qu'il faut les solliciter doucement jusqu'à ce qu'ils arrivent à se rapprocher et à fournir un ensemble où toutes les données soient heureusement fondues. Serait-on sûr alors d'avoir, trait pour trait, la statue grecque? Non; mais on n'en aurait pas du moins la caricature: on aurait l'esprit général de l'œuvre, une des façons dont elle a pu exister.
Ce sentiment d'un organisme vivant, on n'a pas hésité à le prendre pour guide dans l'agencement général du récit. La lecture des évangiles suffirait pour prouver que leurs rédacteurs, quoique ayant dans l'esprit un plan très-juste de la vie de Jésus, n'ont pas été guidés par des données chronologiques bien rigoureuses; Papias, d'ailleurs, nous l'apprend expressément[82]. Les expressions: «En ce temps-là... après cela... alors... et il arriva que...,» etc., sont de simples transitions destinées à rattacher les uns aux autres les différents récits. Laisser tous les renseignements fournis par les évangiles dans le désordre où la tradition nous les donne, ce ne serait pas plus écrire l'histoire de Jésus qu'on n'écrirait l'histoire d'un homme célèbre en donnant pêle-mêle les lettres et les anecdotes de sa jeunesse, de sa vieillesse, de son âge mûr. Le Coran, qui nous offre aussi dans le décousu le plus complet les pièces des différentes époques de la vie de Mahomet, a livré son secret à une critique ingénieuse; on a découvert d'une manière à peu près certaine l'ordre chronologique où ces pièces ont été composées. Un tel redressement est beaucoup plus difficile pour l'Évangile, la vie publique de Jésus ayant été plus courte et moins chargée d'événements que la vie du fondateur de l'islam. Cependant, la tentative de trouver un fil pour se guider dans ce dédale ne saurait être taxée de subtilité gratuite. Il n'y a pas grand abus d'hypothèse à supposer qu'un fondateur religieux commence par se rattacher aux aphorismes moraux qui sont déjà en circulation de son temps et aux pratiques qui ont de la vogue; que, plus mûr et entré en pleine possession de sa pensée, il se complaît dans un genre d'éloquence calme, poétique, éloigné de toute controverse, suave et libre comme le sentiment pur; qu'il s'exalte peu à peu, s'anime devant l'opposition, finit par les polémiques et les fortes invectives. Telles sont les périodes qu'on distingue nettement dans le Coran. L'ordre adopté avec un tact extrêmement fin par les synoptiques suppose une marche analogue. Qu'on lise attentivement Matthieu, on trouvera dans la distribution des discours une gradation fort analogue à celle que nous venons d'indiquer. On observera, d'ailleurs, la réserve des tours de phrase dont nous nous servons quand il s'agit d'exposer le progrès des idées de Jésus. Le lecteur peut, s'il le préfère, ne voir dans les divisions adoptées à cet égard que les coupes indispensables à l'exposition méthodique d'une pensée profonde et compliquée.
Si l'amour d'un sujet peut servir à en donner l'intelligence, on reconnaîtra aussi, j'espère, que cette condition ne m'a pas manqué. Pour faire l'histoire d'une religion, il est nécessaire, premièrement, d'y avoir cru (sans cela, on ne saurait comprendre par quoi elle a charmé et satisfait la conscience humaine); en second lieu, de n'y plus croire d'une manière absolue; car la foi absolue est incompatible avec l'histoire sincère. Mais l'amour va sans la foi. Pour ne s'attacher à aucune des formes qui captivent l'adoration des hommes, on ne renonce pas à goûter ce qu'elles contiennent de bon et de beau. Aucune apparition passagère n'épuise la divinité; Dieu s'était révélé avant Jésus, Dieu se révélera après lui. Profondément inégales et d'autant plus divines qu'elles sont plus grandes, plus spontanées, les manifestations du Dieu caché au fond de la conscience humaine sont toutes du même ordre. Jésus ne saurait donc appartenir uniquement à ceux qui se disent ses disciples. Il est l'honneur commun de ce qui porte un cœur d'homme. Sa gloire ne consiste pas à être relégué hors de l'histoire; on lui rend un culte plus vrai en montrant que l'histoire entière est incompréhensible sans lui.
NOTES:
[1] Leyde, Noothoven van Goor, 1862. Paris, Cherbuliez. Ouvrage couronné par la société de La Haye pour la défense de la religion chrétienne.
[2] Strasbourg, Treuttel et Wurtz. 2e édition, 1860. Paris, Cherbuliez.
[3] Paris, Michel Lévy frères, 1860.
[4] Paris, Ladrange. 2e édition, 1856.
[5] Strasbourg, Treuttel et Wurtz. Paris, Cherbuliez.
[6] Au moment où ces pages s'impriment, paraît un livre que je n'hésite pas à joindre aux précédents, quoique je n'aie pu le lire avec l'attention qu'il mérite: Les Évangiles, par M. Gustave d'Eichthal. Première partie: Examen critique et comparatif des trois premiers évangiles. Paris, Hachette, 1863.
[7] Les grands résultats obtenus sur ce point n'ont été acquis que depuis la première édition de l'ouvrage de M. Strauss. Le savant critique y a, du reste, fait droit dans ses éditions successives avec beaucoup de bonne foi.
[8] Il est à peine besoin de rappeler que pas un mot, dans le livre de M. Strauss, ne justifie l'étrange et absurde calomnie par laquelle on a tenté de décréditer auprès des personnes superficielles un livre commode, exact, spirituel et consciencieux, quoique gâté dans ses parties générales par un système exclusif. Non-seulement M. Strauss n'a jamais nié l'existence de Jésus, mais chaque page de son livre implique cette existence. Ce qui est vrai, c'est que M. Strauss suppose le caractère individuel de Jésus plus effacé pour nous qu'il ne l'est peut-être en réalité.
[9] Ant., XVIII, III, 3.
[10] «S'il est permis de l'appeler homme.»
[11] Au lieu de χριστος ουτος ην il y avait sûrement χριστος ουτος ελγετο. Cf. Ant., XX, IX, 1.
[12] Eusèbe (Hist. eccl. I, 11, et Démonstr. évang., III, 5) cite le passage sur Jésus comme nous le lisons maintenant dans Josèphe. Origène (Contre Celse, I, 47; II, 13) et Eusèbe (Hist. eccl., II, 23) citent une autre interpolation chrétienne, laquelle ne se trouve dans aucun des manuscrits de Josèphe qui sont parvenus jusqu'à nous.
[13] Judæ Epist., 14.
[14] Les personnes qui souhaiteraient de plus amples développements peuvent lire, outre l'ouvrage de M. Réville précité, les travaux de MM. Reuss et Scherer dans la Revue de théologie, t. X, XI, XV; nouv. série, II, III, IV, et celui de M. Nicolas dans la Revue germanique, sept, et déc. 1862, avril et juin 1863.
[15] C'est ainsi qu'on disait: «l'Évangile selon les Hébreux,» «l'Évangile selon les Égyptiens.»
[16] Luc, I, 1-4.
[17] Act., I, 1. Comp. Luc, I, 1-4.
[18] A partir de XVI, 10, l'auteur se donne pour témoin oculaire.
[19] II Tim., IV, 44; Philem., 24, Col., IV, 14. Le nom de Lucas (contraction de Lucanus) étant fort rare, on n'a pas à craindre ici une de ces homonymies qui jettent tant de perplexités dans les questions de critique relatives au Nouveau Testament.
[20] Versets 9, 20, 24, 28, 32. Comp. XXII, 36.
[21] Dans Eusèbe, Hist. eccl., III, 39. On ne saurait élever un doute quelconque sur l'authenticité de ce passage. Eusèbe, en effet, loin d'exagérer l'autorité de Papias, est embarrassé de sa naïveté, de son millénarisme grossier, et se tire d'affaire en le traitant de petit esprit. Comp. Irénée, Adv. hær., III, i.
[22] C'est-à-dire en dialecte sémitique.
[23] Luc, I, 1-2; Origène, Hom. in Luc., I, init.; saint Jérôme, Comment. in Matth., prol.
[24] Papias, dans Eusèbe, H. E., III, 39. Comparez Irénée, Adv. hær., III, II et III.
[25] C'est ainsi que le beau récit Jean, VIII, 1-11 a toujours flotté sans trouver sa place fixe dans le cadre des évangiles reçus.
[26] Τα απομνημονευματα των αποστολων, α καλειται συαγγελια . Justin, Apol., I, 33, 66, 67; Dial. cum Tryph., 10, 100, 101, 102, 103, 104, 105, 106, 107.
[27] Jules Africain, dans Eusèbe, Hist. eccl., I, 7.
[28] Apol., I, 32, 61; Dial. cum Tryph., 88.
[29] Legatio pro christ., 10.
[30] Adv. Græc., 5, 7. Cf. Eusèbe, H.E., IV, 29; Théodoret, Hæretic. fabul., I, 20.
[31] Ad Autolycum, II, 22.
[32] Adv. hær., II, xxii, 5; III, i. Cf. Eus., H. E., V, 8.
[33] Irénée, Adv. hær., I, iii, 6; III, xi, 7; saint Hippolyte, Philosophumena, VI, ii, 29 et suiv.
[34] Irénée, Adv. hær., III, xi, 9.
[35] Eusèbe, Hist. eccl., V, 24.
[36] I Joann., I, 3, 5. Les deux écrits offrent la plus complète identité de style, les mêmes tours, les mêmes expressions favorites.
[37] Epist. ad Philipp., 7.
[38] Dans Eusèbe, Hist. eccl., III, 39.
[39] Adv. hær., III, xvi, 5, 8. Cf. Eusèbe, Hist. eccl., V, 8.
[40] XIII, 23; XIX, 26; XX, 2; XXI, 7, 20.
[41] Jean, XVIII, 15-16; XX, 2-6; XXI, 15-19. Comp. I, 35, 40, 41.
[42] VI, 63; XII, 6; XIII, 21 et suiv.
[43] La manière dont Aristion ou Presbyteros Joannes s'exprimait sur l'évangile de Marc devant Papias (Eusèbe, H. E., III, 39) implique, en effet, une critique bienveillante, ou, pour mieux dire, une sorte d'excuse, qui semble supposer que les disciples de Jean concevaient sur le même sujet quelque chose de mieux.
[44] Comp. Jean, XVIII, 15 et suiv., à Matth., XXVI, 58; Jean, XX, 2-6, à Marc, XVI, 7. Voir aussi Jean, XIII, 24-25.
[45] Voir ci-dessous, p. 159.
[46] I, 14; XIX, 35; XXI, 24 et suiv. Comp. la première épître de saint Jean, I, 3, 5.
[47] Voir, par exemple, chap. IX et XI. Remarquer surtout l'effet étrange que font des passages comme Jean, XIX, 35; XX, 31; XXI, 20-23, 24-25, quand on se rappelle l'absence de toute réflexion qui distingue les synoptiques.
[48] Par exemple, IV, 1 et suiv.; XV, 12 et suiv. Plusieurs mots rappelés par Jean se retrouvent dans les synoptiques (XII, 16; XV, 20).
[49] C'est ainsi que Napoléon devint un libéral dans les souvenirs de ses compagnons d'exil, quand ceux-ci, après leur retour, se trouvèrent jetés au milieu de la société politique du temps.
[50] Les versets XX, 30-31, forment évidemment l'ancienne conclusion.
[51] VI, 2, 22; VI, 22.
[52] Par exemple, ce qui concerne l'annonce de la trahison de Judas.
[53] Voir, par exemple, II, 25; III, 32-33, et les longues disputes des ch. VII, VIII, IX.
[54] Souvent on sent que l'auteur cherche des prétextes pour placer des discours (ch. III, V, VIII, XIII et suiv.).
[55] Par exemple, chap. XVII.
[56] Outre les synoptiques, les Actes, les Épîtres de saint Paul, l'Apocalypse en font foi.
[57] Jean, III, 3, 5.
[58] Papias, loc. cit.
[59] Ainsi, le pardon de la femme pécheresse, la connaissance qu'a Luc de la famille de Béthanie, son type du caractère de Marthe répondant au διηχονει de Jean (XII, 2), le trait de la femme qui essuya les pieds de Jésus avec ses cheveux, une notion obscure des voyages de Jésus à Jérusalem, l'idée qu'il a comparu à la Passion devant trois autorités, l'opinion où est l'auteur que quelques disciples assistaient au crucifiement, la connaissance qu'il a du rôle d'Anne à côté de Caïphe, l'apparition de l'ange dans l'agonie (comp. Jean, XII, 28-29).
[60] Ch. I et II surtout. Voir aussi XXVII, 3 et suiv.; 19, 60, en comparant Marc.
[61] V, 41; VII, 34; XV, 34. Matthieu n'offre cette particularité qu'une fois (XXVII, 46).
[62] XIV, 26. Les règles de l'apostolat (ch. X) y ont un caractère particulier d'exaltation.
[63] XIX, 41, 43-44; XXI, 9, 20; XXIII, 29.
[64] II, 37; XVIII, 10 et suiv.; XXIV, 53.
[65] Par exemple, IV, 16.
[66] III, 23. Il omet Matth., XXIV, 36.
[67] IV, 14; XXII, 43, 44.
[68] Par exemple, en ce qui concerne Quirinius, Lysanias, Theudas.
[69] Comp. Luc, I, 31, à Matth., I, 21.
[70] Par exemple, XIX, 12-27.
[71] Ainsi, le repas de Béthanie lui donne deux récits (VII, 36-48, et X, 38-42.)
[72] XXIII, 56.
[73] II, 21, 22, 39, 41, 42. C'est un trait ébionite. Cf. Philosophumena, VII, VI, 34.
[74] La parabole du riche et de Lazare. Comp. VI, 20 et suiv.; 24 et suiv.; XII, 13 et suiv.; XVI entier; XXII, 35; Actes, II, 44-45; V, 1 et suiv.
[75] La femme qui oint les pieds, Zachée, le bon larron, la parabole du pharisien et du publicain, l'enfant prodigue.
[76] Par exemple, Marie de Béthanie devient pour lui une pécheresse qui se convertit.
[77] Jésus pleurant sur Jérusalem, la sueur de sang, la rencontre des saintes femmes, le bon larron, etc. Le mot aux femmes de Jérusalem (XXIII, 28-29) ne peut guère avoir été conçu qu'après le siége de l'an 70.
[78] Voir le passage précité de Papias.
[79] Voir, par exemple, Jean, XIX, 23-24.
[80] Voir la Gazette des Tribunaux, 10 sept. et 11 nov. 1851, 28 mai 1857.
[81] Le livre où seront contenus les résultats de cette mission est sous presse.
[82] Loc. cit.