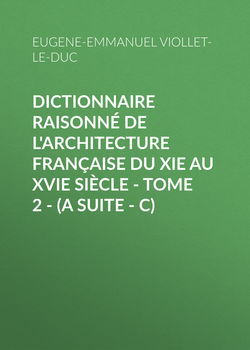Читать книгу Dictionnaire raisonné de l'architecture française du XIe au XVIe siècle - Tome 2 - (A suite - C) - Eugene-Emmanuel Viollet-le-Duc - Страница 2
B
ОглавлениеBADIGEON, s. m. Le badigeon est une peinture d'un ton unique l'on passe indistinctement sur les murs et les divers membres d'architecture extérieurs ou intérieurs d'un édifice. Ce n'est guère que depuis deux siècles que l'on s'est mis à badigeonner à la colle ou à la chaux les édifices, afin de dissimuler leur vétusté et les inégalités de couleur de la pierre, sous une couche uniforme de peinture grossièrement appliquée. La plupart de nos anciennes églises ont été ainsi badigeonnées à l'intérieur à plusieurs reprises, de sorte que les couches successives de badigeon forment une épaisseur qui émousse tous les membres de moulures et la sculpture. Souvent le badigeon est venu couvrir d'anciennes peintures dégradées par le temps; il est donc important de s'assurer, lorsqu'on veut enlever le badigeon, s'il ne cache pas des traces précieuses de peintures anciennes; et dans ce cas il ne doit être gratté ou lavé qu'avec les plus grandes précautions 65.
BAÉE, BÉE, s. f. Ancien mot encore usité dans la construction, qui signifie le vide d'une porte, d'une fenêtre, d'une ouverture quelconque percée dans un mur ou une cloison (voy. FENÊTRE, PORTE).
BAGUE, s. f. On désigne par ce mot un membre de moulure qui divise horizontalement les colonnes dans leur hauteur. Lorsqu'au XIIe siècle on remplaça les grosses piles carrées ou cylindriques dans les édifices par des faisceaux de colonnettes d'un faible diamètre, ces colonnettes, durent être tirées de morceaux de pierre posés en délit, qui n'avaient pas une longueur suffisante pour ne former qu'un seul bloc de la base au chapiteau. Leur petit diamètre relativement à leur longueur obligeait les constructeurs à ménager un ou plusieurs joints dans leur hauteur; ces colonnettes étaient d'autant plus minces qu'elles se trouvaient adossées à une pile ou à un mur, et leurs joints devaient être d'autant plus fréquents qu'elles étaient plus minces. Les joints étaient une cause de dislocation; force était donc d'empêcher les ruptures ou les dérangements sur ces points.
La nécessité de parer à ces inconvénients devint immédiatement un motif de décoration. En intercalant entre les longs morceaux des colonnettes en délit une assise basse de pierre dure reliée au massif des piles ou des murs, les architectes du XIIe siècle les rendirent stables et les fixèrent à la construction. Pour nous faire mieux comprendre, nous donnons ici une bague disposée comme nous venons de l'indiquer (1); la figure A présente la bague avant la pose des fûts de colonnettes, et la figure B la bague après la pose des fûts. Ce principe une fois admis, on ne cessa de l'appliquer que lorsque les colonnettes firent partie des assises de la construction, lorsque les matériaux employés furent assez grands et assez résistants pour permettre d'éviter les joints dans leur hauteur, ou lorsqu'au milieu du XIIIe siècle on évita systématiquement de couper les lignes verticales de l'architecture par des lignes horizontales. Les raisons de construction qui avaient fait adopter les bagues bien comprises (voy. CONSTRUCTION), nous allons présenter une suite d'exemples de ce membre d'architecture, si fréquemment employé pendant le XIIe siècle et le commencement du XIIIe.
Au XIIe siècle, les bagues étaient souvent décorées par des feuilles, des perles, des pointes de diamant. Voici des exemples, 1° d'une bague ornée de feuilles tenant aux colonnettes du bas-côté du tour du choeur de la cathédrale de Langres (2) (milieu du XIIe siècle); et 2° d'une bague des colonnettes des bas-côtés de la nef de la cathédrale de Sens (3) (fin du XIIe siècle) présentant un large profil avec billettes. Au commencement du XIIIe siècle, les bagues ne se composent plus que de profils minces sans ornements, ainsi qu'on peut l'observer dans le bas-côté du croisillon sud de la cathédrale de Soissons, dans la nef de la cathédrale de Laon, dans le choeur de l'église de Vézelay (4) et dans un grand nombre d'édifices du nord et de l'est de la France. Quelquefois aussi les bagues tiennent à des colonnes isolées et ne sont alors qu'un ornement, un moyen de décorer la jonction de deux morceaux de fûts. Un des plus beaux exemples de ce genre de bagues se trouve dans le réfectoire du prieuré de Saint-Martin-des-Champs à Paris (5).
Les colonnes qui portent les grandes voûtes divisent la salle en deux travées. Ces colonnes sont très-hautes et composées de deux morceaux de pierre réunis par une bague; la bague est d'autant plus nécessaire ici, que le morceau inférieur est d'un diamètre plus fort que le fût supérieur (voy. COLONNE).
Voici encore un exemple d'une bague ou tambour mouluré, divisant une colonne en deux portions de fûts (5 bis). La bague est ici une véritable assise entre deux morceaux de pierre posés en délit. Cette colonne appartient à l'une des maisons du XIIIe siècle de la ville de Dol en Bretagne 66. Nous ne pouvons omettre les bagues de métal qui maintiennent les colonnettes de la cathédrale de Salisbury, bien que cet édifice n'appartienne pas à l'architecture française; mais cet exemple est trop précieux pour ne pas être mentionné. La cathédrale de Salisbury, comme chacun sait, est construite avec un grand soin; les piles de la nef, élevées par assises, et qui, en plan, donnent une figure composée de quatre demi-cercles, sont cantonnées, dans les angles curvilignes rentrants, de quatre colonnettes dont les fûts sont en deux morceaux dans leur hauteur. Les joints qui réunissent ces fûts, placés au même niveau pour toutes les piles, sont maintenus par des bagues ou colliers de bronze scellés dans la pile au moyen d'une queue de carpe (6); A représente une de ces bagues avec sa queue de carpe, et B la coupe du cercle de bronze.
On donne aussi le nom de bague aux moulures saillantes, ornées ou simples, qui entourent la base des fleurons des couronnements de pinacles ou de pignons, etc. (Voyez FLEURON.)
BAGUETTE, s. f. C'est un membre de moulure cylindrique d'un petit diamètre, qui fait partie des corniches, des bandeaux, des archivoltes, des nervures. La baguette n'a guère qu'un diamètre de 0,01 à 0,05; au-dessus de cette grosseur, elle prend le nom de boudin (voy. ce mot). Mais ce qui distingue surtout la baguette du boudin c'est sa fonction secondaire. Ainsi dans les profils que nous donnons ici d'arcs-ogives du XIIIe siècle (1), A est une baguette et B un boudin. Dans l'architecture romane du Poitou et de la Normandie, la baguette est parfois décorée de perles (2); son profil C dans ce cas est souvent méplat, pour que la lumière découpe nettement chacune des perles ou petits besans. Dans l'architecture des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, les architectes se sont servis de la baguette parmi les faisceaux de colonnes pour faire valoir leur diamètre par opposition, et leur donner plus de force (3) à l'oeil. On trouve souvent dans les édifices des XIIIe et XIVe siècles des baguettes dégagées dans les angles des piles carrées, et surtout dans les pieds-droits des portes, pour éviter les vives arêtes qui se dégradent facilement ou des aiguités qui peuvent blesser (4).
La baguette alors ne descend pas jusqu'au sol, mais s'arrête sur l'angle vif réservé à la partie inférieure, soit en pénétrant un bizeau D, soit en tombant carrément E, soit en se perdant derrière un ornement F, ce qui se rencontre très-fréquemment dans les édifices de Bourgogne qui datent de la fin du XIIe siècle ou du commencement du XIIIe (voy. CONGÉ). Dans la menuiserie, la baguette est un des membres de moulures les plus souvent employés.
BAHUT, s. m. C'est le nom que l'on donne à un mur bas qui est destiné à porter un comble au-dessus d'un chéneau, l'arcature à jour d'un cloître, une grille, une barrière. Lorsqu'au XIIIe siècle on établit sans exception, dans tous les édifices de quelque importance, des chéneaux en pierre décorés de balustrades à la chute des combles, on éleva ceux-ci (afin d'éviter les dégradations que le passage dans les chéneaux devait faire subir aux couvertures) sur de petits murs qui protégeaient leur base, et empêchaient les filtrations causées par des amas de neige ou de fortes pluies. Les grands combles du choeur et de la nef de la cathédrale de Paris sont ainsi portés sur des bahuts de 1m,25 de hauteur, dont nous donnons ici la figure (1).
Ces bahuts, décorés d'une assise de damiers sous les sablières, sont en outre percés d'ajours pour éclairer et aérer la charpente du comble. Plus tard, vers le milieu du XIIIe siècle, les bahuts furent pourvus d'une dernière assise formant larmier pour éviter que les eaux descendant de la couverture ne dégradassent les parements de pierre et pour les faire tomber directement dans le chéneau (2).
On trouve à Amiens, à Beauvais, à la Sainte-Chapelle du Palais, des bahuts ainsi couronnés. Ce profil saillant permettait d'ailleurs d'établir des coyaux A, et en laissant une circulation d'air entre les pieds des chevrons, les sablières et la couverture, il préservait ces pièces de bois de la pourriture. Les bahuts des grands combles n'ont guère que 0,40 ou 0,60 centimètres d'épaisseur et portent sur les formerets des voûtes hautes (voy. CONSTRUCTION, CHARPENTE), en laissant le plus de largeur possible à la tête des murs pour l'établissement des chéneaux. Quelquefois même les bahuts des combles sont établis sur des arcs de décharge reportant le poids de la charpente sur les sommiers des voûtes intérieures; alors toute l'épaisseur des murs est réservée pour le placement des chéneaux. Les colonnes des galeries intérieures, pendant l'époque romane et au commencement de la période ogivale, sont souvent dressées sur de petits murs d'appui qui sont de véritables bahuts. Les colonnettes du triforium du porche de l'église de Vézelay sont ainsi disposées. Dans la nef et le choeur de la cathédrale d'Amiens même, c'est encore sur un bahut que sont posées les colonnes du triforium (voy. TRIFORIUM).
BAINS, s. m. (Voy. ÉTUVE.)
BAIN DE MORTIER. On désigne ainsi, dans les ouvrages de maçonnerie, le lit de mortier sur lequel on pose une pierre de taille ou des moellons. À Paris, depuis le commencement du XVIIe siècle, on pose les pierres de taille sur des cales de bois et on les fiche au mortier, c'est-à-dire que l'on fait entrer du mortier dans l'espace vide laissé entre ces deux pierres par l'exhaussement des cales, au moyen de lames de fer mince découpées en dents de scie. Ce procédé a l'inconvénient de ne jamais remplir les lits d'un mortier assez compacte pour résister à la pression. Les ficheurs étant obligés, pour introduire le mortier entre les pierres par une fente étroite, de le délayer beaucoup, lorsque la dessiccation a lieu, ce mortier diminue de volume et les pierres ne portent plus que sur leurs cales. Heureusement pour nos édifices modernes qu'on a le soin de mettre en oeuvre un cube de pierre trois ou quatre fois plus fort qu'il n'est besoin, et que, grâce à cet excès de force, chaque pierre ne subit qu'une faible pression; mais lorsqu'on bâtissait au moyen âge, les architectes étaient portés à mettre en oeuvre un cube de pierre plutôt trop faible que trop fort; il devenait donc nécessaire de faire poser ces pierres sur toute la surface de leur lit, afin de profiter de toute leur force de résistance. On posait alors les pierres à bain de mortier, c'est-à-dire qu'après avoir étendu sur le lit supérieur d'une première assise de pierre une épaisse couche de mortier peu délayé, on asseyait la seconde assise sur cette couche, en ayant le soin de la bien appuyer au moyen de masses de bois jusqu'au refus, ce qui, en terme de maçons, veut dire jusqu'à ce que le mortier, après avoir débordé sous les coups de la masse, refuse de se comprimer davantage. On obtenait ainsi des constructions résistant à une pression considérable sans craindre de voir les pierres s'épauffrer, et on évitait des tassements qui, dans des édifices très-élevés sur des points d'appui légers, eussent eu des conséquences désastreuses (voy. CONSTRUCTION).
BALCON, s. m. (Voy. BRETÈCHE.)
BALUSTRADE, s. f. Chancel, Gariol. Le nom de balustrade est seul employé aujourd'hui pour désigner les garde-corps à hauteur d'appui, le plus souvent à jour, qui couronnent les chéneaux à la chute des combles, qui sont disposés le long de galeries ou de terrasses élevées, pour garantir des chutes. On ne trouve pas de balustrades extérieures surmontant les corniches des édifices avant la période ogivale, par la raison que jusqu'à cette époque les combles ne versaient pas leurs eaux dans des chéneaux, mais les laissaient égoutter directement sur le sol. Sans affirmer qu'il n'y ait eu des balustrades sur les monuments romans, ne connaissant aucun exemple à citer, nous nous abstiendrons. Mais il convient de diviser les balustrades en balustrades intérieures, qui sont destinées à garnir le devant des galeries, des tribunes, et en balustrades extérieures, disposées, sur les chéneaux des combles ou à l'extrémité des terrasses dallées des édifices.
Ce n'est guère que de 1220 à 1230 que l'on établit à l'extérieur des grands édifices une circulation facile, à tous les étages, au moyen de chéneaux ou de galeries, et que l'on sentit, par conséquent, la nécessité de parer au danger que présentaient ces coursières, étroites souvent, en les garnissant de balustrades; mais avant cette époque, dans les intérieurs des églises ou de grandes salles, on établissait des galeries, des tribunes, dont l'accès était public, et qu'il fallait par conséquent munir de garde-corps. Il est certain que ces garde-corps furent souvent, pendant l'époque romane, faits en bois; lorsqu'ils étaient de pierre, c'était plutôt des murs d'appui que des balustrades. La tribune du porche de l'église abbatiale de Vézelay (porche dont la construction peut être comprise entre 1150 et 1160), est munie d'un mur d'appui que nous pouvons à la rigueur classer parmi les balustrades, ce mur d'appui étant décoré de grandes dents de scie qui lui donnent l'aspect d'un couronnement plus léger que le reste de la construction (1). Les galeries intérieures des deux pignons du transept de la même église, construit pendant les dernières années du XIIe siècle ou au commencement du XIIIe, possèdent de belles balustrades pleines ou bahuts décorés d'arcatures, sur lesquels sont posées les colonnettes de ce triforium. Nous donnons ici (2) la balustrade de la galerie sud, dont le dessin produit un grand effet.
Mais on ne tarda pas, lorsque l'architecture prit des formes plus légères, à évider les balustrades; un reste des traditions romanes fit que l'on conserva pendant un certain temps les colonnettes avec chapiteaux dans leur composition. Les balustrades n'étaient que des arcatures à jour, construites au moyen de colonnettes ou petits piliers espacés, sur lesquels venait poser une assise évidée par des arcs en tiers-point. Les restes du triforium primitif de la nef de la cathédrale de Rouen (1220 à 1230) présentent à l'intérieur une balustrade ainsi combinée, se reliant aux colonnes portant la grande arcature formant galerie, afin d'offrir une plus grande résistance (3). On concevra facilement, en effet, qu'une claire-voie reposant sur des points d'appui aussi grêles, ne pouvait se maintenir sur une grande longueur, sans quelques renforts qui pussent lui donner de la rigidité. Mais c'est surtout à l'extérieur des monuments que les balustrades jouent un rôle important à partir du XIIIe siècle, car, ainsi que nous l'avons dit plus haut, c'est à dater du commencement de ce siècle que l'on établit des chéneaux et des galeries de circulation à tous les étages. Les balustrades exécutées pendant cette période présentent une extrême variété de formes et de constructions. La nature de la pierre influe beaucoup sur leur composition. Là où les matériaux étaient durs et résistants, mais d'un grain fin et faciles à tailler, les balustrades sont légères et très-ajourées; là où la pierre est tendre, au contraire, les vides sont moins larges, les pleins plus épais. Leur dimension est également soumise aux dimensions des matériaux, car on renonça bientôt aux balustrades composées de plusieurs morceaux de pierre placés les uns sur les autres, comme n'offrant pas assez d'assiette, et on les évida dans une dalle posée en délit. En Normandie, en Champagne, où la pierre ne s'extrait généralement qu'en morceaux d'une petite dimension, les balustrades sont basses et n'atteignent pas la hauteur d'appui (1 m,00 au moins). Dans les parties de la Bourgogne où la pierre est très-dure, difficile à tailler, et ne s'extrait pas facilement en bancs minces, les balustrades sont rares et n'apparaissent que fort tard, lorsque l'architecture imposa les formes qu'elle avait adoptées dans le domaine royal, à toutes les provinces environnantes, c'est-à-dire vers la fin du XIIIe siècle. Les bassins de la Seine et de l'Oise offraient aux constructeurs des qualités de matériaux très-propres à faire des balustrades; aussi est-ce dans ces contrées qu'on trouve des exemples variés de cette partie importante de la décoration des édifices. Comme l'usage de scier les bancs en lames minces n'était pas pratiqué au XIIIe siècle, il fallait trouver dans les carrières des bancs naturellement assez peu épais, pour permettre d'exécuter ces claires-voies légères. Le cliquart de Paris, le liais de l'Oise, certaines pierres de Tonnerre et de Vernon, qui pouvaient s'extraire en bancs de 0,15 à 0,20 centimètres d'épaisseur, se prêtaient merveilleusement à l'exécution des balustrades construites en grands morceaux de pierre posés de champ et évidés. Partout ailleurs les architectes s'ingénièrent à trouver un appareil combiné de manière à suppléer à l'insuffisance des matériaux qu'ils possédaient, et ces appareils ont eu, comme on doit le penser, une grande influence sur les formes adoptées. Il en est des balustrades comme des meneaux de fenêtres, comme de toutes les parties délicates de l'architecture ogivale des XIIIe et XIVe siècles: la nature de la pierre commande la forme jusqu'à un certain point, ou du moins la modifie. Ce n'est donc qu'avec circonspection que l'on doit étudier ces variétés, qui ne peuvent indifféremment s'appliquer aux diverses provinces dans lesquelles l'architecture ogivale s'est développée.
Dans l'Ile de France, une des plus anciennes balustrades que nous connaissions est celle qui couronne la galerie des Rois de la façade occidentale de la cathédrale de Paris; elle appartient aux premières années du XIIIe siècle (1215 à 1225) comme toute la partie inférieure de cette façade (4). Avant la restauration du portail, cette balustrade n'existait plus qu'au droit des deux contreforts extrêmes, ainsi qu'on peut s'en assurer 67; elle est construite en plusieurs morceaux, au moins dans la partie à jour, et se compose d'une assise portant les bases, de colonnettes posées en délit avec renfort par derrière, et d'une assise de couronnement évidée en arcatures, décorées de fleurettes en pointes de diamant. Il existe encore sur les galeries intermédiaires des tours du portail de la Calende à la cathédrale de Rouen une balustrade du commencement du XIIIe siècle, de même construite par morceaux superposés (5). Ici les colonnettes reposent directement sur le larmier de la corniche formant passage, et laissent entre elles les eaux s'écouler naturellement sans chenal. Ce n'est guère que vers 1230 que l'on établit des chéneaux conduisant les eaux dans des gargouilles; jusqu'alors les eaux s'égouttaient sur le larmier des corniches, comme à la cathédrale de Chartres à la chute des grands combles; mais ces balustrades, composées de petits piliers ou colonnettes isolées et scellées sur le larmier, conservaient difficilement leur aplomb. Les constructeurs avaient tenté quelquefois de les réunir à leur base au moyen d'une assise continue évidée par dessous pour l'écoulement des eaux, ainsi qu'on peut le voir à la base du haut choeur nord de la cathédrale de Chartres (6); mais ce moyen ne faisait que rendre le quillage plus dangereux en multipliant les lits, et ne donnait pas à ces claires-voies la rigidité nécessaire pour éviter le bouclement; on dut renoncer bientôt aux colonnettes ou petits piliers isolés réunis seulement par l'assise supérieure continue, et on se décida à prendre les balustrades dans un seul morceau de pierre; dès lors les colonnettes avec chapiteaux n'avaient pas de raison d'être, car au lieu d'une arcature construite, il s'agissait simplement de dresser des dalles percées d'ajours affectant des formes qui ne convenaient pas à des assises superposées.
C'est ainsi que le sens droit, l'esprit logique qui dirigeaient les architectes de ces époques, leur commandaient de changer les formes des détails, comme de l'ensemble de leur architecture, à mesure qu'ils modifiaient les moyens de construction. Dans les balustrades construites, c'est-à-dire composées de points d'appui isolés et d'une assise de couronnement, on remarquera que la partie supérieure des balustrades est, comparativement aux points d'appuis, très volumineuse. Il était nécessaire en effet de charger beaucoup ces points d'appui isolés pour les maintenir dans leur aplomb. Quand les balustrades furent prises dans un seul morceau de pierre, au contraire, on donna de la force, du pied à leur partie inférieure, et de la légèreté à leur partie supérieure, car on n'avait plus à craindre alors les déversements causés par la multiplicité des lits horizontaux.
Les balustrades des grandes galeries de la façade et du sommet des deux tours de la cathédrale de Paris sont taillées conformément à ce principe (7); leur pied s'empatte vigoureusement et prolonge le glacis du larmier de la corniche; un ajour en quatre-feuilles donne une décoration continue qui n'indique plus des points d'appuis séparés, mais qui laisse bien voir que cette décoration est découpée dans un seul morceau de pierre; un appui saillant, ménagé dans l'épaisseur de la pierre, sert de larmier et préserve la claire-voie. Aux angles, la balustrade de la grande galerie est renforcée par des parties pleines ornées de gros crochets saillants et de figures d'animaux, qui viennent rompre la monotonie de la ligne horizontale de l'appui (voy. ANIMAUX). La balustrade extérieure du triforium de la même église, plus légère parce qu'elle couronne un ouvrage de moindre importance, est encore munie de l'empattement inférieur nécessaire à la solidité. Cet empattement, pour éviter les dérangements, est posé en feuillure dans l'assise du larmier (8).
Il ne faudrait pas cependant considérer les principes que nous posons ici comme absolus; si les architectes du XIIIe siècle étaient soumis aux règles de la logique, ils n'étaient pas ce que nous appelons aujourd'hui des rationalistes; le sentiment de la forme, l'à-propos avaient sur leur esprit une grande prise, et ils savaient au besoin faire plier un principe à ces lois du goût qui, ne pouvant être formulées, sont d'autant plus impérieuses qu'elles s'adressent à l'instinct et non au raisonnement. C'est surtout dans les accessoires de l'architecture commandés par un besoin et nécessaires en même temps à la décoration, que le goût doit intervenir et qu'il intervenait alors. Ainsi, en cherchant à donner à leurs balustrades prises dans des dalles découpées l'aspect d'un objet taillé dans une seule pièce, il fallait que ces parties importantes de la décoration ne vinssent pas, par leur forme, contrarier les lignes principales de l'architecture. Si les ajours obtenus au moyen de trèfles ou de quatre-feuilles juxtaposés convenaient à des balustrades continues non interrompues par des divisions verticales rapprochées, ces ajours produisaient un mauvais effet lorsqu'ils se développaient par petites travées coupées par des pinacles ou des points d'appui verticaux; alors il fallait en revenir aux divisions multipliées et dans lesquelles la ligne verticale était rappelée, surtout si les balustrades servaient de couronnement supérieur à l'architecture. D'ailleurs les divisions des ajours de balustrades par trèfles ou quatre-feuilles étaient impérieuses, ne pouvaient se rétrécir ou s'élargir à volonté; si une travée permettait de tracer cinq quatre-feuilles par exemple, une travée plus étroite ou plus large de quelques centimètres dérangeait cette combinaison, ou obligeait le traceur à laisser seulement aux extrémités de sa travée de balustrade une portion de trèfle ou de quatre-feuilles; ce qui n'était pas d'un heureux effet. Les divisions de balustrades par arcatures verticales permettaient au contraire d'avoir un nombre d'ajours complets, et il était facile alors de dissimuler les différences de largeur de travées.
Nous ferons comprendre facilement par une figure ce que nous disons ici. Soit A B (9) une travée de balustrade comprenant trois quatre-feuilles; si la travée suivante A C est un peu moins longue, il faudra que l'un des trois ajours soit en partie engagé. Mais si la travée A B (9 bis) est divisée en cinq arcatures, la travée A C pourra n'en contenir que quatre, et l'oeil, retrouvant des formes complètes dans l'une comme dans l'autre, ne sera pas choqué. Les divisions verticales permettent même des différences notables dans l'écartement des axes, sans que ces différences soient appréciables en exécution; leur dessin est plus facile à comprendre dans des espaces resserrés qui ne permettraient pas à des combinaisons de cercle de se développer en nombre suffisant, car il en est de l'ornementation architectonique comme des mélodies, qui, pour être comprises et produire tout leur effet, doivent être répétées. La balustrade supérieure de la nef et du choeur de Notre-Dame de Paris, exécutés vers 1230, est divisée par travées inégales de largeur, et c'est conformément à ce principe qu'elle a été tracée (10).
De distance en distance, au droit des arcs-boutants et des gargouilles, un pilastre surmonté d'un gros fleuron sépare ces travées, sert en même temps de renfort à la balustrade, et maintient le déversement qui, sans cet appui, ne manquerait pas d'avoir lieu sur une aussi grande longueur 68. Mais que l'on veuille bien le remarquer, si cette balustrade a quelque rapport avec celles qui, peu d'années auparavant, étaient construites par assises, on voit cependant que c'est un évidement, un ajour percé dans une dalle et non un objet construit au moyen de morceaux de pierre superposés; cela est si vrai, que l'on a cherché à éviter dans les ajours les évidements à angle droit qui peuvent provoquer les ruptures. Le pied des montants retombe sur le profil du bas, non point brusquement, mais s'y réunit par un bizeau formant un empattement destiné à donner de la force à ce pied et à faciliter la taille (11).
On voit ici en A la pénétration des montants sur le profil formant traverse inférieure, et en B la naissance des trilobes sur ces montants. Si les formes sont nettement accusées, si les lignes courbes sont franchement séparées des lignes verticales, cependant, soit par instinct, soit par raison, on a cherché à éviter ici toute forme pouvant faire supposer la présence d'un lit, d'une soudure. Mais, nous le répétons, les artistes de ce temps savaient, sans renoncer aux principes basés sur la raison, faire à l'art une large part, se soumettre aux lois délicates du goût. Si nous croyons devoir nous étendre ainsi sur un détail de l'architecture ogivale qui semble très-secondaire, c'est que, par le fait, ce détail acquiert en exécution une grande importance, en tant que couronnement. L'architecture du XIIIe siècle veut que la balustrade fasse partie de la corniche; on ne saurait la plupart du temps l'en séparer; sa hauteur, les rapports entre ses pleins et ses vides, ses divisions, sa décoration, doivent être combinés avec la largeur des travées, avec la hauteur des assises et la richesse ou la sobriété des ornements des corniches. Telle balustrade qui convient à tel édifice et qui fait bon effet là où elle fut placée, semblerait ridicule ailleurs. Ce n'est donc pas une balustrade qu'il faut voir dans un monument, c'est la balustrade de ce monument; aussi ne prétendons-nous pas donner un exemple de chacune des variétés de balustrades exécutées de 1200 à 1300, encore moins faire supposer que telle balustrade de telle époque, appliquée à tel édifice d'une province, peut être appliquée à tous les édifices de cette même époque et de cette province. Nous voyons ici (fig. 10) une balustrade exécutée de 1230 à 1240. Cette balustrade est posée sur une corniche d'un grand édifice, où tout est conçu largement et sur une grande échelle. Aussi ses espacements de pieds-droits sont larges, ses trilobes ouverts, pas de détails; de simples bizeaux, des formes accentuées pour obtenir des ombres et des lumières vives et franches, pour produire un effet net et facile à saisir à une grande distance. Or, voici qu'à la même époque, à cinq ans de distance peut-être, on élève la Sainte-Chapelle du Palais, édifice petit, dont les détails par conséquent sont fins, dont les travées, au lieu d'être larges comme à la cathédrale de Paris, sont étroites et coupées par des gâbles pleins surmontant les archivoltes des fenêtres.
L'architecte fera-t-il la faute de placer sur la corniche supérieure une balustrade lâche, qui par les grands espacements de ses pieds-droits rétrécirait encore à l'oeil la largeur des travées, dont on saisirait difficilement le dessin, visible seulement entre des pinacles et pignons rapprochés? Non pas; il cherchera, au contraire, à serrer l'arcature à jour de sa balustrade, à la rendre svelte et ferme cependant pour soutenir son couronnement; il obtiendra des ombres fines et multipliées par la combinaison de ses trilobes, par des ajours délicats percés entre eux; il fera cette balustrade haute pour relier les gâbles aux pinacles (12), et pour empêcher que le grand comble ne paraisse écraser la légèreté de la maçonnerie, pour établir une transition entre ce comble, ses accessoires importants et la richesse des corniches et fenêtres; mais il aura le soin de laisser à cette balustrade son aspect de dalle découpée, afin qu'elle ne puisse rivaliser avec les fortes saillies, les ombres larges de ces gâbles et pinacles. Dans le même édifice, l'architecte doit couronner un porche couvert en terrasse par une balustrade. Prendra-t-il pour modèle la balustrade du grand comble? Point; conservant encore le souvenir de ces belles claires-voies du commencement du XIIIe siècle, composées de colonnettes portant une arcature ferme et simple comme celle que nous avons donnée (fig. 4); comprenant que sur un édifice couvert d'une terrasse il faut un couronnement qui ait un aspect solide, qui prenne de la valeur autant par la combinaison des lignes et des saillies que par sa richesse, et qu'une dalle plate percée d'ajours avec de simples bizeaux sur les arêtes ne peut satisfaire à ce besoin de l'oeil, il élèvera une balustrade ornée de chapiteaux supportant une arcature découpée en trilobes, refouillée, dont les ombres vives viendront ajouter à l'effet de la corniche en la complétant, à celui des pinacles en les reliant (13).
Mais nous sommes au milieu du XIIIe siècle; et si la balustrade du porche de la Sainte-Chapelle est un dernier souvenir des primitives claires-voies construites au moyen de points d'appui isolés supportant une arcature, elle restera, comme construction, une balustrade de son époque, c'est-à-dire que les colonnettes reliées à leur base par une traverse, et les arcatures trilobées, seront prises dans un même morceau de pierre évidé. La tablette d'appui A sera seule rapportée. C'est ainsi qu'à chaque pas nous sommes arrêtés par une transition, un progrès qu'il faut constater, et que nous devons presque toujours rendre justice au goût sûr de ces praticiens du XIIIe siècle qui savaient si bien tempérer les lois sèches et froides du raisonnement par l'instinct de l'artiste, par une imagination qui ne leur faillait jamais.
Longtemps les balustrades furent évidemment l'un des détails de l'architecture ogivale sur lesquels on apporta une attention particulière; mais il faut convenir qu'à la fin du XIIIe siècle déjà, si elles présentent des combinaisons ingénieuses, belles souvent, on ne les trouve plus liées aussi intimement à l'architecture; elles sont parfois comme une oeuvre à part ne participant plus à l'effet de l'ensemble, et le choix de leurs dessins, de leurs compartiments ne paraît pas toujours avoir été fait pour la place qu'elles occupent. La balustrade supérieure du choeur de la cathédrale de Beauvais en est un exemple (14); l'alternance des quatre-feuilles posés en carré et en diagonale est heureuse; mais cette balustrade est beaucoup trop maigre pour sa place, les ajours en sont trop grands, et, de loin, elle ne prête pas assez de fermeté au couronnement. Sous cette balustrade, la corniche, bien que délicate, paraît lourde et pauvre en même temps. Nous retrouvons cette combinaison de balustrades, amaigrie encore, au-dessus des chapelles de l'église de Saint-Ouen de Rouen (15).
Les défauts sont encore plus choquants ici, malgré que cette balustrade, en elle-même, et comme taille de pierre, soit un chef-d'oeuvre de perfection; mais, étant placée sur des côtés de polygones peu étendus, elle ne donne que quatre ou cinq compartiments; leur dessin ne se comprend pas du premier coup, parce que l'oeil ne peut saisir cette combinaison alternée, qui serait heureuse si elle se développait sur une grande longueur. L'excessive maigreur de cette balustrade lui donne l'apparence d'une claire-voie de métal, non d'une découpure faite dans de la pierre. Du reste, à partir de la fin du XIIIe siècle, on ne rencontre plus guère de balustrades composées d'une suite de petits montants avec arcature; on semble préférer alors les balustrades formées de trèfles, de quatre-feuilles, de triangles, ou de carrés posés sur la pointe avec redents, comme celle qui couronne le choeur et la nef de la cathédrale d'Amiens. Nous avons fait voir comme à la Sainte-Chapelle du Palais on avait heureusement rompu les lignes inclinées des gâbles couronnant les fenêtres par une balustrade à points d'appui verticaux très-multipliés (voy. fig. 12), comme on avait tenu cette balustrade haute pour qu'elle ne fût pas écrasée par l'élévation des pinacles et gâbles. Cette balustrade, indépendante de ces pinacles et gâbles, passe derrière eux, ne fait que s'y appuyer; elle leur laisse toute leur valeur, et parait ce qu'elle doit être: une construction légère, ayant une fonction à part, et n'ajoutant rien à la solidité de la maçonnerie, pouvant être supprimée en laissant à l'édifice les formes qui tiennent à sa composition architectonique. On ne s'en tint pas longtemps à ces données si sages. De 1290 à 1310, on construisait à Troyes l'église de Saint-Urbain. Les fenêtres supérieures du choeur de ce remarquable édifice sont surmontées de gâbles à jour qui viennent, non pas comme à la Sainte-Chapelle de Paris, faire saillie sur la corniche de couronnement et son chéneau, mais qui les pénètrent. Et telle est la combinaison recherchée de cette construction, que les deux pentes de ces gâbles et les cercles appareillés dans les écoinçons portent cette corniche formant chéneau comme le feraient des liens en charpente. Il y avait à craindre que ces gâbles à jour qui n'étaient pas reliés au mur, et cette corniche-chéneau qui reposait seulement sur la tête de ce mur, sans être retenue dans sa partie engagée par une forte charge supérieure, ne vinssent à se déverser en dehors. Le constructeur imagina de se servir de la balustrade pour maintenir ce dévers (16); et voici comment il s'y prit.
Il faut dire d'abord qu'entre chaque travée s'élève un contre-fort avec pinacle bien relié à la masse de la construction; prenant ce pinacle ou contre-fort comme point fixe (il l'est en effet), l'architecte fit ses demi-travées de balustrades A d'un seul morceau chacune, et, ayant eu le soin de poser ses pinacles sur un plan plus avancé que celui dans lequel se trouvent les gâbles, il maintint le sommet de ceux-ci en les étrésillonnant avec les balustrades, ainsi que l'indique le plan (16 bis).
Soit B le pinacle rendu fixe par sa base portant chéneau fortement engagée dans la construction, et C C les têtes des gâbles; les demi-travées de balustrades B C étant d'un seul morceau chacune, et formant en plan un angle rentrant en C, viennent étrésillonner et butter les têtes des gâbles C C, de manière à rendre impossible leur déversement en dehors. Mais pour rendre sa balustrade à jour très-rigide, tout en la découpant délicatement, l'architecte de Saint-Urbain la composa d'une suite de triangles chevauchés réunis par leurs côtés, et formant comme autant de petits liens inclinés se contre-buttant mutuellement de manière à éviter les chances de rupture. C'était là, il faut le dire, plutôt une combinaison de charpente qu'une construction de maçonnerie; mais il faut dire aussi que la pierre à laquelle on imposait cette fonction anormale est de la pierre de Tonnerre, d'une qualité, d'une fermeté et d'une finesse extraordinaires, qui lui donnent, une fois taillée, l'aspect du métal. Certes, cela était ingénieux et bien raisonné comme appareil; il était impossible de dominer la matière d'une façon plus complète que ne le fit avec succès le savant architecte de Saint-Urbain (voy. CONSTRUCTION); mais pour ne parler que de la balustrade dont il est ici question, cette suite de petits triangles semblables aux grands triangles formés par les gâbles est fâcheuse au point de vue de l'art. L'oeil est tourmenté par ces figures géométriques semblables mais inégales; l'harmonie qui doit résulter, non de la similitude des diverses parties d'un édifice, mais de leur contraste, est détruite. Ici, comme dans toutes les formes de l'architecture adoptées à partir de cette époque, le raisonnement, la combinaison géométrique prennent une place trop importante; le sentiment, l'instinct de l'artiste disparaissent étouffés par la logique. L'amour des détails, les raffinements dans leur application vinrent encore ôter aux balustrades leur sévérité de formes. Les architectes du XIIIe siècle, mus par ce sentiment d'art qu'on retrouve à toutes les belles époques, avaient compris que plus les membres de l'architecture sont d'une petite dimension, et plus leurs formes veulent être largement composées, afin de ne pas détruire l'aspect de grandeur que doivent avoir les édifices; car en multipliant les détails sans mesure, on rapetisse au lieu de grandir l'architecture. Si parfois, au XIIIe siècle, dans quelques monuments exécutés avec un grand luxe, on s'était permis de faire des balustrades très-riches par leur combinaison et leur sculpture, sentiment de la grandeur apparaissait toujours, et les détails ne venaient pas détruire les masses; témoin la balustrade qui couronne le passage réservé au-dessus de la porte sud de Notre-Dame de Paris (17), élevée en 1257. Il est impossible de grouper plus d'ornements et de moulures sur une balustrade, et cependant on remarque qu'ici Jean de Chelles, l'auteur de ce portail, avait compris que l'excès de richesse prodigué sur un petit espace pouvait détruire l'unité de sa composition, car il avait eu le soin de relier cette balustrade aux divisions générales de l'architecture par des colonnettes engagées qui viennent la pénétrer et la forcer, pour ainsi dire, à participer à l'ensemble de la décoration 69.
Aussi raffinés, mais moins adroits, les architectes du XIVe siècle arrivèrent promptement à la maigreur ou à la lourdeur (car ces deux défauts vont souvent de compagnie dans les compositions d'art), en surchargeant les balustrades de profils et de combinaisons plus surprenantes que belles. Ils cherchèrent souvent des dispositions neuves et ne se contentèrent pas toujours de la claire-voie percée dans une dalle de champ, et couverte par un appui horizontal. Parmi ces nouvelles formes, nous devons citer les crénelages. Les créneaux avec leurs merlons se découpaient vivement au sommet des édifices, et donnaient déjà, par leur simple silhouette, une décoration. On se servit parfois, pendant le XIVe siècle, de cette forme générale, pour l'appliquer aux balustrades. C'est ainsi que fut couronnée la corniche supérieure du choeur de la cathédrale de Troyes 70. Cet exemple de balustrade crénelée ne manque pas d'originalité, mais il a le défaut de n'être nullement en harmonie avec l'édifice; nous ne le donnons d'ailleurs que comme une exception (18).
Les merlons de cette balustrade crénelée sont alternativement pleins et à jour; les appuis des créneaux sont tous à jour. Derrière chaque merlon plein est un renfort A qui donne du poids à l'ensemble de la construction et retient son dévers. On remarquera que cette balustrade est composée d'assises de pierre d'un assez petit échantillon, et cela vient à l'appui de ce que nous avons dit au commencement de cet article: que les matériaux et leurs dimensions exerçaient une influence sur les formes données aux balustrades. Et, en effet, à Troyes on ne se procurait que difficilement alors des pierres basses, mais longues et larges, propres à la taille des balustrades à jour posées en délit. Il fallait les faire venir de Tonnerre; elles devaient être chères, et ces réparations faites au XIVe siècle à la cathédrale de Troyes sont exécutées avec une extrême parcimonie. À l'église Saint-Urbain de la même ville, presque contemporaine de ces restaurations de la cathédrale, mais où la question d'économie avait été moins impérieuse, nous avons vu, au contraire, comme l'architecte avait profité de la qualité et de la dimension des pierres de Tonnerre, pour faire des balustrades minces et composées de grands morceaux.
Il n'est pas rare de trouver dans les édifices du commencement du XIVe siècle des balustrades pleines, décorées d'un simulacre d'ajour. C'est surtout dans les pays où la pierre, trop tenace ou trop grossière, ne se prêtait pas aux dégagements délicats des redents, et ne conservait pas ses arêtes, que ces sortes de balustrades ont été adoptées. Dans la haute Bourgogne, par exemple, où le calcaire est d'une qualité ferme et difficile à évider, on ne fit des balustrades à jour que fort tard, et lorsque le style d'architecture adopté en France envahissait les provinces voisines, c'est-à-dire vers le commencement du XIVe siècle; et même alors les tailleurs de pierre se contentèrent-ils souvent de balustrades pleines, de dalles posées de champ, décorées de compartiments se détachant sur un fond. C'est ainsi qu'est taillée la balustrade qui surmonte les deux chapelles du transept de l'église Saint-Bénigne de Dijon (18 bis). Le cloître de l'église cathédrale de Béziers, dont la construction date des premières années du XIVe siècle, est couronné d'une balustrade composée de la même manière comme compartiments et comme appareil, ce qui est motivé par la nature grossière de la pierre du pays, qui est un calcaire alpin poreux, tenant mal les arêtes.
Seulement ici (18 ter) l'appui forme recouvrement, il est rapporté sur le corps de la balustrade. L'assise d'appui, taillée dans une pierre d'un grain plus serré, protége les dalles de champ, et (fait qui doit être noté) cet appui porte une dentelure, sorte d'amortissement fleuronné couronnant la balustrade. Celle-ci, étant pleine, terminait lourdement les arcades du cloître; sa ligne horizontale se détachant sur le ciel (car ce cloître est couvert par une terrasse), reliait mal les pinacles qui terminent les contre-forts; et c'est évidemment pour rompre la sécheresse de cette ligne horizontale, à laquelle la balustrade pleine n'apportait aucun allégement, que fut ménagée cette dentelure supérieure. On trouve plusieurs exemples de ces balustrades fleuronnées, même lorsque celles-ci sont à jour, dans quelques églises de Bretagne, surtout pendant les XVe et XVIe siècles (voy. fig. 27). Ce qui caractérise les balustrades exécutées pendant le XIVe siècle, c'est l'adoption du système de panneaux de pierre percés chacun de leur ajour, séparés par un montant le long du joint, et recouverts d'un appui les reliant tous ensemble. Si l'appareil y gagnait, la succession de divisions verticales séparant chacun des panneaux juxtaposés ôtait aux balustrades l'aspect qu'elles avaient au XIIIe siècle, d'un couronnement continu, d'une sorte de frise à jour, laissant aux lignes horizontales leur simplicité calme; nécessaire dans des monuments de cette étendue pour reposer les yeux, que les divisions régulières verticales, trop répétées, fatiguent bientôt.
Les architectes étaient conduits à sacrifier l'art au raisonnement; ils perdaient cette liberté qui avait permis à leurs prédécesseurs de mêler les inspirations du goût aux nécessités de la construction ou de l'appareil. L'exercice de la liberté dans les arts n'appartient qu'au génie, et le génie avait fait place au calcul, aux méthodes, dès le commencement du XIVe siècle, dans tout ce qui tenait à l'architecture. Nous donnons ici (19) un exemple d'une balustrade exécutée en panneaux de pierre, tiré du bras de croix méridional de l'ancienne cathédrale de la cité de Carcassonne. La construction de cette balustrade remonte à 1325 environ. Il faut dire cependant que les formes des balustrades adoptées par les architectes du XIIIe siècle furent longtemps employées; on les amaigrissait, ainsi que nous l'avons vu dans l'exemple présenté dans la fig. 18, on les surchargeait de moulures et de redents évidés; mais le principe était souvent conservé; toutefois, on préférait les formes anguleuses aux formes engendrées par des combinaisons de demi-cercles; les courbes brisées étaient en honneur; et des voûtes, des fenêtres, elles pénétraient jusque dans les plus menus détails de l'architecture. Le simple bizeau qui, au XIIIe siècle, était seul destiné à produire des jeux d'ombre et de lumière dans les balustrades, parut trop simple, lorsque tous les membres de l'architecture se subdivisèrent à l'infini; on le doubla par un temps d'arrêt, et les balustrades eurent deux plans de moulures; l'un donnait la forme générale, le thème, le second était destiné à former les redents, la broderie. Un exemple est nécessaire pour faire comprendre l'emploi de ce nouveau mode.
Voici (20) la balustrade qui couronne la corniche du choeur de l'église que nous venons de citer, la cathédrale de Carcassonne 71. La forme génératrice de cette balustrade, le thème, pour nous servir d'un mot qui rend parfaitement notre pensée, est une suite de triangles équilatéraux curvilignes.
Si nous examinons la coupe sur A B de cette balustrade, nous voyons que le bizeau C est divisé par un arrêt résultant d'une petite coupe à angle droit D. Cette coupe produit un listel, parallèle à la face de la balustrade. C'est ce listel qui dessine les redents E, et le second membre du bizeau qui leur donne leur modelé. Mais les parties pleines de l'architecture, les points d'appui, se perdaient de plus en plus sous les subdivisions des moulures, des colonnettes; les meneaux des fenêtres s'amaigrissaient chaque jour sous la main de constructeurs; les balustrades chargées de ce double bizeau taillé suivant un angle de 45 degrés, et de ce listel du second plan, recevaient trop de lumière; elles paraissaient lourdes comparativement aux autres membres de l'architecture, dont les plans renfoncés découpaient seulement quelques lignes fines de lumière, sur des ombres larges. Dès lors on renonça aux bizeaux coupés suivant un angle de 45 degrés dans le profil des balustrades, et l'on voulut avoir des plans plus vivement accusés. Soit (21) fig. A: si le rayon lumineux B C tombe sur le bizeau E F, lui étant parallèle, il le frisera et ne produira qu'une demi-teinte. Mais si, fig. D, le bizeau E F donne un angle moindre de 45 degrés, le même rayon lumineux B C laissera toute la partie E F dans une ombre franche. Les balustrades étant composées presque toujours de petites courbes, la lumière frappe sur une grande partie des surfaces fuyantes; pour obtenir des ombres larges, il était donc nécessaire de rapprocher, autant que possible, la coupe de ces surfaces fuyantes de la ligne horizontale, afin de les dérober à la lumière; et comme on ne donne de la finesse aux parties éclairées que par l'opposition d'ombres larges, que les parties éclairées, dans les formes de l'architecture, comptent seules, et qu'elles produisent, suivant la largeur ou la maigreur de leurs surfaces, la lourdeur ou la finesse, les architectes, voulant obtenir la plus grande finesse possible dans la coupe des balustrades, arrivèrent à dérober de plus en plus les surfaces fuyantes aux rayons lumineux. À la fin du XIVe siècle déjà, ils avaient entièrement renoncé aux bizeaux qui, sur quelques points, par le glissement de la lumière, donnaient toujours des demi-teintes, et ils les remplaçaient par des profils légèrement concaves (22) qui donnent plus d'ombre et découpent plus vivement les plans.
Mais alors ils amaigrissaient tellement les dalles à jour, qu'elles n'offraient plus de solidité; pour remédier à cet inconvénient, ils leur donnèrent plus d'épaisseur, et les balustrades qui, en moyenne, au XIIIe siècle, n'avaient guère que 0,12 centimètres d'épaisseur dans leur partie à jour, prirent jusqu'à 0,20 centimètres.
Par l'effet de la perspective, ces balustrades, vues de bas en haut ou de côté, présentaient de si larges surfaces de champ, qu'elles laissaient à peine voir les ajours. Il fallut encore dissimuler ce défaut, et, pour y arriver, on profila les balustrades en dedans comme en dehors. On avait voulu d'abord dérober à la lumière les surfaces fuyantes des épaisseurs pour obtenir des ombres accentuées; par ce dernier moyen, on dérobait une partie de ces surfaces aux yeux (23).
On nous pardonnera la longueur d'une théorie qu'il nous a paru nécessaire d'exposer, afin de faire comprendre les motifs des diverses transformations que l'on fit subir aux balustrades jusqu'au XVe siècle. Nous l'avons dit déjà, et nous le répétons, cet accessoire de l'architecture du moyen âge est d'une grande importance; il a préoccupé nos anciens architectes, et cela avec raison.
Une balustrade de couronnement complète heureusement ou gâte un édifice, selon qu'elle est bien ou mal composée, qu'elle est ou n'est pas, dans son ensemble et ses détails, à l'échelle des divers membres architectoniques de cet édifice, qu'elle aide ou contrarie son système général de décoration. Une balustrade bien liée à la corniche qui lui sert de base, en rapport de proportions avec le monument qu'elle couronne, qui rappelle ses formes de détail sans les reproduire à une plus petite échelle, dont les divisions font valoir les dimensions de ce monument, est une oeuvre assez rare pour qu'il soit permis de croire que c'est là un des écueils de l'architecture du moyen âge, et pour qu'il soit nécessaire d'étudier avec grand soin les quelques beaux exemples qui nous sont restés.
L'adoption du système de panneaux divisés à chaque joint par des montants verticaux dans l'appareil des balustrades fit quelquefois ajouter des terminaisons en forme de fleurons ou d'aiguilles sur ces montants, car les architectes du XIIIe siècle et, à plus forte raison, du XIVe siècle n'admettaient pas dans les formes de l'architecture un montant vertical d'une certaine largeur sans le couronner par quelque chose. Pour eux, le pilastre venant se perdre dans une moulure horizontale était un membre tronqué. Mais c'est au commencement du XVIe siècle surtout que les balustrades à panneaux séparés par des montants verticaux le long du joint, furent adoptées sans exception. Les compartiments à jour dont elles se composaient ne permettaient plus, par la complication de leur forme, un autre appareil.
Pendant le XVe siècle, les balustrades à panneaux se rencontrent fréquemment, mais ne sont pas les seules. Ce sont alors les losanges, les triangles rectilignes qui dominent dans la composition des balustrades. Il faut remarquer que ces formes se prêtaient mieux à l'assemblage d'ajours en pierre, étaient plus solides que les formes curvilignes; et au XVe siècle, l'architecte était surtout appareilleur.
Un morceau de balustrade, taillé suivant la fig. 24, présentait beaucoup de résistance et s'assemblait facilement par les extrémités A B. L'appui, souvent d'un autre morceau, recouvrait et reliait ces claires-voies. Lorsque, pendant le XVe siècle, les balustrades étaient composées de panneaux, les montants verticaux étaient parfois saillants en forme de petits contre-forts, ainsi que l'indiquent les fig. 25 et 26.
Ce fut aussi pendant le XVe siècle que l'on eut l'idée de sculpter dans les ajours des balustrades, des attributs, des pièces principales d'armoiries 72. Nous donnons (25) des panneaux de la balustrade couronnant la nef de la cathédrale de Troyes, et dans lesquels les tailleurs de pierre du XVe siècle ont figuré alternativement les clefs de saint Pierre et des fleurs de lis. La balustrade refaite, au XVe siècle, à la base du pignon de la Sainte-Chapelle du Palais, à Paris, présente également, dans chacun de ses panneaux, une belle et grande fleur de lis inscrite dans un cercle (26). Un grand K couronné tenu par deux anges se détache au milieu de cette balustrade; c'est le chiffre ou la première lettre du nom de Charles VII (Karolus), qui la fit refaire (voy. CHIFFRE). La balustrade de l'oratoire, bâti par Louis XI sur le flanc sud du même édifice, porte également un grand L couronné. Cet usage de placer des chiffres, des lettres dans les balustrades fut assez généralement adopté à la fin du XVe siècle et au commencement du XVIe; le château de Blois porte, sur la façade élevée par François Ier, des balustradès dans lesquelles on voit des F couronnées et des salamandres. On alla même jusqu'à y sculpter de grandes inscriptions à jour, comme au choeur de l'église de la Ferté-Bernard près du Mans, comme au château de Josselin en Bretagne, sur les balustrades duquel on lit la devise: A PLUS (27) 73.
Dans l'architecture civile de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe, on fit souvent aussi des balustrades aveugles qui n'étaient, sous les appuis des fenêtres, que des bandeaux larges formant une riche décoration. Telles étaient les balustrades qui réunissaient les alléges des fenêtres du premier étage de l'hôtel la Trémoille à Paris (28), balustrades qui sont toutes variées soit comme dessin, soit comme division; car il n'est pas rare de trouver une grande variété dans la composition d'une même balustrade de la fin du XVe siècle et du commencement du XVIe.
Lorsque le goût de l'architecture romaine antique eut effacé, vers le milieu du XVIe siècle, les derniers vestiges des formes adoptées par le moyen âge dans les détails de l'architecture, on se complut à faire des balustrades composées d'ordres réduits. Il existe une balustrade de ce genre à la base du pignon de la petite église de Belloy près Beaumont; c'est une suite de colonnettes doriques surmontées d'une corniche à denticules avec soffites sculptés entre les chapiteaux. À Saint-Eustache de Paris, on voit des balustrades formées de petits pilastres doriques ou composites séparés par des arcades portées sur des pieds-droits avec leurs impostes 74. Mais cette succession de lignes verticales données par les colonnettes ou pilastres rapprochés prenait trop d'importance dans l'ensemble de la décoration, et avait l'inconvénient de rappeler en petit les grandes divisions et décorations de l'architecture alors en honneur; c'était là un défaut majeur, qui ne manqua pas de frapper les architectes de la renaissance; on voulut rendre aux balustrades leur échelle, et pour que les colonnettes formant la partie principale de leur décoration ne parussent pas un diminutif des ordres de l'architecture, on leur donna un galbe particulier, qui les fait ressembler à un potelet de bois tourné au tour. Les profils de ces supports se divisent en bagues, gorges, panses, etc. Quelquefois même les renflements des colonnettes ainsi galbées furent décorés de sculptures; celles-ci prirent dès lors le nom de balustres qui leur est resté. Peu à peu ces balustres s'alourdirent et arrivèrent à ce profil bizarre qui rappelle la forme d'un flacon avec son goulot, et dont la réunion, comprise entre des pilastres et de lourds appuis, couronne assez désagréablement depuis le XVIIe siècle la plupart de nos édifices. Il faut croire que ces morceaux de pierre tournés parurent être la dernière expression du goût, car, une fois adoptés, les architectes ne se mirent plus en frais d'imagination pour composer des balustrades en harmonie avec leur architecture; que celle-ci fut simple ou riche, plate ou accusant de fortes saillies, basse ou élevée, religieuse ou civile, la balustrade fut toujours la même ou peu s'en faut, bien que les architectes du XVIIe siècle aient prétendu la diviser en balustrade toscane, ionique, corinthienne, etc. On ne se contenta pas d'en placer là où le besoin demandait une barrière à hauteur d'appui, on s'en servit comme d'un motif de décoration. Rien cependant n'autorisait, dans l'architecture romaine antique que l'on voulait imiter, un pareil abus de la balustrade, ni comme emploi ni comme forme. Il faut dire même que la corniche saillante de l'entablement romain porte mal ces rangées de morceaux de pierre tournés, posés à l'aplomb de la frise, et qui, par leur retraite, n'indiquent pas la présence du chéneau. La balustrade de l'architecture du moyen âge, posée sur l'arête supérieure du glacis du larmier portant le chéneau, est non-seulement un garde-corps pour ceux qui passent dans ces chéneaux, mais elle arrête la chute des tuiles ou des ardoises, et est une sécurité pour les couvreurs qui sont obligés de poser des échelles sur la pente des combles lorsqu'il est nécessaire de les réparer; elle fait partie de la corniche, car le glacis du larmier demande un couronnement; tandis que la balustrade moderne, posée sur l'entablement romain, à l'aplomb de la frise, est un grossier contre-sens, puisque, d'après la configuration de cet entablement, le chéneau se trouverait en dehors de la balustrade et non en dedans. Aussi, jamais les architectes Romains, qui possédaient cette qualité précieuse qu'on appelle le sens-commun, n'ont eu l'idée bizarre de placer des balustrades sur les corniches supérieures de leurs édifices, faites pour porter les premières tuiles des combles.
Nous ne devons pas omettre de parler des balustrades de bois fréquemment employées pendant les XVe et XVIe siècles. Quant aux balustrades en métal, il en est fait mention dans le mot GRILLE. C'est à l'intérieur des édifices ou à couvert qu'étaient posées les balustrades de bois. Le peu d'exemples qui nous restent de ces claires-voies à hauteur d'appui, antérieures au XVIe siècle, sont d'une grande simplicité; ce sont presque toujours de petits potelets assemblés haut et bas dans deux traverses, ainsi que le démontre la fig. 29, copiée sur une balustrade du XVe siècle, posée encore aujourd'hui le long du triforium de l'église paroissiale de Flavigny (Côte-d'Or). Au XVIe siècle, la forme des balustres tournés convenait parfaitement aux balustrades de bois; c'était le cas de l'employer et les architectes ne s'en firent pas faute (voy. MENUISERIE).
BANC, s. m. Il n'était pas d'usage, avant la fin du XVIe siècle, de placer dans les églises, des chaises ou bancs en menuiserie pour les fidèles. Les femmes riches qui se rendaient à l'église se faisaient suivre de valets qui portaient des pliants et coussins pour s'asseoir et se mettre à genoux. Le menu peuple, les hommes, se tenaient debout ou s'agenouillaient sur les dalles. À Rome, dans presque toute l'Italie et une partie de l'Allemagne catholique, encore aujourd'hui, on ne voit aucun siége dans les églises. Mais quand, au XVIe siècle, des prêches se furent établis sur toute la surface de la France, les réformistes placèrent dans leurs temples des bancs séparés par des cloisons à hauteur d'appui destinés aux fidèles. Le clergé catholique, craignant sans doute que la rigidité de la tradition ancienne ne contribuât encore à éloigner le peuple des églises, imita les réformistes et introduisit les bancs et les chaises. L'effet intérieur des édifices sacrés perdit beaucoup de sa grandeur par suite de cette innovation; et pour qui a pu voir la foule agenouillée sur le pavé de Saint-Pierre de Rome ou de Saint-Jean-de-Latran, cet amas de chaises, ou ces bancs cellulaires de nos églises françaises, détruisent complétement l'aspect religieux des réunions de fidèles. Il n'y avait autrefois, dans nos églises, de bancs que le long des murs des bas-côtés ou des chapelles; ces bancs formaient comme un soubassement continu entre les piles engagées sous les arcatures décorant les appuis des fenêtres de ces bas-côtés ou chapelles (voy. ARCATURE).
Quelquefois même ces bancs fixes en pierre s'élevaient sur un emmarchement, comme on peut le voir à l'intérieur de la cathédrale de Poitiers (fin du XIIe siècle) (1), et le long des murs de la nef de la cathédrale de Reims. On en plaçait presque toujours aussi sous les porches des églises, dans les ébrasements des portails, dans les galeries des cloîtres, soit le long des claires-voies, soit le long des murs.
Voici (2) quelle est la disposition des bancs formant soubassement intérieur de la claire-voie du cloître de Fontfroide près Narbonne (commencement du XIIIe siècle). Ces bancs se combinent adroitement avec la construction des piles principales de ce cloître, ainsi que nous le voyons dans la figure. Le bahut de la claire-voie lui tient lieu de dossier. On voit encore des bancs avec une marche au devant dans les salles capitulaires, dans les chauffoirs des monastères, et dans les parloirs.
Les grandes salles des palais royaux, des châteaux, les salles synodales étaient toujours garnies de bancs au pourtour, ainsi que les salles des gardes et les vestibules des habitations princières (voy. SALLE). On plaçait aussi à demeure des bancs de pierre le long des jambages des cheminées, particulièrement dans les habitations de campagne, dans les maisons de paysans, les fermes, dont l'unique cheminée servait à faire la cuisine et à chauffer les habitants.
Des deux côtés des portes des maisons, il était également d'usage de placer des bancs de pierre sur la voie publique, soit taillés dans une seule pierre, soit composés d'une dalle et de montants avec ou sans accoudoirs. Nous avons encore vu de ces sortes de bancs de pierre très-simples, avec accoudoir, le long de quelques maisons anciennes du midi de la France (3), à Cordes, à Saint-Antonin près Alby; c'était là que se reposaient les piétons fatigués, les pauvres; que le soir, après le travail, on venait s'asseoir et causer entre voisins. Si les façades des maisons étaient garanties par des contreforts très-saillants portant des galeries et les charpentes du comble, les bancs étaient alors posés le long de ces contreforts perpendiculairement au mur de face (voy. MAISON). Lorsque les murs des maisons ou châteaux présentaient une assez forte épaisseur, on réservait des bancs en pierre dans les ébrasements, à l'intérieur des fenêtres.
Voici (4) l'un de ces bancs tenant à la fenêtre de premier étage d'une des maisons construites pendant le XIIIe siècle dans la ville de Flavigny (Bourgogne). Il est placé dans l'ébrasement de la baie; le meneau A sépare ce banc en deux stalles et se termine en accoudoir; les personnes assises tournaient le dos au jour. Mais ordinairement, quand les murs sont très-épais, comme par exemple dans les châteaux fortifiés, les bancs sont disposés perpendiculairement au jour, le long des deux ébrasements si la fenêtre est large (5), ou d'un seul côté si la fenêtre est étroite (6).
Ce dernier exemple de banc est fréquent dans les tours de guet, où l'on plaçait des sentinelles pour observer ce qui se passait à l'extérieur par des fenêtres étroites. Les meurtrières percées à la base des courtines sous de grands arcs formant comme de petites chambres pouvant contenir facilement deux hommes, sont toujours garnies de bancs posés le long des deux côtés du réduit, perpendiculairement au mur de face. Cette disposition de bancs à demeure dans les ébrasements des fenêtres se conserva jusqu'au XVIe siècle (voy. FENÊTRE, MEURTRIÈRE).
BANDEAU, s. m. C'est une assise de pierre saillante décorée de moulures ou d'ornements sculptés ou peints qui sépare horizontalement les étages d'un monument. Le bandeau indique un plancher, un sol; il ne peut être indifféremment placé sur une façade ou dans un intérieur; c'est un repos pour l'oeil, c'est l'arase d'une construction superposée. Dans les églises de l'époque romane, un bandeau intérieur indique presque toujours le sol du triforium, il est interrompu par la ligne verticale des colonnes engagées, ou passe devant elles. Dans l'architecture domestique, le niveau des planchers est marqué souvent, à l'extérieur, par un bandeau de pierre. Sur les façades, des bandeaux séparent les ordonnances d'architecture superposées. Ils ont cet avantage de garantir les parements extérieurs, leur saillie empêchant les eaux pluviales de laver les murs; aussi les a-t-on fait généralement en pierre plus dure que celle dont on se servait pour la construction des parements, et leurs profils étaient-ils, surtout à partir du XIIIe siècle, tracés de manière à former une mouchette ou un larmier. L'influence des profils antiques romains se fait sentir dans les bandeaux comme dans tous les autres membres de l'architecture romane. Pris dans une assise assez basse, les bandeaux affectent, jusqu'au XIIe siècle, à l'extérieur ou à l'intérieur, des formes très-simples, et se composent ordinairement d'un bizeau A, d'un cavet B légèrement concave, ou d'une doucine C sous un plan horizontal (1).
Ces bandeaux sont fréquemment ornés de sculptures, surtout à partir de la fin du XIe siècle, et ils passent devant les saillies verticales de l'architecture, piles, contre-forts, etc. Tels sont les bandeaux intérieurs de la nef de l'église abbatiale de Vézelay posés à l'arase du dessus des archivoltes des bas-côtés (2) (commencement du XIIe siècle).
Le lit supérieur de ces bandeaux forme encore une saillie horizontale. On remarqua bientôt que ces saillies à l'intérieur des édifices masquaient, par leur projection, une partie des parements élevés au-dessus d'elles. Soit A le profil d'un bandeau intérieur (3), la plus forte reculée du point visuel étant suivant la ligne D C, toute la hauteur sera perdue pour l'oeil, la proportion de l'ordonnance architectonique placée au-dessus de B sera détruite par la perte de cet espace B C. Décorant les bandeaux de sculptures, surtout à l'intérieur, les architectes tenaient à présenter les ornements sur une surface perpendiculaire à la ligne visuelle; ils ne renoncèrent pas facilement aux plans inclinés E F, et se contentèrent de diminuer peu à peu les saillies E B.
Tel est le profil (4) des bandeaux intérieurs du bras de croix sud de la cathédrale de Soissons, du choeur de Saint-Remy de Reims (fin du XIIe siècle).
À l'extérieur, on avait également reconnu que les bandeaux saillants dont le lit supérieur était laissé horizontal avaient l'inconvénient de ne pas donner un écoulement prompt aux eaux pluviales. Les bandeaux extérieurs taillés suivant le profil A (5) retenaient la neige, faisaient rejaillir les gouttes de pluie projetées suivant C D jusqu'en E, se détérioraient facilement et étaient une cause de ruine pour la base des parements F G élevés au-dessus de leur saillie, à cause de ce rejaillissement. Jusqu'au commencement du XIIIe siècle, on décorait volontiers les bandeaux extérieurs, comme ceux intérieurs, d'ornements sculptés, particulièrement dans les provinces de la Normandie, du Poitou, de la Saintonge, du Languedoc et de l'est; on tenait à ce que les sculptures fussent vues, et en même temps préservées des dégradations causées par les eaux pluviales. Ces ornements étaient taillés sur un bizeau, une doucine ou un talon très-plats et protégés par le lit horizontal supérieur; les ornements les plus ordinaires étaient des dents de scie, des billettes, des damiers (voy. ces mots). Mais lorsque au XIIe siècle, dans les provinces du nord particulièrement, tous les membres de l'architecture furent soumis à un système général de construction, tendant à ne jamais présenter à la pluie des surfaces horizontales, on protégea les bandeaux eux-mêmes par des talus en pierre et une mouchette.
C'est ainsi que sont disposés les bandeaux de la tour Saint-Romain (6) de la cathédrale de Rouen (XIIe siècle). À la même époque, dans les provinces méridionales, on se contentait de donner aux bandeaux extérieurs une faible saillie, mais on ne les surmontait pas d'une pente très-prononcée comme on le faisait dans l'Ile de France, la Picardie et la Normandie, et leurs ornements n'étaient pas abrités par une saillie formant mouchette.
Entre autres exemples, nous donnons ici (7) un des bandeaux extérieurs du bas-côté nord de l'église Saint-Euthrope de Saintes, qui, sans offrir à la pluie des aspérités pouvant être facilement détruites, ne sont pas cependant garantis par une assise ou un profil formant larmier. Il n'est pas besoin de dire que ces détails d'architecture présentent une grande variété, soit comme profils, soit comme ornementation; nous ne prétendons donner dans cet article que leurs dispositions générales. Nous ne saurions cependant passer sous silence les bandeaux extérieurs qui servent de soubassement au triforium des églises d'Autun, de Beaune et de Langres; leur ornementation est trop empreinte des traditions romaines, pour que nous ne reproduisions pas un de ces exemples. Voici le bandeau qui pourtourne le choeur de l'église de Beaune, à la hauteur du sol des galeries surmontant les bas-côtés (8). Le même bandeau, à peu de différences près, se retrouve à la cathédrale d'Autun; à Langres, les rosaces sont remplacées par un enroulement évidemment copié sur des fragments antiques.
Au XIIIe siècle, les bandeaux deviennent plus rares dans l'architecture que pendant la période romane. Déjà, à cette époque, les architectes semblaient exclure la ligne horizontale, et ils ne lui donnaient qu'une importance relativement secondaire. Cependant l'architecte de la cathédrale d'Amiens avait cru devoir accuser très-vigoureusement la hauteur du sol du triforium dans l'intérieur de la nef, par un large bandeau richement décoré de feuillages très-saillants; ce bandeau prend d'autant plus d'importance dans l'ordonnance architectonique de cet intérieur, qu'il passe devant les faisceaux de colonnes et les coupe vers le milieu de leur hauteur (9).
A indique la coupe de ce bandeau avec l'appui du triforium. Évidemment, ici, le maître de l'oeuvre a voulu rompre les lignes verticales qui dominent dans cette nef, dont la construction remonte à 1230 environ (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, fig. 35). Il y avait là comme un dernier souvenir de l'architecture romane 75. Sans avoir une aussi grande importante, il arrive presque toujours que les bandeaux, dans les édifices du commencement du XIIIe siècle, passent devant les faisceaux de colonnes, et servent de bagues pour maintenir leurs fûts posés en délit (voy. BAGUE). Quelquefois aussi les bandeaux s'arrondissent en corbeille, et, soutenus par un cul-de-lampe, servent de point d'appui à des faisceaux de colonnettes ne naissant qu'au-dessus des colonnes du rez-de-chaussée entre les archivoltes. Cette disposition est particulièrement adoptée lorsque les piles de rez-de-chaussée sont monocylindriques mais non composées de la réunion des colonnes qui doivent porter les voûtes supérieures. L'intérieur de l'église de Notre-Dame de Semur en Auxois présente de ces bandeaux devenant tablettes de cul-de-lampe sous les bases des colonnettes supérieures (10).
Pendant le XIIIe siècle, à l'extérieur, les bandeaux ne sont plus guère que des moulures avec larmiers sans ornements; car les architectes de cette époque craignaient évidemment de détruire l'effet des lignes verticales, en donnant aux membres horizontaux de leur architecture une trop grande importance, et la sculpture, en occupant les yeux, aurait prêté aux bandeaux trop de valeur. Cependant on voit encore quelquefois, à cette époque, des bandeaux avec ornements; mais c'est lorsque l'on a voulu indiquer un étage ou sol. C'est ainsi qu'à l'extérieur de la Sainte-Chapelle de Paris il existe un grand bandeau décoré de feuilles et de crochets au niveau du sol de la chapelle haute.
Si séduisante que soit l'architecture romane du Poitou et des provinces de l'ouest, il faut convenir qu'elle n'est pas si scrupuleuse, et ses monuments sont parfois couverts de bandeaux sculptés dont la place est déterminée seulement par le goût ou la fantaisie de l'artiste, non par un étage, une ordonnance d'architecture distincte. Pendant la période romane, beaucoup de membres horizontaux d'architecture dont la fonction est très-secondaire, comme les impostes des archivoltes, les tailloirs des chapiteaux de colonnes engagées, des appuis de croisées, où les tablettes basses des arcatures de couronnement, deviennent de véritables bandeaux, c'est-à-dire qu'ils pourtournent toutes les saillies de la construction, tels que les contre-forts, par exemple. Jusqu'à la fin du XIIe siècle, cette méthode persiste; mais quand le système de l'architecture ogivale est développé, on ne voit jamais ces membres secondaires horizontaux devenir des bandeaux. Cela est bien évident à la Sainte-Chapelle de Paris; seul, le profil dont nous venons de parler, et qui indique le niveau du sol de la chapelle haute, pourtourne l'édifice, passe sur les nus des murs comme sur les contre-forts. À la cathédrale d'Amiens, à la cathédrale de Reims et à celle de Chartres, les appuis des fenêtres du rez-de-chaussée forment bandeau, mais sans ornements (voy. CHAPELLE); à partir de ce profil, les contre-forts montent verticalement sans ressauts ni interruption horizontale sur les côtés, leurs faces étant seules munies de larmiers qui empêchent les eaux de laver leurs parements exposés à la pluie. Il ne peut en être autrement; lorsqu'on examine la structure des édifices dans lesquels le système ogival est franchement adopté et suivi, toute la construction ne se composant que de contre-forts entre lesquels des fenêtres s'ouvrent dans toute la hauteur des étages, il n'y avait pas de murs; les bandeaux indiquent des repos horizontaux, des arases, étaient contraires à ce système vertical; leur effet eût été fâcheux; leurs profils saillants sur les faces latérales des contre-forts seraient venus pénétrer gauchement les piédroits des fenêtres, sans utilité ni raison (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CONTREFORT). À partir du XIIIe siècle, dans l'architecture religieuse, le bandeau n'existe plus par le fait, les murs pleins étant supprimés; on ne les rencontre, comme dans le dernier exemple que nous venons de donner, que lorsqu'ils sont le prolongement horizontal des appuis des fenêtres; seulement, leurs profils se modifient suivant le goût du moment (voy. PROFIL). Dans l'architecture civile, où les murs sont conservés forcément, où la construction ne se compose pas uniquement de contre-forts laissant de grands jours entre eux, des bandeaux indiquent le niveau des planchers (voy. CHÂTEAU, MAISON). Parfois alors les bandeaux sont décorés de sculptures, particulièrement pendant le XVe siècle. Composés de simples moulures profilées dans une assise basse pendant les XIIe, XIIIe et XIVe siècles, ils prennent, au contraire, de la hauteur et une saillie prononcée au XVe siècle, coupent les façades horizontalement, par une ornementation plus ou moins riche. Au XVIe siècle, les bandeaux perdent leur aspect d'arase, pour devenir de véritables entablements avec leur architrave, leur frise et leur corniche, même lorsque l'absence d'un ordre antique devrait exclure l'emploi de tous ces membres. Les façades ne sont plus alors que des bâtiments superposés (voy. ORDRE).
BARBACANE, barbequenne. s. f. On désignait pendant le moyen âge, par ce mot, un ouvrage de fortification avancé qui protégeait un passage, une porte ou poterne, et qui permettait à la garnison d'une forteresse de se réunir sur un point saillant à couvert, pour faire des sorties, pour protéger une retraite ou l'introduction d'un corps de secours. Une ville ou un château bien munis étaient toujours garnis de barbacanes, construites simplement en bois, comme les antemuralia, procastria des camps romains, ou en terre avec fossé, en pierre ou moellon avec pont volant, large fossé et palissades antérieures (voy. ARCHITECTURE MILITAIRE). La forme la plus ordinaire donnée aux barbacanes était la forme circulaire ou demi-circulaire, avec une ou plusieurs issues masquées par la courbe de l'ouvrage. Les armées qui campaient avaient le soin d'élever devant les entrées des camps de vastes barbacanes, qui permettaient aux troupes de combiner leurs mouvements d'attaque, de retraite ou de défense. Au moment d'un siége, en dehors des murs des forteresses, on élevait souvent des barbacanes, qui n'étaient que des ouvrages temporaires, et dans lesquels on logeait un surcroît de garnison.
«Hordéiz ot et bon et bel,
Par defors les murs dou chastel
Ses barbacanes fist drecier
Por son chastel miauz enforcier.
Sodoiers mande por la terr
Qu'il vaingnent à li por conquerre.
Sergens à pié et à cheval:
Tant en y vint que tot un val
En fu covert, grant joie en fist
Renart, et maintenant les mist
Es barbacanes por deffense 76.»
Mais, le plus souvent, les barbacanes étaient des ouvrages à demeure autour des forteresses bien munies.
«Haut sont li mur, et parfont li fossé,
Les barbacanes de fin marbre listé,
Hautes et droites, ja greignors ne verrés 77.»
Parmi les barbacanes temporaires, une des plus célèbres est celle que le roi saint Louis fit faire pour protéger la retraite de son corps d'armée et passer un bras du Nil, après la bataille de la Massoure. Le sire de Joinville parle de cet ouvrage en ces termes: «Quant le roy et ses barons virent celle chouse, et que nul autre remède n'y avoit (le camp était en proie à la peste et à la famine), tous s'accordèrent, que le roy fist passer son ost devers la terre de Babilonne, en l'ost du duc de Bourgoigne, qui estoit de l'autre part du fleuve, qui alloit à Damiette. Et pour retraire ses gens aisément, le roy fist faire une barbacane devant le poncel, dont je vous ai devant parlé. Et estoit faite en manière, que on pouvoit assez entrer dedans par deux coustez tout à cheval. Quant celle barbacanne fut faite et apprestée, tous les gens de l'ost se armèrent; et là y eut ung grant assault des Turcs, qui virent bien que nous en allions oultre en l'ost du duc de Bourgoigne, qui estoit de l'autre part. Et comme on entroit en icelle barbacanne, les Turcs frappèrent sur la queue de nostre ost: et tant firent, qu'ils prindrent messire Errart de Vallery. Mais tantoust fut rescoux par messire Jehan son frère. Toutesfoiz le roy ne se meut, ne toute sa gent, jusques à ce que tout le harnois et armeures fussent portez oultre. Et alors passâmes tous après le roy, fors que messire Gaultier de Chastillon, qui faisoit l'arrière garde en la barbacanne. Quant tout l'ost fut passé oultre, ceulx qui demourerent en la barbacanne, qui estoit l'arrière garde, furent à grant malaise des Turcs, qui estoient à cheval. Car ilz leur tiroient de visée force de trect, pour ce que la barbacanne n'estoit pas haulte. Et les Turcs à pié leur gectoient grosses pierres et motes dures contre les faces, et ne se povoient deffendre ceulx de l'arrière garde. Et eussent été tous perduz et destruitz, si n'eust esté le conte d'Anjou, frère du roy, qui depuis fut roy de Sicille, qui les alla rescourre asprement, et les amena à sauveté 78.»
Cette barbacane n'était évidemment qu'un ouvrage en palissades, puisque les hommes à cheval pouvaient voir par-dessus. Dans la situation où se trouvait l'armée de saint Louis à ce moment, ayant perdu une grande partie de ses approvisionnements de bois, campée sur un terrain dans lequel des terrassements de quelque importance ne pouvaient être entrepris, c'était tout ce qu'on avait pu faire que d'élever une palissade servant de tête de pont, pouvant arrêter l'armée ennemie, et permettre au corps d'armée en retraite de filer en ordre avec son matériel. La vue à vol d'oiseau que nous donnons ici (1) fera comprendre l'utilité de cet ouvrage.
Une des plus importantes barbacanes construites en maçonnerie était celle qui protégeait le château de la cité de Carcassonne, et qui fut bâtie par saint Louis (voy. ARCHITECTURE MILITAIRE, fig. 11, 12 et 13). Cette barbacane, très-avancée, était fermée; c'était un ouvrage isolé. Mais le plus souvent les barbacanes étaient ouvertes à la gorge et formaient comme une excroissance, un saillant semi-circulaire, tenant aux enceintes extérieures, aux lices. C'est ainsi que sont construites la barbacane élevée en avant de la porte Narbonnaise à Carcassonne (voy. PORTE), celle du château du côté de la cité, et celle qui protége la poterne sud de l'enceinte extérieure de la même ville. Cette dernière barbacane communique aux chemins de ronde des courtines de l'enceinte extérieure par deux portes qui peuvent être fermées. En s'emparant de la poterne ou des deux courtines, les assiégeants ne pouvaient se jeter immédiatement sur le chemin de ronde de l'ouvrage saillant, et se trouvaient battus en écharpe en pénétrant dans les lices. Étant ouverte à la gorge, cette barbacane était elle-même commandée par l'enceinte intérieure.
Nous donnons (2 A) les vues cavalières de l'extérieur et (2 B) de l'intérieur de cet ouvrage de défense. Jusqu'à l'invention des bouches à feu, la forme donnée aux barbacanes dès le XIIe siècle ne fut guère modifiée, encore les établit-on même souvent sur un plan semi-circulaire; cependant, vers le milieu du XVe siècle, on ne les regarda pas seulement comme un flanquement pour les portes extérieures; on chercha à les flanquer elles-mêmes, soit par d'autres ouvrages élevés devant elles, soit par la configuration de leur plan, La barbacane qui défend la principale entrée du château de Bonaguil, élevé au XVe siècle, près Villeneuve d'Agen, est une première tentative en ce sens (voy. CHÂTEAU). Des pièces d'artillerie étaient disposées à rez-de-chaussée et les parties supérieures conservaient leurs crénelages destinés aux archers et arbalétriers. En perdant leur ancienne forme, à la fin du XVe siècle, avec l'adoption d'un nouveau système approprié aux bouches à feu, ces ouvrages perdirent leur ancien nom, pour prendre la dénomination de boulevard. Lorsque les barbacanes du moyen âge furent conservées, on les renforça extérieurement, pendant les XVIe et XVIIe siècles, par des ouvrages d'une grande importance.
C'est ainsi que les dehors de la barbacane A (3) du faubourg Sachsenhausen de Francfort sur le Mein furent protégés au commencement du XVIIe siècle; vers la même époque, la barbacane A du château de Cantimpré de Cambrai (4) devint l'occasion de la construction d'un ouvrage à couronne B très-étendu (voy. BOULEVARD).
BARD, s. m. Est un chariot à deux roues sur l'essieu desquelles porte un tablier et un timon armé de deux ou trois traverses. Ce chariot, employé de temps immémorial dans les chantiers de construction, sert à transporter les pierres taillées à pied d'oeuvre; on le désigne aussi sous le nom de binard. Six ou huit hommes s'attellent à ce chariot, et le font avancer en poussant avec les mains sur les traverses, et en passant des courroies en bandoulière qui vont s'attacher à des crochets en fer disposés à l'extrémité antérieure du tablier et sur le timon. Lorsqu'on veut charger ou décharger les pierres, on relève le timon, l'extrémité postérieure du tablier porte à terre, et forme ainsi un plan incliné qui facilite le chargement ou déchargement des matériaux. On dit bardage pour exprimer l'action du transport des pierres à pied d'oeuvre, et les ouvriers employés à ce travail sont désignés dans les chantiers sous le nom de bardeurs. Par extension on dit barder des pierres sur les échafauds, c'est-à-dire les amener de l'équipe qui sert à les monter, au point de la pose, sur des plateaux et des rouleaux de bois. Ces dénominations sont fort anciennes. Le bardage des pierres, du sol au point de pose, se faisait souvent autrefois au moyen de plans inclinés en bois. Le donjon cylindrique du château de Coucy, construit en pierres de taille d'un très-fort volume de la base au faîte, fut élevé au moyen d'un plan incliné en spirale qui était maintenu le long des parements extérieurs par des traverses et des liens engagés dans la maçonnerie (voy. CONSTRUCTION, ÉCHAFAUD).
BARDEAU, s. m. Bauche, Essente, Esseau. C'est le nom que l'on donne à de petites tuiles en bois de chêne, de châtaignier, ou même de sapin, dont on se servait beaucoup autrefois pour couvrir les combles et même les pans de bois des maisons et des constructions élevées avec économie. Dans les pays boisés, le bardeau fut surtout employé. Ce mode de couverture est excellent; il est d'une grande légèreté, résiste aux efforts du vent, et, lorsque le bois employé est d'une bonne qualité, il se conserve pendant plusieurs siècles. Quelquefois les couvertures en bardeaux étaient peintes en brun rouge, en bleu noir, pour imiter probablement les tons de la tuile ou de l'ardoise. Ces fonds obscurs étaient relevés par des lignes horizontales, des losanges de bardeaux peints en blanc.
Le bardeau est toujours plus long que large, coupé carrément, ou en dents de scie, ou en pans, ou arrondis au pureau; il est généralement retenu sur la volige par un seul clou. Voici quelles sont les formes les plus ordinaires des bardeaux employés dans les couvertures des XVe et XVIe siècles (1).
Leur longueur n'excède guère 0,22 c. et leur largeur 0,08 c. Ils sont souvent taillés en bizeau à leur extrémité inférieure, ainsi que l'indiquent les deux figures A, afin de donner moins de prise au vent et de faciliter l'écoulement des eaux. Les bardeaux étaient refendus et non sciés, de manière à ce que le bois fût toujours parfaitement de fil; cette condition de fabrication est nécessaire à leur conservation. Le sciage permet l'emploi de bois défectueux, tandis que le débitage de fil exige l'emploi de bois sains, à mailles régulières et dépourvues de noeuds. La scie contrarie souvent la direction du fil; il en résulte, au bout de peu de temps, sur les sciages exposés à la pluie, des éclats, des esquilles entre lesquelles l'eau s'introduit. Lorsque les bardeaux sont posés sur des surfaces verticales telles que les pans de bois, ils affectent les formes que l'on donnait aux ardoises dans la même position (voy. ARDOISE); le bois se découpant avec plus de facilité que le schiste, les dentelures des bardeaux posés le long des rampants des pignons, sur les sablières ou les poteaux corniers, présentent parfois des dentelures ouvragées et même des ajours.
Nous avons encore vu à Honfleur, en 1831 79, une maison de bois sur le port, dont les sablières étaient couvertes de bardeaux découpés en forme de lambrequins (2). On voit beaucoup de moulins à vent en France qui sont totalement couverts en bardeaux. En Allemagne, on fait encore usage des bardeaux de sapin, particulièrement en Bavière, dans le voisinage du Tyrol 80.
BARRE, BARRIÈRE, s. f. Depuis les premiers temps du moyen âge jusqu'à nos jours, il est d'usage de disposer devant les ouvrages de défense des villes ou châteaux, tels que les portes, des palissades de bois avec parties mobiles pour le passage des troupes. Mais c'est surtout pendant les XIe, XIIe, XIIIe et XIVe siècles que les barrières jouent un grand rôle dans l'art de la fortification. Les parties ouvrantes de ces barrières se composaient ou de vantaux à claire-voie, roulant sur des gonds; ou de tabliers à bascule (voy. ARCHITECTURE MILITAIRE, fig. 30); ou de simples barres de bois qui se tiraient horizontalement, comme nos barrières de forêts, se relevaient au moyen d'un contre-poids (1), et s'abaissaient en pesant sur la chaine.
Ces dernières sortes de barres ne servaient que pour empêcher un corps de cavalerie de forcer brusquement un passage. On les établissait aussi sur les routes, soit pour percevoir un péage, soit pour empêcher un poste d'être surpris par des gens à cheval 81. Lorsqu'une armée venait mettre le siége devant une forteresse, il ne se passait guère de jour sans qu'il se fit quelque escarmouche aux barrières; et les assiégeants attachaient une grande importance à leur prise, car une fois les défenses extérieures en leur pouvoir, ils s'y retranchaient et gênaient beaucoup les sorties des assiégés. Ces barrières, souvent très-avancées et vastes, étaient de véritables barbacanes, qui permettaient à un corps nombreux de troupes de se réunir pour se jeter sur les ouvrages et les engins des assaillants; une fois prises, les assiégés ne pouvaient sortir en masses compactes par les portes étroites des défenses construites en maçonnerie; forcés de passer à la file par ces issues, ils étaient facilement refoulés à l'intérieur. Dans toutes les relations des siéges des XIIe, XIIIe et XIVe siècles, il est sans cesse question de combats aux barrières extérieures des places fortes; elles sont prises et reprises avec acharnement et souvent en perdant beaucoup de monde, ce qui prouve l'importance de ces défenses avancées. Pour éviter que les assaillants n'y missent le feu, on les couvrait extérieurement, comme les bretèches et les beffrois, de peaux fraîches, et même de boue ou de fumier.
«...Or avint ainsi que messire Henri de Flandre, en sa nouvelle chevalerie, et pour son corps avancer et accroître son honneur, se mit un jour en la compagnie et cueillette de plusieurs chevaliers, desquels messire Jean de Hainaut étoit chef, et là étoient le sire de Fauquemont, le sire de Berghes, le sire de Baudresen, le sire de Kuck et plusieurs autres, tant qu'ils étoient bien cinq cents combattans; et avoient avisé une ville assez près de là, que on appeloit Honnecourt, où la plus grand partie du pays étoit sur la fiance de la forteresse, et y avoient mis tous leurs biens. Et jà Y avoient été messire Arnoul de Blakeben et messire Guillaume de Duvort et leurs routes; mais rien n'y avoient fait: donc, ainsi que par esramie (promptement), tous ces seigneurs s'étoient cueillis en grand désir de là venir, et faire leur pouvoir de la conquérir. Adonc avoit dedans Honnecourt, un abbé de grand sens et de hardie entreprise, et étoit moult hardi et vaillant homme en armes; et bien y apparut, car il fit au dehors de la porte de Honnecourt faire et charpenter en grand' hâte une barrière, et mettre et asseoir au travers de la rue; et y pouvoit avoir, entre l'un banc (banchart) et l'autre, environ demi-pied de creux d'ouverture (c'est-à-dire que les pieux étaient écartés l'un de l'autre d'un demi-pied); et puis fit armer tous ses gens et chascun aller es guérites, pourvu de pierres, de chaux, et de telle artillerie qu'il appartient pour là déffendre. Et si très tôt que ces seigneurs vinrent à Honnecourt, ordonnés par bataille, et en grosse route et épaisse de gens d'armes durement, il se mit entre les barrières et la porte de ladite ville, en bon convenant, et fit la porte de la ville ouvrir toute arrière, et montra et fit bien chère manière de défense.
«Là vinrent messire Jean de Hainaut, messire Henri de Flandre, le sire de Fauquemont, le sire de Berghes et les autres, qui se mirent tout à pied et approchèrent ces barrières, qui étoient fortes durement, chacun son glaive en son poing; et commencèrent à lancer et à jeter grands coups à ceux de dedans; et ceux de Honnecourt à eux défendre vassalment. Là était damp abbé, qui point ne s'épargnoit, mais se tenoit tout devant en très bon convenant, et recueilloit les horions moult vaillamment, et lançoit aucune fois aussi grands horions et grands coups moult apertement. Là eut fait mainte belle appertise d'armes; et jetoient ceux des guérites contreval, pierres et bancs, et pots pleins de chaux, pour plus essonnier les assaillans. Là étoient les chevaliers et les barons devant les barrières, qui y faisoient merveilles d'armes; et avint que, ainsi que messire Henri de Flandre, qui se tenoit tout devant, son glaive empoigné, et lançoit les horions grands et périlleux, damp abbé, qui étoit fort et hardi, empoigna le glaive dudit messire Henri, et tout paumoiant et en tirant vers lui, il fit tant que parmi les fentes des barrières il vint jusques au bras dudit messire Henri, qui ne vouloit mie son glaive laisser aller pour son honneur. Adonc quand l'abbé tint le bras du chevalier, il le tira si fort à lui qu'il l'encousit dedans les barrières jusques aux épaules, et le tint là à grand meschef, et l'eut sans faute saché dedans, si les barrières eussent été ouvertes assez. Si vous dis que le dit messire Henri ne fut à son aise tandis que l'abbé le tint, car il étoit fort et dur, et le tiroit sans épargner. D'autre part les chevaliers tiroient contre lui pour rescourre messire Henri; et dura cette lutte et ce tiroi moult longuement, et tant que messire Henri fut durement grévé. Toutes fois par force il fut rescous; mais son glaive demeura par grand' prouesse devers l'abbé, qui le garda depuis moult d'années, et encore est-il, je crois, en la salle de Honnecourt. Toutes fois il y étoit quand j'écrivis ce livre; et me fut montré un jour que je passai par là et m'en fut recordée la vérité et la manière de l'assaut comment il fut fait, et le gardoient encore les moines en parement (comme trophées) 82.»
Les barrières étaient un poste d'honneur; c'était là que l'élite de la garnison se tenait en temps de guerre. «À la porte Saint-Jacques (de Paris) et aux barrières étoient le comte de Saint-Pol, le vicomte de Rohan, messire Raoul de Coucy, le sire de Cauny, le sire de Cresques, messire Oudart de Renty, messire Enguerran d'Eudin. Or avint ce mardi au matin (septembre 1370) qu'ils se délogèrent (les Anglais) et boutèrent le feu ès villages où ils avoient été logés, tant que on les véoit tout clairement de Paris. Un chevalier de leur route avoit voué, le jour devant, qu'il viendroit si avant jusques à Paris qu'il hurteroit aux barrières de sa lance. Il n'en mentit point, mais se partit de son conroi, le glaive au poing, la targe au col, armé de toutes pièces; et s'en vint éperonnant son coursier, son écuyer derrière lui sur un autre coursier, qui portoit son bassinet. Quant il dut approcher Paris, il prit son bassinet et le mit en sa tête: son écuyer lui laça par derrière. Lors se partit cil brochant des éperons, et s'en vint de plein élai férir jusques aux barrières. Elles étoient ouvertes; et cuidoient les seigneurs qui là étoient qu'il dût entrer dedans; mais il n'en avoit nulle volonté. Ainçois quand il eut fait et hurté aux barrières, ainsi que voué avoit, il tira sur frein et se mit au retour. Lors dirent les chevaliers de France qui le virent retraire: Allez-vous-en, allez, vous vous êtes bien acquitté... 83»
Il n'est pas besoin de dire qu'autour des camps on établissait des barrières (voy. LICE, ENCLOSURE) 84. Dans les tournois, il y avait aussi le combat à la barrière. Une barrière de cinq pieds environ séparait la lice en deux. Les jouteurs, placés à ses extrémités, à droite et à gauche, lançaient leurs chevaux l'un contre l'autre, la lance en arrêt, et cherchaient à se désarçonner; la barrière, qui les séparait, empêchait les chevaux de se choquer, rendait le combat moins dangereux en ne laissant aux combattants que leurs lances pour se renverser. Ces barrières de tournois étaient couvertes d'étoffes brillantes ou peintes, et parfaitement planchéiées des deux côtés pour que les chevaux ou les combattants ne pussent se heurter contre les saillies des poteaux ou traverses.
Quant aux barres proprement dites, c'étaient des pièces de bois qui servaient à clore et renforcer les ventaux des portes que l'on tenait à fermer solidement. Les portes extérieures des tours, des ouvrages isolés de défense, lorsqu'elles ne se ferment que par un vantail, sont souvent munies de barres de bois qui rentrent dans l'épaisseur de la muraille. En cas de surprise, en poussant le vantail et tirant la barre de bois, on le maintenait solidement clos et on se donnait le temps de verrouiller. Voici (2) une des portes des tours de la cité de Carcassonne fermée par ce moyen si simple. Du côté opposé au logement de la barre est pratiqué, dans l'ébrasement de la porte, une entaille carrée qui reçoit le bout de cette barre, lorsqu'elle est complétement tirée: le vantail se trouvait ainsi fortement barricadé; pour tirer cette barre, un anneau était posé à son extrémité, et, pour la faire rentrer dans sa loge, une mortaise profonde, pratiqué en dessous, permettait à la main de la faire sortir de l'entaille dans laquelle elle s'engageait (3).
Les portes à deux vantaux des forteresses se barricadaient au moyen d'une barre en bois à fléau, comme cela se pratique encore aujourd'hui dans bien des cas. Ce fléau, pivotant sur un axe, entrait dans deux entailles faites dans les ébrasements en maçonnerie de la porte (4) lorsque les vantaux étaient poussés. Quelquefois, comme à la porte Narbonnaise de la cité de Carcassonne, la barre des vantaux doubles était fixée horizontalement à l'un des deux vantaux, venait battre sur l'autre et était maintenue à son extrémité par une forte clavette passant à travers deux gros pitons en fer (5).
Les deux vantaux se trouvaient ainsi ne former qu'une clôture rigide, pendant que l'on prenait le temps de pousser les verroux et de poser d'autres barres mobiles engagées à leurs extrémités dans des trous carrés pratiqués dans les ébrasements.
BART, s. m. Vieux mot employé pour moellon, pavé.
BAS-COTÉ, s. m. C'est le nom que l'on donne aux nefs latérales des églises (voy. ARCHITECTURE RELIGIEUSE, CATHÉDRALE, ÉGLISE).
BASE, s. f. On nomme ainsi l'empatement inférieur d'une colonne ou d'un pilier. Les Grecs de l'antiquité ne plaçaient une assise formant base que sous les colonnes des ordres ionique et corinthien; l'ordre dorique en était dépourvu. Sous l'empire, les Romains adoptèrent la base pour tous leurs ordres, et cette tradition fut conservée pendant les premiers siècles du moyen âge. L'ordre toscan, qui n'est que le dorique modifié par les Romains, fut très-rarement employé pendant le Bas-Empire; on donnait alors la préférence aux ordres corinthien et composite, comme plus somptueux. Les bases appliquées aux colonnes de ces ordres se composaient, avec quelques variétés de peu d'importance, d'une tablette inférieure carrée ou plinthe, d'un tore, d'une ou deux scoties séparées par une baguette, et d'un second tore; le fût de la colonne portait le listel et le congé. Souvent la base était posée sur un dé ou stylobate, simple ou décoré de moulures. Rien n'égale la grossièreté des bases de colonnes appartenant aux édifices des époques mérovingienne et carlovingienne, comme profil et comme taille. On y trouve encore les membres des bases romaines, mais exécutés avec une telle imperfection qu'il n'est pas possible de définir leur forme, de tracer leur profil. Leur proportion, par rapport au diamètre de la colonne, est complétement arbitraire; ces bases sont parfois très-hautes pour des colonnes d'un faible diamètre, et basses pour de grosses colonnes. Tantôt elles ne se composent que d'un biseau, tantôt on y voit une série de moulures superposées sans motif raisonnable. Il nous serait difficile de donner une suite complète de bases de ces temps de barbarie; car il semble que chaque tailleur de pierre n'ait été guidé que par sa fantaisie ou une tradition fort vague des formes adoptées pendant les bas temps. Nous ne pouvons que signaler les particularités que présentent certaines bases de l'époque carlovingienne, et surtout nous nous appliquerons à expliquer la transition de la base romaine corrompue à la base définitivement adoptée à la fin du XIIe siècle et pendant la période ogivale.
Un détail très-remarquable distingue la base antique romaine de la base du moyen âge dès les premiers temps; la colonne romaine porte à son extrémité inférieure une saillie composée d'un congé et d'un listel, tandis que la colonne du moyen âge, sauf quelques rares exceptions dont nous tiendrons compte, ne porte aucune saillie inférieure, et vient poser à cru sur la base. Ainsi, dans la colonne antique, entre le tore supérieur de la base et le fût de la colonne, il y a une moulure dépendant de celle-ci qui sert de transition. Cette moulure est supprimée dès l'époque romane. Le congé et le filet inférieur du fût de la colonne exigeaient, pour être conservés, un évidement dans toute la hauteur de ce fût; ces membres supprimés, les tailleurs de pierre s'épargnaient un travail considérable. C'est aussi pour éviter cet évidement à faire sur la longueur du fût que l'astragale fut réunie au chapiteau au lieu de tenir à la colonne (voyez ASTRAGALE).
Nous donnons tout d'abord quelques-unes des variétés de bases adoptées du VIIe au Xe siècle. La fig. 1 est une des bases trouvées dans les substructions de l'église collégiale de Poissy, substructions qui paraissent appartenir à l'époque mérovingienne 85. La fig. 1 bis reproduit le profil de la plupart des bases de l'arcature carlovingienne; visible encore dans la crypte de l'église abbatiale de Saint-Denis en France (Xe siècle).
On retrouve dans ces deux profils une grossière imitation de la base romaine des bas temps.
La fig. 2 donne une des bases des piliers à pans coupés de la crypte de Saint-Avit à Orléans: c'est un simple biseau orné d'un tracé grossièrement ciselé (VIIe ou VIIIe siècle); la fig. 3, les bases des piliers de la crypte de l'église Saint-Étienne d'Auxerre (IXe siècle). Ici les piliers se composent d'une masse à pan carré cantonnée de quatre demi-colonnes; la base n'est qu'un biseau reposant sur un plateau circulaire. Ce fait est intéressant à constater, car c'est une innovation introduite dans l'architecture par le moyen âge. L'idée de faire reposer les piliers composés de colonnes sur une première assise offrant une assiette unique aux diverses saillies que présentent les plans de ces piliers, ne cesse de dominer dans la composition des bases des époques romane et ogivale.
Nous en trouvons un autre exemple dans l'église Saint-Remy de Reims. Les piliers de la nef de cette église datent du IXe siècle; ils sont formés d'un faisceau de colonnes (4) avec leur base romaine corrompue reposant sur une assise basse circulaire (voy. PILIER). Dans les contrées où les monuments antiques restaient debout, il va sans dire que la base romaine persiste, est conservée plus pure que dans les provinces où ces édifices avaient été détruits. Dans le midi de la France, sur les bords du Rhône, de la Saône et du Rhin, on retrouve le profil de la base antique jusque vers les premières années du XIIIe siècle; les innovations apparaissent plus tôt dans le voisinage des grands centres d'art, tels que les monastères. Jusqu'au XIe siècle cependant, les établissements religieux ne faisaient que suivre les traditions romaines en les laissant s'éteindre peu à peu; mais quand, à cette époque, la règle de Cluny eut formé des écoles, relevé l'étude des lettres et des arts, elle introduisit de nouveaux éléments d'architecture, parmi les derniers restes des arts romains. Dans les détails comme dans l'ensemble de l'architecture, Cluny ouvrit une voie nouvelle (voy. ARCHITECTURE MONASTIQUE); pendant que le chaos règne encore sur la surface de l'Occident, Cluny pose des règles, et donne aux ouvriers qui travaillent dans ses établissements certaines formes, impose une exécution qui lui appartiennent. C'est dans ses monastères que nous voyons la base s'affranchir de la tradition romaine, adopter des profils nouveaux et une ornementation originale. Les bases des colonnes engagées de la nef de l'église abbatiale de Vézelay fournissent un nombre prodigieux d'exemples variés; quelques-uns rappellent encore la base antique, mais déjà les profils ne subissent plus l'influence stérile de la décadence; ils sont tracés par des mains qui cherchent des combinaisons neuves et souvent belles; d'autres sont couverts d'ornements (5) et même de figures d'animaux (6). À la même époque (vers la fin du XIe siècle), on voit ailleurs l'ignorance et la barbarie admettre des formes sans nom, confuses et sans caractère déterminé.
Les bases de piliers appartenant à la nef romane de l'église Saint-Nazaire de Carcassonne (fin du XIe siècle) dénotent et l'oubli des traditions romaines et le plus profond mépris pour la forme, l'invention la plus pauvre: (7) est une des bases des piles monocylindriques, et (8) une base des colonnes engagées de cette nef. Toutes portent sur un dé carré qui les inscrit.
Ailleurs, dans le Berry, dans le Nivernais, on faisait souvent alors des bases tournées, c'est-à-dire profilées au tour; ce procédé était également appliqué aux colonnes (voy. COLONNE).
Nous donnons (9) le profil de l'une des bases supportant les colonnes du tour du choeur de l'église Saint-Étienne de Nevers, qui est taillé d'après ce procédé (XIe siècle). Le tour invitait à donner aux profils une grande finesse; il permettait de multiplier les arêtes, les filets; et les tourneurs de bases usaient de cette faculté. La base tournée B, composée d'une assise, repose sur un socle à huit pans A qui inscrit son plus grand diamètre.
Dans le nord, en Normandie, dans le Maine, déjà dès le Xe siècle les tailleurs de pierre avaient laissé de côté les moulures romaines corrompues, et s'appliquaient à exécuter des profils fins, peu saillants, d'un galbe doux et délicat. Naturellement les bases subissaient cette nouvelle influence. C'est par la finesse du galbe et le peu de saillie que les profils normands se distinguent pendant l'époque romane (voyez PROFIL).
Voici une des bases des piédroits de l'arcature intérieure de la nef de la cathédrale du Mans (Xe siècle) (10), qui se rapproche plutôt des profils des bas temps orientaux que de ceux adoptés par les Romains d'occident. Toutefois, nous pourrions multiplier les exemples de bases antérieures au XIIe siècle, sans trouver un mode général, l'application d'un principe. Un monument antique encore debout, un fragment mal interprété, le goût de chaque tailleur de pierre influaient sur la forme des bases de tel monument, sans qu'il soit possible de reconnaître parmi tous ces exemples, d'une exécution souvent très-négligée, une idée dominante. Nous mettons cependant, comme nous l'avons dit déjà, les monuments clunisiens en dehors de ce chaos.
Dans les provinces où le calcaire dur est commun, la taille de la pierre atteignit, vers le commencement du XIIe siècle, une rare perfection. Cluny était le centre de contrées abondantes en pierre dure, et les ouvriers attachés à ses établissements mirent bientôt le plus grand soin à profiler les bases des édifices dont la construction leur était confiée. Ce membre de l'architecture, voisin de l'oeil, à la portée de la main, fut un de ceux qu'ils traitèrent avec le plus d'amour. Il est facile de voir dans la taille des profils des bases l'application d'une méthode régulière; on procède par épannelages successifs pour arriver du cube à la forme circulaire moulurée.
Comme principe de la méthode appliquée au XIIe siècle, nous donnons une des bases si fréquentes dans les édifices du centre de la France et du Charolais (11) 86. Les deux disques A et B sont, comme la figure l'indique, exactement inscrits dans le plan carré du socle D. À partir du point E, le tailleur de pierre a commencé par dégager un cylindre E F, puis il a évidé la scotie C et ses deux listels, se contentant d'adoucir les bords des deux disques A B, sans chercher à donner autrement de galbe à son profil par la retraite du second tore B ou des tailles arrondies en boudins. Ce profil est lourd toutefois, et ne peut convenir qu'à des bases appartenant à des colonnes d'un faible diamètre; mais ce système de taille est appliqué pendant le cours du XIIe siècle et reste toujours apparent; il commande la coupe du profil.
Soit (12) un morceau de pierre O destiné à une base: 1° laissant la hauteur AB pour la plinthe, on dégage un premier cylindre AC, comme dans la fig. 11, puis un second cylindre ED; on obtient l'évidement DEP. 2° on évide la scotie F. 3° On abat les deux arêtes GH. 4° On cisèle les filets IKLM. 5° On arrondit le premier tore, la scotie et le second tore. Quelquefois même, ainsi que nous le verrons tout à l'heure, la base reste taillée conformément au quatrième épannelage en tout ou partie. Le profil des bases du XIIe siècle conserve, grâce à cet épannelage simple dont on sent toujours le principe, quelque chose de ferme qui convient parfaitement à ce membre solide de l'architecture et qui contraste, il faut l'avouer, avec la mollesse et la forme indécise de la plupart des profils des bases romaines. Le tore inférieur, au lieu d'être coupé suivant un demi-cercle et de laisser entre lui et la plinthe une surface horizontale qui semble toujours prête à se briser sous la charge, s'appuie et semble comprimé sur cette plinthe. Mais les architectes du XIIe siècle vont plus loin, observant que, malgré son empatement, le tore inférieur de la base laisse les quatre angles de la plinthe carrée vides, que ces angles peu épais s'épaufrent facilement pour peu que la base subisse un tassement; les architectes, disons-nous, renforcent ces angles par un nerf, un petit contre-fort diagonal qui, partant du tore inférieur, maintient cet angle saillant. Cet appendice, que nous nommons griffe aujourd'hui (voy. ce mot), devient un motif de décoration et donne à la base du XIIe siècle un caractère qui la distingue et la sépare complétement de la base romaine.
Nous donnons (13) le profil d'une des bases des colonnes monocylindriques du tour du choeur de l'église de Poissy taillé suivant le procédé indiqué par la fig. 12, et le dessin de la griffe d'angle de cette base partant du tore inférieur pour venir renforcer la saillie formée par la plinthe carrée. Il n'est pas besoin d'insister, nous le croyons, sur le mérite de cette innovation si conforme aux principes du bon sens et d'un aspect si rassurant pour l'oeil. Quand on s'est familiarisé avec cet appendice, dont l'apparence comme la réalité présentent tant de solidité, la base romaine, avec sa plinthe isolée, a quelque chose d'inquiétant; il semble (et cela n'arrive que trop souvent) que ses cornes maigres vont se briser au moindre mouvement de la construction, ou au premier choc. C'est vers le commencement du XIe siècle que l'on voit apparaître les premières griffes aux angles des bases; elles se présentent d'abord comme un véritable renfort très-simple, pour revêtir bientôt des formes empruntées à la flore ou au règne animal (voy. GRIFFE).
Il nous serait difficile de dire dans quelle partie de l'Occident cette innovation prit naissance, mais il est incontestable qu'on la voit adoptée presque sans exception dans toutes les provinces françaises, à partir de la première moitié du XIIe siècle. Sur les bords du Rhin, comme en Provence et dans le nord de l'Italie, les bases des colonnes sont presque toujours dès cette époque, et pendant la première moitié du XIIIe siècle, munies de griffes.
Nous représentons (14) une des bases des colonnes de la nef de l'église de Rosheim, près Strasbourg (rive gauche du Rhin), qui est renforcée de griffes très-simples (première moitié du XIIe siècle); et (15) une base des colonnes engagées de l'église de Schelestadt, même époque, qui offre la même particularité, bien que, de ces deux profils, l'un soit très-saillant et l'autre très-peu accentué. Mais on remarquera que dans ces deux exemples, comme dans tous ceux que nous pourrions tirer des monuments rhénans, le goût fait complétement défaut.
Les bases des colonnes de l'église de Rosheim sont ridiculement empatées et lourdes, celles de l'église de Schelestadt sont au contraire trop plates et leurs griffes fort pauvres d'invention.
C'est toujours dans l'Ile de France ou les provinces avoisinantes qu'il faut chercher les beaux exemples de l'architecture du moyen âge, soit comme ensemble soit comme détails. Tandis que dans ces contrées, centre des arts et du mouvement intellectuel au XIIe siècle, la base se soumettait, ainsi que tous les membres de l'architecture, à des règles raisonnées, l'anarchie ou les vieilles traditions régnaient encore dans les provinces du centre, qui ne suivaient que tardivement l'impulsion donnée par les artistes du XIIe siècle. En Auvergne, dans le Berry, le Bourbonnais et une partie du Poitou, la base reste longtemps dépourvue de son nouveau membre, la griffe, et les architectes paraissent livrés aux fantaisies les plus étranges. C'est ainsi que nous voyons au clocher d'Ébreuil (Allier) des colonnes dont les chapiteaux et les bases sont identiques de forme (16). Même chose à la porte de l'église de Neuvy-Saint-Sépulcre (Indre), à l'église de Cusset, qui nous laisse voir encore une base dont la forme et la sculpture appartiennent à un chapiteau (17) 87.
Là même où les traditions romaines avaient conservé le plus d'empire, à Langres, par exemple, mais où l'influence des écoles d'art de la France pénétrait, nous voyons, au XIIe siècle, la base antique adopter la griffe. Les bases des colonnes du tour du choeur de la cathédrale de Langres sont pourvues de griffes finement sculptées (18). Le profil A de ces bases est presque romain, sauf la scotie, qui semble seulement épannelée; la plinthe (voir le plan B), au lieu d'être tracée sur un plan carré, est brisée suivant l'angle du polygone sur lequel les colonnes du choeur s'élèvent. Il y a là une recherche qui dénote de la part des constructeurs de cet édifice un soin tout particulier 88.
Cette recherche dans les détails se retrouve poussée fort loin dans les bases des colonnettes du triforium du choeur de la cathédrale de Langres. Les colonnettes jumelles qui reposent sur des bases taillées dans un même morceau de pierre, lorsqu'elles sont très-chargées, portent toutes la charge aux deux extrémités de ce morceau de pierre, et manquent rarement de le faire casser au milieu, là où il est le plus faible, puisqu'il n'a sur ce point que l'épaisseur de la plinthe. Pour éviter cet inconvénient, les constructeurs du choeur de la cathédrale de Langres ont eu l'idée de réserver entre les deux colonnettes jumelles, sur la plinthe, un renfort pris dans la hauteur d'assise de la base (19). Cela est fort ingénieux, et ce principe est également appliqué aux chapiteaux de ce triforium (voy. CHAPITEAU).
Il ressort déjà de ces quelques exemples que nous venons de donner un fait remarquable: c'est la propension croissante des architectes du XIIe siècle à établir des transitions entre la ligne verticale et la ligne horizontale, à ne jamais laisser porter brusquement la première sur la seconde sans un intermédiaire. Et pour nous faire comprendre par une figure (20): soient A A deux assises horizontales d'une construction et B un point d'appui vertical; les constructeurs ne laisseront jamais les angles C C vides, mais ils les rempliront par des renforts inclinés D D, des transitions qui sont des épaulements, contreforts, glacis, quand on part de la ligne horizontale pour arriver à la ligne verticale; des encorbellements, quand on part de la ligne verticale pour arriver à l'horizontale. Tout est logique dans l'architecture du moyen âge, à dater de la grande école du XIIe siècle, dans les ensembles comme dans les moindres détails; le principe qui conduisait les architectes à élever sur la colonne cylindrique un chapiteau évasé pour porter les membres divers des constructions supérieures, à multiplier les encorbellements pour passer, par une succession de saillies, du point d'appui vertical à la voûte, les amenait naturellement à procéder de la même manière lorsqu'il s'agissait de poser un point d'appui vertical mince sur un large empalement. Aussi, mettant à part les marches, les bancs qui doivent nécessairement, dans les soubassements des édifices, présenter des surfaces horizontales, voyons-nous toujours la surface horizontale exclue comme ne fonctionnant pas, ne portant pas.
En effet: soit (21) A une colonne et B une assise servant d'empatement inférieur, de base. Toute la charge de la colonne porte seulement sur la surface C D. Si forte que soit l'assise de pierre B, pour peu que la surface C D s'affaisse sous la charge, les extrémités C F, D G non chargées ne suivront pas ce mouvement, et la pierre ne possédant aucune propriété élastique cassera en E E. Mais si (21 bis), entre la colonne A et l'empatement B, on place une assise O, les chances de rupture n'existeront plus, car la charge se répartira sur une surface C D beaucoup plus large. Les angles E seront abattus comme inutiles; dès lors, plus de surface horizontale apparente. Telle est la loi qui commande la forme de toutes les bases de l'époque ogivale 89.
Voyons maintenant comment cette loi une fois établie, non-seulement les architectes ne s'en écartent plus, mais encore l'appliquent jusque dans ses dernières conséquences, sans dévier jamais, avec une rigueur de logique qui, dans les arts, à aucune époque ne fut poussée aussi loin; telle enfin, que chaque tentative, chaque essai nouveau dans cette voie, n'est qu'un degré pour aller au delà. Mais, d'abord, observons que la qualité des matériaux, leur plus ou moins de dureté, influe sur les profils des bases. Lorsque les architectes du XIIe siècle employèrent le marbre ou des calcaires compactes et d'une nature fière, ils se gardèrent de refouiller les scoties des bases; ils multiplièrent les arêtes fines, les plans, pour obtenir des ombres vives, minces, et de l'effet à peu de frais. Dans le Languedoc, où les marbres et les pierres calcaires compactes froides se rencontrent à peu près seules, on trouve beaucoup de profils de bases taillés au XIIe siècle avec un grand soin, une grande finesse de galbe, mais où les refouillements profonds si fréquents dans le Nord sont évités.
Nous prenons comme exemple une des bases des colonnes jumelles de la galerie du premier étage de l'hôtel de ville de Saint-Antonin près Montauban (22). La pierre employée est tellement compacte et fière qu'elle éclate sous le ciseau, à moins de la tailler à très-petits coups, sans engager l'outil.
Or le profil A de cette base montre avec quelle adresse les tailleurs de pierre ont évité les refouillements, les membres saillants des moulures, comme ils ont tiré parti de la finesse du grain de la pierre pour obtenir, par des ciselures faites à petits coups, des plans nettement coupés, des arêtes vives quoique peu accentuées. Les traditions antiques, là où elles étaient vivantes, comme en Provence, conservaient encore, à la fin du XIIe siècle, leur influence, tout en permettant l'introduction des innovations. Parmi un grand nombre d'exemples que nous pourrions citer, il en est un fort remarquable: ce sont les bases des piliers du tour du choeur de l'église de Saint-Gilles (23).
Les griffes d'angle viennent s'attacher au tore inférieur de la base ionique romaine; leur sculpture rappelle la sculpture antique. Cette base qui, en se retournant entre les piles, forme le socle d'une clôture, porte sur le sol du choeur et n'est surélevée que du côté du bas-côté en A. Il est à présumer que les colonnes portaient le filet et le congé comme la colonne antique 90. Dans le choeur de l'église de Vézelay, peu postérieur à celui de Saint-Gilles (dernières années du XIIe siècle), nous retrouvons encore la tradition romaine, mais seulement dans le fût de la colonne qui porte en B un tore, un filet et un cavet (24). Quant à la base elle-même, outre ses griffes, qui sont bien caractérisées et n'ont rien d'antique (voy. GRIFFE), son profil est le profil de la fin du XIIe siècle; le bahut, qui surélève cette base sur le bas-côté, n'est pas couronné par le quart de rond antique de Saint-Gilles, mais par un profil beaucoup mieux approprié à cette place, en ce qu'au lieu de former une arête coupante, il présente un adouci. Ces quelques exceptions mises de côté, la base ne dévie plus de la forme rationnelle que lui avaient donnée les architectes français du XIIe siècle; elle ne fait que la perfectionner jusqu'à l'abus du principe logique qui avait commandé sa composition.
Un des plus beaux et derniers exemples de la base du XIIe siècle se rencontre dans une petite église de Bourgogne, l'église de Montréal près Avallon 91. Nous donnons ici (25) une des bases des colonnes engagées de la nef de cette église et son profil A moitié d'exécution. L'épannelage indiqué par la ligne ponctuée est encore parfaitement respecté ici. Les piles de cette église présentent parfois des pilastres à pans coupés au lieu de colonnes engagées.
Ces pilastres ne portent pas sur un profil de base répétant celui des colonnes: ils ont leur base spéciale (26), dont la composition vient appuyer notre théorie expliquée par la fig. 21 bis. Ce n'est guère que dans les monuments élevés sous une influence romaine, comme les cathédrales de Langres et d'Autun, comme beaucoup d'édifices du Charolais et de la haute Bourgogne, que les pilastres (fréquents dans ces constructions pendant le XIIe siècle) posent sur des profils de bases semblable à ceux des colonnes. La véritable architecture française, naissante alors, n'admettait pas qu'un même profil de base pût convenir à un pilastre carré et à un cylindre. Et en cela, comme en beaucoup d'autres choses, la nouvelle école avait raison. Les tores et filets des bases, fins, détachés, présentent dans les retours d'équerre des aiguités désagréables à la vue, et surtout fort gênants à la hauteur où ils se trouvent placés; car il est rare que le niveau supérieur des bases, à dater du XIIe siècle, excède 1m,20 au-dessus du pavé. Les arêtes saillantes des bases de pilastres se fussent donc trouvées à la hauteur des hanches ou du coude d'un homme; et si les architectes du moyen âge avaient toujours en vue l'échelle humaine dans leurs compositions (voy. ARCHITECTURE), s'ils tenaient à ce qu'une base fût plutôt proportionnée à la dimension humaine qu'à celle de l'édifice, on ne doit pas être surpris qu'ils évitassent avec soin ces angles dont les vives arêtes menacent le passant. Tenant compte de la dimension humaine, ils devaient naturellement penser à ne pas gêner ou blesser l'homme, pour lequel leurs édifices étaient faits 92. Ces raisons, celles non moins impérieuses déduites du nouveau système de construction adopté dès le commencement du XIIIe siècle, amenèrent successivement les architectes à modifier les bases.
C'est dans l'Ile de France qu'il faut étudier ces transformations suivies avec persistance. Les architectes de cette province ne tardèrent pas à reconnaître que le plan carré de la plinthe et du socle était gênant sous le tore inférieur, quoique ses angles fussent adoucis et rendus moins dangereux par la présence des griffes. S'ils conservèrent les plinthes carrées pour les bases des colonnes hors de portée, ils les abattirent aux angles pour les grosses colonnes du rez-de-chaussée. Témoin les colonnes monocylindriques du tour du choeur de la cathédrale de Paris (fin du XIIe siècle); celles de la nef de la cathédrale de Meaux, du tour du choeur de l'église Saint-Quiriace de Provins, dont les bases sont élevées sur des socles et des plinthes donnant en plan un octogone à quatre grands côtés et quatre petits. Toutefois, comme pour conserver à la base son caractère de force, un empatement considérable sous le fût de la colonne, les constructeurs reculent encore devant l'octogone à côtés égaux; ils conservent la griffe, mais en lui donnant moins d'importance puisqu'elle couvre une plus petite surface. La fig. 26 bis indique le plan, et l'angle abattu avec sa griffe d'une des bases du tour du choeur dans la cathédrale de Paris, taillée d'après ce principe.
Mais que l'on veuille bien remarquer que ces bases, à plan octogonal irrégulier, ne sont placées que sous les grosses colonnes isolées du rez-de-chaussée; ces angles abattus ne se trouvent pas aux bases des colonnes engagées d'un faible diamètre. L'intention de ne pas gêner la circulation est ici manifeste 93. Autour du choeur de la cathédrale de Chartres (commencement du XIIIe siècle), les grosses colonnes qui forment la précinction du deuxième bas-côté sont portées sur des bases dont le socle est cubique, et la plinthe octogonale régulière (27). Mais la position de ces colonnes accompagnant un emmarchement justifie la présence du socle à pan carré. En effet, ces marches interdisant la circulation en tous sens, il était inutile d'abattre les angles des carrés. Ici la griffe est descendue d'une assise; elle dégage la base dont la plinthe à la portée de la main est franchement octogone. Déjà même le tore inférieur de cette base, pour garantir par sa courbure les arêtes du polygone, éviter la saillie des angles obtus, déborde les faces de ce polygone, ainsi que l'indique en A le profil pris sur une ligne perpendiculaire au milieu de l'une d'elles. En si beau chemin de raisonner, les architectes du XIIIe siècle ne s'arrêtent plus. À la cathédrale de Reims (28), nous les voyons conserver la plinthe carrée avec ses griffes, mais garder les passants des arêtes par la première assise du socle B, qui est taillée sur un plan octogonal; le tore inférieur C déborde les faces D.
À la même époque, on construisait la nef de la cathédrale d'Amiens et une quantité innombrable d'édifices dont les bases des gros piliers sont profilées sur des plinthes et socles octogones. La griffe alors disparaît. Voici un exemple de ces sortes de bases à socle octogone tiré des colonnes monocylindriques des bas-côtés du choeur de l'église Notre-Dame de Semur en Auxois (29). Pendant que l'on abattait partout, de 1230 à 1240, les angles des plinthes et les socles des grosses piles, afin de laisser une circulation plus facile autour de ces piliers isolés, on maintenait encore les bases à plinthes et socles carrés pour les colonnes engagées le long des murs, pour les colonnettes des fenêtres, des arcatures, et toutes celles qui étaient hors de la circulation; seulement, pour les colonnes engagées, on posait, lorsqu'elles étaient triples (ce qui arrivait souvent afin de porter l'arc doubleau et les deux arcs ogives des voûtes), les bases ainsi que l'indique la fig. 30.
Il y avait à cela deux raisons: la première, que les tailloirs des chapiteaux étant souvent à cette époque posés suivant la direction des arcs des voûtes, les faces B des tailloirs étaient perpendiculaires aux diagonales A; que dès lors les bases prenaient en plan une position semblable à celle des chapiteaux; la seconde, que les bases ainsi placées présentaient des pans coupés B ne gênant pas la circulation. Déjà, dès 1230, la direction et le nombre des arcs des voûtes commandaient non-seulement le nombre et la force des colonnes, mais la position des bases (voy. CONSTRUCTION). Supprimant les griffes aux bases des piliers isolés, on ne pouvait les laisser aux bases des colonnes engagées et des colonnettes des galeries, des fenêtres, etc. Les architectes du XIIIe siècle tenaient trop à l'unité de style pour faire une semblable faute; mais nous ne devons pas oublier leur aversion pour toute surface horizontale découverte et par conséquent ne portant rien. Les griffes enlevées, l'angle de la plinthe carrée redevenait apparent, sec, contraire au principe des épaulements et transitions. Pour éviter cet écueil, les architectes commencèrent par faire déborder de beaucoup le tore inférieur de la base sur la plinthe (31) 94; mais les angles A, malgré le bizeau C, laissaient encore voir une surface horizontale, et le tore B ainsi débordant (quoique le bizeau C ne fût pas continué sous la saillie en D) était faible, facile à briser; il laissait voir par-dessous, si la base était vue de bas en haut, une surface horizontale E.
On ne tarda guère à éviter ces deux inconvénients en entaillant les angles et en ménageant un petit support sous la saillie du tore.
La fig. 32 A indique en plan l'angle de la plinthe dissimulé par un congé, et B le support réservé sous la saillie du tore inférieur.
La fig. 33 donne les bases d'une pile engagée du cloître de la cathédrale de Verdun taillées d'après ce principe. On voit que là les angles saillants, contre lesquels il eût été dangereux de heurter les pieds dans une galerie destinée à la promenade ou à la circulation, ont été évités par la disposition à pan coupé des assises inférieures P. Toutes ces tentatives se succèdent avec une rapidité incroyable; dans une même construction, élevée en dix ans, les progrès, les perfectionnements apparaissent à chaque étage. De 1235 à 1245, les architectes prirent le parti d'éviter les complications de tailles pour les plinthes et socles des bases des colonnes secondaires, comme ils l'avaient fait déjà pour les grosses colonnes des nefs, c'est-à-dire qu'ils adoptèrent partout, sauf pour quelques bases de colonnettes de meneaux, la plinthe et le socle octogones. À la cathédrale d'Amiens, dans les parties inférieures du choeur, à la Sainte-Chapelle de Paris, dans la nef de l'église de Saint-Denis, dans le choeur de la cathédrale de Troyes, etc., toutes les bases des colonnes engagées ou isolées sont ainsi taillées (34).
Quelques provinces cependant avaient, à la même époque, pris un autre parti. La Normandie, le Maine, la Bretagne établissaient les bases de leurs piliers, colonnes ou colonnettes isolées ou engagées, sur des plinthes et socles circulaires concentriques à ces tores.
Telles sont les bases des piles de la nef de la cathédrale de Séez (35), les bases des colonnes de la partie de l'église d'Eu qui date de 1240 environ, du choeur de la cathédrale du Mans de la même époque, etc.; car il est à remarquer que, pendant les premières années du XIIIe siècle, ces détails de l'architecture normande ne diffèrent que bien peu de ceux de l'architecture de l'Ile de France, et qu'au moment où, dans les diocèses de Paris, de Reims, d'Amiens, d'Auxerre, de Tours, de Bourges, de Troyes, de Sens, on faisait passer le plan inférieur de la base du carré à l'octogone, on adoptait en Normandie et dans le Maine le socle circulaire. Cette dernière forme est molle, pauvre, et est loin de produire l'effet encore solide de la base sur socle octogone. C'est aussi à la forme circulaire que s'arrêtèrent les architectes anglais, à la même époque. L'influence du style français se fait sentir en Normandie à la fin du règne de Philippe-Auguste; plus tard, le style anglo-normand semble prévaloir, dans cette province, dans les détails sinon dans l'ensemble des constructions.
Cependant le profil de la base avait subi des modifications essentielles de 1220 à 1240. Le tore inférieur (fig. 34) A s'était aplati; la scotie C se creusait et arrivait parfois jusqu'à l'aplomb du nu de la colonne; le tore supérieur B, au lieu d'être tracé par un trait de compas, subissait une dépression qui allégeait son profil et lui donnait de la finesse. Le but de ces modifications est bien évident: les architectes voulaient donner plus d'importance au tore inférieur aux dépens des autres membres de la base, afin d'arrêter la colonne par une moulure large et se dérobant le moins possible aux yeux. Mais ce n'est que dans les provinces mères de l'architecture ogivale que ces détails sont soumis à des règles dictées par le bon sens et le goût; ailleurs, en Normandie, par exemple, où la dernière période romane jette un si vif et bel éclat, on voit que l'école ogivale est flottante, indécise; elle mêle ses profils romans au nouveau système d'architecture; elle trace ses moulures souvent au hasard, ou cherche des effets dans lesquels l'exagération a plus de part que le goût. Le profil de la base que nous donnons (fig. 35) en est un exemple: c'est un profil roman; la scotie est maladroitement remplie par un perlé qui amollit encore ce profil, déjà trop plat pour une pile de ce diamètre. Ce n'est pas ainsi que procédaient les maîtres, les architectes tels que Robert de Luzarches, Pierre de Corbie, Pierre de Montereau et tant d'autres sortis des écoles de l'Ile de France, de la Champagne, de la Picardie et de la Bourgogne; ils ne donnaient rien au hasard, et ils se rendaient compte, dans leurs compositions d'ensemble comme dans le tracé des moindres profils, en praticiens habiles qu'ils étaient, des effets qu'ils voulaient produire.
Qu'on ne s'étonne pas si, à propos des bases, nous entrons dans des considérations aussi étendues. Les bases, leur compositions leurs profils, ont, dans les édifices, une importance au moins égale à celle des chapiteaux; elles donnent l'échelle de l'architecture. Celles qui sont posées sur le sol étant près de l'oeil deviennent le point de comparaison, le module qui sert à établir des rapports entre les moulures, les faisceaux de colonnes, les nervures des voûtes. Trop fines ou trop accentuées, elles feront paraître les membres supérieurs d'un monument lourds ou maigres 95.
Aussi les bases sont-elles traitées par les grands maîtres des oeuvres du XIIIe siècle avec un soin, un amour tout particulier. Si elles sont posées très-près du sol et vues de haut en bas, leurs profils s'aplatiront, leurs moindres détails se prêteront à cette position (36 A). Si, au contraire, elles portent des colonnes supérieures telles que celles des fenêtres hautes, des triforiums, et si, par conséquent, on ne peut les voir que de bas en haut, leurs moulures, tores, scoties et listels prendront de la hauteur (36 B), de manière que, par l'effet de la perspective, les profils de ces bases inférieures et supérieures paraîtront les mêmes. Cette étude de l'effet des profils des bases est bien évidente dans la nef de la cathédrale d'Amiens, bâtie d'un seul jet de 1225 à 1235. Là, plus les bases se rapprochent de la voûte et plus leurs profils sont hauts, tout en conservant exactement les mêmes membres de moulures.
Depuis les premiers essais de l'architecture du XIIe siècle, dans les provinces de France, jusque vers 1225 environ, lorsque des piles se composent de faisceaux de colonnes inégales de diamètre, la réunion des bases donne des profils différents de hauteur en raison de la grosseur des diamètres des colonnes; du moins cela est fréquent; c'est-à-dire que la grosse colonne a sa base et la colonne fine la sienne, les profils étant semblables mais inégaux. Ce fait est bien remarquable à la cathédrale de Laon 96
65
On peut enlever le badigeon, suivant sa qualité, de plusieurs manières. Lorsqu'il est épais et qu'il se compose de plusieurs couches, que la pierre sur laquelle il a été posé n'est pas poreuse, on le fait tomber facilement par écailles au moyen de râcloirs de bois dur. S'il cache d'anciennes peintures, ce procédé est celui qui réussit le mieux, car, alors il laisse à nu et n'entraîne pas avec lui les peintures appliquées directement sur la pierre. Si, au contraire, la couche de badigeon est très-mince, la méthode humide est préférable. Dans ce cas, on humecte à l'eau chaude, au moyen d'éponges ou de brosses, les parties de badigeon que l'on veut enlever, et lorsque l'humidité commence à s'évaporer, on râcle avec les ébauchoirs de bois. Presque toujours alors le badigeon tombe comme une peau. Le lavage à grande eau est le moyen le plus économique, et réussit souvent; on peut l'employer avec succès, si le badigeon est mince et s'il ne recouvre pas d'anciennes peintures. En tous cas, il faut se garder d'employer des grattoirs de fer qui, entre les mains des ouvriers, enlèvent avec le badigeon la surface de la pierre, émoussent et déforment les profils et altèrent les sculptures, surtout si la pierre est tendre.
66
Nous devons ce curieux dessin à M. Ruprich Robert.
67
Cette balustrade est rétablie aujourd'hui sur toute la longueur de la façade, et remplace celle qui avait été refaite au XIVe siècle et qui tombait en ruine.
68
Cette balustrade n'appartient pas à la construction première de la nef, qui remonte à 1210 au plus tard; elle a été refaite vers 1230, lorsque après un incendie la partie supérieure de la nef fut complétement remaniée et rhabillée (voy. CATHÉDRALE).
69
Il n'existe plus que deux fragments de cette charmante balustrade sur les deux contreforts du portail, mais ces fragments indiquent clairement la disposition de l'ensemble. La richesse de cette balustrade est motivée par l'extrême délicatesse des parties d'architecture qu'elle accompagne et couronne.
70
Le choeur de la cathédrale de Troyes fut construit de 1240 à 1250, mais tous les couronnements extérieurs furent refaits au XIVe siècle.
71
Toutes les fois que nous aurons à parler des édifices du XIVe siècle, on ne s'étonnera pas si nous mettons en première ligne la cathédrale de Carcassonne, qui est un chef-d'oeuvre de cette époque, et qui comme style appartient à l'architecture du Nord.
72
Voir l'hôtel de Jacques Coeur à Bourges, sur les balustrades duquel on a sculpté des coeurs, des coquilles, et cette devise «A VAILLANS RIENS IMPOSSIBLE.»
73
Cete baluslrade est taillée dans des dalles de granit; elle est surmontée d'une dentelure présentant des couronnes et des fleurons alternés.
74
Voy. L'Église Saint-Eustache à Paris, par Victor Calliat. Paris, 1850.
75
Nous avons entendu souvent louer ou blâmer la disposition du grand bandeau de la cathédrale d'Amiens, par des personnes compétentes. Mais la vérité nous force d'ajouter que les louanges étaient données par des amateurs de l'architecture gothique, à son apogée, elle blâme par des enthousiastes du style roman. Comme dans l'un ou l'autre cas il y avait contradiction entre les goûts et les jugements de chacun, nous ne savons trop quel jugement porter nous-même. Nous dirons seulement que le parti adopté à Amiens est franc, qu'il dénote une intention bien arrêtée, que cet intérieur de nef nous paraît être le plus beau spécimen que nous possédions en France de l'architecture du XIIIe siècle, que nous nous rendons difficilement compte de l'effet que produirait cet intérieur dépourvu de cette riche ceinture de feuillages vigoureusement refouillés, s'il y gagnerait ou s'il y perdrait; et prenant la chose pour for-belle, exécutée par des artistes aussi bons connaisseurs que nous, et plus familiers avec les grands effets, nous ne pouvons qu'approuver cette hardiesse de l'architecte de la nef d'Amiens.
76
Roman du Renard, t. II, p. 327, vers 18495.
77
Le Roman de Garin.
78
Histoire du roy saint Loys, par J. sire de Joinvile. Édit. de Dufresne Du Cange, 1678. Paris, in-folio.
79
Nous donnons cette date, parce que tous les jours ces restes de revêtements de maisons disparaissent, et que la maison dont nous parlons peut avoir perdu son ornementation d'essente ou même être démolie aujourd'hui.
80
Le bardeau cloué sur les pans de bois les préserve parfaitement de l'humidité extérieure, et on ne saurait trop recommander son emploi pour les constructions isolées, exposées aux vents de pluie. Trempé avant la pose dans une dissolution d'alun, il devient incombustible.
81
Les barrières à contre-poids sont encore en usage dans le Tyrol autrichien. On défendait les faubourgs des villes avec de simples barrières, et souvent même les rues de ces faubourgs, en avant des portes. L'attaque devenait alors très-dangereuse, car on garnissait les logis à l'entour de combattants, et les assaillants se trouvaient arrêtés de face et pris de flanc et en revers. Froissart rend compte d'une attaque de ces sortes de barrières, et son récit est trop curieux pour que nous ne donnions pas ce passage tout au long. Le roi d'Angleterre est campé entre Saint-Quentin et Péronne (1339).
82
Les Chroniques de Froissart, liv. I, p. 78. Édit. Buclion.
83
Les Chroniques de Froissart, liv. I, IIe partie, p. 618.
84
En 1386, lors du projet d'expédition en Angleterre, «le connétable de France Olivier de Clisson fit ouvrer et charpenter l'enclosure d'une ville, tout de bon bois et gros, pour asseoir en Angleterre là où il leur plairoit, quand ils y auroient pris terre, pour les seigneurs loger et retraire de nuit, pour eschiver les périls des réveillemens (surprises)... On la pouvoit défaire par charnières ainsi que une couronne et rasseoir membre à membre. Grand foison de charpentiers et d'ouvriers l'avoient compassée et ouvrée...» Les Chroniques de Froissart, liv. III, p. 498.
85
C'est au-dessous du sol de l'église reconstruite au XIIe siècle que ces bases ont été découvertes à leur ancienne place; autour d'elles ont été trouvés de nombreux fragments de chapiteaux et tailloirs du travail le plus barbare, des débris de tuiles romaines. Il n'est pas douteux que ces restes dépendent de l'église bâtie à Poissy par les premiers rois mérovingiens. Le sol de ces bases est à 0m,60 en contre-bas du sol de l'église du XIIe siècle.
86
Cette base provient de l'église d'Ebreuil (Allier).
87
Ces deux derniers exemples appartiennent au XIIe siècle. C'est à M. Millet, architecte, que nous devons les dessins de ces deux bases.
88
Le choeur de la cathédrale de Langres ouvre un large champ à l'étude de la construction pendant le XIIe siècle; nous avons l'occasion d'y revenir aux mots CONSTRUCTION, VOUTE.
89
Cette loi, bien entendu, ne s'applique pas seulement aux bases, mais à tout l'ensemble comme aux détails des constructions du moyen âge, à partir du XIIe siècle (voy. CONSTRUCTION).
90
Ce choeur est malheureusement détruit, et les bases restent seules à leur place, ainsi que l'indique notre dessin.
91
Les profils de l'église de Montréal sont d'une pureté et d'une beauté très-remarquables, et leur exécution est parfaite. Dans ce monument, toutes les bases et profils à la portée de la main sont polis, tandis que les parements sont taillés au taillant simple d'une façon assez rustique. Ce contraste entre la taille des moulures et des parements est fréquent à la fin du XIIe siècle et au commencement du XIIIe; il prête un charme tout particulier aux détails de l'architecture (voy. TAILLE).
92
Combien ne voyons-nous pas dans nos édifices modernes de ces corniches de stylobates présenter leurs angles vifs à la hauteur de l'oeil? de ces arêtes de pilastres ou de bases que l'on maudit avec raison lorsque la foule vous précipite sur elles?
93
Ces bases de la cathédrale de Paris doivent avoir été taillées et mises en place entre les années 1175 et 1180.
94
Base de l'église de Notre-Dame de Semur, de Notre-Dame de Dijon, etc. Voyez aussi(37) la figure d'une base de la cathédrale de Laon, commencement du XIIIe siècle.
95
Combien d'édifices, dont l'effet intérieur était détruit par ces amas de chaises ou de bancs encombrant leurs bases, paraissent cent fois plus beaux une fois ces meubles enlevés.
96
Commencement du XIIIe siècle.