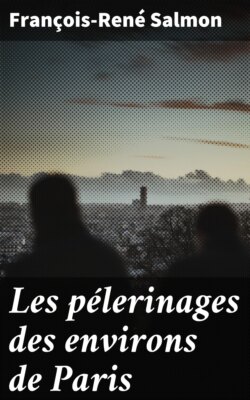Читать книгу Les pélerinages des environs de Paris - François-René Salmon - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
Saint-Denis, le tombeau et la basilique.
ОглавлениеTable des matières
Il est temps de revenir aux corps sacrés des martyrs pour voir comment, le Seigneur les a gardés et de quels honneurs il les a entourés. Nous les avons laissés ensevelis à six milles de Paris dans un champ appartenant à une païenne nommée Catulla qui ne tarda pas à se convertir. Quand la moisson qui avait dérobé aux recherches des persécuteurs la sépulture des saints eût été recueillie et que la paix eût été, pour quelques temps du moins, rendue à l’Eglise, Catulla fit élever un mausolée au lieu où ces restes précieux avaient été déposés .
Bien des contestations se sont élevées au sujet de l’emplacement de cette sépulture. En écartant les opinions qui n’ont aucune bonne raison en leur faveur, celle de Launoy qui place arbitrairement le tombeau de l’apôtre au lieu où s’élevait autrefois l’église de Saint-Denys-du-Pas, celle de Tillemont qui voit dans Chaillot, le Catulliacum ou Vicus Catulliacensis où les actes disent que les martyrs furent ensevelis, celle du P. Toussaint Duplessis qui cherchait cet endroit dans la rue qui porte à Paris le nom du saint évêque, nous sommes inévitablement conduits à la ville qui, depuis le septième siècle au moins s’appelle Saint-Denis, et qui se nommait auparavant Catulliacum du nom de cette femme qui y conserva, dans son domaine, les corps des saints martyrs. La distance de cette ville à la capitale est bien, à peu de chose près, celle qui est indiquée dans les Actes. Ce fut là, certainement, que sainte Geneviève assez voisine encore du temps de saint Denis se rendit fréquemment en pèlerinage, là qu’elle fit élever, pour honorer le tombeau du martyr, une petite église dont le roi Dagobert devait, plus tard, faire une superbe basilique. Toutefois, il serait difficile d’affirmer avec une entière certitude que la sépulture primitive de saint Denis ait été précisément à la place même où s’élève la basilique.
Qu’on se représente, pour se faire une idée de l’ancien Catolacum ou Catulliacum, une vaste plaine marécageuse séparée en deux par la voie romaine qui allait de Paris à Pontoise et qu’on trouve mentionnée, dans l’Itinéraire d’Antonin, sous le nom de Strata. A gauche, en venant de Lutèce, on rencontrait d’abord un petit village qui est devenu plus tard Saint-Denis de l’Estrée, de Stratâ ; plus loin, sur la droite, un autre village, ou plutôt une propriété, villa, appartenant à Catulla. Suivant certains auteurs, la sépulture primitive des martyrs aurait été sur le territoire de Saint-Denis de l’Estrée, où Catulla pouvait avoir un champ séparé de sa propriété par la voie romaine. Il est certain qu’il y eût là, jusqu’au dix-huitième siècle, une église de ce nom. Le témoignage de l’auteur anonyme des Gestes de Dagobert qui ne jouit pas d’une grande autorité a donné naissance à cette opinion. Selon lui, ce monarque fit élever sa basilique à quelque distance de l’église bâtie par sainte Geneviève et non pas sur son emplacement, il y fit prendre les corps des martyrs qui y reposaient et leur donna le nouveau temple pour asile comme un monument plus digne de leur gloire. Cependant, l’opinion la plus commune et la mieux appuyée croit que la basilique actuelle qui remplace au même lieu celle de Dagobert est située sur le terrain du champ de Catulla, à l’endroit où elle avait fait construire le mausolée qui servit de tombeau aux saints martyrs.
La piété des fidèle, ne tarda pas à se manifester par de fréquentes visites au monument, qui commencèrent bien avant les premières invasions des Francs et durèrent tout le temps de la domination romaine. Elles furent, dès ce moment, récompensées par de nombreux miracles. Le tombeau qu’avait élevé Catulla dura jusqu’aux jours du roi Clovis. A cette époque, il était en ruines, soit qu’il eût été ravagé dans les guerres de la conquête franque, soit que le temps déjà eût eu raison de sa construction peu solide apparemment.
Sainte Geneviève qui vivait alors avait une très-grande dévotion pour les saints de son pays, elle comptait qu’ils ne laisseraient pas leur œuvre inachevée, et que leur intercession obtiendrait du Seigneur l’entière conversion des Gaulois et des Francs. Nous l’avons déjà vue au tombeau de saint Martin de Tours , mais celui de saint Denis était bien plus à sa proximité et nous savons par l’auteur anonyme de sa vie qu’elle s’y rendait souvent en pèlerinage. Elle partait de Paris avec quelques pieuses compagnes bien avant l’aurore, surtout en hiver; elle portait alors un flambeau pour se diriger dans sa route. Les peintres et les sculpteurs du moyen-âge n’ont pas négligé ce détail, ils ont même volontiers mêlé la légende à l’histoire et nous ont montré la sainte tenant à la main le flambeau que le démon cherchait à éteindre. Dans une statue de la sacristie du lycée Bonaparte, le malin esprit s’est placé sur l’épaule de sainte Geneviève, mais de l’autre côté se tient l’ange protecteur de la lumière et de l’âme de la sainte.
Geneviève était affligée cependant de voir qu’il n’y eut pas une église sur le tombeau de l’apôtre de Paris. Elle voulait qu’on en fit une. Elle en parla à quelques prêtres de la ville qui lui objectèrent qu’il n’y avait pas de chaux dans le pays. Mais, le prêtre Génésius en ayant découvert comme par miracle, sur les indications de sainte Geneviève, on commença de suite les travaux et, grâce à de nombreux prodiges opérés à la prière de la sainte, l’œuvre fut terminée en 496.
Les années qui suivirent la mort de Clovis furent troublées par les guerres de ses fils et ne durent pas être favorables au sanctuaire qu’avait élevé sainte Geneviève. On y venait cependant de toutes les Gaules. Saint Marius, abbé de Bodane, y arriva vers cette époque avec le sénateur Agricola. Il y tomba malade, mais ce fut une épreuve passagère, car il eut un songe dans lequel saint Denis lui apparut et il se trouva subitement guéri.
Autant la bénédiction de Dieu se répandait visiblement sur ceux qui s’approchaient avec respect du sanctuaire des saints martyrs, autant sa vengeance était prompte contre ceux qui ne le respectaient pas. Grégoire de Tours raconte qu’un officier de l’armée de Sigebert alors en guerre avec-Chilpéric, tenté par une cupidité sacrilége, déroba un voile tissu de soie et d’or qui recouvrait le saint tombeau. Un instant après, son domestique se noya en traversant la Seine, et deux cents livres d’or qu’il avait dans sa barque furent englouties avec lui. L’officier effrayé courut remettre à sa place le voile qu’il avait pris; il n’en mourut pas moins dans l’année. — Un autre soldat voulut dérober une colombe d’or suspendue au-dessus du tombeau; ce devait être, selon toute apparence, le vase sacré qui contenait les saintes espèces, car telle était la forme qu’on lui donnait alors. A peine fut-il monté sur le tombeau, que les deux pieds lui glissèrent à la fois; il tomba sur sa pique, qui le traversa de part en part.
L’église de Saint-Denis était déjà le centre d’une communauté de religieux riche et florissante. Une noble dame, nommée Théodetrude, lui fit don de trois terres importantes, à condition que son nom serait inscrit sur le livre de vie de l’abbaye et qu’elle serait ensevelie dans l’église, honneur qui était réservé aux évêques et aux grands personnages.
En l’année 580, tandis que le roi Chilpéric était au palais de Brissacum, entre Paris et Soissons, un enfant de quatre mois qu’il avait eu de Frédégonde vint à mourir. Le roi fit porter son corps à Saint-Denis et demanda qu’il y fut enseveli. C’est à cette lointaine époque de notre histoire que les sépultures royales ont commencé à venir se placer sous la protection du premier évêque de Paris; ainsi fut ouverte cette marche funèbre où tant de princes et de monarques allaient suivre cet enfant royal dans les caveaux de Saint-Denis, pour y dormir du sommeil de la mort.
Clotaire II, en 589, fit don au monastère d’un domaine considérable. Mais ce fut surtout son fils, Dagobert, qui signala sa piété envers saint Denis par des largesses inouïes. Ses libéralités dépassèrent tout ce qu’on avait vu et laissèrent à jamais un souvenir reconnaissant dans les annales de l’abbaye. Dom Félibien, dans son histoire, ne trouve pas d’expressions pour exprimer la magnificence de Dagobert. Non-seulement il fit construire la maison abbatiale, la dota de très-beaux revenus, lui fit donner cent têtes de bétail, et lui en assura autant chaque année, mais il prodigua ses trésors pour l’érection de la superbe basilique qui dut remplacer l’église bâtie par sainte Geneviève.
Les circonstances auxquelles se rattache la fondation de la royale abbaye de Saint-Denis ont été religieusement consignées par l’auteur anonyme, mais contemporain, qui a écrit les Gesta Dagoberti. Elles sont intéressantes et curieuses au point de vue de la légende et des mœurs historiques, et méritent d’être racontées.
Le fils de Clotaire II et de la pieuse reine Bertrade n’était pas encore monté sur le trône qu’il devait illustrer par ses exploits. Il était jeune, dans toute l’ardeur de sa nature généreuse; c’était en l’année 615. Il y avait ce jour-là grande chasse à courre dans les forêts voisines de Paris. Un magnifique cerf était lancé ; la meute depuis plusieurs heures poursuivait le noble animal, qui avec une agilité étonnante se dérobait à leurs atteintes. On touchait au Vicus Catulliacus. Le cerf s’élance à travers la rue du village, trouve toute grand ouverte la porte de la chapelle que sainte Geneviève avait élevée sur le tombeau de saint Denis, s’y précipite, et dans cet asile, fait tête aux chiens, les tient à distance jusqu’au moment où Dagobert y arrive. Le jeune prince se persuada que les célestes patrons de l’oratoire avaient pris sous leur protection l’hôte innocent des bois, il fit respecter le droit d’asile en sa faveur, et le laissa aller sain et sauf.
Il allait venir bientôt lui-même chercher un abri contre la colère de son père dans l’inviolabilité de la sainte demeure. Un ministre de Clotaire II, Sadrégisèle, duc d’Aquitaine, ose insulter un jour le jeune Dagobert. Le Mérovingien, la rage dans le cœur, ne trouve aucun moyen de se venger sur l’heure, tant est grand le crédit du ministre. Il dissimule, paraît avoir tout oublié ; et un jour que Clotaire II est absent, il invite à sa table Sadrégisèle, qui eut l’imprudence d’accepter et qui reçut un châtiment pire que la mort. Qu’on se figure le ministre fouetté au sang par les serviteurs de Dagobert, puis tondu et rasé, ce qui était la pire de toutes les humiliations, et chassé honteusement du palais. L’imprudent jeune homme n’avait écouté que son ressentiment et s’était bien gardé de prendre avis de son gouverneur, saint Arnoul, évêque de Metz, pour cette folle équipée. Quand le roi vit en quel état on avait mis son malheureux favori, sa fureur n’eut plus de bornes. Il fit appeler sur l’heure le jeune prince, disposé à lui infliger un châtiment exemplaire. Mais Dagobert n’eut garde d’obéir, et s’enfuit à toute bride au Vicus Catulliacus, où il s’enferma dans la chapelle de saint Denis. Là, prosterné sur le pavé, il implora l’assistance du glorieux patron des Gaules. Sa prière fut entendue. Le sommeil ferma ses yeux, et trois personnages vêtus de blanc lui apparurent dans une auréole de lumière. L’un d’eux prit la parole et lui dit. «Jeune Franc, nous sommes les serviteurs du Christ, Denis, Rustique et Eleuthère. Tu sais que nous avons souffert le martyre pour son nom, et que nos corps reposent en ce lieu jusqu’ici trop négligé. Si tu t’engages à glorifier notre tombeau et notre mémoire, nous te délivrerons du péril et nous serons toujours tes intercesseurs auprès de Dieu.» Dagobert se réveilla et promit avec joie de s’employer tout entier à glorifier les saints tombeaux. Les messagers de Clotaire arrivèrent un instant après pour s’emparer du fugitif, mais une force invisible les arrêta sur le seuil du saint asile. Le roi y vint lui-même, éprouva la même résistance et demeura cloué au sol. Son cœur s’adoucit en présence d’un tel prodige, il pardonna au coupable, et put entrer dès ce moment dans la chapelle miraculeuse, où il vint s’agenouiller auprès de son fils sur la tombe des saints martyrs.
En reconnaissance d’un si grand bienfait, Dagobert crut devoir un temple magnifique à l’honneur de saint Denis et de ses compagnons, et rien ne fut épargné pour le rendre tel. S’il faut en croire les anciens écrivains, ce fut une vraie merveille. Aimon rapporte que l’église de Dagobert surpassait en magnificence toutes celles qui existaient dans les Gaules. C’étaient des colonnes de marbre qui en soutenaient les voûtes, des dalles de marbre qui-en formaient le pavé. Les murs à l’intérieur n’étaient point recouverts de peintures ou de mosaïques; un nouveau genre de décoration leur était appliqué ; c’étaient de magnifiques tentures de fines draperies tissues d’or et de soie qui les recouvraient entièrement .
Il est difficile de dire avec précision ce qu’on put faire en ces âges de décadence, même avec le plus grand désir d’élever un superbe monument. L’architecte ne reproduisait alors que les formes les plus défectueuses et les plus lourdes du style romain. Si les murs avaient été bien remarquables, il est probable qu’on n’eût pas été obligé de les couvrir de tapisseries. Le peu de durée qu’eut l’édifice ne nous donne pas l’idée d’une construction bien magnifique. Il est à croire, toutefois, que l’autel et le tombeau de saint Denis, dont les décorations avaient été confiées à saint Eloi, furent bien supérieurs au monument. Eloi était un habile orfèvre. La description que saint Ouen nous a laissée du travail de son ami marque une œuvre d’une sérieuse valeur. C’était, au rapport du saint évêque, un tombeau de marbre, construit dans la forme des autres tombeaux; il se terminait par un dôme soutenu sur des colonnes. La façade en était très-riche, l’or et les pierreries en rehaussaient l’éclat. L’autel placé en avant, aux pieds des saints martyrs, était revêtu d’une boiserie couverte de feuilles d’or d’où sortaient une multitude de pommes d’or entremêlées de perles; le haut de l’autel était recouvert d’argent. Il n’y avait rien de plus beau dans aucune église.
La basilique eut, au dire de la légende, l’insigne honneur d’être consacrée de la main de Notre-Seigneur, comme le furent plus tard celles d’Einsidlen et de Notre-Dame-de-Vaux en Poitou.
La psalmodie y fut réglée comme à Saint-Martin-de-Tours et comme à Saint-Maurice-du-Valais. On avait reçu des reliques de ces deux saints; une maison attenante au monastère fut construite pour les recevoir, et l’on bâtit en même temps un hôpital pour les pèlerins.
Toutes ces largesses avaient bien mérité à Dagobert l’honneur qu’il réclama d’être enseveli à Saint-Denis auprès du tombeau des saints martyrs, où Nanthilde, son épouse, vint le rejoindre quelques années après. Elles lui valurent quelque chose de mieux encore, au dire des chroniqueurs. Le salut du monarque, dont la vie n’avait pas toujours été exemplaire, eût été fort compromis, si saint Denis ne l’eût tiré d’affaire. Ces données légendaires se sont conservées fidèlement: elles sont reproduites dans le tombeau de Dagobert, monument très-curieux du treizième siècle qu’on voit encore aujourd’hui dans la basilique de Saint-Denis. On y voit l’âme du roi, sous la figure d’un enfant couronné, entraînée dans une barque par les démons qui la maltraitent; elle est arrachée, de leurs mains par les saints martyrs, qui l’enlèvent dans un linceul et l’emportent vers les cieux.
Au temps où Pépin le Bref écartait du trône les rois fainéants de la dynastie mérovingienne, la France reçut, en la personne d’Etienne II, la première visite pontificale. Le pape s’était fixé à l’abbaye de Saint-Denis. Il y tomba malade, et bientôt on désespéra de ses jours. Mais, comme il le raconte lui-même dans une de ses bulles, il se fit porter dans l’église. Il y eut un songe dans lequel il vit saint Denis lui apparaître avec les deux apôtres Pierre et Paul. «Le bienheureux Denis s’approcha de moi, dit-il, ayant en main une palme et un encensoir, et il me dit: «La
«paix soit avec toi, mon frère, ne crains rien; tu ne
«mourras pas avant d’être retourné à ton siège,
«lève-toi, car tu es guéri. Tu devras dédier cet autel
« à Dieu en l’honneur de ses apôtres Pierre et
«Paul que tu vois ici, et y célébrer ensuite des messes
« en actions de grâces.» Je me levai en effet entièrement guéri, et pus accomplir ce qui m’avait été prescrit.»
Dans la messe qu’il célébra, le pape donna l’onction royale à Pépin, à Berthe son épouse, et à ses deux fils Charles et Carloman. L’abbé de Saint-Denis était alors Fulrad, homme d’action et d’une grande influence, qui tient sa place dans l’histoire et qui avait joué un rôle considérable dans l’élévation de Pépin au trône. Avec l’aide du nouveau monarque, l’abbé entreprit de faire reconstruire la basilique: l’œuvre de Dagobert déjà touchait à sa ruine. On ne conserva qu’une faible partie des anciennes murailles, par respect pour la consécration divine qui leur avait été donnée, disait-on. Comme on tenait cette fois à faire un monument durable, on bâtit lentement, et le roi mourut bien avant que l’église fut achevée. Chef d’une nouvelle race qui avait chassé du trône les Mérovingiens, il n’en voulut pas moins reposer auprès d’eux à l’abri des murs du sanctuaire de Saint-Denis. Toutes les rivalités disparaissent devant la mort. Par un acte d’humilité chrétienne, le monarque demanda d’être enseveli au seuil de la porte, la face tournée contre terre. Ses vœux furent exaucés, et son corps demeura à cette place jusqu’au jour où saint Louis le fit porter dans le chœur, auprès des restes mortels des autres rois.
Quelques années plus tôt, le fameux Charles Martel, bien qu’il ne fut que maire du palais, avait eu les honneurs d’une sépulture royale à Saint-Denis. Sa victoire sur les Sarrasins l’en rendait bien digne. Elle eut dû pareillement recommander sa mémoire auprès de ses contemporains; mais, en certaines circonstances, le vainqueur avait méconnu les droits de l’Eglise, le peuple d’alors était trop religieux pour l’oublier aisément. On racontait que saint Eucher, ayant obtenu de visiter le séjour des damnés, y avait reconnu Charles Martel; on disait encore qu’on avait ouvert son tombeau quelques années après sa mort, et qu’on avait vu son âme en sortir sous la forme d’un grand dragon noir. La postérité a été plus indulgente envers l’illustre maire du palais: elle a placé son nom au premier rang parmi les héros chrétiens.
Charlemagne poursuivit et termina avec Fulrad l’œuvre commencée par son père. Sous l’action du grand monarque, l’architecture a, comme tous les arts, semblé prendre une vie nouvelle. Le monde a fait effort pour s’arracher aux derniers éléments de la barbarie. Des maîtres intelligents ont rapporté d’Italie les principes de l’architecture lombarde, ils en ont fait l’application à Saint-Denis avec un véritable succès.
La nouvelle basilique, étant achevée, fut consacrée en présence du roi, le 24 février 775. Il ne reste plus aujourd’hui de l’œuvre carlovingienne que quelques piliers qui se trouvent vers le milieu de la crypte.
Le culte de saint Denis était de plus en plus florissant; de nombreux pèlerinages témoignaient de la confiance et de la piété des populations chrétiennes, en même temps que les miracles se multipliaient au tombeau du saint martyr.
Un seigneur, nommé Gondebaud, avait été complice du meurtre de saint Lambert que le comte Dodon avait fait lâchement assassiner. La vengeance divine ne perdait pas de vue les meurtriers. Gondebaud était en proie au remords; il avait été frappé subitement d’un mal qui l’avait rendu boiteux. Déjà il était allé en pèlerinage à Rome pour l’expiation de son crime. Il vint à Saint-Denis, y fut miraculeusement guéri et y recouvra la paix. Touché de la grâce, il voulut se consacrer au Seigneur, il fut reçu dans le monastère et il en devint abbé.
Les reliques de saint Denis étaient, comme on doit bien le penser, l’objet de la plus haute vénération. Charlemagne ne voulut pas s’engager dans son expédition de l’année 796 contre les Saxons, sans en être accompagné. Ceux qui avaient le bonheur d’en obtenir quelques parcelles estimaient avoir reçu un trésor incomparable. Ce fut avec des transports de joie et un enthousiasme indescriptible qu’on accueillit à l’abbaye de Fleury celles que Boson, son abbé, y apporta. L’huile de la lampe qui brûlait devant le saint tombeau était miraculeuse. Une femme d’Angers, nommée Doctrude, était aveugle: elle en mit quelques gouttes à ses yeux et recouvra la vue.
Il faut se contenter d’effleurer ces faits trop nombreux pour qu’il soit possible de les citer. Charles le Chauve a succédé à Charlemagne. Hilduin, l’auteur des Aréopagitiques, est abbé de Saint-Denis. Les Normands ont envahi nos contrées; ils approchent de Paris. Hilduin se hâte d’emporter les saintes reliques à l’abbaye de Ferrières; il reconnaît bientôt qu’elles n’y sont pas en sûreté et le précieux trésor est dirigé vers une destination qui nous est inconnue. Hilduin meurt à Soissons en 842, il est enseveli dans l’église de Saint-Médard. Quatre ans après sa mort, les Normands se présentent de nouveau aux portes de Paris. Charles le Chauve, qui a fait fortifier l’église et l’abbaye de Saint-Denis, y vient chercher asile. Les barbares n’osèrent pas en approcher. Mais les religieux avaient eu peur que leur église ne fût incendiée comme celles de Paris; ils avaient pris leurs précautions pour sauver les reliques et les avaient portées à Nogent-sur-Seine. L’abbaye, d’ailleurs, n’était pas si bien défendue qu’elle fût imprenable. En 865, elle tomba au pouvoir des Normands, fut saccagée et dépouillée de tout ce que les religieux n’avaient pas mis hors de l’atteinte des barbares.
A la dernière apparition des Normands, en 887, ce fut à Reims qu’on alla chercher un refuge avec les châsses des saints martyrs. L’archevêque Foulques accueillit les fugitifs. Ils demeurèrent trois ans chez lui et fondèrent une abbaye qui prit le nom de leur patron. L’abbé de Saint-Denis, Robert, fut le parrain de Rollon, quand le chef des hommes du Nord consentit à recevoir le baptême à Rouen. Les Normands convertis réparèrent d’ailleurs leurs pillages d’autrefois par les libéralités qu’ils firent aux églises et par leur empressement à bâtir des monuments religieux.
La plupart des rois ou empereurs de la seconde race avaient été, comme leurs prédécesseurs de la-dynastie mérovingienne, ensevelis à Saint-Denis; Hugues Capet, qui fonda la troisième race, y reçut aussi la sépulture.
Quelque temps après, vers l’an 1050, il y eut, au sujet du corps de saint Denis, un curieux débat entre les Allemands et les Français. Les religieux du monastère de Saint-Emmerand, près de Ratisbonne, avaient, en creusant des fondations, trouvé un corps qu’ils prétendirent — on ne sait trop pourquoi — être celui de l’apôtre de Paris. Les moines de Saint-Emmerand affirmaient que les restes de saint Denis l’Aréopagite avaient été autrefois apportés chez eux, qu’ils les avaient gardés et soigneusement cachés. Comme à cette époque la question de l’Aréopagitisme avait pleinement triomphé en France, grâce au livre d’Hilduin, et que la question n’était plus même discutée, si les prétentions des moines étaient fondées, la France se trouvait par là même dépossédée de son patron . Le fait fut accepté dans toute l’Allemagne, spécialement par l’évêque de Ratisbonne et par l’empereur Henri II qui se rendit en cette ville pour y assister à la reconnaissance solennelle des reliques. Il paraît même que le pape Léon IX était sur le point d’y aller. Cependant les ambassadeurs du roi de France, qui avait été invité, représentèrent à l’empereur qu’il serait prudent d’envoyer tout d’abord à l’abbaye de Saint-Denis voir si les reliques du saint patron n’étaient pas dans leur tombeau. L’empereur se décida, sur l’avis du pape, à suivre ces conseils, et fit partir des envoyés chargés d’éclaircir cette affaire.
Il fut décidé qu’on procéderait à l’ouverture publique des châsses des saints martyrs. L’abbé Hugues convoqua pour le 7 juin les évêques et les grands du royaume, l’évêque de Ratisbonne et les religieux de Saint-Emmerand. La cérémonie eut lieu en présence d’un nombre prodigieux de princes, de prélats et d’abbés. Les trois châsses d’argent furent, à l’issue de l’office, apportées devant le frère du roi, les seigneurs et les évêques. L’intégrité des scellés ayant été constatée, on les brisa, et, dans les châsses ouvertes, les trois corps furent trouvés intacts. Celui de saint Denis enveloppé dans un tissu qui tombait en poussière — tant il était vieux — exhalait une suave odeur. Le roi avait donné un voile de pourpre dans lequel il fut enveloppé de nouveau: une procession solennelle avec les châsses eut lieu dans l’église. Le roi, après s’être confessé, y vint faire son pèlerinage et rendre grâces à Dieu. L’acte du procès-verbal déposé dans les châsses portait, entre autres signatures, celles de Guy, archevêque de Reims; de Robert, archevêque de Cantorbéry; d’Imbert, évêque de Paris; d’Elinand de Laon, de Beaudoin de Noyon, des abbés de Saint-Denis, de Marmoutiers, de Fécamp, etc. Pour le moment, les religieux de Saint-Emmerand durent abandonner la partie, mais ils devaient renouveler plus tard leurs prétentions en 1385.
Saint-Denis avait atteint l’apogée de sa grandeur; il allait s’y maintenir longtemps encore. Nulle part on n’eût su voir un plus brillant concours de prélats, de rois et de papes. Sous le seul règne de Louis VI, on n’y compta pas moins de six papes. Trois d’entre eux y célébrèrent les fêtes de Pâques. Pascal II ouvrit la marche pontificale, en 1106. Il était venu en France demander assistance contre l’empereur d’Allemagne. Les ambassadeurs du roi, parmi lesquels se trouvait le célèbre Suger, le reçurent au prieuré de la Charité-sur-Loire. Quelque temps après, le souverain Pontife était au tombeau de saint Denis, y répandait ses prières et ses larmes et demandait comme une faveur qu’on lui donnât quelques fragments des vêtements du saint martyr.
En l’année 1124, eut lieu à Saint-Denis la première levée d’oriflamme dont il soit fait mention dans l’histoire. L’empereur Henri V d’Allemagne avait déclaré la guerre à Louis le Gros. Le roi fit appel à ses milices et à ses communes et se trouva bientôt à la tête de deux cent mille hommes. Après avoir communié à Notre-Dame, Louis VI se rendit à Saint-Denis, suivi d’un nombreux cortége.
L’oriflamme qu’il venait y prendre était une très-ancienne bannière appendue dans le chœur au-dessus des châsses des trois martyrs. «C’était, d’après l’inventaire de dom Doublet, un étendard d’un sandal épais, fendu par le milieu en forme de gonfanon, fort caduque, enveloppé d’un bâton couvert de cuivre doré et un fer longuet aigü au bout.» On en a donné des descriptions quelque peu différentes, et cela se conçoit: l’étendard s’usait; il fallait remplacer tantôt la hampe, tantôt l’étoffe, qui d’ordinaire était de couleur écarlate, semée d’étoiles d’or, taillée en trois pointes avec des houppes vertes. L’oriflamme était comme le palladium de la France. On ne sait rien de son origine. Quelques écrivains, pour expliquer le respect qu’on avait pour la sainte bannière, ont dit qu’elle était venue du ciel..
Suger, qui, depuis deux ans, était abbé de Saint-Denis, la bénit en récitant une oraison qu’on trouve encore dans un antique manuscrit de l’abbaye; il la remit au roi qui, après la messe, la confia au plus vaillant chevalier de son armée, sans doute au comte du Vexin; c’était son privilège, et les rois de France, quand ils la portèrent eux-mêmes, le firent à ce titre; car le Vexin ne tarda pas à être annexé à la couronne. Celui qui reçut l’oriflamme fit le serment de la défendre au péril de sa vie et de la rapporter au lieu où il l’avait prise. Le roi sortit de la basilique au milieu des acclamations des hommes d’armes et du peuple: «Montjoye et Saint-Denys!» Ce fut désormais le cri national, le cri de guerre, d’allégresse et de victoire.
L’empereur d’Allemagne qui avait déjà envahi la France, n’attendit pas que l’armée du roi l’eût atteint, et se retira précipitamment. Louis VI revint à Saint-Denis où, depuis son départ, on avait prié jour et nuit en présence des saintes reliques exposées; il y rendit de solennelles actions de grâces et voulut reporter lui-même, sur ses épaules, dans leurs sanctuaires, les châsses des saints protecteurs de son royaume.
Suger, depuis qu’il était abbé, travaillait avec l’énergie de sa volonté et la prudence de ses vues à la réforme devenue nécessaire de son abbaye. Ayant réussi dans cette œuvre importante, il en voulut entreprendre une autre. La basilique de Pépin et de Charlemagne ne répondait plus ni au goût de l’époque ni aux magnificences des cérémonies pontificales qu’on avait à y célébrer souvent. Suger en avait jugé ainsi lorsque le pape Innocent II, en 1131, y présidait aux fêtes de Pâques. Il songea donc à la faire reconstruire entièrement. Il fit venir de toute l’Europe des ouvriers de toutes sortes, tailleurs de pierres, charpentiers, fondeurs de vîtres, orfèvres, etc. et l’on se mit à l’œuvre. On voulait aller vite et terminer promptement. En sept années, de 1137 à 1144, on avait agrandi tout l’édifice, construit le chevet avec ses neuf chapelles, élevé le transept et commencé les quatre tours angulaires de ses extrémités. Derrière l’autel, au chevet de l’église, un mausolée avait été construit pour recevoir les châsses des martyrs qui jusque-là étaient restées dans la crypte. L’autel de porphyre gris, avec une table d’or, toute couverte de pierreries, était d’une magnificence exceptionnelle. Une première consécration, en l’année 1140, avait été donnée au monument, en présence du roi, par Hugues, archevêque de Tours, et par Manassès, évêque de Meaux. Il en reçut une seconde plus solennelle en 1147. On y ouvrit les châsses d’argent, les saintes reliques furent portées en procession et déposées ensuite dans le nouveau mausolée. Suger parle beaucoup dans ses lettres de la magnificence de son œuvre, du choix des matériaux et des riches ornements qui la décorent. Il paraît toutefois qu’il sacrifia trop la solidité de l’édifice à l’éclat de l’ornementation. Les fondations étaient mauvaises. La façade surtout était une pauvre construction qui ne pouvait durer; mais les verrières étaient superbes, beaucoup de merveilleux travaux, des œuvres d’art, des ciselures en fer, en argent et en or, produisaient un coup d’œil extraordinaire. Pourtant la nouvelle basilique, à part le narthex et les bas côtés de l’abside, n’avait de vie que pour cent ans.
En attendant, les grandes cérémonies, les réceptions royales et pontificales, les levées d’oriflamme, les sépultures des rois, les processions avec les châsses, s’y faisaient beaucoup mieux. Il y avait assez d’espace pour qu’on pût y déployer toute la pompe religieuse. Dans les calamités publiques, les saintes reliques étaient portées en procession et la confiance des populations chrétiennes était souvent récompensée par des faits miraculeux. L’historien de Philippe- Auguste en rapporte plusieurs exemples. Le fils du roi étant tombé dangereusement malade, on apporta les reliques de saint Denis à Saint-Lazare, où l’évêque de Paris vint les recevoir. Pour la première fois, en cette circonstance, le saint-clou que Charles le Chauve avait donné à l’abbaye accompagna les châsses. On fit toucher au jeune prince les saintes reliques, et il se trouva guéri.
Il est encore fait mention de la résurrection d’un enfant qui eut lieu vers cette époque. Cet enfant, qui venait de mourir le jour de la fête de saint Denis, fut porté à l’église et mis sur l’autel. Il se leva un instant après, plein de vie, en présence de toute l’assistance. Le pèlerinage était, on le conçoit, dans toute sa splendeur. Dix lampes brûlaient nuit et jour devant les châsses, et l’affluence y était toujours très-considérable. L’abbaye, d’ailleurs, était devenue, depuis la réforme de Suger, un foyer de vie chrétienne et de charité évangélique. Les immenses richesses qu’elle possédait recevaient le plus noble emploi et soulageaient d’innombrables misères, en ces jours où les inondations, les guerres, les maladies et les famines faisaient tant de malheureux.
La Seine ayant débordé d’une façon terrible en l’année 1233, les châsses furent portées en procession et le fleuve aussitôt rentra dans son lit. Mais il y eut un accident qui plongea tout le monde dans une indicible stupeur: le saint-clou tomba par terre et fut dérobé par une femme qui le cacha dans l’intention de le garder. Ce fut une désolation générale, à laquelle succéda une joie universelle, quand, poussée par le remords, celle qui avait commis le vol, se décida à rendre la sainte relique. Il y eut des fêtes publiques auxquelles prirent part la reine Blanche et saint Louis, qui vint lui-même à Saint-Denis pour y rendre grâce à Dieu.
Cependant toutes les constructions de Suger avaient eu besoin déjà d’être reprises ou consolidées. L’abbé Eudes Clément s’était consacré tout entier à ce travail. L’art gothique était alors dans sa fleur la plus pure et l’œuvre fut conduite cette fois avec une rare perfection. L’abbaye avait atteint d’ailleurs le comble de la richesse. Les ressources ne manquaient pas. La construction fut continuée sous l’abbé Matthieu de Vendôme, qui éleva les travées de la nef voisines de la tribune, ajouta plusieurs chapelles, bâtit la haute tour du nord avec sa flèche et fit exécuter par Eudes de Montreuil un splendide jubé. Dans le même temps, saint Louis faisait rechercher les cendres des monarques et des princes ensevelis dans l’église. Plusieurs de ces royales dépouilles perdues dans les travaux et les remaniements du sol ne purent être retrouvées; on se contenta d’en marquer la place par des cénotaphes. C’est à partir de cette époque seulement que les statues tumulaires furent sculptées à la ressemblance des personnages dont elles couvraient les restes. L’ornementation de la basilique se poursuivit activement et demanda encore bien des années pour arriver à son entier achèvement.
Il serait trop long de mentionner ici les visites de saint Louis au sanctuaire et les libéralités dont il le combla. A l’occasion de la maladie qu’il fit à Pontoise, il y eut une procession des châsses où les religieux marchèrent nu-pieds. C’est à Saint-Denis que le monarque, avant de partir pour la Terre-Sainte, vint prendre l’écharpe et le bourdon du pèlerin. Il y reçut en même temps l’oriflamme des mains du cardinal Odon, légat apostolique. Six ans plus tard, à son retour en France, il vint y célébrer la fête du saint patron et ne manqua plus de le faire chaque année. Enfin, il y prit une dernière fois l’oriflamme,. avant sa dernière expédition en Orient; mais frappé déjà sans doute de la pensée qu’il ne reverrait plus la France, il fit son testament et le déposa entre les mains des prélats et de l’abbé de Saint-Denis.
Son fils, Philippe III, revint de cette croisade, rapportant, au milieu d’un deuil national sans exemple, le cercueil du saint roi avec ceux de quatre autres princes ou princesses. Les religieux allèrent au-devant du funèbre cortège et la basilique reçut ces morts illustres et donna asile à leurs cendres. En cette circonstance, un fait assez curieux se produisit, Les religieux de Saint-Denis, en vertu de leurs priviléges, refusèrent d’ouvrir leurs portes, parce que l’évêque de Paris se présentait vêtu des ornements pontificaux. Le roi dût attendre avec le prélat, qui dût, pour être admis, se dépouiller des insignes de sa dignité. Le corps de saint Louis fut inhumé près de Louis VIII et de Philippe-Auguste, derrière l’autel de la Trinité ; en attendant les honneurs de la canonisation qui allaient présenter bientôt ses restes mortels à la vénération des fidèles. La cérémonie de l’élévation eut lieu en 1298, à la grande joie du royaume. Un instant, il fut question de laisser le corps du saint roi à la Sainte-Chapelle; sa tête seule y fut conservée, le reste fut remis aux religieux de Saint-Denis.
Quelques années auparavant, le chef de saint Denis avait été extrait de sa châsse et mis dans un buste d’or par le cardinal Simon, légat apostolique, en présence du roi Philippe III. On avait donné beaucoup d’éclat à cette cérémonie, comme pour infliger un démenti public aux chanoines de Notre-Dame qui se vantaient, sans aucune raison sérieuse, de posséder les reliques du saint.
Une nouvelle levée d’oriflamme eut lieu en 1283: Philippe III y prit, avec l’étendard, le bâton du pèlerin. En 1315, Louis X leva aussi l’oriflamme pour marcher contre les Flamands. Puis, ce fut le tour de Philippe de Valois, en 1328; il gagna la bataille de Cassel et fit à Saint-Denis de grandes libéralités en témoignage de sa reconnaissance. Avec Charles V un règne glorieux s’ouvrit pour la France: Duguesclin qui toute sa vie avait guerroyé contre les Anglais et porté bien haut l’honneur de nos armés, fut enseveli à côté des rois dans les caveaux de Saint-Denis. Les débuts du règne de Charles VI furent assez heureux. Mais, après les fêtes du couronnement d’Isabeau de Bavière à la Sainte-Chapelle d’abord, à Saint-Denis ensuite, après plusieurs levées d’oriflamme et quelques succès accordés à nos armes, la démence du roi livra la France en proie aux factions et aux Anglais; elle plongea le royaume dans un abîme de maux, d’où l’on ne commença à sortir que par la protection signalée de Dieu qui suscita Jeanne d’Arc. L’héroïne avait déjà mené loin l’œuvre de la délivrance et infligé aux Anglais de sanglantes défaites, quand elle vint, à la suite d’une première attaque infructueuse contre Paris, trouver le roi Charles VII à Saint-Denis. Elle fit hommage de son armure au patron de la France et la déposa près des châsses des saints martyrs. Son épée s’y trouvait encore avant la Révolution.
A partir de ce moment, il n’est plus question de l’oriflamme. Elle a disparu tout à coup sans qu’on puisse savoir comment ni en quelle circonstance. Des historiens ont dit qu’elle avait été perdue à la bataille d’Azincourt; mais jamais les Anglais ne se sont vantés de l’avoir eue en leur possession, et quelque temps après ce désastre, on la mentionnait comme faisant toujours partie du trésor de la basilique. Toujours est-il que Charles VII ne fit jamais aucune levée d’oriflamme et que, pour la première fois, lors de son entrée à Paris, il porta la bannière blanche semée de fleurs de lis d’or.
Ce prince, après avoir reconquis son royaume presque tout entier, mourut en 1461, à Mehun-sur-Yèvre. Ses funérailles ont été minutieusement décrites et peuvent donner une idée de ce qu’étaient à Saint-Denis ces cérémonies funèbres. Le corps du roi ayant été embaumé fut enfermé en trois cercueils, de bois, de cyprès et de plomb. On avait fait préalablement une effigie qui reproduisait au naturel la figure du roi et qui fut mise sur un char étendue sur un lit de parade, la couronne en tête, avec tout l’appareil du costume royal. Une litière couverte de drap d’or reçut le triple cercueil et l’on se mit en marche vers Paris. Le cortége s’arrêta au prieuré de Notre-Dame des Champs, où l’on passa la nuit dans l’église au milieu des prières et des chants sacrés. Le lendemain, les chanoines, les prêtres, les religieux, l’Université, les compagnies de justice vinrent l’y chercher; et la procession présidée par Louis de Harcourt, patriarche de Jérusalem, se déploya le long des rues de la ville. On y comptait treize évêques ou abbés crosses. Le char qui portait la royale effigie était entouré de deux cents pauvres en habits de deuil avec des torches à la main. Venaient après vingt-quatre crieurs en habits de deuil, puis quatre hérauts d’armes qui précédaient la litière où reposait le corps du roi. Derrière marchaient tous les membres du Parlement en manteaux d’écarlate, puis les seigneurs et les princes du sang. Quand le convoi fut arrivé à Notre-Dame, l’effigie royale et le corps du monarque furent déposés au milieu du chœur dans une chapelle ardente. On chanta les vigiles; dans l’après-midi, la procession se remit en marche dans le même ordre. Les religieux de Saint-Denis qui venaient au devant d’elle, tous en chappes, la rencontrèrent au lieu dit la Croix penchée. L’église de Saint-Denis, comme celle de Notre-Dame, était entièrement tendue, par le haut, de toile bleue semée de fleurs de lis, par le bas, de velours noir; elle était éclairée par un luminaire qui formait autour de la nef un double rang de torches du poids de trois à quatre livres chacune. Le tour du chœur et le grand autel étaient garnis d’un nombre prodigieux de cierges.
Il était huit heures du soir quand le cortège entra dans l’église. On y chanta les vêpres. Les vigiles furent remises au lendemain; elles furent suivies de la messe, pendant laquelle, après l’offrande, le doyen de Notre-Dame, Thomas de Courcelles, docteur en théologie, fit l’oraison funèbre. La messe terminée, les princes du sang et les seigneurs se rendirent pour l’enterrement dans la chapelle royale où furent apportés le corps du roi et son effigie. A l’issue des cérémonies, le héraut cria à haute voix: «Priez Dieu pour l’âme du très-excellent, très-puissant et très-victorieux prince, le roy Charles VII de ce nom.» Puis il jeta sa masse d’armes dans la fosse, contre le cercueil; un moment après, il la retira en criant: «Vive le roy!» A l’instant, des cris et des acclamations lui répondirent: «Vive Louis, roy de France !»
Le nouveau monarque, dans sa dévotion dont les excès et les importunités durent fatiguer Dieu, la Vierge et les saints et dont ce n’est pas le lieu de justifier ici les excentricités, n’eut garde d’oublier saint Denis. Il eut recours à lui surtout dans la maladie dont il mourut. En même temps qu’il faisait apporter dans sa chambre toutes les reliques imaginables, qu’il appelait en toute hâte un grand saint, sur la présence duquel il comptait pour échapper à la mort et se mettre à l’abri de l’enfer dont il avait peut-être quelque raison d’avoir peur, il ordonnait qu’on fit une procession de Paris à Saint-Denis, pour faire cesser le mauvais vent de galerne qui l’incommodait fort. On ne saurait dire si le vent cessa ou non, toujours est-il que le roi mourut et qu’il alla rejoindre ses prédécesseurs à Saint-Denis!
Mais, comme le disait le vieux cri national: «Le roy est mort! Vive le roy!» et la joie ne tardait pas à faire place au deuil dans l’enceinte de la vieille basilique. Louis XII, après s’être fait sacrer à Reims, venait se faire couronner à Saint-Denis. C’était une coutume déjà établie non-seulement pour les reines, mais aussi pour les rois. Qu’on s’imagine quel mouvement, quel éclat et quelle vie apportaient à la basilique de pareilles solennités, où rivalisaient en magnificence princes, seigneurs et prélats. C’était surtout pour le trésor de l’église une source de richesses inouïes. Les insignes royaux, les couronnes d’or, les dons des souverains, les croix, les crosses, les. mitres, les vases sacrés, les reliquaires, ajoutaient incessamment de nouvelles merveilles aux merveilles du passé.
A peine François Ier eut-il reçu, comme son prédécesseur, la couronne royale dans la basilique qu’il fit préparer de nouvelles fêtes pour le couronnement de la reine, Claude de France. L’église, parée avec une magnificence inouïe, vit en cette circonstance le cardinal de Luxembourg, évêque du Mans, officier au milieu d’un nombre considérable d’archevêques et d’évêques. La reine, vêtue de soie et de pierreries, fit son entrée, conduite par les évêques de Toulouse et de Laon, accompagnée par les duchesses d’Alençon et de Vendôme, suivie d’un long cortége de grandes dames et de princesses. Un Te Deum solennel fit, au même moment, retentir les vieilles voûtes du temple. La reine, à genoux à l’entrée du chœur, reçut les onctions saintes de la main du cardinal qui lui remit ensuite avec les formules et les oraisons prescrites, la main de justice et l’anneau. Puis il commença la messe, assisté, comme diacre, de l’archevêque de Tours et de l’évêque de Beauvais, comme sous-diacre. A l’offrande, des dames présentèrent des pains dorés et argentés, du vin en un vase d’or et treize pièces d’or monnayé. La reine fit très-dévotement la sainte communion et la cérémonie se termina par la bénédiction que lui donna le cardinal.
Ainsi s’enchaînaient les unes aux autres, dans l’enceinte du vieux temple, les solennités tantôt tristes, tantôt joyeuses, avec une régularité qui en rendrait monotones les autres descriptions, bien que les funérailles de François 1er aient été d’une magnificence exceptionnelle. Ce prince avait pris cependant, à l’égard de l’abbaye, une mesure qui devait être fatale à la régularité des religieux. Il lui avait donné, dans la personne du cardinal de Bourbon, un abbé commendataire. Cet exemple ne fut que trop suivi. Ces prélats, grands seigneurs, qui ne résidaient pas et se contentaient de toucher les revenus de leurs gros bénéfices, négligeaient tous les soins du monastère. La discipline ne pouvait manquer d’en souffrir; le relâchement qui en résulta, ne fut que trop favorisé par la guerre civile et religieuse qui jeta le trouble dans les institutions et dans les vies, dans les personnes et dans les choses.
Le temps des épreuves avait commencé pour la basilique, pour l’abbaye et pour tout ce qui intéresse le culte de saint Denis. En 1563, les huguenots se rendirent maîtres de la ville et du monastère et dépouillèrent l’église de bon nombre d’objets précieux qui n’avaient pas été mis à l’abri de leurs atteintes. Le 10 novembre 1567, le connétable de Montmorency livra dans les plaines de Saint-Denis la bataille qui en a porté le nom et paya de sa vie la victoire qui resta à son armée. L’année suivante, Charles IX fit apporter à la Sainte-Chapelle les châsses des saints martyrs et celle de saint Louis et prescrivit une procession solennelle avec toutes les reliques pour obtenir que la paix fut rendue au royaume.
Bien du sang devait couler encore, bien des alternatives de succès et de revers, toujours désastreuses pour la France, allaient marquer ces tristes guerres, avant que la conversion d’Henri IV vint apporter la seule solution capable de sauver le pays. Ce fut l’église de Saint-Denis qui reçut l’abjuration du roi. Le 25 juillet 1593, le monarque s’y présenta dès le matin, suivi d’un immense concours de peuple. Les religieux allèrent le recevoir en aubes et sans chappes à la porte de la basilique; Henri de Navarre ne pouvant être encore qu’un pénitent aux yeux de l’Eglise. Seul, l’archevêque de Bourges, comme officiant, était en habits pontificaux, au milieu des évêques et des abbés rangés autour de lui. Quand le roi fut arrivé au seuil du parvis, l’archevêque lui demanda qui il était et ce qu’il voulait: «Je suis le roy,» répondit simplement Henri, qui demanda d’être reçu au giron de l’Eglise apostolique et romaine. Puis, se jetant à genoux, il fit sa profession de foi qu’il présenta signée de sa main à l’archevêque; après quoi, il entra dans la basilique où reposaient les cendres de ses aïeux.
L’ordre de saint Benoît tout entier avait été atteint dans sa discipline au milieu des guerres civiles qui désolaient la France. A diverses reprises, on avait essayé de remédier au mal; toutes les tentatives étaient restées impuissantes. L’abbaye de Saint-Denis avait ressenti comme les autres et plus encore peut-être l’influence pernicieuse des circonstances. Cependant, le prieur de l’abbaye de Sainte-Vanne, dom Didier de la Cour, vint à bout d’introduire dans son monastère une sérieuse réforme qui donna bientôt naissance à celle de la fameuse congrégation de Saint-Maur. Ce ne fut pas sans difficulté qu’on put la faire accepter à Saint-Denis; le cardinal de la Rochefoucauld y réussit enfin, grâce à l’appui que lui prêta Richelieu.
Louis XIV fut reçu fréquemment à Saint-Denis; il ne paraît pas, malgré cela, qu’il ait jamais eu beaucoup d’affection pour cette église. Il la dépouilla d’abord de son titre abbatial; puis, le 15 juin 1686, sur les instances de Mme de Maintenon qui venait de fonder Saint-Cyr et qui avait besoin d’argent pour ce nouvel établissement, il enleva à la basilique la. somme de 100,000 fr. dont elle était annuellement dotée, pour la donner à la maison de Saint-Cyr. Les Bénédictins en grand nombre quittèrent l’abbaye et se retirèrent au monastère de Saint-Maur.
Sous Louis XV, ce fut le monument qui eut à souffrir des inintelligentes modifications que lui imposa le mauvais goût de l’époque. L’autel des reliques fut refait à neuf et fut loin d’y gagner. On ne se fit aucun scrupule d’enfoncer plusieurs verrières pour donner plus de clarté à l’intérieur. Tout annonçait la décadence ou plutôt la catastrophe qui allait emporter avec la monarchie les grandeurs du passé. Déjà le corps de Louis XIV avait été conduit aux caveaux de Saint-Denis dans un appareil peu digne du grand roi. Ce fut bien pis pour son successeur qu’un simple carrosse de chasse y transporta. On avait déjà perdu le respect des rois. A voir la manière dont la fille aînée de Louis XV, Mme Henriette, fut conduite à sa dernière demeure, au milieu des rires et des folies des gens de la cour et de la populace, on eût dit qu’on s’essayait déjà à braver au convoi de cette jeune femme la sainteté de la mort et qu’on préludait aux horribles profanations de la Révolution.
«Dieu avait juré par lui-même de châtier la France.» Dans la nuit du 11 au 12 septembre de l’année 1793, les commissaires de la Convention arrivaient à Saint-Denis, se faisaient ouvrir les portes du trésor et organisaient, en présence de la municipalité, le pillage des dix armoires qui contenaient d’innombrables merveilles dues à la magnificence de cinquante-huit générations royales. Ce fut à pleines brassées qu’on enleva, pour les jeter dans les fourgons de la Convention, les crosses, les croix, les ostensoirs, les calices, les ciboires et les reliquaires d’or et d’argent. Les œuvres incomparables de l’art des vieux siècles, les châsses ciselées émaillées et incrustées de pierreries, les manuscrits sur vélin revêtus d’ivoire et d’or, les métaux damasquinés et constellés de perles, les couronnes et les sceptres d’or, les coupes de cristal de roche, d’agathe et de porphyre, les camées et les onyx, les ornements de velours et de brocart, les chappes gemmées brochées d’or et de soie, avec des rinceaux de perles fines, les tissus qu’avaient brodés des reines, les objets précieux par leur antiquité et par leurs souvenirs, les vêtements du sacre de Louis XIV, l’épée de Jeanne d’Arc, la main de justice de saint Louis, la couronne, le sceptre et l’épée de Charlemagne, la chaise romaine en bronze de Dagobert: tout fut entassé pêle-mêle sur les chariots; et la municipalité de Saint-Denis accompagna jusqu’à Paris les trésors qu’on enlevait à son église, non pour protester contre la spoliation, mais pour y applaudir et pour faire parade de civisme en jetant publiquement l’insulte aux reliques des saints.
Tous ces trésors artistiques et sacrés vinrent échouer à la Monnaie; quelques-uns seulement des plus curieux furent conservés et formèrent, plus tard, le Musée des souverains. Plusieurs des saintes reliques avaient été heureusement soustraites au pillage, grâce au dévouement d’un religieux, dom Varenflot, qui sut conserver, entre autres, une partie notable des corps des saints Denis, Rustique et Eleuthère.
La spoliation des richesses de la basilique n’avait été que le premier acte du drame de la profanation; un attentat inouï allait y mettre le comble. La Convention avait décrété que les monuments funèbres de Saint-Denis seraient détruits et que les cadavres royaux seraient exhumés. L’œuvre de destruction des tombeaux commença le 6 août 1794 et dura trois jours. Ainsi furent arrachés à leurs caveaux les corps des rois et des reines qui dormaient dans leur poussière séculaire, les uns réduits à des ossements desséchés, les autres tombés en putréfaction, exhalant une insupportable odeur, quelques-uns conservés et reconnaissables: Henri IV, Louis XIII, le premier avec sa barbe, l’autre avec ses moustaches, Louis XIV avec ses grands traits, mais le visage noir comme de l’encre. «Il était encore tout entier dans son cercueil, dit Chateaubriand. En vain, pour défendre son trône, il parut se lever avec la majesté de son siècle et une arrière-garde de huit siècles de rois; en vain son geste menaçant épouvanta les ennemis des morts, lorsque, précipité dans uno fosse commune, il tomba sur le sein de Marie de Médicis: tout fut détruit. Dieu, dans l’effusion de sa colère, avait juré par lui-même de châtier la France.»
Les lugubres travailleurs poursuivirent sans relâche, jusqu’au 26 octobre, leur sinistre besogne. La fosse commune où s’engloutissaient les royales dépouilles se trouvait au nord de l’église, dans un terrain connu sous le nom de cimetière de la Glacière. auquel était autrefois contiguë la splendide chapelle en rotonde des Valois, détruite en 1719. Plus tard, en 1817, ce sol, qui contenait les restes de trois dynasties souveraines, fut religieusement fouillé, et les cendres royales furent, avec de grands honneurs, rendues aux caveaux de Saint-Denis, sans qu’il fût possible toutefois d’établir entre elles aucune distinction.
La basilique avait été dépouillée, sous la Révolution, de sa couverture en plomb et des vantaux de bronze historiés de ses portes; elle était vouée à une ruine certaine. Elle servit d’abord aux fêtes décadaires de la ville qui avait pris le nom de Franciade; puis, on en fit successivement un dépôt d’artillerie, un théâtre et un magasin. Ses magnifiques vitraux du temps de Suger et de saint Louis furent presque tous détruits; c’est à peine s’il en reste quelques débris, ailleurs que dans la chapelle de la sainte Vierge et dans celle de saint Eugène. Cette antique et fameuse église que Dagobert avait proclamée la première métropole du royaume, que Charlemagne appelait «la vénérable mère et sainte église de monseigneur saint Denys, notre patron,» à l’exemple des. conciles qui lui donnaient ce titre: Sancta mater ecclesia, était ainsi livrée aux outrages des hommes et du temps, ouverte à la pluie et aux vents; l’herbe croissait sur ses autels et dans les jointures de toutes ses pierres. Elle était en cet état quand, en 1806, un décret impérial déclara qu’elle serait, non-seulement rendue au culte, mais qu’elle allait devenir le siège d’un chapitre et qu’elle recevrait les tombeaux de la dynastie napoléonnienne. Mais la volonté et les décrets d’un homme, fût-il au comble de la puissance, ne règlent pas le cours des choses à venir; et ce dernier vœu ne reçut jamais sa réalisation. Toutefois, le 25 mars 1809, le chapitre fut constitué et la basilique lui fut rendue. Les bâtiments de l’abbaye furent affectés à la nouvelle institution de la Légion d’honneur, créée par l’empereur en faveur des filles des officiers légionnaires.
Si difficile que pût être la restauration de la basilique totalement délabrée, l’administration impériale se crut de force à l’entreprendre et ne recula pas devant les frais. Mais les travaux furent exécutés avec une rare inintelligence. On crut avoir fait merveille quand on eut retaillé les sépultures, gratté les cryptes, exhaussé le sol, sapé les piliers, retouché tout l’édifice, sans aucun souci des traces anciennes ni des exigences de la solidité ; on donna même aux rosaces et aux baies d’affreux vitraux; il se trouva qu’on avait simplement recrépi une ruine et dépensé quelque chose comme sept millions en pure perte.
En 1833, la grande flèche, ayant été frappée de la foudre, en fut tellement ébranlée qu’on ne put songer à la conserver et qu’il fallut l’abattre une douzaine d’années après. La chute d’une partie de la façade était imminente et le reste de la construction eût eu le même sort dans un avenir prochain, lorsque, en 1847, on songea enfin à prévenir une ruine totale par une restauration sérieuse de l’édifice. M. Violet le Duc fut chargé de cette tâche. Si grande qu’elle fût, elle n’était point supérieure au savoir de l’habile architecte. L’argent seul manqua bien souvent, et l’œuvre ne put avancer que lentement. La construction cependant s’est trouvée bientôt consolidée; l’ensemble et les détails ont été repris avec cette parfaite entente des lois architecturales qui la fera reparaître bientôt dans la splendeur de son état primitif et dans la vérité de son caractère historique.
Les événements contemporains n’offrent plus rien dans la vieille métropole de Saint-Denis qui puisse intéresser le pèlerinage. Les funérailles de Louis XVIII, célébrées avec toute la pompe des anciens jours, et quelques autres solennités qui sont venues encore réjouir les murs de la basilique, ne s’y rapportent que d’une manière éloignée. Quand on la visite aujourd’hui, ce ne sont plus guère les souvenirs du premier évêque de Paris qu’on vient y chercher. Les visiteurs ne se proposent que rarement de prier à son tombeau. Ses reliques mêmes, sauvées de la destruction, n’y sont plus. Elles ont été déposées dans le trésor de Notre-Dame et portées depuis dans l’église paroissiale de Saint-Denis. En ces derniers temps, une châsse splendide leur a été donnée. On les y a exposées dernièrement; et, pendant toute l’octave de la fête du saint patron, on a vu les populations en foule y accourir et renouveler, par leur empressement et par l’ardeur de leur piété, le spectacle des anciens jours.
Les visiteurs toujours nombreux de la basilique sont surtout aujourd’hui des curieux qu’attire le musée des tombes royales, ou des amis de l’art religieux qui s’intéressent aux merveilles de nos monuments gothiques. Ces deux sentiments sont légitimes, mais secondaires, au point de vue qui nous occupe; c’est affaire aux guides de leur donner une entière satisfaction; il suffit ici d’y toucher en les effleurant.
Il y a là des curiosités bien remarquables: des pierres antiques, comme celle de Frédégonde, avec la mosaïque qui la représente, d’autres en grand nombre du temps de saint Louis, de splendides mausolées en marbre, des colonnes, des statues de l’époque et des meilleurs artistes de la Renaissance. Citons seulement, en passant, le monument de Louis XII et d’Anne de Bretagne qu’on voit étendus dans leur catafalque, ayant une tête de mort et figurés vivants et agenouillés sur la plate-forme du mausolée, avec de superbes bas-reliefs sur les faces, où sont reproduits les faits d’armes du monarque. Toute cette œuvre a été exécutée à Tours, vers 1591, sous la direction de Jean Juste. Voici encore le tombeau non moins remarquable d’Henri II et de Catherine de Médicis, par Germain Pilon; celui de François Ier et de Claude de France, avec les statues du roi, de la, reine et de leurs enfants, et des bas-reliefs des principales batailles de François Ier, une œuvre hors ligne commencée en 1552 sous la direction de Philibert Delorme. Les sculptures sont de Germain Pilon et d’autres artistes du plus grand mérite. Viennent ensuite la colonne de François II, érigée d’abord dans l’église des Célestins à Paris, celle de Henri III dressée en 1594 dans l’église de Saint-Cloud, celle du cardinal de Bourbon également de la fin du seizième siècle.
Ces monuments que le marteau des démolisseurs de 93 avait respectés, avaient été dispersés dans les musées; quand on songea à les rendre à leur ancien asile, on les réunit à la hâte avec des pièces de tout style et de toute provenance, choisies sans beaucoup de discernement, tronquées, mutilées, faites de morceaux divers. M. Violet le Duc s’est appliqué à restituer à chaque chose son caractère primitif et sa vraie place. Les tombeaux avaient été mis d’abord dans les caveaux, et s’y trouvaient, suivant l’expression du savant architecte, rangés comme des futailles dans une cave; aujourd’hui, l’église haute a reçu, par ses soins, le plus grand nombre de ces cénotaphes qu’on est heureux de voir ainsi remis en lumière.
Dans ses dispositions générales, la basilique ressemble aux édifices religieux de l’âge gothique. Le plan forme une croix latine, la nef étant coupée par le transept qui la sépare de l’abside couronnée de ses chapelles rayonnantes. L’orientation y est observée et l’inflexion de l’axe du chœur, symbole de l’inclinaison de la tête du Sauveur sur la croix, y est très-sensible. L’ensemble du monument peut se diviser en cinq parties. C’est d’abord le porche intérieur, lequel comprend les deux premières travées de la nef, puis la nef elle-même qui a six travées, le transept, le chœur et l’abside.
Extérieurement, quand on arrive en face de la basilique, on remarque les deux tours de la façade, celle du nord découronnée de sa flèche, celle du midi avec un clocher très-simple, entre les deux une muraille lisse et crénelée dans sa partie supérieure, ouverte en bas par trois larges baies en ogive, tapissées de bas-reliefs et de statues, lesquelles forment le grand portail occidental. C’est un caractère mixte, moitié militaire et moitié religieux. La partie la plus voisine du sol est l’entrée d’une cathédrale; en haut, c’est le simulacre d’une forteresse, dont rien ne défend l’accès d’ailleurs; il n’y a trace ni de fossés ni de ponts-levis. Dans le pignon aigu qui porte la statue de saint Denis à son sommet, entre les deux tours, s’ouvre la grande rose occidentale. Les trois baies du dehors sont dignes d’attention. On les aborde directement: elles sont à découvert, rien ne les dérobe au regard. Le porche de Saint-Denis, contrairement aux dispositions adoptées d’ordinaire, est non pas extérieur, mais intérieur; on avait voulu sans doute, dans les réceptions pontificales et royales, mettre les visiteurs à l’abri du froid et de la pluie.
Dans la baie centrale, les vantaux de la porte étaient autrefois séparés par un trumeau qui portait la statue colossale de saint Denis; les religieux, trouvant qu’il gênait pour le passage du dais dans les processions, l’avaient fait abattre. Les bas-reliefs des montants sont curieux: ils représentent d’un côté les Vierges sages, de l’autre les Vierges folles. Toute la partie supérieure est consacrée à la grande scène du jugement dernier. Au centre du tympan, se tient le Christ, juge suprême des vivants et des morts, les bras étendus, avec des banderolles à la main. On lit sur celle de droite: «Venite, benedicti Patris; mei» sur l’autre: «Ite, maledicti, in ignem æternum.» Les apôtres sont au-dessous du Sauveur. La très-sainte Vierge, placée à la droite de son Fils, intercède pour les pécheurs. Au linteau de la porte, est figurée la résurrection des morts. On les voit qui soulèvent la pierre de leurs tombeaux. Dans les cordons de l’archivolte, sont groupés d’une part les élus, de l’autre les réprouvés, que les démons s’arrachent et qu’en dépit de leur résistance et de leurs cris, ils entraînent dans l’enfer. Dans les cordons supérieurs, au milieu de la voussure, apparaît la maison de Dieu; le Saint-Esprit est au centre, on voit au-dessous le Père éternel portant l’Agneau divin, autour duquel se rangent les vingt-quatre vieillards et les anges adorateurs. La porte méridionale de cette façade est, comme celle-ci, du temps de Suger, sauf les restaurations modernes. Elle représente les scènes de la légende de saint Denis: l’apôtre, dans sa prison, recevant la communion de la main du Sauveur, le juge sur son tribunal, les bourreaux qui s’apprêtent; dans les cordons, le martyr décapité portant sa tête entre ses mains. La baie du nord s’appelait autrefois la porte de Dagobert, parce qu’on y voyait la statue de ce prince; elle a les caractères généraux de celle qui lui correspond au midi, mais les sculptures sont toutes modernes et des plus mauvaises.
Si l’on prend à gauche, on arrive devant le coté septentrional de la basilique; c’est la partie la plus brillante. Les élégants contreforts à double cintre, la galerie trilobée qui surmonte le triforium, les hautes fenêtres avec leurs frontons aigus, leurs baies largement ouvertes et leurs gracieux entrelacs, en un mot, toute celte végétation de pierre où se jouent, à travers les feuillages et les fleurs, les animaux les plus divers, compose tout un ensemble d’une richesse extrême et d’un travail exquis. De ce côté, le portail du transept s’ouvre entre les deux bases grandioses qui devaient porter les tours commencées pas Suger, il est dominé par un fronton, au sommet duquel s’élève la statue de saint Rustique. La rose qui s’y épanouit et dont les pétales sont dessinées par des meneaux gracieusement entrelacés, a trente-six pieds de diamètre. Il faut voir en détail toute l’ornementation de ce portail, ces tourelles si bien décorées, ces frises si richement brodées, et toute la statuaire symbolique qui anime cette façade avec les personnifications du péché, le tout taillé dans la pierre avec l’éclat et la verve qu’avait acquis la sculpture et dont elle possédait tous les secrets dès le quatorzième siècle.
La façade méridionale ne peut être vue que du côté des bâtiments de l’ancienne abbaye. Elle est loin de valoir celle du nord. Le portail à pignon, portant la statue de saint Eleuthère, a été en grande partie mutilé par la prétendue restauration de 1718.
Pour avoir un coup d’œil magnifique et une vue complète du monument à l’intérieur, il faut, autant que le permettent les échafaudages qu’ont nécessités les travaux en cours d’exécution, se placer sous la tribune de l’orgue. C’est de là qu’il faut voir l’étendue, la hardiesse et l’élévation des voûtes et l’élégance des énormes piliers qui les soutiennent; de là, qu’il faut saisir l’effet des verrières qui produisent, indépendamment de leur valeur assez médiocre, ces reflets irisés dont la lumière discrète et tamisée convient si bien aux combinaisons architectoniques du moyen âge; de là, qu’il faut embrasser ce quadruple emmarchement qui sépare l’abside du transept dans une disposition ascensionnelle, où la perspective se prolonge, où l’autel s’élève dans les airs avec la couronne lumineuse de ses chapelles rayonnantes.
Sans évoquer les richesses du passé, le crucifix et les statues en or de la sainte Vierge et des apôtres, les boiseries sculptées de Jehan de Malot, le jubé de Suger avec ses tables d’ivoire, «ajourées et ystoriées » de personnages, d’animaux et d’agencements en cuivre doré, il en reste assez encore pour éblouir le regard, quand on a franchi ces escaliers de marbre qui conduisent au deambulatorium, du choeur. Ce sont encore les splendeurs des anciens âges. Ces colonnes à droite sont du temps de Suger, celles de gauche ont été élevées par saint Louis. Et ces chapelles avec leurs vitraux, comme elles sont éclatantes! Et ces superbes autels, comme ils ont été bien conçus, relevés, décorés d’or et do peintures, avec leurs retables anciens et leurs statues dans le vrai goût de l’époque!
C’est la main de M. Violet le Duc qu’on trouve ici partout. C’est lui qui a fait disparaître d’affreux badigeons, qui a fouillé le terrain, retrouvé la base ancienne des colonnes, rétabli le niveau du sol tel qu’il était sous saint Louis; c’est lui qui a restauré toutes les chapelles, dessiné les autels avec leurs baldaquins, et mis partout, à la place de la confusion et du mauvais goût, la grâce, la richesse et l’harmonie.
La main des Prussiens a passé, elle aussi, sur ces merveilles. Elle a mutilé quelques-unes de ces statues de marbre qui dorment sur leurs tombeaux; elle a brisé çà et là des bas-reliefs antiques, arraché des fragments de ces beaux retables du temps de saint Louis. On ne sait où se fut arrêté ce vandalisme, si d’énergiques protestations n’avaient enfin obligé les chefs à rappeler au respect une soldatesque grossière. Le brutal obus qui dans le môme temps brisait toute une verrière, rebondissait à travers le temple sur une des colonnes et de là sur un mausolée, fut-il aussi barbare que les mutilateurs qui ont ainsi abusé de la force et de la victoire?