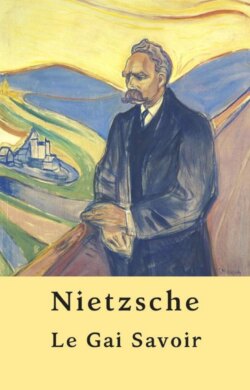Читать книгу Le Gai Savoir - FRIEDRICH NIETZSCHE, Friedrich Nietzsche - Страница 6
На сайте Литреса книга снята с продажи.
2.
Оглавление— Mais laissons là M. Nietzsche : que nous importe que M. Nietzsche ait recouvré la santé ?… Un psychologue connaît peu de questions aussi attrayantes que celles du rapport de la santé avec la philosophie, et pour le cas où il tomberait lui-même malade, il apporterait à sa maladie toute sa curiosité scientifique. Car, en admettant que l’on soit une personne, on a nécessairement aussi la philosophie de sa personne : mais il existe là une différence sensible. Chez l’une ce sont les défauts qui font les raisonnements philosophiques, chez l’autre les richesses et les forces. Le premier a besoin de sa philosophie, soit comme soutien, tranquillisation, médicament, soit comme moyen de salut et d’édification, soit encore pour arriver à l’oubli de soi ; chez le second la philosophie n’est qu’un bel objet de luxe, dans le meilleur cas la volupté d’une reconnaissance triomphante qui finit par éprouver le besoin de s’inscrire en majuscules cosmiques dans le ciel des idées. Mais dans l’autre cas, plus habituel, lorsque la détresse se met à philosopher, comme chez tous les penseurs malades — et peut-être les penseurs malades dominent-ils dans l’histoire de la philosophie : — qu’adviendra-t-il de la pensée elle-même lorsqu’elle sera mise sous la pression de la maladie ? C’est là la question qui regarde le psychologue : et dans ce cas l’expérience est possible. Tout comme le voyageur qui se propose de s’éveiller à une heure déterminée, et qui s’abandonne alors tranquillement au sommeil : nous autres philosophes, en admettant que nous tombions malades, nous nous résignons, pour un temps, corps et âme, à la maladie — nous fermons en quelque sorte les yeux devant nous-mêmes. Et comme le voyageur sait que quelque chose ne dort pas, que quelque chose compte les heures et ne manquera pas de le réveiller, de même, nous aussi, nous savons que le moment décisif nous trouvera éveillés, — qu’alors quelque chose sortira de son repaire et surprendra l’esprit en flagrant délit, je veux dire en train de faiblir, ou bien de rétrograder, de se résigner, ou de s’endurcir, ou bien encore de s’épaissir, ou quelles que soient les maladies de l’esprit qui, pendant les jours de santé, ont contre elles la fierté de l’esprit (car ce dicton demeure vrai : « l’esprit fier, le paon, le cheval sont les trois animaux les plus fiers de la terre » —). Après une pareille interrogation de soi, une pareille tentation, on apprend à jeter un regard plus subtil vers tout ce qui a été jusqu’à présent philosophie ; on devine mieux qu’auparavant quels sont les détours involontaires, les rues détournées, les reposoirs, les places ensoleillées de l’idée où les penseurs souffrants, précisément parce qu’ils souffrent, sont conduits et transportés ; on sait maintenant où le corps malade et ses besoins poussent et attirent l’esprit — vers le soleil, le silence, la douceur, la patience, le remède, le cordial, sous quelque forme que ce soit. Toute philosophie qui place la paix plus haut que la guerre, toute éthique avec une conception négative de l’idée de bonheur, toute métaphysique et physique qui connaît un final, un état définitif d’une espèce quelconque, toute aspiration, surtout esthétique ou religieuse, à un à-côté, un au-delà, un en-dehors, un au-dessus autorisent à s’informer si ce ne fut pas la maladie qui a inspiré le philosophe. L’inconscient déguisement des besoins physiologiques sous le manteau de l’objectif, de l’idéal, de l’idée pure va si loin que l’on pourrait s’en effrayer, — et je me suis assez souvent demandé si, d’une façon générale, la philosophie n’a pas été jusqu’à présent surtout une interprétation du corps, et un malentendu du corps. Derrière les plus hautes évaluations qui guidèrent jusqu’à présent l’histoire de la pensée se cachent des malentendus de conformation physique, soit d’individus, soit de castes, soit de races tout entières. On peut considérer toujours en première ligne toutes ces audacieuses folies de la métaphysique, surtout pour ce qui en est de la réponse à la question de la valeur de la vie, comme des symptômes de constitutions physiques déterminées ; et si de telles affirmations ou de telles négations de la vie n’ont, dans leur ensemble, pas la moindre importance au point de vue scientifique, elles n’en donnent pas moins à l’historien et au psychologue de précieux indices, étant des symptômes du corps, de sa réussite ou de sa non-réussite, de sa plénitude, de sa puissance, de sa souveraineté dans l’histoire, ou bien alors de ses arrêts, de ses fatigues, de ses appauvrissements, de son pressentiment de la fin, de sa volonté de la fin. J’attends toujours encore qu’un médecin philosophe, au sens exceptionnel du mot, — un de ceux qui poursuivent le problème de la santé générale du peuple, de l’époque, de la race, de l’humanité — ait une fois le courage de pousser à sa conséquence extrême ce que je ne fais que soupçonner et de hasarder cette idée : « Chez tous les philosophes, il ne s’est, jusqu’à présent, nullement agi de « vérité », mais d’autre chose, disons de santé, d’avenir, de croissance, de puissance, de vie… »