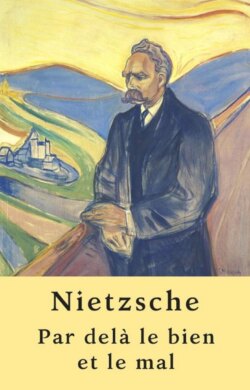Читать книгу Par delà le bien et le mal (Édition annotée) - FRIEDRICH NIETZSCHE, Friedrich Nietzsche - Страница 5
CHAPITRE DEUXIÈME
ОглавлениеL’ESPRIT LIBRE
24.
O sancta simplicitas ! Quelle singulière simplification, quel faux point de vue l’homme met dans sa vie ! On ne peut pas assez s’en étonner quand une fois on a ouvert les yeux sur cette merveille ! Comme nous avons tout rendu clair, et libre, et léger autour de nous ! Comme nous avons su donner à nos sens le libre accès de tout ce qui est superficiel, à notre esprit un élan divin vers les espiègleries et les paralogismes ! Comme, dès l’abord, nous avons su conserver notre ignorance pour jouir d’une liberté à peine compréhensible, pour jouir du manque de scrupule, de l’imprévoyance, de la bravoure et de la sérénité de la vie, pour jouir de la vie ! Et c’est seulement sur ces bases, dès lors solides et inébranlables de l’ignorance, que la science a pu s’édifier jusqu’à présent, la volonté de savoir sur la base d’une volonté bien plus puissante encore, la volonté de l’ignorance, de l’incertitude, du mensonge ! Le langage, ici comme ailleurs, ne peut pas aller au delà de sa lourdeur, et continue à parler de contrastes alors qu’il n’y a que des degrés et des subtilités de nuances ; de plus, la tartuferie de la morale, cette tartuferie incarnée qui maintenant s’est à jamais mêlée à notre chair et notre sang, nous retourne les mots dans la bouche, même à nous autres savants. Quoi qu’il en soit, nous nous rendons compte de temps en temps, non sans en rire, que c’est précisément la meilleure des sciences qui prétend nous retenir le mieux dans ce monde simplifié, artificiel de part en part, dans ce monde habilement imaginé et falsifié, que nolens volens cette science aime l’erreur, parce qu’elle aussi, la vivante, aime la vie !
25.
Après un début aussi gai, je voudrais qu’une parole sérieuse fût écoutée : elle s’adresse aux hommes les plus sérieux. Soyez prudents, philosophes et amis de la connaissance, et gardez-vous du martyre ! Gardez-vous de la souffrance « à cause de la vérité » ! Gardez-vous de la défense personnelle ! Votre conscience y perd toute son innocence et toute sa neutralité subtile, vous vous entêtez devant les objections et les étoffes rouges. Vous aboutissez à la stupidité du taureau. Quel abêtissement, lorsque, dans la lutte avec les dangers, la diffamation, la suspicion, l’expulsion et les conséquences, plus grossières encore, de l’inimitié, il vous faudra finir par jouer le rôle ingrat de défenseurs de la vérité sur la terre. Comme si la « vérité » était une personne si candide et si maladroite qu’elle eût besoin de défenseurs ! Et que ce soit justement de vous, messieurs les chevaliers à la triste figure, vous qui vous tenez dans les recoins, embusqués dans les toiles d’araignées de l’esprit ! En fin de compte, vous savez fort bien qu’il doit être indifférent si c’est vous qui gardez raison et, de même que jusqu’à présent aucun philosophe n’a eu le dernier mot, vous n’ignorez pas que chaque petit point d’interrogation que vous ajouteriez derrière vos mots préférés et vos doctrines favorites (et à l’occasion derrière vous-mêmes) pourrait renfermer une véracité plus digne de louanges que toutes vos attitudes solennelles et tous les avantages que vous présentez à vos accusateurs et à vos juges ! Mettez-vous plutôt à l’écart ! Fuyez dans la solitude ! Ayez votre masque et votre finesse, pour que l’on ne vous reconnaisse pas ! ou pour que, du moins, on vous craigne un peu ! Et n’oubliez pas le jardin, le jardin aux grilles dorées ! Ayez autour de vous des hommes qui soient semblables à un jardin, ou qui soient comme de la musique sur l’eau lorsque vient le soir, alors que le jour n’est déjà plus qu’un souvenir. Choisissez la bonne solitude, la solitude libre, légère et impétueuse, celle qui vous donne le droit à vous-même de rester bons, dans quelque sens que ce soit ! Combien toute longue guerre qui ne peut pas être menée ouvertement rend perfide, rusé et mauvais ! Combien toute longue crainte rend personnel, et aussi toute longue attention accordée à l’ennemi, à l’ennemi possible ! Tous ces parias de la société, longtemps pourchassés et durement persécutés — tous ces ermites par nécessité, qu’ils s’appellent Spinoza ou Giordano Bruno — finissent tous par devenir, ne fût-ce que dans une mascarade intellectuelle, et peut-être à leur insu, des empoisonneurs raffinés et avides de vengeance. (Qu’on aille donc une fois au fond de l’éthique et de la théologie de Spinoza !) Pour ne point parler du tout de la sottise dans l’indignation morale qui est, chez un philosophe, le signe infaillible que l’humour philosophique l’a quitté. Le martyre du philosophe, son « sacrifice pour la vérité », fait venir au jour ce qu’il tient de l’agitateur, du comédien, caché au fond de lui-même. Et, en admettant que l’on ne l’ait considéré jusqu’à présent qu’avec une curiosité artistique, pour plus d’un philosophe, on comprendra, il est vrai, le désir dangereux de le voir une fois, de le contempler une fois sous un aspect dégénéré (je veux dire dégénéré jusqu’au « martyr », jusqu’au braillard de la scène et de la tribune). En face d’un pareil désir, il faut cependant bien se rendre compte du spectacle qui nous est offert : c’est une satire seulement, une farce présentée en épilogue, la démonstration continuelle que la longue tragédie véritable est terminée ; en admettant que toute philosophie fût à son origine une longue tragédie. —
26.
Tout homme d’élite aspire instinctivement à sa tour d’ivoire, à sa réclusion mystérieuse, où il est délivré de la masse, du vulgaire, du grand nombre, où il peut oublier la règle « homme », étant lui-même une exception à cette règle. À moins du cas particulier où, obéissant à un instinct plus virulent encore, il va droit à cette règle, étant lui-même le Connaisseur, au sens grand et exceptionnel du mot. Celui qui, dans la société des hommes, n’a pas parcouru toutes les couleurs de la misère, passant tour à tour à l’aversion et au dégoût, à la compassion, à la tristesse et à l’isolement, celui-là n’est certainement pas un homme de goût supérieur. Mais, pour peu qu’il ne se charge pas volontairement de ce fardeau de déplaisir, qu’il essaie de lui échapper sans cesse et de rester caché, silencieux et fier, dans sa tour d’ivoire, une chose sera certaine : il n’est pas fait pour la connaissance, il n’y est pas prédestiné. Car si c’était le cas, il devrait se dire un jour : « Au diable mon bon goût ! La règle est plus intéressante que l’exception, plus intéressante que moi qui suis l’exception ! » Et, ce disant, il descendrait au milieu de la multitude. L’étude de l’homme moyen, l’étude prolongée et minutieuse avec le déguisement, la victoire sur soi-même, l’abnégation et les mauvaises fréquentations qui y sont nécessaires — toutes les fréquentations sont de mauvaises fréquentations, à moins que l’on s’en tienne à ses pairs — c’est là une partie nécessaire de la vie de tout philosophe, peut-être la partie la plus désagréable, la plus nauséabonde et la plus féconde en déceptions. Mais si le philosophe a de la chance, comme il convient à tout enfant chéri de la connaissance, il rencontrera des auxiliaires qui abrégeront et allégeront sa tâche, j’entends de ceux que l’on appelle les cyniques, de ceux qui reconnaissent simplement en eux la bête, la vulgarité, la « règle » et qui, de plus, possèdent encore assez d’esprit pour être poussés par une sorte d’aiguillon, à parler, devant témoins, d’eux-mêmes et de leurs semblables. Il leur arrive même de s’étaler dans des livres, comme dans leur propre fumier. Le cynisme est la seule forme sous laquelle les âmes basses frisent ce que l’on appelle la sincérité. Et l’homme supérieur doit ouvrir l’oreille devant toutes les nuances du cynisme, et s’estimer heureux chaque fois que viennent à ses oreilles les bouffonneries sans pudeur ou les écarts scientifiques du satyre. Il y a même des cas où l’enchantement se mêle au dégoût, par exemple quand, par un caprice de la nature, le génie se trouve départi à un de ces boucs, à un de ces singes indiscrets, comme ce fut le cas chez l’abbé Galiani, l’homme le plus profond, le plus pénétrant et peut-être aussi le plus malpropre de son siècle, — il était beaucoup plus profond que Voltaire et, par conséquent, beaucoup plus silencieux. Cependant, il arrive plus souvent, comme je l’ai indiqué, que le cerveau d’un savant appartienne à un corps de singe, qu’une intelligence subtile et exceptionnelle soit départie à une âme vulgaire. Le cas n’est pas rare chez les médecins et les moralistes physiologistes. Partout où il y a quelqu’un qui parle de l’homme, sans amertume mais avec une sorte de candeur, comme d’un ventre doué de deux sortes de besoins et d’une tête n’en ayant qu’un seul ; quelqu’un qui ne voit, ne cherche et ne veut voir que la faim, l’instinct sexuel et la vanité, comme si c’étaient là les ressorts essentiels et uniques des actions humaines ; bref, partout où l’on parle mal de l’homme — et cela sans vouloir être méchant— l’amateur de la connaissance doit écouter attentivement et avec soin ; ses oreilles doivent être partout où l’on parle sans indignation, car l’homme indigné, celui qui se lacère la chair de ses propres dents (ou, à défaut de lui-même, Dieu, l’univers, la société), celui-là peut être placé plus haut, au point de vue moral, que le satyre riant et content de lui-même ; sous tous les autres rapports il sera le cas plus ordinaire, plus quelconque et moins instructif. D’ailleurs, personne ne ment autant que l’homme indigné. —
27.
Il est difficile de se faire comprendre, surtout lorsque l’on pense et que l’on vit gangasrotogati, au milieu d’hommes qui pensent et vivent autrement, c’est-à-dire kurmagati, ou tout au plus mandeikagati, « d’après l’allure des grenouilles », — je fais tout ce que je peux pour être difficilement compris. Or, il faudrait être reconnaissant du fond du cœur rien qu’à cause de la bonne volonté que l’on met à interpréter avec quelque subtilité. Mais, pour ce qui en est des « bons amis » qui aiment toujours trop leurs aises et qui, précisément en tant qu’amis, croient avoir un droit à avoir leurs aises, on ferait bien de leur accorder dès le début tout un champ de course où ils pourraient étaler leur manque de compréhension. De cette façon, on aura du moins de quoi rire. On pourrait aussi les supprimer tout à fait, ces bons amis — et rire malgré cela.
28.
Ce qui se traduit le plus difficilement d’une langue dans l’autre, c’est l’allure du style, laquelle est basée sur le caractère de la race, pour m’exprimer plus physiologiquement sur l’allure moyenne de son processus d’« assimilation ». Il y a des traductions faites avec une entière bonne foi qui sont presque des faux, car elles vulgarisent involontairement l’original, seulement parce que l’allure vive et joyeuse de l’original était intraduisible, cette allure qui passe et aide à passer sur tout ce qu’il y a de dangereux dans le sujet et l’expression. L’Allemand est presque incapable du presto dans sa langue et aussi, ou s’en doute bien, de certaines nuances plaisantes et audacieuses propres à l’esprit libre et indépendant. De même que le bouffon et le satyre lui sont étrangers, en son âme et conscience, de même Aristophane et Pétrone sont intraduisibles pour lui. Toute la gravité, la lourdeur, la pompe solennelle, toutes les variétés du style ennuyeux sont développées chez les Allemands dans leurs variétés infinies. Qu’on me pardonne d’affirmer que la prose de Gœthe elle-même, avec son mélange de gravité et de préciosité, ne fait pas exception, étant l’image du « bon vieux temps », dont elle fait partie, et l’expression du goût allemand à une époque où il y avait encore un « goût allemand » : lequel était un goût rococo, in moribus et artibus. Lessing doit être excepté, grâce à sa nature de comédien qui comprenait bien des choses et s’y entendait, lui qui ne fut pas en vain le traducteur de Bayle et aimait à se réfugier dans le voisinage de Diderot et de Voltaire et, plus volontiers encore, dans celui des auteurs comiques latins. Car Lessing aimait aussi l’indépendance dans l’allure du style, la fuite hors d’Allemagne. Mais comment la langue allemande, fût-ce même dans la prose d’un Lessing, pourrait-elle imiter l’allure d’un Machiavel qui nous fait respirer dans son Principe l’air fin et sec de Florence, et qui ne peut s’empêcher de présenter les circonstances les plus graves avec un allegrissimo indiscipliné, peut-être non sans un malicieux plaisir d’artiste, à la pensée de la contradiction où il se hasarde ; car il y a là des pensées lointaines, lourdes, dures et dangereuses, présentées à une allure de galop, avec une bonne humeur pleine de pétulance. Qui, enfin, oserait s’atteler à une traduction allemande de Pétrone lequel, plus qu’aucun musicien jusqu’à présent, fut le maître du presto, par ses inventions, ses trouvailles, ses expressions ! Qu’importent, du reste, tous les marécages du monde méchant et malade, même du « monde antique », lorsque, comme lui, on possède les ailes du vent, le souffle et l’haleine du vent, son dédain libérateur qui assainit tout, qui fait tout courir ! Et, pour ce qui en est d’Aristophane, cet esprit qui transfigure et complète, en faveur duquel on pardonne au monde grec tout entier d’avoir existé — en supposant qu’on ait compris, jusqu’au fond, tout ce qui a besoin de pardon, de transfiguration, — je ne sais rien qui m’ait fait autant rêver au sujet de la mystérieuse nature de sphinx de Platon que ce petit fait, heureusement conservé : sous l’oreiller de son lit de mort, on n’a pas trouvé de « bible », rien qui fût égyptien, pythagoricien ou platonicien — mais un Aristophane ! Comment Platon aurait-il supporté la vie — une vie grecque à laquelle il avait dit non — sans un Aristophane ! —
29.
C’est affaire d’une toute petite minorité que d’être indépendant, et c’est le privilège des forts. Celui qui s’y essaye, même à bon droit, mais sans y être obligé, prouve par là qu’il est non seulement fort, mais encore audacieux jusqu’à la témérité. Il s’aventure dans un labyrinthe, il multiplie à l’infini les dangers que la vie apporte déjà par elle-même. Et le moindre de ces dangers n’est pas que personne ne voit de ses propres yeux comment il s’égare, où il s’égare, déchiré dans la solitude par quelque souterrain minotaure de la conscience. À supposer qu’un tel homme périsse, ce sera si loin de l’entendement des hommes que ceux-ci ne peuvent ni le sentir, ni le comprendre. Et il n’est pas dans son pouvoir de retourner en arrière ! il ne peut pas non plus revenir à la compassion des hommes !
30.
Nos vues les plus hautes doivent forcément paraître des folies, parfois même des crimes, quand, de façon illicite, elles parviennent aux oreilles de ceux qui n’y sont ni destinés, ni prédestinés. L’exotérisme et l’ésotérisme, — suivant la distinction philosophique en usage chez les Hindous, les Grecs, les Persans et les Musulmans, bref partout où l’on croyait à une hiérarchie et non pas à l’égalité et à des droits égaux — ces deux termes ne se distinguent pas tant parce que l’Exotérique, placé à l’extérieur, voit les choses du dehors, sans les voir, les apprécier, les mesurer et les juger du dedans, mais par le fait qu’il les voit de bas en haut, — tandis que l’Ésotérique les voit de haut en bas. Il y a des hauteurs de l’âme d’où la tragédie même cesse de paraître tragique ; et, toute la misère du monde ramenée à une sorte d’unité, qui donc oserait décider si son aspect forcera nécessairement à la pitié et, par là, à un redoublement de la misère ?… Ce qui sert de nourriture et de réconfort à une espèce d’hommes supérieure doit faire presque l’effet d’un poison sur une espèce très différente et de valeur inférieure. Les vertus de l’homme ordinaire, chez un philosophe, indiqueraient peut-être des vices et des faiblesses. Il serait possible qu’un homme d’espèce supérieure, en admettant qu’il dégénère et aille à sa perte, ne parvînt que par là à posséder les qualités qui obligeraient, dans le monde inférieur où il est descendu, à le vénérer dès lors comme un saint. Il y a des livres qui possèdent, pour l’âme et la santé, une valeur inverse, selon que l’âme inférieure, la force vitale inférieure ou l’âme supérieure et plus puissante s’en servent. Dans le premier cas, ce sont des livres dangereux, corrupteurs, dissolvants, dans le second cas, des appels de hérauts qui invitent les plus braves à revenir à leur propre bravoure. Les livres de tout le monde sont toujours des livres mal odorants : l’odeur des petites gens y demeure attachée. Partout où le peuple mange et boit, même là où il vénère, cela sent mauvais. Il ne faut pas aller à l’église lorsque l’on veut respirer l’air pur. —
31.
Durant les jeunes années on vénère ou on méprise encore, sans cet art de la nuance qui fait le meilleur bénéfice de la vie, et plus tard, il va de soi que l’on paye très cher d’avoir ainsi jugé choses et gens par un oui et un non. Tout est disposé de façon à ce que le goût le plus mauvais, le goût de l’absolu, soit cruellement bafoué et profané jusqu’à ce que l’homme apprenne à mettre un peu d’art dans ses sentiments et que, dans ses tentatives, il donne la préférence à l’artificiel, comme font tous les véritables artistes de la vie. Le penchant à la colère et l’instinct de vénération, qui sont le propre de la jeunesse, semblent n’avoir de repos qu’ils n’aient faussé hommes et choses pour pouvoir s’y exercer. La jeunesse, par elle-même, est déjà quelque chose qui trompe et qui fausse. Plus tard, lorsque la jeune âme, meurtrie par mille désillusions, se trouve enfin pleine de soupçons contre elle-même, encore ardente et sauvage, même dans ses soupçons et ses remords, comme elle se mettra en colère contre elle-même, comme elle se déchirera avec impatience, comme elle se vengera de son long aveuglement, que l’on pourrait croire volontaire, tant elle s’acharne contre lui ! Dans cette période de transition, on se punit soi-même, par la méfiance à l’égard de ses propres sentiments ; on martyrise son enthousiasme par le doute, la bonne conscience vous apparaît déjà comme un danger, au point que l’on pourrait croire que le moi en est irrité et qu’une sincérité plus subtile s’en fatigue. Encore, et avant toute autre chose, on prend parti, par principe, contre la « jeunesse ». — Dix ans plus tard on se rend compte que cela aussi n’a été que — jeunesse !
32.
Durant la plus longue période de l’histoire humaine — on l’appelle les temps préhistoriques — on jugeait de la valeur et de la non-valeur d’un acte d’après ses conséquences. L’acte, par lui-même, entrait tout aussi peu en considération que son origine. Il se passait à peu près ce qui se passe encore aujourd’hui en Chine, où l’honneur ou la honte des enfants remonte aux parents. De même, l’effet rétroactif du succès ou de l’insuccès poussait les hommes à penser bien ou mal d’une action. Appelons cette période la période prémorale de l’humanité. L’impératif « connais-toi toi-même » était alors encore inconnu. Mais, durant les derniers dix mille ans, on en est venu, peu à peu, sur une grande surface du globe, à ne plus considérer les conséquences d’un acte comme décisives au point de vue de la valeur de cet acte, mais seulement son origine. C’est, dans son ensemble, un événement considérable qui a amené un grand affinement du regard et de la mesure, effet inconscient du règne des valeurs aristocratiques et de la croyance à l’ « origine », signe d’une période que l’on peut appeler, au sens plus étroit, la période morale : ainsi s’effectue la première tentative pour arriver à la connaissance de soi-même. Au lieu des conséquences, l’origine. Quel renversement de la perspective ! Certes, renversement obtenu seulement après de longues luttes et des hésitations prolongées ! Il est vrai que, par là, une nouvelle superstition néfaste, une singulière étroitesse de l’interprétation, se mirent à dominer. Car on interpréta l’origine d’un acte, dans le sens le plus précis, comme dérivant d’une intention, on s’entendit pour croire que la valeur d’un acte réside dans la valeur de l’intention. L’intention serait toute l’origine, toute l’histoire d’une action. Sous l’empire de ce préjugé, on se mit à louer et à blâmer, à juger et aussi à philosopher, au point de vue moral, jusqu’à nos jours. — Ne serions-nous pas arrivés, aujourd’hui, à la nécessité de nous éclairer encore une fois au sujet du renversement et du déplacement général des valeurs, grâce à un nouveau retour sur soi-même, à un nouvel approfondissement de l’homme ? Ne serions-nous pas au seuil d’une période qu’il faudrait, avant tout, dénommer négativement période extra morale ? Aussi bien, nous autres immoralistes, soupçonnons-nous aujourd’hui que c’est précisément ce qu’il y a de non-intentionnel dans un acte qui lui prête une valeur décisive, et que tout ce qui y paraît prémédité, tout ce que l’on peut voir, savoir, tout ce qui vient à la « conscience », fait encore partie de sa surface, de sa « peau », qui, comme toute peau, cache bien plus de choses qu’elle n’en révèle. Bref, nous croyons que l’intention n’est qu’un signe et un symptôme qui a besoin d’interprétation, et ce signe possède des sens trop différents pour signifier quelque chose par lui-même. Nous croyons encore que la morale, telle qu’on l’a entendue jusqu’à présent, dans le sens de morale d’intention, a été un préjugé, une chose hâtive et provisoire peut-être, de la nature de l’astrologie et de l’alchimie, en tous les cas quelque chose qui doit être surmonté. Surmonter la morale, en un certain sens même la morale surmontée par elle-même : ce sera la longue et mystérieuse tâche, réservée aux consciences les plus délicates et les plus loyales, mais aussi aux plus méchantes qu’il y ait aujourd’hui, comme à de vivantes pierres de touche de l’âme. —
33.
Cela ne sert de rien, il faut impitoyablement demander raison à tous les sentiments d’abnégation et de sacrifice pour le prochain, citer en justice toute la morale d’abnégation. Il faut agir de même avec l’esthétique de la « vision désintéressée », sous les auspices de laquelle l’efféminement de l’art cherche aujourd’hui à se créer, d’insidieuse façon, une bonne conscience. Il y a beaucoup trop de séduction et de douceur dans ce sentiment qui veut s’affirmer « pour autrui » et non « pour moi », aussi est-il nécessaire de se méfier doublement et de se demander si ce ne sont pas là simplement des séductions. — Qu’elles plaisent à celui qui les possède et jouit de leurs fruits, et aussi au simple spectateur, — ce n’est pas un argument en leur faveur ; cela invite, tout au contraire, à la méfiance. Soyons donc méfiants.
34.
Quel que soit le point de vue philosophique où l’on se place aujourd’hui, partout le caractère erroné du monde dans lequel nous pensons vivre nous apparaît comme la chose la plus certaine et la plus solide que notre œil puisse saisir. Nous trouvons une raison après l’autre qui voudraient nous induire à des suppositions au sujet du principe trompeur, caché dans « l’essence des choses ». Mais quiconque rend responsable de la fausseté du monde notre mode de penser, c’est-à-dire « l’esprit » — échappatoire honorable pour tout avocat de Dieu, conscient ou inconscient — quiconque considère ce monde, ainsi que l’espace, le temps, la forme, le mouvement, comme faussement inférés, celui-là aurait du moins de bonnes raisons pour apprendre à se méfier, enfin, de la pensée même. La pensée ne nous aurait-elle pas joué jusqu’à présent le plus mauvais tour ? Et quelle garantie aurions-nous de croire qu’elle ne continuera pas à faire ce qu’elle a toujours fait ? Sérieusement, l’innocence des penseurs a quelque chose de touchant qui inspire le respect. Cette innocence permet aux penseurs de se dresser aujourd’hui encore, en face de la conscience, pour lui demander une réponse loyale, pour lui demander, par exemple, si elle est « réelle », pourquoi elle se débarrasse en somme si résolument du monde extérieur, et autres questions de même nature. La croyance en des « certitudes immédiates » est une naïveté morale qui nous fait honneur, à nous autres philosophes. Mais, une fois pour toutes, il nous est interdit d’être des hommes « exclusivement moraux » ! Abstraction faite de la morale, cette croyance est une absurdité qui nous fait peu d’honneur ! Dans la vie civile la méfiance toujours aux aguets peut être la preuve d’un « mauvais caractère » et passer dès lors pour peu habile, mais, lorsque nous sommes entre nous, au delà du monde bourgeois et de ses appréciations, qu’est-ce qui devrait nous empêcher d’être déraisonnables et de nous dire : le philosophe a acquis le droit au « mauvais caractère », étant l’être qui jusqu’à présent a été le plus dupé sur la terre ? Il a aujourd’hui le devoir de se méfier, de regarder toujours de travers, comme s’il voyait des abîmes de suspicion. — On me pardonnera ce tour d’esprit macabre, car j’ai appris moi-même, depuis longtemps, à penser autrement, à avoir une évaluation différente sur le fait de duper quelqu’un et d’être dupé, et je tiens en réserve quelques bonnes bourrades pour la colère aveugle des philosophes qui se défendent d’être dupés. Eh pourquoi pas ! Ce n’est qu’un préjugé moral de croire que la vérité vaut mieux que l’apparence. C’est même la supposition la plus mal fondée qui soit au monde. Qu’on veuille bien se l’avouer, la vie n’existerait pas du tout si elle n’avait pour base des appréciations et des illusions de perspective. Si, avec le vertueux enthousiasme et la balourdise de certains philosophes, on voulait supprimer totalement le « monde des apparences » — en admettant même que vous le puissiez — il y a une chose dont il ne resterait du moins plus rien : de votre « vérité ». Car y a-t-il quelque chose qui nous force à croire qu’il existe une contradiction essentielle entre le « vrai » et le « faux ? » Ne suffit-il pas d’admettre des degrés dans l’apparence, des ombres plus claires et plus obscures en quelque sorte, des tons d’ensemble dans la fiction, — des valeurs différentes, pour parler le langage des peintres ? Pourquoi le monde qui nous concerne ne serait-il pas une fiction ? Et si quelqu’un nous disait : « Mais, la fiction nécessite un auteur » — ne pourrions-nous pas répondre « Pourquoi ? ». Car « nécessiter » n’est-ce pas là aussi une partie de la fiction ? N’est-il donc pas permis d’être quelque peu ironique à l’égard du sujet, comme à l’égard de l’attribut et du complément ? Le philosophe n’aurait-il pas le droit de s’élever contre la foi en la grammaire ? Nous sommes pleins de respect pour les gouvernantes ; mais ne serait-il pas temps que la philosophie abjurât la foi aux gouvernantes ? —
35.
Ô Voltaire ! Ô humanité ! Ô bêtise ! La « vérité », la recherche de la vérité, ce sont là choses délicates ; et si l’homme s’y prend d’une façon humaine, trop humaine, — « il ne cherche le vrai que pour faire le bien », — je parie qu’il ne trouvera rien.
36.
En admettant que rien de réel ne soit « donné », si ce n’est notre monde des désirs et des passions, que nous n’atteignons d’autre « réalité » que celle de nos instincts — car penser n’est qu’un rapport de ces instincts entre eux, — n’est-il pas permis de se demander si ce qui est « donné » ne suffit pas pour rendre intelligible, par ce qui nous ressemble, l’univers nommé mécanique (ou « matériel ») ? Je ne veux pas dire par là qu’il faut entendre l’univers comme une illusion, une « apparence », une « représentation » (au sens de Berkeley ou de Schopenhauer), mais comme ayant une réalité de même ordre que celle de nos passions, comme une forme plus primitive du monde des passions, où tout ce qui, plus tard, dans le processus organique, sera séparé et différencié (et aussi, comme il va de soi, affaibli et efféminé —) est encore lié par une puissante unité, pareil à une façon de vie instinctive où l’ensemble des fonctions organiques, régulation automatique, assimilation, nutrition, sécrétion, circulation, — est systématiquement lié, tel une forme primaire de la vie. — En fin de compte, il est non seulement permis d’entreprendre cette tentative, la conscience de la méthode l’impose même. Ne pas admettre plusieurs sortes de causalité, tant que l’on n’aura pas poussé jusqu’à son extrême limite l’effort pour réussir avec une seule (— jusqu’à l’absurde, soit dit avec votre permission), c’est là une morale de la méthode à quoi l’on ne peut pas se soustraire aujourd’hui. C’est une conséquence « par définition », comme disent les mathématiciens. Il faut se demander enfin si nous reconnaissons la volonté comme agissante, si nous croyons à la causalité de la volonté. S’il en est ainsi — et au fond cette croyance est la croyance à la causalité même — nous devons essayer de considérer hypothétiquement la causalité de la volonté comme la seule. La « volonté » ne peut naturellement agir que sur la « volonté », et non sur la « matière » (sur les « nerfs » par exemple) ; bref, il faut risquer l’hypothèse que, partout où l’on reconnaît des « effets », c’est la volonté qui agit sur la volonté, et aussi que tout processus mécanique, en tant qu’il est animé d’une force agissante, n’est autre chose que la force de volonté, l’effet de la volonté. — En admettant enfin qu’il soit possible d’établir que notre vie instinctive tout entière n’est que le développement et la différenciation d’une seule forme fondamentale de la volonté — je veux dire, conformément à ma thèse, de la volonté de puissance, — en admettant qu’il soit possible de ramener toutes les fonctions organiques à cette volonté de puissance, d’y trouver aussi la solution du problème de la fécondation et de la nutrition — c’est un seul et même problème, — on aurait ainsi acquis le droit de désigner toute force agissante du nom de volonté de puissance. L’univers vu du dedans, l’univers défini et déterminé par son « caractère intelligible », ne serait pas autre chose que la « volonté de puissance ». —
37.
« Mais comment ? Cela ne veut-il pas dire au sens populaire : Dieu est réfuté, le diable ne l’est point ? » Tout au contraire, au contraire, mes amis ! Et, que diable, qui donc vous oblige à parler d’une façon populaire ?
38.
De même qu’il en est advenu encore, dans le plein jour des temps modernes, de la Révolution française, cette horrible farce, superflue, si on la juge de près, où cependant des spectateurs nobles et enthousiastes répandus dans toute l’Europe ont cru voir de loin la réalisation de leur long rêve passionné, rêve de révolte et d’enthousiasme, jusqu’à ce que le texte disparût sous l’interprétation : de même il se pourrait qu’une noble postérité interprétât mal encore une fois tout le passé et qu’elle rendît ainsi supportable l’aspect de celui-ci. — Ou plutôt, cela n’est-il pas arrivé déjà ? N’avons-nous pas été nous-mêmes cette « noble postérité » ? Et, en tant que nous le comprenons, ne sommes-nous pas au bout maintenant ?
39.
Personne n’admettra facilement la vérité d’une doctrine simplement parce que cette doctrine rend heureux ou vertueux, exception faite peut-être des aimables « idéalistes », qui s’exaltent pour le vrai, le beau et le bien et qui élèvent dans leurs marécages, où elles nagent dans un pêle-mêle bariolé, toutes sortes de choses désirables, lourdes et inoffensives. Le bonheur et la vertu ne sont pas des arguments. On oublie cependant volontiers, même du côté des esprits réfléchis, que rendre malheureux, rendre méchant, sont tout aussi peu des arguments contraires. Une chose pourrait être vraie bien qu’elle fût au plus haut degré nuisible et dangereuse. Périr par la connaissance absolue pourrait même faire partie du fondement de l’Être, de sorte qu’il faudrait mesurer la force d’un esprit selon la dose de « vérité » qu’il serait capable d’absorber impunément, plus exactement selon le degré auquel il faudrait délayer pour lui la vérité, la voiler, l’adoucir, l’épaissir, la fausser. Mais le doute n’est pas possible, dans la découverte de certaines parties de la vérité les méchants et les malheureux sont plus favorisés et ont plus de chance de réussir. Pour ne point parler ici des méchants qui sont heureux, une espèce que les moralistes passent sous silence. Peut-être la dureté et la ruse fournissent-elles des conditions plus favorables pour l’éclosion des esprits robustes et des philosophes indépendants que cette bonhomie pleine de douceur et de souplesse, cet art de l’insouciance que l’on apprécie à juste titre chez les savants. Avec cette réserve cependant qu’on ne borne pas la conception du « philosophe » au philosophe qui écrit des livres, ou qui fait des livres avec sa philosophie. — Stendhal ajoute un dernier trait à l’esquisse du philosophe de la pensée libre, un trait que, pour l’édification du goût allemand je ne veux pas omettre de souligner ici. « Pour être bon philosophe, dit ce dernier grand psychologue, il faut être sec, clair, sans illusion. Un banquier qui a fait fortune a une partie du caractère requis pour faire des découvertes en philosophie, c’est-à-dire pour voir clair dans ce qui est. »
40.
Tout ce qui est profond aime le masque. Les choses les plus profondes éprouvent même une certaine haine à l’égard des images et des symboles. Le contraste ne serait-il pas le meilleur déguisement que revêtirait la pudeur d’un dieu ? C’est là une question digne d’être posée. Il serait singulier que quelque mystique n’eût pas essayé sur lui quelque chose de semblable. Il y a des phénomènes d’espèce si délicate qu’on fait bien de les étouffer sous une grossièreté pour les rendre méconnaissables. Il est des actions inspirées par l’amour et une générosité sans borne qu’il faut faire oublier en rossant à coups de bâtons celui qui en a été témoin. C’est une façon de troubler sa mémoire. Quelques-uns s’entendent à troubler leur propre mémoire, à la martyriser pour exercer une vengeance du moins sur cet unique complice. La pudeur est inventive. Ce ne sont pas les pires choses dont on a le plus honte ! Un masque cache souvent autre chose que de la perfidie. Il y a tant de bonté dans la ruse ! J’imaginerais facilement un homme qui, ayant à cacher quelque chose de précieux et de délicat, roulerait à travers la vie, gros et rond, tel un fût de vin solidement cerclé. Sa subtile pudeur exige qu’il en soit ainsi. Pour un homme doué d’une pudeur profonde, les destinées et les crises délicates choisissent des voies où presque personne n’a jamais passé, des voies que doivent même ignorer ses plus intimes confidents. Il se cache d’eux lorsque sa vie est en danger et aussi lorsqu’il a reconquis sa sécurité. Un tel homme caché qui, par instinct, a besoin, de la parole pour se taire et pour taire, inépuisable dans les moyens de voiler sa pensée, demande que ce soit un masque qui emplisse, à sa place, le cœur et l’esprit de ses amis, et il s’entend à encourager ce mirage. En admettant pourtant qu’il veuille être sincère, il s’apercevra un jour que, malgré tout, ce n’est qu’un masque que l’on connaît de lui et qu’il est bon qu’il en soit ainsi. Tout esprit profond a besoin d’un masque. Je dirai plus encore : autour de tout esprit profond grandit et se développe sans cesse un masque, grâce à l’interprétation toujours fausse, c’est-à-dire plate, de chacune de ses paroles, de chacune de ses démarches, du moindre signe de vie qu’il donne.
41.
Il faut faire ses preuves devant soi-même, pour démontrer que l’on est né pour l’indépendance et le commandement, il faut les faire au bon moment. Il ne faut pas vouloir éviter ses épreuves d’essai, bien qu’elles soient peut-être le jeu le plus dangereux que l’on puisse jouer et qu’en somme il ne s’agit que d’essais dont nous sommes les seuls témoins et dont personne d’autre n’est juge. Ne s’attacher à aucune personne, fût-elle même la plus chère, — toute personne est une prison, et aussi un recoin. Ne pas rester lié à une patrie, fût-elle la plus souffrante et la plus faible, — il est moins difficile de détacher son cœur d’une patrie victorieuse. Ne pas rester lié à un sentiment de pitié, dût-il s’adresser à des hommes supérieurs, dont le hasard nous aurait laissé pénétrer le martyre et l’isolement. Ne pas rester lié à une science, nous apparût-elle sous l’aspect le plus séduisant, avec des trouvailles précieuses qui parussent réservées pour nous. Ne pas rester lié à son propre détachement, à cet éloignement voluptueux de l’oiseau qui fuit toujours plus haut dans les airs, emporté par son vol, pour voir toujours plus de choses au-dessous de lui, — c’est le danger de celui qui plane. Ne pas rester lié à nos propres vertus et être victime, dans notre ensemble, d’une de nos qualités particulières, par exemple de notre « hospitalité », comme c’est le danger chez les âmes nobles et abondantes qui se dépensent avec prodigalité et presque avec indifférence et poussent jusqu’au vice la vertu de la libéralité. Il faut savoir se conserver. C’est la meilleure preuve d’indépendance.
42.
Une nouvelle race de philosophes se lève. J’ose la baptiser d’un nom qui n’est pas sans danger. Tels que je les devine, tels qu’ils se laissent deviner — car il est dans leur nature de vouloir rester quelque peu énigmes, — ces philosophes de l’avenir voudraient avoir, justement et peut-être aussi injustement — un droit à être appelés des séducteurs. Lancer ce qualificatif ce n’est peut-être, en fin de compte, qu’une tentative et, si l’on veut, une tentation.
43.
Seront-ils de nouveaux amis de la « vérité », ces philosophes de l’avenir ? Sans doute, car tous les philosophes ont, jusqu’à présent, aimé leur vérité. Mais certainement ce ne seront pas des dogmatiques. Ce serait contraire à leur fierté et irait aussi contre leur goût si leur vérité devait être une vérité pour tout le monde, ce qui fut jusqu’à présent le secret désir et la pensée de derrière la tête de toutes les aspirations dogmatiques. « Mon jugement, c’est mon jugement à moi : un autre ne me semble pas y avoir droit — ainsi s’exprimera peut-être un de ces philosophes de l’avenir. Il faut se garder du mauvais goût d’avoir des idées communes avec beaucoup de gens. « Bien » n’est plus bien dès que le voisin l’a en bouche. Et comment, se pourrait-il qu’il y eût un « bien public » ! Le mot se contredit lui-même. Ce qui peut être public est toujours de peu de valeur. En fin de compte, il faut qu’il en soit comme il en a toujours été : les grandes choses sont réservées aux grands, les profondes aux profonds, les douceurs et les frissons aux âmes subtiles, bref, tout ce qui est rare aux êtres rares.
44.
Après tout cela, ai-je encore besoin de dire qu’eux aussi seront des esprits libres, de très libres esprits, ces philosophes de l’avenir, bien qu’il soit certain qu’ils ne seront pas seulement des esprits libres, mais quelque chose de plus, quelque chose de supérieur et de plus grand, quelque chose de foncièrement différent, qui ne veut être ni méconnu, ni confondu ? Mais, tout en disant cela, je sens envers eux, autant qu’envers nous-mêmes, qui sommes les hérauts et les précurseurs, nous autres esprits libres ! — je sens le devoir d’écarter de nous un vieil et stupide préjugé, une ancienne méprise, qui, depuis trop longtemps, ont obscurci comme d’un brouillard l’idée d’« esprit », lui enlevant sa limpidité. Dans tous les pays de l’Europe, et aussi en Amérique, il y a maintenant des gens qui abusent de ce mot. C’est une espèce d’esprits très étroits, d’esprits bornés et attachés de chaînes, qui aspirent à peu près au contraire de ce qui répond à nos intentions et à nos instincts, — sans compter que l’avènement de ces nouveaux philosophes les fait demeurer fenêtres fermées et portes verrouillées. Pour le dire sans ambages, ils font malheureusement partie des niveleurs, ces esprits faussement dénommés « libres » — car ce sont les esclaves diserts, les plumitifs du goût démocratique et des « idées modernes » propres à ce goût. Tous hommes sans solitude, sans une solitude qui leur soit propre ; ce sont de braves garçons à qui l’on ne peut dénier ni courage ni mœurs honorables, si ce n’est qu’ils sont sans liberté et ridiculement superficiels, surtout avec cette tendance qui leur fait voir, à peu près, dans les formes de la vieille société, la cause de toutes les misères humaines et de tous les déboires : par quoi la vérité finit par être placée sur la tête ! Ce à quoi ils tendent de toutes leurs forces, c’est le bonheur général des troupeaux sur le pâturage, avec la sécurité, le bien-être et l’allègement de l’existence pour tout le monde. Les deux rengaines qu’ils chantent le plus souvent sont « égalité des droits » et « pitié pour tout ce qui souffre », et ils considèrent la souffrance elle-même comme quelque chose qu’il faut supprimer. Nous, qui voyons les choses sous une autre face, nous qui avons ouvert notre esprit à la question de savoir où et comment la plante « homme » s’est développée le plus vigoureusement jusqu’ici, nous croyons qu’il a fallu pour cela des conditions toutes contraires que, chez l’homme, le danger de la situation a dû grandir jusqu’à l’énormité, le génie d’invention et de dissimulation (l’« esprit »), sous une pression et une contrainte prolongée, se développer en hardiesse et en subtilité, la volonté de vivre se surhausser jusqu’à l’absolue volonté de puissance. Nous pensons que la dureté, la violence, l’esclavage, le péril dans l’âme et dans la rue, que la dissimulation, le stoïcisme, les artifices et les diableries de toutes sortes, que tout ce qui est mauvais, terrible, tyrannique, tout ce qui chez l’homme tient de la bête de proie et du serpent sert tout aussi bien à l’élévation du type homme que son contraire. Et, en ne disant que cela, nous n’en disons pas assez, car, tant par nos paroles que par nos silences en cet endroit, nous nous trouvons à l’autre bout de toute idéologie moderne, de tous désirs du troupeau. Serions-nous peut-être les antipodes de ceux-ci ? Quoi d’étonnant si nous autres « esprits libres » ne sommes pas précisément les esprits les plus communicatifs ? si nous ne souhaitons pas de révéler, à tous égards, de quoi un esprit peut se libérer, et où il sera peut-être poussé ensuite. Pour ce qui en est de la dangereuse formule « par delà le bien et le mal », elle nous préserve au moins d’un quiproquo, car nous sommes tout autre chose que des « libres-penseurs », des « liberi pensatori », des « freie Geister » et quels que soient les noms qu’aiment à se donner ces braves sectateurs de l’« idée moderne ». Familiers dans beaucoup de provinces de l’esprit, dont nous avons, pour le moins, été les hôtes ; nous échappant toujours des réduits obscurs et agréables où les préférences et les préjugés, la jeunesse, notre origine, le hasard des hommes et des livres, ou même les lassitudes des pèlerinages, paraissaient nous retenir, pleins de malice en face des séductions de la dépendance qui se cachent dans les honneurs, dans l’argent, les fonctions publiques ou l’exaltation des sens ; reconnaissants même à l’égard du malheur et des vicissitudes de la maladie, puisque toujours ils nous débarrassaient d’une règle et du « préjugé » de cette règle ; reconnaissants envers Dieu, le diable, la brebis et le ver qui se cachent en nous ; curieux jusqu’au vice, chercheurs jusqu’à la cruauté, avec des doigts audacieux pour l’insaisissable, avec des dents et un estomac pour ce qu’il y a de plus indigeste, prêts à n’importe quel métier qui demande de la sagacité et des sens aigus ; prêts à n’importe quelle aventure grâce à un excès de libre jugement ; possédant des âmes antérieures et postérieures dont personne ne pénètre les dernières intentions, des premiers plans et des arrière-plans que nul n’oserait parcourir. Cachés sous le manteau de la lumière, nous sommes des conquérants, bien que nous paraissions semblables à des héritiers et à des dissipateurs ; classeurs et collectionneurs du matin au soir, avares de nos richesses et de nos casiers débordants, économes à apprendre et à oublier, inventifs dans les systèmes, quelquefois orgueilleux des tables de catégories, parfois pédants, parfois nocturnes hiboux du travail, même en plein jour ; parfois épouvantails aussi, quand il le faut — et aujourd’hui il le faut ; je veux dire en tant que nous sommes les amis de la solitude, amis innés, jurés et jaloux, de notre propre solitude profonde de midi et de minuit. Voilà l’espèce d’hommes que nous sommes, nous autres esprits libres ! Et peut-être en êtes-vous aussi, vous qui viendrez dans l’avenir, vous les nouveaux philosophes ? —