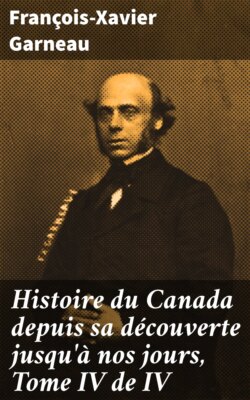Читать книгу Histoire du Canada depuis sa découverte jusqu'à nos jours, Tome IV de IV - Garneau François-Xavier - Страница 5
CONSTITUTION DE 91. 1792-1800.
ОглавлениеEtablissement d'un gouvernement représentatif.--Réunion de la législature. --Le parti anglais veut abolir l'usage de la langue française; vives discussions il ce sujet.--Les Canadiens l'emportent.--La discussion est renouvelée lors de la considération des règles pour la régie intérieure de la chambre.--Violens débats; discours de M. Bédard et autres.--Les anglificateurs sont encore défaits.--Travaux de la session; projets de loi pour les pauvres, les chemins et les écoles.--Biens des Jésuites.--Subsides.--Justice.--Prorogation des chambres; discours de sir Alured Clarck--Lord Dorchester.--Il convoque les chambres.--Organisation de la milice.--Comptes publics.--Judicature.--Suspension de la loi de l'habeas corpus.--Association générale pour le soutien du gouvernement.-- Troisième session.--Revenus et dépenses.--Fixation des charges; rentes seigneuriales.--Voies publiques.--Monnaies.--Lord Dorchester remplacé par le général Prescott.--Session de 97.--Défection de MM. De Bonne et de Lotbinière.--Traité de commerce avec les Etats-Unis.--Emissaires français.--Les pouvoirs de l'exécutif sont rendus presque absolus; ses terreurs.--Exécution de M. Law.--Sessions de 98 et 99.--Amélioration du régime des prisons.--Impôts, revenus publics.--Querelles entre le gouverneur et son conseil au sujet de la régie des terres.--Il est rappelé avec le juge Osgoode.--Sir Robert Shore Milnes convoque les chambres en 1800.--Nouvelle allusion aux principes de la révolution française; motif de cette politique.--Proposition d'exclure le nommé Bouc de l'assemblée.--Le gouvernement s'empare des biens des Jésuites.
L'introduction du gouvernement représentatif forme l'une des époques les plus remarquables de notre histoire. La constitution de 91, telle qu'elle allait être mise en pratique, était loin d'être équitable, parfaite; mais la portion de liberté qu'elle introduisait suffisait pour donner l'essor à l'expression fidèle et énergique des besoins et des sentimens populaires. L'opinion longtemps comprimée se sentit soulagée en voyant enfin une voie toute restreinte qu'elle fut ouverte devant elle pour se faire connaître et se faire apprécier au-delà des mers.
Cette constitution cependant promettait beaucoup plus qu'elle ne devait tenir. L'un de ses vices essentiels, c'était de laisser deux des trois branches de la législature à la disposition du bureau colonial, qui allait par ce moyen se trouver armé de deux instrumens qu'il ferait mouvoir à sa volonté tout en paraissant n'en faire mouvoir qu'un seul. Ce défaut capital qui n'était encore aperçu que du petit nombre d'hommes expérimentés dans les affaires publiques, leur fit présager la chute du nouveau système dans un avenir plus ou moins éloigné. La masse du peuple toujours plus lente à soupçonner les motifs, les arrière-pensées, les injustices, crut d'après les paroles de Pitt, que le Bas-Canada serait à eux, que la législation, en tant qu'elle ne serait pas incompatible avec l'intérêt et la suprématie de l'Angleterre, serait fondée sur ses sentimens et sur ses intérêts, qu'elle serait en un mot l'expression de la majorité des habitans. Vaine illusion! Outre l'intérêt canadien, outre l'intérêt métropolitain, il y avait déjà ce que lord Stanley a depuis qualifié «l'intérêt britannique» ou l'intérêt de la portion anglaise de la population, qui ne comptait alors que quelques centaines d'âmes dispersées dans les villes et dans les arrondissemens situés sur les limites orientales du Canada, le long des Etats de New Hampshire, du Massachusetts et du Maine. La plupart étaient d'origine allemande ou hollandaise. 1 Ils étaient venus s'établir en Canada pendant la révolution américaine qu'ils fuyaient. La métropole en se réservant la nomination du conseil législatif, s'était conservé le moyen de donner à cette petite population un pouvoir égal à celui du reste des habitans et ainsi de nullifier la majorité ou en d'autres termes de gouverner les uns par les autres.
Note 1: (retour) A short view of the present state of the Eastern townships etc., by the Honble. and Revd. Chs. Stewart A. M. minister of St. Armand Lower Canada and Champlain to the Lord Bishop of Québec, 1815.
Dans la nouvelle constitution, le roi ou plutôt le bureau colonial, car le bureau colonial seul en Angleterre connaissait ce qui se passait en Canada, formait une branche; le conseil législatif la seconde, mais comme il était à la nomination de la couronne, il devait être nécessairement la créature de l'exécutif, composé d'hommes dévoués à toutes ses volontés, en possession de toutes ses sympathies et toujours prêts à lui servir de bouclier contre les représentans du peuple.
Telle fut dès le début la mise en pratique de l'acte de 91. La division du Canada en deux parties pour assurer à ses anciens habitans leurs usages et leur nationalité, suivant l'intention de Pitt, manqua son but et ne donna réellement la prépondérance à personne. Quant au conseil exécutif lui-même, qui devait être l'image du ministère en Angleterre, il ne fut qu'un instrument servile entre les mains des gouverneurs, et ce fut là ce qui amena plus tard la ruine de la nouvelle constitution. En effet, qui allait conserver l'harmonie entre les deux chambres, si le bureau colonial ne le voulait pas? Tout dépendait de cette volonté, puis qu'elle était maîtresse du conseil exécutif et du conseil législatif dont elle avait la nomination.
Les membres du conseil exécutif choisis parmi les anciens habitans y furent toujours en petit nombre, excepté à son origine, où les Canadiens se trouvèrent quelque temps, comme dans le conseil législatif, dans la proportion de 4 sur 8. Mais plus tard l'on garda les plus obéissans et l'on repoussa les autres, car dès 99 ce conseil ne contenait plus que six Canadiens sur quinze membres.
Sir Alured Clarke fixa les élections pour le mois de juin et la réunion des chambres pour le mois de décembre.
Après toutes les tentatives du parti anglais depuis 64 pour les faire proscrire, l'on aurait pu croire que les Canadiens, le coeur encore ulcéré de l'exclusion dont on avait voulu les frapper, eussent refusé leurs suffrages à tous les candidats connus pour lui appartenir. Il n'en fut rien cependant à l'étonnement de beaucoup de monde. Deux choses contribuèrent à cette conduite; d'abord le peuple en général ignorait une partie des intrigues des Anglais qui avaient soin de se tenir dans l'ombre de ce côté-ci de l'Océan, ou de dissimuler leur conduite par des explications trompeuses, chose facile à faire à une époque où les journaux ne contenaient aucune discussion politique sur les événemens du jour; en second lieu, ils jugèrent, non sans raison, que ceux qui avaient été élevés au milieu d'un pays en possession depuis longtemps d'institutions dont ils allaient faire l'essai, devaient posséder une expérience utile au bon fonctionnement de la nouvelle constitution, et ils les choisirent partout où ils se présentaient sans exiger d'autre garantie que leurs déclarations verbales.
Les Anglais qui connaissaient tout le prix de l'instrument qu'on mettait ainsi à leur disposition, montrèrent la plus grande activité et une audace qui doit nous étonner aujourd'hui. C'était un spectacle nouveau que de voir le peuple assemblé pour se choisir des représentans; mais c'en était un qui l'était encore plus que de voir tous les Anglais tant soit peu respectables de Montréal et de Québec courir partout solliciter les suffrages de cette race dont ils avaient demandé l'anéantissement politique avec tant d'ardeur et tant de persévérance, et les obtenir pour la plupart en opposition à ses propres enfans. Seize Anglais sur cinquante membres furent élus, lorsque pas un seul ne l'eut été si les électeurs eussent montré le même esprit d'exclusion que les pétitionnaires de 73 et les électeurs anglais d'aujourd'hui. C'était une grande hardiesse de la part du peuple que de hasarder ainsi les intérêts de sa nationalité en mettant sa cause entre les mains de ses ennemis les plus acharnés; mais les anciens gouverneurs ne l'avaient rendu ni défiant ni vindicatif; le vote sur l'usage de la langue française qui eut lieu à l'ouverture de la session, put seul réveiller des soupçons dans son coeur naturellement honnête et confiant, et lui montrer le danger de sa facile générosité.
Les chambres se réunirent le 17 décembre dans le palais épiscopal occupé par le gouvernement depuis la conquête. Lorsqu'elles eurent prêté serment, le gouverneur assis sur un trône et entouré d'une suite nombreuse, requit les communes de se choisir un président et de le présenter le jeudi suivant à son approbation.
Ce choix fit connaître leur caractère. Le parti anglais proposa de suite l'abolition de la langue française dans les procédés législatifs et la nomination d'un président de son origine nationale. Cette nomination qui fournit le sujet de la première discussion, fut ajournée au lendemain après des débats et une division provoquée par le désir de chaque parti de connaître ses forces, qui se trouvèrent dans le rapport de un à deux.
Le lendemain, M. Dunière proposa M. J. Antoine Panet. Les Anglais opposèrent successivement à ce candidat M. Grant, M. McGill et un M. Jordan, trois hommes que rien ne recommandait à ce poste élevé que leurs heureuses spéculations dans le commerce. Ils espéraient par cette persévérance intimider leurs adversaires nouveaux dans les luttes parlementaires, et qu'ils taxaient déjà de factieux dès qu'ils osaient manifester une opinion indépendante. Les débats qui furent très animés, se prolongèrent longtemps et annoncèrent une session orageuse. McGill qui avait proposé Grant et qui était lui-même proposé par un autre, déclara pour raison de son opposition à M. Panet, que le président devait connaître les deux langues et surtout la langue anglaise. On lui répondit que ce candidat entendait assez cette langue pour la conduite des affaires publiques. Un autre membre, M. Richardson, avança que les Canadiens étaient tenus par tous les motifs d'intérêt et de reconnaissance d'adopter la langue de la métropole, et soutint sa proposition avec tant d'apparence de conviction qu'il acquit M. P. L. Panet à son parti. «Le pays n'était-il pas une dépendance britannique demanda ce représentant? la langue anglaise n'était-elle pas celle du souverain et de la législature? Ne devait-on pas conclure de là que, puisque l'on parlait anglais à Londres, l'on devait le parler à Québec.» Ce raisonnement qui paraissait plus servile que logique ne convainquit personne. La discussion sur un pareil sujet était de nature à exciter les passions les plus haineuses. «Est-ce parce que le Canada fait partie de l'empire britannique, s'écria M. Papineau dont la parole avait d'autant plus de poids qu'il s'était distingué par son zèle et sa fidélité durant la révolution américaine, est-ce parce que les Canadiens ne savent pas la langue des habitans des bords de la Tamise qu'ils doivent être privés de leurs droits?» Cette apostrophe suivie d'un discours plein de force et de logique déconcerta l'opposition, dont les faits cités ensuite par MM. Bedard, de Bonne et J. A. Panet achevèrent la défaite. Ce dernier rappela que dans les îles de la Manche comme Jersey et Guernesey, l'on parlait le français; que ces îles étaient attachées à l'Angleterre depuis Guillaume le conquérant, et que jamais population n'avait montré plus de fidélité à l'Angleterre que celle qui les habitait.» Il aurait pu ajouter encore que pendant plus de trois siècles après la conquête normande, la cour, l'église la robe, les tribunaux, la noblesse, tout parlait français en Angleterre; que c'était la langue maternelle de Richard coeur-de-lion, du Prince noir et même de Henri V; que tous ces personnages illustres étaient de bons Anglais; qu'ils élevèrent avec leurs arbalétriers bretons et leurs chevaliers de Guyenne la gloire de l'Angleterre à un point où les rois de la langue saxonne n'avaient jamais pu la faire parvenir; 2 enfin que c'était la langue de la grande Charte, et que l'origine de la grandeur présente de l'empire était due à ces héros et aux barons normands qui l'avaient signée et dont les opinions avaient toujours conservé la plus grande influence sur le pays.
Note 2: (retour) On sait que les deux tiers de l'armée du Prince noir à la bataille de Poitiers étaient composés de Gascons, de Français.
La discussion se termina après une lutte vigoureuse par l'élection de M. Panet au fauteuil présidentiel, et la défaite de ses trois concurrens; mais pas un seul anglais ne vota pour lui, tandis que deux Canadiens votèrent contre. La division fut de 28 contre 18.
L'élément anglais malgré sa faiblesse cherchait à dominer sous le prestige de l'influence métropolitaine. Le premier président élu, sans être un homme de talens supérieurs, avait l'expérience des affaires comme l'avocat le plus employé de son temps, une abondance d'élocution qui ne tarissait point, l'esprit orné et les manières faciles et polies de la bonne société.
Le 20, le gouverneur approuva le choix de l'assemblée et adressa aux deux chambres réunies un discours dans lequel il recommanda l'harmonie et l'adoption des mesures que pouvaient demander l'avantage et la prospérité du pays. «Dans un jour comme celui-ci, dit-il, remarquable par le commencement d'une forme de gouvernement qui a porté la Grande-Bretagne au plus haut degré d'élévation, il est impossible de ne pas éprouver une émotion profonde, et que cette émotion ne soit pas partagée par tous ceux qui sont en état d'apprécier la grandeur du bienfait qui vient d'être conféré au Canada. Je me contenterai de suggérer qu'après avoir rendu des actions de grâces à l'arbitre de l'univers, nous rendions hommage à la magnanimité du roi et du parlement auxquels nous le devons en leur exprimant tous nos remercîmens et toute notre reconnaissance.»
La réponse de la chambre fut simple et respectueuse; mais le conseil législatif crut devoir lancer un anathème contre la révolution française et remercier la providence d'avoir arraché le Canada des mains d'un pays où il se passait des scènes que l'on pouvait reprocher à des barbares. Ces réflexions, qui pouvaient être bonnes en elles-mêmes, étaient impolitiques et inopportunes; elles partaient de trop loin pour atteindre la France, et le moindre bon sens aurait du faire apercevoir qu'elles ne pouvaient être agréables aux Canadiens, qui devaient conserver des sentimens de respect pour la nation d'où sortaient leurs pères. Aussi cela fut-il regardé comme une petite malice du conseil, qui voulait se donner le plaisir de dire quelque chose de désagréable pour la population.
Après ces préliminaires, les chambres votèrent une adresse au roi pour le remercier de la nouvelle constitution, et se mirent sérieusement à l'ouvrage. La discussion des règlemens pour leur régie inférieure les occupa une grande partie de la session. Elles adoptèrent les règles du parlement impérial avec les modifications nécessitées par la différence de circonstances. Ce travail ramena encore les débats sur l'idiome populaire.
Sur la proposition de dresser les procès-verbaux de l'assemblée dans les deux langues, M. Grant fit une motion d'amendement tendant à les rédiger en anglais seulement avec liberté d'en faire faire des traductions françaises pour les membres qui le désireraient. Après de violens débats, l'amendement fut rejeté. Les discussions recommencèrent lorsque le rapport du comité fut présenté. Grant proposa de nouveau qu'afin de conserver l'unité de la langue légale qu'aucune législature subordonnée n'avait le droit de changer, l'anglais fut déclaré texte parlementaire. M. de Lotbinière prit la parole: «Le plus grand nombre de nos électeurs, dit-il, étant placés dans une situation particulière, nous sommes obligés de nous écarter des règles ordinaires et de réclamer l'usage d'une langue qui n'est pas celle de l'empire, mais aussi équitables envers les autres que nous espérons qu'on le sera envers nous, mêmes nous ne voudrions pas que notre langue vint à bannir celle des autres sujets de sa Majesté. Nous demandons que l'une et l'autre soient permises. Nous demandons que nos procès-verbaux soient écrits dans les deux langues, et que lorsqu'il sera nécessaire d'y avoir recours, le texte soit pris dans la langue des motions originairement présentées, et que les bills soient passés dans la langue de la loi qui leur aura donné naissance.
Ayant eu l'honneur d'être du comité où cet objet a déjà été débattu, et ayant entendu ce qui vient d'être dit par, les honorables membres qui ont parlé avant moi, je crois qu'il est nécessaire de récapituler celles de leurs raisons qui m'ont le plus frappé, et auxquelles il est de mon devoir de répondre d'une manière détaillée.
La première raison qui a été donnée, est, que la langue anglaise étant celle du souverain et de la législation de la mère-pairie, nous ne serons entendus ni des uns ni des autres si nous n'en faisons usage, et que tous les projets de loi que nous présenterons en langue française seront refusés.
La seconde, que l'introduction de la langue anglaise assimilera et unira plus promptement les Canadiens à la mère-patrie.
Ces raisons sont d'une si grande importance qu'il est indispensablement nécessaire de les examiner l'une après l'autre.
Pour répondre à la première, je dirai avec cet enthousiasme qui est le fruit d'une vérité reconnue et journellement sentie, que notre très gracieux souverain est le centre de la bonté et de la justice; que l'imaginer autrement serait défigurer son image et percer nos coeurs. Je dirai, que notre amour pour lui est tel que je viens de l'exprimer; qu'il nous a assuré de son attachement et que nous sommes persuadés, que ses nouveaux sujets lui sont aussi chers que les autres. Enfans du même père, nous sommes tous égaux à ses yeux. D'après cet exposé, qui est l'opinion générale de la province, pourra-t-on nous persuader qu'il refusera de nous entendre, parce que nous ne savons parler que notre langue? De pareils discours ne seront jamais crus: ils profanent la majesté du trône, ils le dépouillent du plus beau de ses attributs, ils le privent d'un droit sacré, du droit de rendre justice! Non, M. le président, ce n'est point ainsi qu'il faut peindre notre roi; ce monarque équitable saura comprendre tous ses sujets, et en quelque langue que nos hommages et nos voeux lui soient portés, quand nos voix respectueuses frapperont le pied de son trône, il penchera vers nous une oreille favorable et il nous entendra quand nous lui parlerons français. D'ailleurs, monsieur, cette langue ne peut que lui être agréable dans la bouche de ses nouveaux sujets, puisqu'elle lui rappelle la gloire de son empire et qu'elle lui prouve d'une manière forte et puissante, que les peuples de ce vaste continent sont attachés à leur prince, qu'ils lui sont fidèles, et qu'ils sont anglais par le coeur avant même d'en savoir prononcer un seul mot.
Ce que je viens de dire du meilleur des rois, rejaillit sur les autres branches de la législature britannique. Ce parlement auguste ne peut-être représenté sous des couleurs défavorables, puisqu'il nous a donné des marques de sa libéralité et de ses intentions bienfaisantes. Le statut de la 14e année de sa Majesté est une preuve de ce que j'avance; notre religion nous y est conservée, nos lois de propriété nous y sont assurées, et nous devons jouir de tous nos droits de citoyens d'une manière aussi ample, aussi étendue et aussi avantageuse, que si aucune proclamation, ordonnance, commission ni autre acte public n'avaient été faits. Après une loi aussi solennelle qui n'a pas été révoquée, peut-on croire que le parlement voulût retirer ce qu'il nous a si généreusement accordé; peut-on croire qu'en nous assurant tous nos droits de citoyens, qu'en nous conservant toutes nos lois de propriété, dont le texte est français, il refuserait de nous entendre quand nous lui parlerons dans cette langue, qu'il refuserait de prendre connaissance des actes que nous lui présenterons sur un texte qu'il nous a conservé; cela ne peut-être. Nous voyons une continuation de la bienveillance de ce parlement auguste dans l'acte de la 31e année de sa Majesté. Pourquoi la division de la province? pourquoi cette séparation du Haut et du Bas-Canada? Si nous lisons les débats de la chambre des communes lors de la passation de ce bill, nous en connaîtrons les raisons, c'est pour que les Canadiens aient le droit de faire leurs lois dans leur langue et suivant leurs usages, leurs préjugés et la situation actuelle de leur pays.
Est-il dit par cet acte de la 31e année de sa Majesté que nos lois seront uniquement faites en anglais? Non, et aucune raison ne le donne même à l'entendre: pourquoi donc vouloir introduire un procédé qui ne peut-être admissible en ce moment? pourquoi regarder comme indispensable, une chose dont il n'est pas même fait mention dans l'acte constitutionnel? Croyons, M. le président, que si l'intention du parlement britannique avait été d'introduire la seule langue anglaise dans notre législature, il en aurait fait une mention expresse, et que dans sa sagesse il aurait trouvé des moyens pour y parvenir; croyons, monsieur, et soyons bien convaincus, qu'il n'en aurait employé que de doux, de justes et d'équitables. C'est donc à nous à imiter sa prudence et à attendre ce beau jour dont nous n'apercevons que l'aurore.... La seconde raison, qui est d'assimiler et d'attacher plus promptement les Canadiens à la mère-patrie, devrait faire passer par dessus toute espèce de considérations, si nous n'étions pas certains de la fidélité du peuple de cette province; mais rendons justice à sa conduite de tous les temps, et surtout rappelions-nous l'année 1775. Ces Canadiens qui ne parlaient que français, ont montré leur attachement à leur souverain de la manière la moins équivoque. Ils ont aidé à défendre toute cette province. Cette ville, ces murailles, cette chambre même où j'ai l'honneur de faire entendre ma voix, ont été en partie sauvées par leur zèle et par leur courage. On les a vus se joindre aux fidèles sujets de sa Majesté, et repousser les attaques que des gens qui parlaient bien bon anglais faisaient sur cette ville. Ce n'est donc pas, M. le président, l'uniformité du langage qui rend les peuples plus fidèles ni plus unis entre eux. Pour nous en convaincre, voyons la France en ce moment et jetons les yeux sur tous les royaumes de l'Europe....
Non, je le répète encore, ce n'est point l'uniformité du langage qui maintient et assure la fidélité d'un peuple; c'est la certitude de son bonheur actuel, et le nôtre en est parfaitement convaincu. Il sait qu'il a un bon roi et le meilleur des rois! il sait qu'il est sous un gouvernement juste et libéral; il sait enfin, qu'il ne pourrait que perdre beaucoup dans un changement ou une révolution, et il sera toujours prêt à s'y opposer avec vigueur et courage.»
M. Taschereau parla dans le même sens que M. de Lotbinière et avec beaucoup d'à-propos. Il dit qu'il avait été opposé à une chambre d'assemblée en 88 parce qu'il craignait pour la sûreté des droits Canadiens; mais que les craintes qu'il avait alors avaient disparu depuis qu'il voyait que le pays avait su se choisir une représentation qui assurait la tranquillité de tout le monde. Je me suis levé, ajouta-t-il, armé non-seulement de l'acte de 74, mais aussi de celui de 91 dont les Canadiens qu'on a si souvent peints avec des couleurs désavantageuses, sauront faire usage au grand étonnement de quelques individus, mais à la satisfaction de la Grande-Bretagne. Passant ensuite rapidement sur l'objet de la discussion, il termina par ces paroles qui ne pouvaient être réfutées:
«Mais l'on a dit et l'on dira encore, le conseil législatif, son excellence le lieutenant gouverneur, ces deux premières puissances qui doivent concourir avec nous, ne recevront pas nos bills en fiançais; oui, monsieur, ils les recevront, cet acte de la 31e année m'en assure, et pour l'interpréter dans son vrai sens et dans toute sa force, je demanderai si la représentation est libre? personne me dit que non; étant libre, il pouvait donc se faire que 50 membres qui comme moi, n'entendent point l'anglais, auraient composé cette chambre; auraient-ils pu faire des lois en langue anglaise? non, assurément. Eh bien! ç'aurait donc été une impossibilité et une impossibilité ne peut exister. Je demanderai actuellement si pour cela cet acte de la 31e année qui nous constitue libres, pourrait être annulé et anéanti; non certainement, rien ne peut empêcher son effet, et cet acte commande aux premières puissances de la législation de concourir avec nous; et notre confiance en leur justice est telle, que nous sommes persuadés qu'elles le feront de manière à répondre aux intentions bienfaisantes de sa Majesté et de son parlement, qui ne nous restreignent point à la dure nécessité de statuer, en ce moment, nos lois dans une langue que nous n'entendons point.»
«D'ailleurs, observa un autre membre, M. de Rocheblave, quelles circonstances choisit-on pour nous faire adopter un changement également dangereux pour la métropole et pour la province? Ignore-t-on que nous avons besoin de toute la confiance du peuple pour l'engager à attendre avec patience que nous trouvions des remèdes aux maux et aux abus dont il a à se plaindre? Ne peut-on pas voir qu'il est dangereux pour la Grande-Bretagne même à la quelle nous sommes liés par reconnaissance et par intérêt, de détruire les autres barrières qui nous séparent de nos voisins; que tout espoir et toute confiance de la part du peuple dans ses représentans sont perdus si nous n'avons qu'un accroissement de privation à lui offrir pour résultat de nos travaux?
Eh! de quoi pourraient se plaindra quelques-uns de nos frères anglais en nous voyant décidés à conserver avec nos lois, usages et coutumes, notre langue maternelle, seul moyen qui nous reste pour défendre nos propriétés? Le stérile honneur de voir dominer leur langue pourrait-il les porter à faire perdre leur force et leur énergie à ces mêmes lois, usages et coutumes qui font la sécurité de leur propre fortune? Maîtres sans concurrence du commerce qui leur livre nos productions, n'ont-ils pas infiniment à perdra dans le bouleversement générai qui en serait la suite infaillible, et n'est-ce pas leur rendre le plus grand service que de s'y opposer? 3
Note 3: (retour) Gazette de Montréal, 14 février 1793.
Ces discussions agitaient profondément les Canadiens. En effet l'abandon de la langue maternelle n'est pas dans la nature de l'homme, dit un savant 4; elle ne tombe qu'avec lui, si même elle ne lui survit pas. Comme cela devait être, tout l'avantage de la discussion resta à ceux qui repoussaient l'oppression, et comme la première fois la division sur l'amendement de Grant, montra tous les Anglais pour et tous les Canadiens contre, excepté toujours M. P. L. Panet. L'amendement fut repoussé par les deux tiers de la chambre. Plusieurs autres dans le même sens furent encore proposés par MM. Lees, Richardson et les orateurs les plus remarquables du parti anglais, et subirent le même sort après trois jours de discussions. La résolution définitive fut, que tous les procédés de la chambre seraient dans les deux langues; mais que le français ou l'anglais serait le texte des actes législatifs selon qu'ils auraient rapport aux lois françaises ou aux lois anglaises existantes en Canada.
Note 4: (retour) Lettres sur l'origine des sciences par Bailly.
Dans cette importante question, l'on voit que les membres anglais élus par les Canadiens, trahirent sans hésitation les intérêts et les sentimens les plus intimes de leurs commettans. Ils prouvèrent que leurs opinions de 64 n'avaient point changé, et qu'ils étaient toujours les organes du parti qui ne cessait point de porter contre tout ce qui était catholique et français cette haine aveugle qui a inspiré plus tard l'un de leurs partisans dans le passage suivant: «L'acte de 74 a été injudicieusement libéral envers le clergé et les hantes classes, et celui de 91 envers la masse des Canadiens. Ce dernier en sanctionnant l'existence des lois civiles françaises, en mesurant le libre exercice de la religion catholique et le payement des dîmes, en modifiant le serment fidélité, de manière que les catholiques pussent le prêter, en confirmant aux Canadiens catholiques la propriété de leurs biens avec leurs usages et leurs coutumes, en n'abolissant pas leur langue maternelle et la tenure de leurs terres, en prenant pour base de la répartition du droit électoral, le nombre et ne faisant rien pour les Anglais et la langue anglaise, en ne stipulant pas une liste civile pour le soutien du gouvernement et l'usage exclusif de l'anglais pour la rédaction des lois, enfin en oubliant de limiter la représentation franco-canadienne de manière à la laisser dans la minorité. L'acte de 91 fut la plus grande faute que pouvait faire le gouvernement britannique, puisqu'il s'agissait d'un peuple qui différait de manières, d'habitudes, de coutumes, de religion et de langue d'avec la nation anglaise. 5 La chambre d'assemblée ayant enfin disposé de ces questions brûlantes, put s'occuper avec, plus de calme d'un grand nombre, de projets de loi, dont plusieurs ne paraissaient pas bien pressans comme celui pour le soulagement des personnes en détresse dans les paroisses. Une loi des pauvres peut être bonne dans un pays surchargé de population comme l'Angleterre, mais elle est impolitique dans une contrée dont les trois quarts du territoire sont encore à défricher et à établir. L'acte des écoles de paroisse qui fut présenté était d'une nature bien autrement importante pour l'avenir du pays. Ceux pour la tolérance des quakers et l'abolition de l'esclavage avaient de l'importance plutôt comme déclaration de principe que comme besoin social réellement senti, car les quakers et les esclaves étaient très rares en Canada, l'esclavage dans le fait n'y ayant jamais été admis sous la domination française.
Note 5: (retour) Fleming.
La question d'éducation prima donc dans cette première session. L'on a vu comment le collège des jésuites avait été fermé par ordre du gouvernement dans les premières années de la conquête, sans droit, sans loi, sans aucun jugement public de l'autorité compétente; et que le peuple avait réclamé dès 87 les biens de cet ordre religieux pour les rendre à leur destination primitive, l'éducation. En 93, les habitans de Québec et des environs présentèrent une seconde pétition à la législature pour le même objet dans laquelle ils exposaient en réponse aux représentations de lord Amherst et des consultations des officiers de la couronne, que la nature des titres et de la fondation du collège de Québec avait été déguisée en Europe; que le Canada se trouvait privé d'écoles publiques depuis la conquête, et que la continuation de ce malheur pouvait-être attribuée aux efforts de quelques individus qui convoitaient les biens de cette institution. La majorité de la chambre d'assemblée approuvant les conclusions des pétitionnaires, M. de Rocheblave proposa, après quelque discussion, que leur requête fut renvoyée à un comité de 9 membres pour vérifier l'exactitude des allégués touchant les titres de ces biens.
M. Grant s'opposa à la motion qui comportait, suivant lui, la reconnaissance tacite du droit que le pays avait à leur propriété, et proposa un amendement par lequel tout en déclarant que la couronne pouvait en disposer comme bon lui semblerait, l'on priait le roi de les affecter à l'instruction publique. L'adoption d'un pareil amendement aurait mis, par analogie, tous les biens des institutions religieuses à la merci d'un ordre de l'Angleterre, et les craintes que l'on avait à ce sujet n'étaient pas imaginaires, car le bruit courait déjà que le gouvernement allait s'emparer de l'église et du couvent des récollets pour les convertir à l'usage du culte protestant, ce qu'il exécuta après l'incendie du couvent en 96. L'on n'avait pas oublié non plus qu'il avait pris de la même manière un terrain précieux appartenant aux ursulines sans les indemniser. Après des débats prolongés jusqu'au lendemain, l'amendement fut écarté par toute la chambre de même que la motion principale lorsqu'elle fut soumise à son concours sous forme de rapport.
Le projet de la loi d'éducation parvint à sa seconde lecture et tomba sur la proposition qui fut faite de le prendre en considération en comité général. L'on finit par résoudre après plusieurs ajournemens et des discussions très vives, de présenter une adresse au roi pour le prier simplement d'approprier les biens des jésuites à l'instruction de la jeunesse, sans faire allusion au titre que le pays avait pour les réclamer; et la question des écoles se trouva par là ajournée indéfiniment.
La chambre passa ensuite aux finances. La résolution la plus importante de la session fut celle par laquelle elle déclara que le vote des subsides lui appartenait d'une manière exclusive et incontestable, et qu'aucune loi d'appropriation ne pourrait être amendée par le conseil législatif. Elle passa aussi un bill pour imposer des droits sur l'importation des boissons, dans le but de créer un revenu sur lequel elle put affecter le payement des dépenses de la législature, mesure nécessaire pour assurer son indépendance, car le trésor anglais payait encore une forte proportion du budget canadien. Les droits sur la portion des boissons consommées dans le Haut-Canada, devaient être remboursés à cette province. Enfin elle porta son attention sur l'état de l'administration de la justice, et le conseil législatif lui envoya un projet de loi sur la formation des tribunaux, dont la considération fut remise à la session suivante après une première lecture.
Tels furent les principaux sujets qui occupèrent la session de 92. Le résultat ne répondit point à sa longueur; mais les discussions qui avaient eu lieu produisirent plusieurs avantages. Celles sur la régie intérieure mirent les membres au fait des règles parlementaires, et la politesse française introduite par les Canadiens dans la tenue de la chambre et dans les débats, donna à ce corps un air de respectueuse gravité que n'avait point, par exemple, la chambre des communes d'Angleterre avec ses membres enveloppés de leurs manteaux, la tête couverte et la canne ou la cravache à la main comme la foule dans une foire.
Le principal événement de la session fut le triomphe de la langue des Canadiens; le résultat la conviction de leur aptitude pour la nouvelle forme de gouvernement. Le caractère subtil, litigieux et disputeur qu'ils tenaient des Normands leurs ancêtres, trouvait à se satisfaire dans les controverses parlementaires, et leur soumission caractéristique aux lois était une des conditions essentielles pour les rendre propres à la jouissance d'institutions libres.
C'est le 9 mai que furent prorogées les chambres. Le gouverneur sanctionna les huit bills qu'elles avaient passés, et leur témoigna dans un discours toute la satisfaction qu'il éprouvait en voyant l'attachement que le Canada montrait pour le roi et pour la nouvelle constitution dans un temps où la révolution française forçait les nations de l'Europe à prendre part à une lutte qui enveloppait les premiers intérêts de la société. Il se flattait que dans la session suivante, elles régleraient les deux importans sujets sur lesquels il avait appelé leur attention, l'administration de la justice et la réorganisation de la milice pour la défense du pays en cas que la guerre ou les mauvaises dispositions des ennemis de toute espèce rendissent une défense nécessaire.
Les progrès de la révolution française qui attirait dans ce moment les regards de toutes les nations, et qui, comme un immense météore menaçait d'embraser l'Europe entière, remuait toutes les masses et remplissait tous les gouvernemens d'une terreur profonde. Les progrès de cette révolution dont l'influence avait puissamment contribué à déterminer l'Angleterre à nous accorder une extension de liberté, fixaient aussi les regards du Canada. Le peuple et le gouvernement regardaient ce spectacle avec des sentiments de crainte et d'étonnement. L'un offrait, l'autre demandait des témoignages de fidélité au roi et à l'ordre établi, tant on avait de méfiance les uns contre les autres, et tant l'on avait conséquemment besoin de se rassurer. L'on était réservé dans son langage et dans ses actes, et en réclamant l'usage de leur langue maternelle, les Canadiens protestaient sans cesse dans les termes les plus forts de leur attachement à la couronne. Cette retenue dans leurs discours et cette fermeté dans leurs principes assurèrent pour le moment deux avantages au pays, la paix intérieure et la conservation de ses droits. Le parti anglais abandonna ses prétentions outrées, soit qu'il vît l'inutilité de ses efforts, soit qu'il reçût des avertissemens en haut lieu, soit enfin qu'il résolût de se reposer sur l'avenir; et tandis que l'ancien monde était en feu, le Canada jouissait de la liberté et de la paix, deux choses nouvelles pour lui. Tel était l'état des esprits lorsque lord Dorchester revint en Canada en 93 armé d'instructions nouvelles et fort amples, qui l'autorisaient à nommer un nouveau conseil exécutif, qu'il composa de 9 membres dont 4 Canadiens, et qui portaient que toutes les nominations aux charges publiques ne subsisteraient que durant le bon plaisir de la couronne; que les terres ne seraient concédées qu'à ceux qui seraient capables de les établir, après qu'elles auraient été divisées en arrondissemens (townships), enfin qui permettaient aux séminaires de Québec et de Montréal ainsi qu'aux communautés religieuses de femmes de se perpétuer suivant les règles de leur institution. Les troubles de l'Europe qui menaçaient d'embraser l'Amérique, et la popularité de cet ancien gouverneur parmi les Canadiens, furent probablement les motifs qui engagèrent la Grande-Bretagne à lui remettre pour la troisième fois les rênes du gouvernement. Il fut parfaitement accueilli par l'ancienne population, mais avec froideur par les Anglais, qui trouvèrent ensuite le discours qu'il prononça à l'ouverture des chambres beaucoup trop flatteur pour la représentation nationale.
Il appela dans ce discours leur attention sur l'organisation de la milice, sur l'administration de la justice; et, en leur annonçant qu'il allait leur faire transmettre un état des comptes publics, il les informa que les revenus étaient encore insuffisans pour couvrir toutes les dépenses; mais qu'il espérait que la métropole continuerait de combler le déficit.
Cette session fut plus longue encore que la première et dura depuis le mois de novembre 93 jusqu'au mois de juin suivant ou six mois et demi. Il ne fut passé cependant que six lois dont une pour réorganiser la milice, deux autres pour amender les lois de judicature, et autoriser le gouverneur à suspendre la loi de l'habeas-corpus à l'égard des étrangers soupçonnés de menées séditieuses, acte renouvelé d'année en année jusqu'en 1812. Les intrigues de l'ambassadeur de la république française auprès du gouvernement des Etats-Unis, M. Genet, et celles de ses émissaires en Canada, nécessitaient, disait-on, ces mesures de précautions qui blessaient la liberté du sujet et dont l'abus sous l'administration de sir James Craig devait tant agiter le pays. La plus grande harmonie ne cessa point de régner pendant toute la session. M. Panet, fait juge des plaidoyers communs, fut remplacé à la présidence de la chambre, par M. de Lotbinière qui fut élu à l'unanimité. L'influence pacifique de lord Dorchester se faisait déjà sentir sur l'opposition, qui se désabusait chaque jour sur ses prétentions. C'est dans cette session que, pour la première fois, les comptes du revenu public furent mis sous les yeux des contribuables. Dans le message qui les accompagnait, le gouverneur recommanda de donner des salaires fixes aux fonctionnaires et d'abolir le système des émolumens, afin de prévenir tout abus et que les charges imposées sur le peuple pour le soutien de l'état, fussent exactement connues. Le revenu annuel n'atteignait pas le tiers des dépenses de l'administration civile, qui s'élevaient à £25,000, laissant ainsi un découvert de plus de £17,000 qui était comblé par le budget impérial.
Les recettes provenaient des droits sur les vins, les spiritueux, la mêlasse, de la taxe sur les aubergistes et des amendes et confiscations. Dans le vrai l'on pourrait presque dire que la taxation était inconnue eu Canada.
Le gouverneur, sans demander expressément un vote de subsides pour couvrir lu totalité des dépenses, avait appelé l'attention de la chambre sur les moyens d'augmenter le revenu et de pourvoir par elle-même à tout le budget, ce qu'elle ne parut pas s'empresser de goûter pour le moment. Plus tard cependant lorsqu'elle voulut y revenir pour mieux contrôler l'administration, on lui fit un crime de son offre tant les intérêts et les passions peuvent mettre les hommes en contradiction avec eux-mêmes.
Tandis que l'on s'occupait ainsi avec assez d'unanimité de la question des finances, les idées révolutionnaires faisaient toujours des progrès et le gouvernement canadien ne paraissait pas plus rassuré que les autres malgré la tranquillité qui régnait dans le pays. Lord Dorchester qui se surprenait quelquefois avec ces craintes, saisit l'occasion de la fermeture des chambres pour recommander la soumission à l'ordre établi. «Je n'ai aucun doute, dit-il, aux membres, qu'en retournant dans vos foyers vous ne répandiez avec zèle, parmi tes habitans, ces principes de justice, de patriotisme et de loyauté qui ont distingué vos travaux publics pendant le cours de cette longue session; que vous ne lassiez tous vos efforts pour découvrir et amener devant les tribunaux les personnes mal-disposées qui, par leurs discours et leurs conversations inflammatoires, ou la diffusion d'écrits séditieux, chercheraient à séduire ceux qui ne sont pas sur leurs gardes, et à troubler la paix et le bon ordre de la société, et que vous ne saisissiez toutes les occasions de persuader à vos compatriotes que les bienfaits dont ils jouissent sous une constitution vraiment libre et heureuse ne peuvent-être conservés que par une sincère obéissance aux lois.»
Le clergé catholique faisait tout en lui de son côté pour rassurer le gouvernement et maintenir le peuple dans l'obéissance. Le curé de Québec, M. Plessis, prononçant l'oraison funèbre de M. Briand, évêque, dans la cathédrale, le 27 juin, disait:
«Nos conquérans, regardés d'un oeil ombrageux et jaloux, n'inspiraient que de l'horreur et du saisissement. On ne pouvait se persuader que des hommes étrangers à notre sol, à notre langage, à nos lois, à nos usages et à notre culte, fussent jamais capables de rendre au Canada ce qu'il venait de perdre en changeant de maîtres. Nation généreuse, qui nous avez fait voir avec tant d'évidence combien ces préjugés étaient faux; nation industrieuse, qui avez fait germer les richesses que cette terre renfermait dans son sein; nation exemplaire, qui dans ce moment de crise enseignez à l'univers attentif, en quoi consiste cette liberté après laquelle tous les hommes soupirent et dont si peu connaissent les justes bornes; nation compatissante, qui venez de recueillir avec tant d'humanité les sujets les plus fidèles et les plus maltraités de ce royaume auquel nous appartîntes autrefois; nation bienfaisante, qui donnez chaque jour au Canada de nouvelles preuves de votre libéralité;--non, non, vous n'êtes pas nos ennemis, ni ceux de nos propriétés que vos lois protègent, ni ceux de notre sainte religion que vous respectez. Pardonnez donc ces premières défiances à un peuple qui n'avait pas encore le bonheur de vous connaître; et si après avoir appris le bouleversement de l'Etat et la destruction du vrai culte en France, et après avoir goûté pendant trente-cinq ans les douceurs de votre empire, il se trouve encore parmi nous quelques esprits assez aveugles ou assez mal intentionnés pour entretenir les mêmes ombrages et inspirer au peuple des désirs criminels de retourner à ses anciens maîtres; n'imputez pas à la totalité ce qui n'est que le vice d'un petit nombre.
«M. Briand avait pour maxime, qu'il n'y a de vrais chrétiens, de catholiques sincères, que les sujets soumis à leur Souverain légitime. Il avait appris de Jésus-Christ, qu'il faut rendre à César ce qui appartient à César; de St.-Paul, que toute âme doit être soumise aux autorités établies; que celui qui résiste à la puissance résiste à Dieu même, et que par cette résistance il mérite la damnation; du chef des apôtres, que le roi ne porte pas le glaive sans raison, qu'il faut l'honorer par obéissance pour Dieu, propter Deum, tant en sa personne qu'en celle des officiers et magistrats qu'il députe sive ducibus tanquam ab eo missis. Tels sont, chrétiens, sur cette matière, les principes de notre sainte religion; principes que nous ne saurions trop vous inculquer, ni vous remettre trop souvent devant les yeux, puisqu'ils font partie de cette morale évangélique à l'observance de laquelle est attaché votre salut. Néanmoins, lorsque nous vous exposons quelquefois vos obligations sur cet article, vous murmurez contre nous, vous vous plaignez avec amertume, vous nous accusez de vues intéressées et politiques, et croyez que nous passons les bornes de notre ministère! Ah! mes frères, quelle injustice!»
On ne pouvait rassurer l'Angleterre dans un langage plus soumis ni plus dévoué. Le prêtre oubliant tout le reste, remerciait presque la providence d'avoir arraché le Canada à la nation impie qui brisait ses autels.
Il prêchait l'obéissance la plus absolue en disant que celui qui résiste à la puissance résiste à Dieu même, et que par cette résistance il mérite la damnation.
Toutes ces maximes du reste étaient et sont encore celles de l'église catholique. Quoique les protestans les répudient ou du moins ne les poussent pas si loin que Rome, ils en profitèrent en Canada, et M. Plessis fut toute sa vie en grande considération parmi eux.
Les recommandations du gouverneur et du clergé n'étaient pas toutefois sans prétexte. Quelques personnes de Montréal que les discours et les prétentions des Anglais choquaient; d'autres autant par esprit de contradiction probablement que pour exciter les frayeurs de l'autorité, tenaient des propos qui les firent accuser devant les tribunaux et condamner à de fortes amendes. A Québec la même chose eut lieu: trois habitans de Charlesbourg furent accusés de haute trahison; quelques uns de menées séditieuses; leur crime était si peu considérable que le gouverneur fit abandonner les poursuites en 95. Il avait voulu seulement frapper l'imagination populaire et mettre en garde contre les cris des agitateurs.
Dans l'été, il se forma dans la capitale une grande association pour le soutien des lois et du gouvernement, en opposition aux propagandistes révolutionnaires; elle couvrit bientôt tout le pays et témoigna de sa fidélité à la royauté par de nombreuses adresses qui durent rassurer l'inquiétude métropolitaine. Cet état de choses dura plusieurs années. A chaque session, le gouvernement demandait et obtenait de nouveaux pouvoirs pour organiser une milice soumise, pour maintenir la tranquillité intérieure, pour repousser les ennemis extérieurs s'ils s'en présentaient, enfin pour continuer la suspension de l'acte d'habeas-corpus à l'égard des étrangers. Il est inutile de dire que pendant ce temps là la plus grande concorde régnait entre les différentes branches de la législature. Plusieurs des membres les plus marquans avaient reçu des emplois, comme M. Panet et M. de Bonne. Les autres satisfaits, se félicitaient du repos dont l'on jouissait en comparaison de l'Europe et ne songeaient qu'à en profiter.
Dans la session de 95 qui dura plus de quatre mois, le gouverneur fit mettre devant la chambre un état des revenus de l'année écoulée et les comptes d'une partie des dépenses du gouvernement civil, en la priant d'y pourvoir. Pour répondre à cette demande et couvrir la différence qu'il y avait entre la dépense et le revenu, la chambre passa deux lois d'impôt, l'une augmentant les droits sur les eaux-de-vie étrangères, les mélasses, les sirops, les sucres, le café, le tabac, le sel; l'autre continuant la taxe annuelle sur les colporteurs et les aubergistes. Cette augmentation ne répondit pas immédiatement au besoin qui l'avait fait décréter; mais l'on avait reconnu le principe. La plupart des actes qu'on passa dans cette session continuaient d'anciennes lois avec de légères modifications, et ne les continuaient que pour un temps limité, car l'assemblée avait déjà pour règle de leur donner la plus courte durée possible, afin que le gouvernement fût moins indépendant d'elle.
Une question incidente fort intéressante occupa un instant la législature. Le taux des rentes et les charges seigneuriales avaient été fixés d'une manière précise et permanente par la lot sous l'ancien régime. Après la conquête, plusieurs Anglais qui avaient acheté les seigneuries des Canadiens partant pour la France, haussèrent ces taux et furent imités par quelques uns des anciens seigneurs. Bientôt l'abus fut poussé à tel point qu'il arracha des plaintes aux habitans, qui ne trouvaient plus dans les juges nommés par le nouveau gouvernement, la protection qu'ils avaient coutume de recevoir des tribunaux anciens. Les nouveaux propriétaires qui attendaient depuis longtemps l'occasion de changer la tenure de leurs seigneuries pour en retirer de plus grands revenus, voulurent profiter du moment pour accomplir leur dessein. Ils feignirent d'être beaucoup alarmés de la propagation des idées révolutionnaires en Amérique, et de craindre l'abolition de la tenure féodale sans indemnité comme en France; ils firent sonner bien haut l'introduction de ces idées dans le pays; ils accusèrent les Canadiens de rébellion et transformèrent leur opposition à l'acte des chemins en insurrection politique, s'imaginant qu'au milieu du trouble et de la frayeur, ils réussiraient à engager la chambre d'assemblée à faire faire, par voie de reforme pour satisfaire les mécontens, des modifications à la tenure surannée et oppressive, disaient-ils, qui existait dans le pays en dépit des progrès du siècle. Ils se croyaient si sûrs du succès, qu'ils avaient pris même des arrangemens avec des émigrans américains pour leur concéder, après commutation de toutes les autres redevances, leurs terres à la charge de certaines rentes, préférant ces derniers aux Canadiens parce qu'ils les trouvaient disposés à payer des taux plus élevés. Mais leur plan fut déjoué aussitôt que mis au jour. La question dont les motifs paraissaient étrangers à toute idée de réforme réelle et salutaire, fut portée par M. de Rocheblave devant la chambre, qui la discuta pendant plusieurs séances, et finit par l'abandonner sans donner satisfaction ni aux uns ni aux autres, soit qu'elle n'osât pas attaquer les juges qui avaient perverti la loi, soit que des intérêts dissimulés la paralysassent sur un abus qui n'a fait qu'augmenter depuis dans plusieurs parties du pays.
On était alors dans la chaleur des discussions suscitées par l'acte des chemins auquel nous venons de faire allusion. Cette question importante pour les campagnes, fut d'abord mal interprétée par l'imprudence de certaines gens, qui crièrent au fardeau des taxes et surtout des corvées détestées par le peuple depuis Haldimand. On croyait que cette mesure voilait un retour au système de ce gouverneur décrié; mais petit à petit les esprits mieux éclairés se calmèrent, et l'acte prit après des amendemens nombreux, la forme à peu près dans laquelle il est parvenu jusqu'à nos jours.
Une autre question non moins importante fut encore agitée, celle du numéraire qui avait cours dans le pays. Il circulait des monnaies de toute les nations en rapport avec l'Amérique. Une partie de ces espèces dépréciée par l'usure, entraînait dans les échanges des pertes considérables. Un remède était devenu nécessaire. M. Richardson, comme négociant, prit l'initiative et une loi fut rendue par laquelle on donna une valeur légale fixe aux monnaies d'or et d'argent frappées aux coins et aux titres du Portugal, de l'Espagne, de la France et des Etats-Unis, et on convertit la valeur des monnaies anglaises du sterling en cours du pays. Dans tous les temps le système de la comptabilité a été imparfait et vicieux en Canada, et il a toujours été fort difficile de débrouiller le chaos des comptes publics; de là une partie des abus, des erreurs, des malversations des agens comptables. Toutes les lois d'impôts furent aussi réunies en une seule, pour simplifier les opérations de ces agens, et des mesures furent prises pour diminuer les frais de perception. L'acte passé pour deux ans, fut réservé à la sanction royale. Par une de ces anomalies dont l'on vit beaucoup d'exemples dans la suite, il resta si longtemps en Angleterre que lorsqu'il revint les deux ans étaient expirés.
Le gouverneur repassa en Europe dans l'été. Il organisa ou donna l'ordre avant son départ d'organiser un régiment canadien à deux bataillons comme l'avait suggéré Du Calvet. Mais ce corps fut licencié plus tard, peut-être par motif politique, la métropole jugeant qu'il n'était pas prudent d'enseigner l'usage des armes aux colons, et se rappelant que les Etats-Unis avaient préludé à la guerre de l'indépendance par celle du Canada dans laquelle ils avaient fait leur apprentissage.
Lord Dorchester avait convoqué aussi avant de déposer les rênes du pouvoir, les collèges électoraux pour procéder à une nouvelle élection générale. Le scrutin du peuple fut sévère, et plus de la moitié de la représentation fut changée. On remarquait parmi les nouveaux membres le procureur et le solliciteur-général, MM. Sewell et Foucher. Plusieurs anciens membres furent repoussés à cause de leurs tentatives pour faire proscrire la langue française. Le général Prescott, qui remplaça lord Dorchester d'abord comme lieutenant-gouverneur et ensuite comme gouverneur-général, réunit la législature dans le mois de janvier. Comme au début du premier parlement, l'élection du président de la branche populaire amena la séparation des deux partis, avec cette différence, cette fois, que les organes avoués du gouvernement firent connaître le drapeau avec lequel il prétendait s'identifier. Elle accusa aussi plusieurs défections soupçonnées depuis longtemps. Le juge de Bonne et M. de Lanaudière passèrent dans le camp opposé. Le premier qui était fils de ce capitaine de Bonne de Miselle attiré en Canada par le marquis de la Jonquière, descendait de l'illustre race des ducs de Lesdiguières, dont à ce titre il aurait dû glorifier l'origine. Il ne fut plus désormais qu'un partisan hostile à ses compatriotes. Il proposa pour président de la chambre, M. Young en opposition à M. Panet, qui fut réélu à une grande majorité. Comme la première fois, pas un Anglais ne vota pour ce dernier, tandis que quatre Canadiens votèrent contre, outre ceux qui remplissaient des charges publiques, comme le solliciteur-général qui ne vota plus que comme un homme vendu. On n'eut plus de doute dès lors sur les dispositions du gouvernement, auquel le traité d'amitié et de commerce qui venait d'être signé avec les Etats-Unis, permettait plus de hardiesse. A partir de cette époque, l'administration se montra de plus en plus ouvertement opposée à la chambre excepté pendant la guerre de 1812, où tout à coup elle devint affable et bienveillante et s'entoura de quelques hommes populaires dans lesquels elle trouva des qualités qu'elle n'avait pas aperçues auparavant et qu'elle a rarement vues depuis. Mais ce système avec des institutions électives, devait finir contre les prévisions de ses auteurs par augmenter le nombre des agitateurs et des mécontens.
Le gouverneur en informant la chambre que le traité avec les Etats-Unis allait augmenter beaucoup les relations commerciales du Canada, recommanda toutefois de renouveler la loi contre les étrangers pour neutraliser les efforts que faisaient sans cesse les émissaires français répandus partout pour troubler la tranquillité des Etats. C'était rassurer les craintes d'un côté pour les exciter de l'autre sans motif sérieux, car le Canada était hors de la portée de la république française par la distance et encore plus par les idées. Aussi pour bien des gens, feindre des craintes sous ce rapport pour les Canadiens qui avaient pu joindre la république voisine et ne l'avaient pas fait, et demander des lois de proscription contre des émissaires français imaginaires, c'était annoncer que le motif avoué de ces recommandations en cachait un autre, que ceux qui les faisaient se donnaient bien de garde de dévoiler; c'était à leurs yeux un moyen détourné de faire soupçonner la fidélité des Canadiens et d'exciter les craintes de la métropole, et la suite des événemens montra que si ce motif ne fut pas le véritable dans l'origine, il le fut plus tard.
Au reste cette session ne fut remarquable que par le pouvoir presqu'absolu que se fit donner le gouvernement. La résistance offerte à quelques unes des clauses de la loi des chemins par quelques villageois mal conseillés avait alarmé les autorités. Non contentes de la loi contre les étrangers, elles obtinrent de la complaisance des deux chambres le pouvoir de déférer au conseil exécutif ou à trois de ses membres le droit de faire arrêter qui que ce fut sur une simple accusation et même sur le simple soupçon de haute trahison ou de pratiques séditieuses. L'acte d'habeas-corpus en tant qu'opposé à cette loi fut suspendu. En prorogeant les chambres, le gouverneur les remercia d'avoir montré combien il était nécessaire dans un temps de danger public, d'augmenter les pouvoirs de l'exécutif.
Il y a lieu de croire que l'esprit du général Prescott était en proie à de vives inquiétudes, ce que l'on aurait de la peine à concevoir aujourd'hui si l'on ne savait que ceux qui avaient été témoins de la révolution américaine et de la révolution française, devaient penser que rien n'était impossible après le grand démenti que ces événemens mémorables avaient donné à toutes leurs croyances et à toutes leurs prévisions. Pour peu que le gouverneur fût imbu de cette idée, il ne fallait pas de grands efforts de la part de la faction qui tous les jours dominait de plus en plus le pouvoir, pour lui faire croire que le peuple canadien était toujours au moment de se soulever et que des agens révolutionnaires l'excitaient sans cesse en circulant furtivement dans ses rangs. A force de répéter que si les représentans du peuple se rendaient aux voeux de l'exécutif, c'était pour parvenir plus sûrement à leurs vues ambitieuses; s'ils s'y opposaient, c'était par esprit de rébellion et de déloyauté, l'on devait parvenir à faire croire tout ce que l'on voulait au chef que l'Angleterre plaçait à la tête du gouvernement, et qui le plus souvent était complètement étranger au pays. Aussi dès que l'acte pour accroître les pouvoirs de l'exécutif fut passé, l'ordre fut-il envoyé à tous les juges de paix, à tous les capitaines de milice, d'arrêter ceux qui chercheraient, par leurs intrigues ou par leurs discours, à troubler la tranquillité publique. L'on semblait croire que les réfractaires à la loi des chemins dont plusieurs furent punis pour turbulence ou sédition, avaient des chefs dont les vues s'étendaient plus loin que celle loi, et que ces chefs correspondaient ou se concertaient avec des émissaires étrangers dont le pays aurait été rempli.
Le procureur-général Sewell se transporta à Montréal à la fin de l'été de 96 pour voir ce qui s'y passait. Il fît rapport que l'île et le district étaient très désaffectionnés; que la loi des chemina avait augmenté le mécontentement jusqu'à soulever le peuple contre l'exécution des ordres des tribunaux; que le mécontentement était excité par des émissaires étrangers; que l'ambassadeur de France aux Etats-Unis, M. Adet, avait adressé un pamphlet aux Canadiens dans lequel il annonçait que la république française ayant battu l'Espagne, l'Autriche et l'Italie, allait attaquer l'Angleterre à son tour et commencer par ses colonies, et les invitait à se rallier autour de son drapeau, qu'enfin son gouvernement avait intention de lever des troupes en Canada. 6
Note 6: (retour) Procès-verbal du Conseil exécutif.
Un américain, enthousiaste insensé, nommé McLane, ajoutant foi aux soupçons que l'on semait ainsi contre la population, qui ne songeait plus alors certainement à se soustraire à la domination britannique, se laissa attirer à Québec par un charpentier de navire, nommé Black, qui avait su acquérir assez de popularité pour se faire élire l'année précédente à la chambre d'assemblée. Lorsque McLane qui se faisait passer pour un général français agissant d'après les ordres de M. Adet fut en son pouvoir, Black feignit de sortir pour quelque affaire et alla avertir l'autorité qui avait été prévenue d'avance. McLane fut saisi et livré aux tribunaux sous prévention de haute-trahison. Le choix des jurés, les témoignages, le jugement et le châtiment, tout fut extraordinaire. Il fut condamné à mort et exécuté avec un grand appareil militaire sur les glacis des fortifications dans un endroit élevé et visible des campagnes environnantes. Le corps après quelque temps de suspension au gibet, fut descendu au pied de l'échafaud, et le bourreau en ayant tranché la tête, la prit par les cheveux et la montra au peuple en disant: «Voici la tête du traître.» Il ouvrit ensuite le cadavre, en arracha les entrailles, les brûla, et fit des incisions aux quatre membres, sans les séparer du tronc. 7 Jamais pareil spectacle ne a'était encore vu en Canada. L'objet de ces barbaries était de frapper de terreur l'imagination populaire. Mais ce qu'il y eut de plus hideux dans cette tragédie, ce furent les récompenses que l'on jeta aux accusateurs et aux témoins à charge, lesquels acceptèrent sans rougir des terres considérables pour prix de leur complaisance eu de leur délation. 8 Black lui-même reçut des gratifications, qui ne lui portèrent pas bonheur, car tout le monde ne voulut plua voir en lui qu'un traître; repoussé par ses concitoyens, couvert du mépris public, il finit par tomber dans une profonde misère, et on le vit quelques années après, rongé de vermine, mendier son pain dans la ville où il avait siégé autrefois comme législateur. Cette exécution, fruit des frayeurs des autorités coloniales, toujours plus impitoyables que celles des métropoles, ne fit que mettre davantage au jour l'esprit de l'administration et la dépendance honteuse des tribunaux, qui avaient fermé les yeux sur les violations les plus flagrantes des régies imposées par la sagesse des lois pour la protection de l'innocence.
Note 7: (retour) Procès de David McLane.
Note 8: (retour) Gazette de Québec.
Plus le pouvoir devenait absolu moins la représentation nationale avait d'empire. Une grande retenue caractérisait depuis un an ou deux toutes les démarches de l'assemblée, qu'on s'était mis à accuser de révolte chaque fois qu'elle voulait montrer un peu d'indépendance. Quoique l'on fut loin du théâtre de la guerre, les gouverneurs représentaient constamment les ennemis comme à nos portes, comme au milieu de nous. C'était la politique que le gouvernement, entre les mains de l'aristocratie, suivait en Angleterre pour faire repousser les idées républicaines de la France. La mission des chambres semblait devoir se borner à passer des lois pour augmenter les subsides et les pouvoirs de l'exécutif rempli d'appréhensions vraies ou simulées. Parmi ces lois exceptionnelles, il s'échappa quelquefois des délibérations législatives, des décrets d'une utilité pratique. Tels furent l'établissement pour la première fois dans les prisons de ce pays, des salles de correction ou de travail forcé, institution favorable à la régénération du condamné, et le règlement des poids et mesures, objet qui devenait de plus en plus nécessaire par l'accroissement du commerce.
Pendant ce temps-là, le revenu public augmentait toujours avec les anciens impôts. De 14,000 louis qu'il était en 97, il monta en 1801 à 27,000 louis. Mais les dépenses du gouvernement civil qui étaient encore de 25 ou 26 mille louis en 99, furent portées tout à coup l'année suivante à 36,000 louis sans que l'on eût même demandé la sanction de la colonie pour cet accroissement fait par ordre du ministre, le duc de Portland.
Cette usurpation de pouvoir ne put troubler le calme du peuple; mais les esprits commençaient à s'agiter même là où la concorde n'avait jamais cesser de régner, entre le gouverneur et son conseil.
Il paraît que le bureau chargé de la régie des terres, composé d'une section de ce conseil, se rendait coupable d'abus et de prévarications dont le public ne connaissait pas encore toute l'étendue. Le juge en chef Osgoode en était le président. Les membres sous divers prétextes et sous des noms empruntés, s'étaient fait accorder à eux-mêmes, ou avaient fait accorder à leurs amis de vastes étendues de terres en diverses parties du pays. Dans tous les temps les plus grands abus s'étaient commis dans ce département, et l'on avait vu des membres de l'ancien conseil législatif s'entendre avec des officiers publics à Londres, qui avaient l'entrée des bureaux du ministère, pour s'en faire accorder sur le lac S.-François, sur le chemin postal ouvert entre Québec et Halifax et dans tous les endroits où ils pouvaient en avoir. 9 Ces abus allaient toujours en augmentant. Ceux qui en profitaient, mettaient en même temps tous les obstacles possibles à ce qu'on en accordât aux Canadiens sous le prétexte qu'ils allaient y porter leur langue leurs usages et leur religion; ce qui était alors un motif suffisant d'exclusion, sinon ouvertement avoué du moins tacitement reconnu; mais dans la conviction secrète qu'en les conservant, ils obtiendraient plus tard des prix plus élevés. Ces terres avaient été divisées en townships, et on avait donné aux nouvelles divisions des noms anglais, chose indifférente en elle-même en apparence, et qui cependant contribuait à en éloigner les cultivateurs canadiens, qui n'en comprenaient pas bien la tenure avec le système de quit-rents qui y était attaché. Ces entraves artificielles dépassèrent le but. Des Canadiens, surtout des Américains pénétrèrent dans les forêts de la rive droite du St.-Laurent, près de la frontière des Etats-Unis, et s'y choisirent des fermes sur lesquelles ils s'établirent sans titre. Le gouverneur auquel ces derniers s'étaient plaints de la conduite du bureau, transmit dès la première année de son administration, une dépêche à Londres dans laquelle il blâmait tout le système comme contraire à l'honneur et à l'intérêt de l'empire, et comme nul sous le rapport fiscal, puisqu'il ne produisait rien. Il embrassa avec chaleur surtout la cause de ces émigrés qu'on nommait loyalistes dès qu'ils mettaient le pied sur le territoire canadien. Ses représentations firent effet. Il revint d'Angleterre en 98 des instructions fort amples pour remédier au mal qu'il avait signalé, et qui déplurent extrêmement au bureau des terres. De là la brouille de ce bureau avec le gouverneur et du gouverneur avec le conseil exécutif, l'âme et le nerf de l'oligarchie qui commençait à peser de tout son poids sur le pays, et qui se crut obligé de soutenir en cette circonstance un département formé de ses principaux membres. Il s'était déjà établi une communauté d'opinions et d'intérêts entre les fonctionnaires publics et la majorité de ce conseil, communauté qui a fini ensuite par maîtriser complètement la marche de l'administration en s'emparant de l'esprit des gouverneurs et en influençant continuellement les ministres, dont cette oligarchie employait toute son habileté à nourrir les craintes et les antipathies nationales contre la masse de la population. Le conseil exécutif, qui avait ignoré jusque là la dépêche du gouverneur, se tint pour offensé par son silence; il fut froid d'abord à son égard et ensuite il lui fit une opposition ouverte et redoutable sous la direction de son président, M. Osgoode, fils naturel de George II, dit-on, qui avait des talens, et ce qui était mieux dans, la circonstance des amis puissans à la cour. Entraîné par ses inspirations, le conseil refusa de publier les nouvelles instructions et compléta ainsi la rupture entre ces deux hommes. L'Angleterre, pour éviter les conséquences de leur désunion dans la colonie où chacun avait son parti, jugea nécessaire de les rappeler tous deux, ce dernier conservant ses appointemens.
Note 9: (retour) Correspondance manuscrite du conseiller Finlay, etc.
Cette querelle fit peu de sensation dans le public parce que la presse étant muette et les débats s'étant passés dans les hauts lieux de l'administration enveloppés comme à l'ordinaire dans les nuages du mystère, le peuple n'en connaissait pas bien le sujet ni les motifs. En outre, quoique ce gouverneur fût en difficulté avec les principaux fonctionnaires, il n'avait point cherché d'appui dans la population. Au contraire, il se montrait fort hostile à son égard, et soit mauvaise interprétation donnée à ses instructions, soit toute autre raison, il accueillit très mal la demande des catholiques d'ériger de nouvelles paroisses pour répondre à l'augmentation de leurs établissemens qui se formaient de proche en proche tout autour de la partie habitée du pays. Ni les réclamations du peuple, ni celles du clergé, ni même celles de l'assemblée ne parurent le faire revenir du refus qu'il avait donné à ce sujet contrairement à l'ordonnance de 91. Il fallut que les catholiques recourussent au régime insuffisant des missions comme aux premiers jours de la colonie.
Une pareille conduite n'était pas de nature à augmenter sa popularité. Aussi vit-on sa retraite avec plaisir, et sir Robert Shore Milnes prendre en 99 les rênes de l'administration en qualité de lieutenant-gouverneur. Celui-ci en ouvrant les chambres dans le mois de mars remercia dans son discours le Canada des témoignages de fidélité qu'il venait de donner au roi et aux intérêts des sociétés civilisées on souscrivant généreusement des sommes assez considérables pour le soutien de la guerre contre la révolution française.
Cette Souscription avait été commencée par le parti anglais dans le but de capter exclusivement la bienveillance du gouvernement en montrant un zèle plus empressé que celui des Canadiens. La chose s'était faite rapidement, et les auteurs du projet s'étaient donnés peu de peine pour la rendre générale parmi la population. M. de Bonne voulut faire ajouter, lorsque la partie de l'adresse relative à ce sujet, fut soumise aux voix, que l'on regrettait que, par le peu de moyens de la majorité des habitans, les contributions eussent été si modiques, et par le mode adopté pour les recueillir, si peu générales; mais son amendement fut écarté, la majorité ne pensant pas qu'il fut de sa dignité de donner des explications à ce sujet. Les Canadiens du reste se rappelaient que le gouvernement n'avait pas pris tant de précaution contre les révolutionnaires américains à la suite des événemens de 75, quoique le danger fût bien plus imminent. Mais ils ne purent plus avoir de doute lorsqu'ils virent ceux qui n'avaient jamais cessé de chercher à les dominer, oubliant leurs écarts de 75, commencer à se donner le nom de «loyaux» par excellence et de donner aux Canadiens celui de «rebelles.» Ce machiavélisme sur lequel l'Angleterre ferma complaisamment les yeux, a duré jusqu'à nos jours qu'il a été flétri par lord Durham et par lord Sydenham. Il paraît que l'esprit de querelle qu'on venait de voir éclater entre le dernier gouverneur et son conseil, se répandit jusqu'aux chambres. L'assemblée montra dans cette session moins de calme et d'unanimité que de coutume. La question des biens des jésuites et une question de privilèges touchant un membre condamné pour escroquerie à une sentence emportant flétrissure, et qu'elle voulut exclure de son siège, excitèrent de vifs débats, dans lesquels les deux partis manifestèrent la même ardeur que dans les discussions de 92 sur l'usage de la langue française.
La question des biens des jésuites étaient d'une bien plus haute importance. Le dernier membre de cette société religieuse, le P. Casot, venait de mourir. Sa mort fournit une nouvelle occasion de réclamer les biens de son ordre pour les conserver à leur destination primitive. Lorsqu'un membre, M. Planté, voulut en faire la proposition, M. Young, l'un des conseillers exécutifs, se leva et annonça qu'il était chargé de déclarer que le gouverneur avait donné les instructions nécessaires pour en faire prendre possession au nom de la couronne. On affectait alors ce ton de commandement absolu, et l'on aurait cru déroger en donnant les motifs de ses résolutions. Celle du gouverneur pourtant était fondée sur des instructions récentes et sur d'autres plus anciennes données à lord Dorchester et qui lui enjoignaient de supprimer cette société et de prendre possession de ce qu'elle avait pour en faire l'usage que la couronne jugerait à propos plus tard. De grands débats s'élevèrent sur la proposition de M. Planté, qui fut adoptée finalement par une majorité de 17. Un seul Canadien catholique vota contre, le solliciteur-général Foucher. La chambre passa ensuite à la majorité des deux tiers, une adresse au gouverneur pour demander copie des titres de la fondation de l'ordre, adresse à laquelle celui-ci répondit affirmativement tout en faisant observer que c'était sur les instructions du roi transmises dans le mois d'avril précédent, qu'il avait agi, et que c'était à la chambre à considérer s'il était compatible avec le respect qu'elle avait toujours montré pour le trône de persister dans sa demande.
Pendant la discussion, M. Grant avait proposé de présenter une adresse pour exposer au roi l'état déplorable dans lequel était tombée l'éducation depuis la conquête, et pour le prier, tout en reconnaissant la légitimité de son droit, d'approprier les biens des jésuites à l'éducation de la jeunesse. Mais cette motion avait été écartée sur un amendement de M. Planté portant que l'on devait remettre à un autre temps l'examen des prétentions de la province sur ces biens. La répugnance de reconnaître la légitimité du droit de la couronne à leur propriété, et la crainte de les voir placer sous l'administration de l'Institution royale, commission protestante alors en projet et entre les mains de laquelle on songeait à placer l'instruction publique, motivèrent le vote des catholiques dans cette occasion. La question de l'éducation se trouva par là ajournée à un temps indéfini.