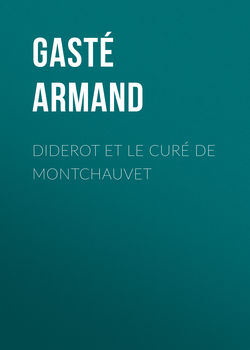Читать книгу Diderot et le Curé de Montchauvet - Gasté Armand - Страница 2
DIDEROT ET LE CURÉ DE MONTCHAUVET 1
I
ОглавлениеL'abbé Le Petit3, – c'est le nom de notre curé, – s'ennuyait à mourir dans le village où l'avait enterré son évêque4. Il avait beau monter sur les âpres rochers qui dominent le presbytère et interroger l'horizon, il ne voyait venir personne qui fût digne de le comprendre et sût goûter les vers qu'il composait dans sa morne solitude. Et laissant tomber ses regards sur les masures de ses paroissiens: «Ici, il n'y a que moi d'homme d'esprit, se disait-il. Point de société!.. Pour toute ressource, le magister, c'est-à-dire un paysan habillé de noir!»
Un beau jour, l'abbé Le Petit, n'y pouvant plus tenir, boucla sa valise et partit pour Paris. A Paris, en effet, il trouverait un de ses anciens camarades de séminaire, l'abbé Basset5, professeur de philosophie au collège d'Harcourt. L'abbé Basset avait de belles relations: il procurerait certainement un éditeur à son confrère. L'éditeur trouvé, le livre prôné par les gazettes s'enlevait en un clin d'œil; les salons se disputaient l'illustre compatriote de Malherbe et de Pierre Corneille; et qui sait? l'Académie ne se faisait pas trop prier pour lui offrir un de ses quarante fauteuils.
Tels étaient les beaux rêves que le curé de Montchauvet confiait à l'abbé Basset, et que celui-ci, en se promenant avec lui, au Luxembourg, par une belle matinée d'hiver, écoutait d'une oreille trop indulgente.
Au détour d'une allée, on rencontre Diderot. Diderot, qui demeurait à quelques pas de là, sur la hauteur d'où il avait tiré son surnom de Philosophe de la Montagne, aimait à se promener le matin au Luxembourg. L'abbé Basset, qui était fort lié avec lui, connaissait ses habitudes. Ce n'était pas sans intention, peut-être, qu'il conduisit, ce jour-là, sur le chemin du philosophe, le curé de Montchauvet, avide de connaître les grands esprits du siècle, avide surtout d'en être connu. L'abbé Basset présente son ami à Diderot. Le curé nage dans la joie; il pâlit d'aise, et son nez, – un nez extrêmement long, dit la chronique, – est dans un mouvement perpétuel. La conversation est bientôt liée. L'abbé Le Petit raconte d'un trait ses infortunes: «Je m'étiolais à Montchauvet, le plus triste lieu du monde; mes talents y étaient enfouis. Mais, Dieu merci! j'en suis hors, et je me réjouis, monsieur, d'avoir fait connaissance avec un homme de votre réputation, afin de vous demander votre avis.
– Mon avis, dit le philosophe, et sur quoi, monsieur l'abbé?
– Sur un madrigal de sept cents vers, que j'ai fait dernièrement.
– Un madrigal de sept cents vers! Et sur quel sujet, je vous prie?
– Voici la chose, dit le curé en souriant d'un air malin: mon valet a eu le malheur de faire un enfant à ma servante, et cela m'a donné un assez beau champ, comme vous allez voir.
Et, disant cela, il tire de la poche de sa soutane un grand cahier de papier. Diderot recule épouvanté; puis se ravisant:
– Monsieur le curé, dit-il, je vous trouve bien blâmable d'employer vos loisirs à de pareils sujets.
L'abbé Le Petit commençait à rougir de colère; son nez s'agitait, menaçant…
– Quand on a un génie aussi sûr que le vôtre, poursuivit Diderot, on doit faire des tragédies, et non pas s'amuser à des madrigaux.
Le curé de Montchauvet, agréablement flatté de ce compliment inattendu, devint radieux: ses yeux brillaient d'un éclat inaccoutumé, son grand nez se dilatait pour mieux aspirer l'encens. Il voulait remercier Diderot; celui-ci ne lui en laissa pas le temps: – Permettez-moi de vous dire que je n'écouterai pas un seul vers de votre façon, avant que vous ne nous ayez apporté une tragédie. – Vous avez raison, répliqua le curé;… je suis trop timide. Puis, remettant dans la vaste poche de sa soutane son long poème, il salua poliment Diderot. Le philosophe, en s'en allant, échangea avec l'abbé Basset un sourire que le bon curé n'aperçut pas, ou dont il ne comprit pas la signification.
C'était un sourire de contentement. Diderot s'était débarrassé du même coup, (il le croyait du moins), d'un madrigal de sept cents vers et d'un importun.
Quelques mois se passent. Diderot, bien tranquille dans son cabinet, travaillait, sans doute à ses Pensées sur l'interprétation de la nature, lorsque, sans se faire annoncer, l'abbé Le Petit se présente avec un énorme manuscrit sous le bras. Qu'on juge de la surprise de Diderot. – Comment, monsieur le curé, c'est bien vous que je vois! Je vous croyais depuis longtemps en Normandie. – On ne peut vivre qu'à Paris, monsieur; j'y suis donc resté, et, suivant vos conseils, je me suis mis avec ardeur au travail. Je vous apporte… – Encore un madrigal? s'écria Diderot; non, monsieur le curé, vous savez nos conventions. Je n'écoute pas un vers de vous, que vous ne m'ayez apporté une tragédie. – C'est justement… – Quoi! C'est une tragédie? – Oui, monsieur, David et Bethsabée…
Diderot faillit tomber à la renverse.
– Avez-vous le loisir de m'écouter? poursuivit l'abbé, impitoyable.
Il n'y avait pas à reculer, il fallait bien essuyer cette lecture.
– Monsieur le curé, répondit le philosophe, que diriez-vous si, dimanche, je vous présentais à nos amis, et si je vous donnais pour juges les plus grands esprits dont notre siècle s'honore?.. Allons, c'est entendu, je vous mènerai dans le salon de M. le baron d'Holbach. Vous y entrerez inconnu; mais, je vous le jure, vous en sortirez célèbre.
– Monsieur, balbutia l'abbé, que de grâces…
– Trève de compliments! C'est moi qui suis votre obligé. Ne pas produire au grand jour un poète de votre force, mais ce serait un crime!.. Allons, adieu, monsieur le curé, ou plutôt, au revoir… A dimanche! Je vous attends chez moi.
Le curé fut exact au rendez-vous. Diderot avait prévenu ses amis, les Encyclopédistes. On sait que le baron d'Holbach les recevait à dîner deux fois par semaine, ce qui le faisait appeler par l'abbé Galiani «le maître d'hôtel de la philosophie».
Ce jour-là – c'était justement le dimanche gras – les convives du baron d'Holbach étaient quinze à vingt. Dans le riche cabinet, où le richissime philosophe venait de faire placer sa récente acquisition, la Chienne allaitant ses petits, un des chefs-d'œuvre du peintre Oudry, on voyait réunis, sans compter Diderot et le maître de la maison, J. – J. Rousseau, d'Alembert, Duclos, Marmontel, Helvétius, de Jaucourt, Raynal, Morellet, de la Condamine, M. de Gauffecourt, M. de Margency, etc.6.
Le curé de Montchauvet est introduit. On lui fait fête; on l'invite à s'asseoir. Il promène ses regards de tous côtés: il ne voit que des visages riants; cela l'encourage. Pourtant, il aperçoit dans un coin du salon une figure renfrognée. C'était J. – J. Rousseau, qui flairait une mystification, et qui, avec sa probité à toute épreuve, était résolu à faire le rôle d'honnête homme. – C'est un jaloux, se dit l'abbé; mais qu'importe?.. Et il déroule lentement son manuscrit. – D'abord, messieurs, leur dit-il, je dois vous lire l'épître que je me permets d'adresser à Madame de Pompadour.
Cette épître commençait par un vers assez singulier:
Rentrez dans le néant, race de mendiants…
C'était pour flétrir les poètes qui font des dédicaces en vue de gagner de l'argent. – Oh! oh! Monsieur le curé, lui dit-on de toutes parts, l'épithète n'est-elle pas un peu violente? – Non, messieurs,
Point d'enfant d'Apollon, s'il ne rime gratis.
Et, continuant sa lecture, il déclame avec emphase ces deux vers:
Tout ainsi comme Icare, parcourant la lumière,
Dans un rayon brûlant vit fondre sa carrière…
– Voilà, lui dit Marmontel, un vers admirable! mais ces sortes de vers doivent être bien difficiles à trouver. – Cela est vrai, répondit le curé en pâlissant de joie et de vanité; mais aussi est-on bien content quand on a trouvé.
L'épître finie, le curé, avant de commencer la lecture de sa tragédie, pria la société de lui permettre d'exposer rapidement sa théorie du poème dramatique. Corneille l'a fait, ajouta-t-il: compatriote de Corneille, ne puis-je pas faire comme lui? – Sans aucun doute, monsieur l'abbé, s'écrièrent en chœur tous les convives. – Vils flatteurs, murmurait dans son coin le citoyen de Genève. – Ma théorie est bien simple, messieurs. Donnez-moi un sujet quelconque.
– Balthazar, dit une voix.
– Balthazar, soit! Eh bien! vous savez, messieurs, que, pendant le souper de ce roi impie, on vit une main écrire sur les murs les mots: Mané, Thécel, Pharès. Il s'agit donc de savoir si le roi soupera ou non; car, s'il ne soupe pas, la main n'écrira pas. Or je n'ai qu'à inventer deux acteurs. Le premier veut que le roi soupe, le second ne le veut pas, et cela alternativement. Si moi, poète tragique, je veux que le roi soupe, celui-là parlera le premier. Ainsi:
Ier acte: Le roi soupera;
2e acte: Il ne soupera pas;
3e acte: Il soupera;
4e acte: Il ne soupera pas;
5e acte: Il soupera.
Si, au contraire, je ne veux pas que le roi soupe, voici quel sera mon plan:
Ier acte: Il ne soupera pas;
2e acte: Il soupera;
3e acte: Il ne soupera pas;
4e acte: Il soupera;
5e acte: Il ne soupera pas.
Voilà, messieurs, tout le mystère.
Un murmure approbateur accueillit ces paroles. Le poète commença alors la lecture de sa tragédie. Tous les philosophes, rangés en cercle, écoutaient attentivement. M. de la Condamine, entre autres, avait tiré le coton de ses oreilles pour mieux entendre7; mais, dès la première scène, sa patience était à bout. Dans la seconde, David paraît; il se plaint que l'amour le tourmente jour et nuit et l'empêche de dormir. Il a cependant de quoi s'occuper; il a de nouveaux ennemis, dit-il:
Quatre rois, vive Dieu! ci-devant mes amis…
– Vive Dieu! s'écria M. de la Condamine, et pourquoi pas Ventre Dieu? Et, remettant le coton dans ses oreilles, il sortit brusquement.
– Voilà, dit le curé froidement, un homme qui ne sait pas que Vive Dieu! est le serment des Hébreux.
Ces quatre rois, «ci-devant les amis» de David, ont embrassé la querelle du barbare Hanon…
A ce mot malencontreux, cinq ou six auditeurs se récrient.
– Ah! messieurs, dit le curé d'un air de profonde pitié, ce nom sonne mal à vos oreilles, apparemment à cause de la ridicule équivoque de celui d'ânon, animal si connu et si commun. Pour moi, je pense qu'un nom, par lui-même, n'a rien qui doive offenser. L'Écriture s'en est servie; elle a bien les oreilles aussi délicates que les nôtres.
– Mais, lui dit Duclos, ajoutez une lettre à ce nom, et l'équivoque cessera.
– Monsieur, répartit le curé, vous voulez sans doute que je fasse de ce personnage un Carthaginois?
Dans un autre endroit, Bethsabée, pressée par David «de le rendre heureux», veut le piquer d'honneur, et lui rappelant ses grandes actions passées, elle dit:
Vous sûtes arracher Saül à ses furies,
Où ce prince, vainqueur de mille incirconcis,
Frémissait que David en eût dix mille occis.
– Ah! Dieu! quels vers! s'écria le citoyen de Genève; et pourquoi occis? pourquoi pas tués?
– Je pourrais, riposta sèchement le curé, vous répondre que tués ne rime pas à incirconcis; mais apparemment que vous imaginez que tué et occis sont des synonymes. Apprenez, monsieur, que cela n'est pas. On dit tous les jours: Cet homme me tue par ses discours, et l'on n'en est pas occis pour cela.
– J'avoue, reprit le citoyen, qu'il doit être fort fâcheux d'être occis; mais je ne me soucierais pas même d'être tué.
Le curé de Montchauvet poursuivit sa lecture, sans s'arrêter plus qu'il ne convenait à cette misérable querelle de mots.
Arrivé à un passage où il faisait rimer angoisse et tristesse, Rousseau l'interrompit de nouveau:
– Angoisse et tristesse ne riment pas; vous êtes trop hardi, monsieur le curé.
– Trop hardi, monsieur? Cette rime est neuve; voilà tout.
– Dites étrange, monsieur le curé.
– Étrange, monsieur? Mais, vous, savez-vous bien ce que c'est que la rime?
– J'ose le croire, monsieur le curé.
– On ne s'en douterait guère, et…
La dispute allait s'envenimer: un geste de d'Holbach rétablit la paix.
– Continuez, dit-il au curé de Montchauvet, nous vous écoutons.
Vers le milieu du deuxième acte, Bethsabée dit à sa confidente:
Le roi ne m'offre plus que d'innocentes charmes.
– Pardon, monsieur le curé, interrompit un des auditeurs, charme est du masculin.
– Ah! vous le prenez comme cela, messieurs, répondit l'abbé; eh bien, dans la scène suivante, vous le trouverez masculin; j'ai tâché de contenter tout le monde.
Plus loin, il faisait rimer superflu et plus.
– Cette rime n'est pas exacte, dit Marmontel.
– Ah! vraiment; et pourquoi cela?
– C'est que superflu, étant au singulier, n'a point d's, et par conséquent ne peut rimer avec plus.
Point d's, reprit vivement le curé en mettant son manuscrit sous le nez de Marmontel, point d's! Mais je vous prie de remarquer, monsieur, que j'en ai mis une8.
Et il continua intrépidement sa lecture.
On lui avait fait croire que M. de Margency était un poète de profession, et qu'il aurait en lui un dangereux concurrent. Il n'est sorte de bassesse que ne lui fit le curé de Montchauvet. M. de Margency, comme on en était convenu auparavant, se fit le champion à outrance du poète bas-normand. Aussi, c'était vers lui qu'il se tournait de préférence.
3
Voir à l'Appendice. note 3
4
Ibid. note 4
5
Ibid. note 5
6
Voir à l'Appendice. note 6
7
Voir à l'Appendice. note 7
8
Voir à l'Appendice. note 8