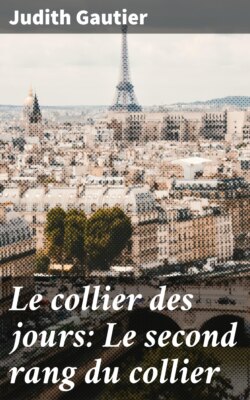Читать книгу Le collier des jours: Le second rang du collier - Gautier Judith - Страница 4
II
ОглавлениеThéophile Gautier adorait les voyages, mais il détestait, ou croyait détester la campagne.
—La villégiature qui me plairait le plus, répétait-il souvent, ce serait un entresol sur le boulevard des Italiens.
Cependant un projet imprévu prit naissance à la maison, un certain printemps, et devint le sujet de toutes les conversations: il était question de déménager, de quitter la rue de la Grange-Batelière, où nous habitions depuis plusieurs années, d'abandonner même Paris, et d'aller s'installer aux environs.
Cette idée avait été suggérée à mon père, insinuée plutôt, et presque imposée, par les directeurs du Moniteur Universel, journal officiel de l'Empire.
Elle fut d'abord accueillie sans enthousiasme, mon père ne se laissa pas convaincre facilement; mais les deux amis qui avaient résolu de le décider revenaient sans cesse a la charge.
Le journal officiel était alors pourvu d'une organisation singulière. Il avait deux directeurs. Non pas deux collaborateurs qui unissaient leurs travaux et se partageaient la besogne, mais deux maîtres successifs, indépendants l'un de l'autre. Ils régnaient chacun quinze jours par mois; quand l'un prenait possession du journal, l'autre n'y paraissait plus; et, comme les deux autocrates étaient de tempéraments très contraires, ils passaient le temps de leur toute-puissance à défaire chacun ce qu'avait fait le prédécesseur. Un de ces directeurs était Paul Dalloz; jeune, élégant, poli et pâle, avec la moustache soyeuse, de courts favoris et des cheveux noirs coquettement bouclés au fer, il avait la voix douce et le regard voilé sous de longs cils.
Son plus grand titre de gloire était exposé dans son cabinet directorial: reliés en vert, les nombreux in-folios du répertoire de jurisprudence de son père, Désiré Dalloz.
L'autre chef du Moniteur s'appelait Turgan. Trapu, nerveux, brutal, mal embouché, tout l'opposé enfin du dandy qu'était Paul Dalloz. Turgan avait étudié la médecine et affectait les allures et le parler d'un carabin; il était très autoritaire, violent et vaniteux, mais bon garçon tout de même.
Paul Dalloz avait un très somptueux appartement dans l'hôtel du Moniteur, 13, quai Voltaire; mais, sa quinzaine directoriale terminée, il devait le céder à Turgan. Sa véritable résidence était située dans le parc de Neuilly: une maison charmante, au milieu d'un beau jardin.
Pour ne se laisser surpasser en rien par son collègue, peut-être, Turgan avait installé, lui aussi, sa famille à Neuilly, du côté de Longchamp. Or, ces deux êtres, qui ne s'entendaient jamais sur rien, étaient parfaitement d'accord sur ce point: décider Théophile Gautier à venir, comme eux, habiter Neuilly.
Mais mon père ne se laissait pas persuader, malgré tous les avantages qu'on lui vantait: le voisinage du bois de Boulogne, les charmes de la rivière, la vie à meilleur compte, l'air pur, l'impression de la vraie campagne à vingt minutes à peine de Paris: Dalloz les mettait juste à parcourir la distance du parc de Neuilly au quai Voltaire, et cela sans forcer l'allure de son cheval, et Turgan affirmait que lui faisait la route en moins de temps encore.
—Mes chers amis, répondait mon père entre deux bouffées de cigare, ce séjour enchanteur peut l'être, en effet, pour des particuliers cossus, tels que vous, qui ont chevaux à l'écurie, voiture en la remise et cocher à portée de la voix. Sauter du perron de la villa dans un tilbury, toucher du bout du fouet la croupe soyeuse d'un pur sang, et, vingt minutes après, jeter élégamment les rênes au valet, pour gravir l'escalier de pierre du Moniteur, cela est faisable; mais pour un simple galapiat de lettres,—l'étymologie de galapiat semble bien être: Gaulois à pied,—c'est une autre affaire. Il faudra me soumettre au bon plaisir de l'omnibus, attendre au bord du trottoir, les pattes dans la crotte, son passage, et subir les cinquante-cinq minutes réglementaires de trimbalage, et encore s'il ne passe pas complet, auquel cas je piétinerai sous la pluie et le vent à n'en plus finir!
Là-dessus, les deux directeurs l'accablaient de reproches affectueux: comment pouvait-il s'imaginer, qu'étant ses voisins, ils le laisseraient aller en omnibus, tandis qu'ils iraient en voiture?...
—Je viendrai vous chercher chaque jour, cher maître, disait Dalloz, et je vous ramènerai.
—Me prends-tu pour un pignouf? clamait Turgan; me crois-tu capable de te laisser patauger et attraper des rhumes de cerveau, pendant que j'aurai les pieds au sec dans une bonne guimbarde?... D'abord tu n'auras pas besoin de venir tant que ça au Moniteur: nous irons cueillir ta copie chez toi, et on te dépêchera des larbins, qui t'apporteront les épreuves et attendront, pour nous les rapporter corrigées.
Mon père hochait la tête, très peu convaincu de la réalisation de toutes ces belles promesses; mais il était forcé de reconnaître qu'habiter une petite maison à soi avait un certain charme; que l'absence de voisins, et surtout l'abolition du concierge étaient à considérer; de plus, la distance débarrasserait des importuns, et Neuilly comptait déjà des habitants de choix.... Le petit Dumas, comme on appelait toujours Alexandre Dumas fils, y habitait; Charles Baudelaire avait un pied-à-terre mystérieux dans l'avenue même; Edmond About se faisait installer un grand chalet du coté de Longchamp; sans parler de nobles mondaines qui venaient passer l'été dans leurs propriétés et organisaient des fêtes fort agréables.
Mon père finit par céder: il donna congé de l'appartement, après avoir visité la petite maison qui était à louer au n° 32 rue de Longchamp, et que Turgan avait découverte.
Elle était bien lointaine, bien petite, bien médiocre; mais le jardin était très séduisant, et mon père signa le bail qui l'exilait de Paris.
Ce fut par un après-midi d'avril ensoleillé que nous quittâmes l'appartement, bouleversé et à moitié vide déjà, de la rue de la Grange-Batelière. Un fiacre à deux chevaux nous attendait au bord du trottoir, sur lequel beaucoup de nos meubles en désarroi, parmi une jonchée de paille, gênaient la circulation.
Les colis les plus précieux furent placés sur la voiture; Annette, la cuisinière, chargée d'un lourd panier contenant un dîner tout prêt, s'assit à coté du cocher; ma mère, ma sœur et moi nous montâmes dans la voiture, où Marianne, notre femme de chambre alsacienne, nous rejoignit bientôt; elle portait avec la plus grande sollicitude et toutes sortes de précautions, don Pierrot de Navarre, l'angora blanc chéri de tous, enfermé dans un panier.
Le véhicule pesant gagna les boulevards, grimpa, sans hâte, l'avenue des Champs-Elysées, atteignit enfin l'avenue de Neuilly, où il se traîna. Don Pierrot, qui en était à son premier voyage, disait son angoisse en quelques miaulements plaintifs, et le cocher se retournait vers nous pour demander d'une voix enrouée où était la rue de Longchamp.
—C'est la dernière à gauche, avant le pont de Neuilly! criait ma mère.
Ma sœur et moi nous n'avions pas vu la maison, nous ne savions pas où nous allions; mais nous étions bien amusées par la nouveauté. Cette avenue, si large, si longue et si déserte, nous paraissait imposante.
Enfin la voiture tourna; le point de vue changea brusquement et d'une façon peu agréable; le cocher retint ses chevaux, qui trébuchaient, sur une pente raide, dont les pavés inégaux nous cahotèrent violemment: on s'engageait dans une rue étroite, entre des maisons basses, noires et sordides, hors desquelles le bruit, peu habituel, d'une voiture fit surgir des femmes en camisole et une nombreuse marmaille ébahie.
Mais bientôt ce pâté de maisons ouvrières fut dépassé, la pente se nivela et l'on roula, plus doucement, sur de la terre battue. A droite, des murs de jardins et des maisonnettes bourgeoises. A gauche, à perte de vue, un parc verdoyant, clôturé seulement par un muret surmonté d'un treillage vermoulu: ce sont là les jardins de la fameuse maison d'aliénés du docteur Pinel. Devant le muret, un fossé se creuse tout empli d'arbustes, d'acacias et d'herbes folles; sous les orties et les ciguës en fleur, de vieux tessons et des débris de vaisselle miroitent.
Le fiacre s'arrêta, de l'autre côté de la rue, et nous sautâmes vite sur l'étroit trottoir, bosselé de gros pavés qui vous tortillaient les pieds, très impatientes de voir enfin notre nouveau logis.
Il est plus banal encore que nous n'avions pu l'imaginer: la maison s'aligne le long du trottoir, et la porte à deux battants, peinte en vert, s'ouvre, au ras du sol, entre deux fenêtres; mais celle de droite n'est là que pour la symétrie: c'est une fausse fenêtre dont les volets clos, peints en blanc, ne s'ouvrent pas. Des barreaux protègent celle de gauche contre l'escalade facile, qui ne serait qu'une enjambée. Un revêtement de pierraille spongieuse jaune et roussâtre, hérisse le mur à hauteur d'homme: c'est le seul essai d'ornement sur le blanc gris de la façade. Au premier, trois fenêtres, avec des persiennes, au lieu de volets pleins comme au rez-de-chaussée; puis, au-dessus, des mansardes. D'un côté, la maison joint un mur percé d'une grille en fer, que flanquent deux piliers, et d'une petite porte qui donne sur la cour.
Celle de la maison est grande ouverte, pour le va-et-vient des déménageurs, et, aussitôt qu'on l'a franchie, la disposition du logis est comprise d'un coup d'œil. C'est très simple: le vestibule et l'escalier le partagent en deux; à gauche, le salon, qui occupe toute l'épaisseur de l'édifice,—ce qui n'est pas encore grand'chose;—à droite, deux portes, celle de la cuisine d'abord, puis celle de la salle à manger; au fond, l'escalier.
—Montez don Pierrot là-haut, sans ouvrir le panier! crie ma mère, qui règle avec le cocher.
Au premier, sur un petit palier, trois portes, deux à droite, une seule à gauche: c'est par celle-ci que nous entrons dans la pièce qui va être la chambre de mon père. Tout de suite, du côté opposé à la façade, une glace sans tain, au-dessus de la cheminée, attire les regards: c'est un lumineux tableau de verdure; de grands peupliers sur le ciel bleu, un fouillis de feuillages nuancés....
Vite, un tour de clé à la porte, pour que don Pierrot ne se sauve pas, et nous dégringolons l'escalier, afin de nous jeter dans cet inconnu, de prendre possession du jardin. C'est par la salle à manger qu'on y accède: une double porte vitrée, juste au-dessous de la glace sans tain que nous venons de voir, s'ouvre sur la cour. De ce côté, la cour devient terrasse, une terrasse large, très longue, pavée, et bordée, sur le jardin en contrebas, par un mur, qui forme parapet, à droite et à gauche d'un escalier de pierre. Du haut des marches, on embrasse le jardin dans son ensemble: il paraît immense, un parc infini: car les petits treillages, verdis de mousse, qui le limitent, sont invisibles. L'escalier, assez raide, descend entre deux talus de gazon; des vases de fonte l'ornent de marche en marche.
En bas, au bord d'une pelouse toute neuve, d'un vert délicieusement tendre, un cerisier a des fleurs, ce qui nous arrache des cris de joie; puis nous nous lançons en courant sur la pente douce de l'allée. Tout est fin et léger encore, beaucoup d'arbres n'ont presque pas de feuilles et, à travers le réseau des branches, on voit des lointains de verdures plus claires, des taillis, des pelouses, de grands arbres magnifiques, des fuites de perspectives attirantes, mais qui garderont leur mystère puisqu'elles appartiennent à des enclos voisins.
Là-bas, tout au fond, la Seine doit couler derrière la colonnade des hauts peupliers.
Un bonhomme, à dos rond, qui ratisse le gravier des allées, nous salue d'un clignement d'yeux. Ce doit être le père Husson, jardinier du propriétaire, et qui, sans doute, va devenir le nôtre.
Au retour, quelque chose que nous apercevons tout à coup, nous intrigue: c'est une voûte sombre, qui apparaît comme un tunnel de chemin de fer, au bout d'une allée, à droite de l'escalier, là où finit le talus. Nous nous approchons; mais il fait bien noir là-dessous, nous n'osons pas risquer une exploration. D'ailleurs, on nous rappelle en haut: mon père, qui était resté à Paris pour surveiller la seconde escouade de déménageurs, vient d'arriver.
Dans la salle à manger, le buffet et la table sont déjà installés, le couvert est mis.
Elle n'est pas bien grande, cette salle, que je n'ai pas regardée tout à l'heure. Du plancher à mi-hauteur, une boiserie peinte, d'un ton sanguinolent qui veut imiter l'acajou, revêt les murs; deux fenêtres donnent sur la cour, très proches l'une de l'autre; à droite de la porte vitrée, dans un pan coupé qui forme niche, un poêle; à gauche, le pan coupé est rempli par deux placards superposés.
Mon père s'assied à table, à la place qu'il occupera toujours désormais, entre les deux fenêtres; le dossier de sa chaise touche presque le mur.
—Ma foi, dit-il, je ne suis pas fâché de m'asseoir, depuis ce matin que je suis debout!... Les tibias me sortent par les yeux.
Il a l'air, en effet, très las, et surtout triste.
—Père, qu'est-ce que tu as?... tu n'es pas content?...
—D'abord, je suis moulu, farci de poussière, et ensuite, dépaysé, désorienté, hors de mon assiette. J'ai horreur des bouleversements et de tout ce qui prend fin. Toi, qui n'en es qu'aux premières étapes de la vie, tu ne peux peut-être pas comprendre cela; mais quitter même un endroit où l'on n'a pas eu beaucoup d'agrément, où l'on a trimé ferme et enduré pas mal d'embêtements, c'est un arrachement pénible. Toutes sortes de fils invisibles se cassent, dans cette atmosphère où vous avez tissé lentement votre vie; vos idées, vos rêveries, vos peines et vos joies, pendant des années, ont imprégné les murs, enveloppé les objets, formé ce capitonnage particulier qui fait le bien-être du chez-soi: tout cela est disloqué, dispersé, détruit, il faut du temps pour que cela se refasse. Et puis, c'est une période de l'existence que l'on tranche, brusquement, pour la jeter dans le passé.
Si je comprenais, moi, qui avais été tant de fois transplantée!... Mais je pensais que la peine était surtout d'être séparé de ceux qu'on aime, et c'est ce que je ne sus pas exprimer.
—Cependant, ajouta mon père, je ne tiens à rien et j'adore les voyages; arrange cela comme tu voudras: l'homme est plein de contradictions!
Marianne apporta la soupe, une julienne fumante et qui embaumait. Annette avait tenu à honneur que son dîner fût aussi bon, ce jour-là, qu'à l'ordinaire, et n'avait préparé, à l'avance, que des mets qui gagnent à être réchauffés, ou qui sont meilleurs froids. Nous prenons, à table, les places que nous occuperons chaque jour: moi, à la droite de mon père, ma sœur à la gauche, ma mère à côté de ma sœur. Tout un demi-cercle reste vide.
Nous sommes tous un peu gênés, à ce commencement de dîner, affectés par ce changement si brusque, ce milieu nouveau, ces murs nus, ce parquet terne où traîne de la paille.
Ma mère récrimine contre les méfaits probables des déménageurs, elle énumère les objets cassés ou écornés, ceux qu'on ne retrouve pas.
Mon père conclut:
—La sagesse des nations l'affirme: «Trois déménagements valent un incendie».
Tout à coup, une lueur empourpre la chambre; à travers les vitres nues, des traînées rouges courent sur la table, sur nos mains, montent le long de la muraille.
—Qu'est-ce que c'est?... le feu?...
Et nous voici tous sur la terrasse; la serviette à la main.
C'est le soleil couchant, qui incendie le ciel, et ce spectacle inusité nous cause une extrême surprise. La pourpre et l'or se fondent, sous des nuages qui flambent, derrière le rideau des grands peupliers, dont les silhouettes prennent une couleur intense de velours loutre. Toutes les ramilles des arbres sont visibles, noires sur cette lumière et laissent fuser çà et là des jets de feu.
Mon père a mis son monocle, pour ne rien perdre de la vision.
—C'est superbe! s'écrie-t-il; le tableau se compose on ne peut mieux, et il est fort heureux que le soleil se couche de ce côté-là. Nous autres, Parisiens, nous finissons par oublier l'astre du jour et ne plus nous soucier des beaux effets qui accompagnent chaque soir son départ: nous ignorons les soleils couchants et la splendeur des crépuscules....
Une brise fit s'incliner, à plusieurs reprises, les hauts peupliers, dans un lent mouvement silencieux.
—Ils ont vraiment l'air de nous saluer, pour nous souhaiter la bienvenue! dit mon père. Eh bien! je me sens débarbouillé de toute la poussière par ce bain de lueurs, particulièrement superbes, et je crois que le mouvement de ces grands plumeaux, balaye les toiles d'araignées, tissées dans mon esprit par la mélancolie des regrets.
Nous nous promenons, ma sœur et moi, sur la terrasse, le long du parapet, quand tinte la clochette que fait sonner, en s'ouvrant, la petite porte de la cour, fermée seulement au pène, qui donne sur la rue près de la loge du jardinier.
Nous nous retournons, pour voir qui vient.
Deux messieurs, que nous ne connaissons pas, sont entrés. L'un, mince, grand, avec des cheveux blonds très frisés, une fine moustache, le teint sombre, presque de la même couleur que les cheveux; l'autre plus gros, très brun, les joues bleues, d'épais sourcils, de grandes oreilles et une grande bouche.
Ils s'avancent en se dandinant, les mains dans les poches, et regardant tout, autour d'eux.
—Est-ce que Théo est là? nous demande le brun.
—Non, il est à Paris. Maman est sortie aussi! Nous sommes seules à la maison.
—C'est ça, la maison? dit le grand blond en la désignant d'un geste de la tête. Et voici le jardin; ajoute-t-il en se rapprochant lentement du parapet.
Son compagnon le rejoint, et ils restent là, plantés, sans mot dire, paraissant très absorbés dans la contemplation du jardin, mais ayant l'air aussi de penser à autre chose. Le brun tient sa canne en fusil, le blond pose alternativement son index sur l'une ou l'autre de ses narines.
Appuyées l'une à l'autre, ma sœur et moi, nous nous poussons le coude, en nous communiquant des yeux, les impressions que nous causent ces singuliers visiteurs. Le blond, qui nous regarde en dessous, surprend le geste.
—Hein! vous ne nous connaissez pas, dit-il; vous vous demandez: «Qu'est-ce que c'est que ces bonshommes-là?» Eh bien, moi, je vous connais: voilà Judith, et voilà Estelle.
Il rit, découvrant des dents très blanches, un peu projetées en avant. Puis il se replonge dans son mutisme, la tête baissée, les sourcils froncés, ses yeux, d'un bleu mat, regardant comme sans voir.
Tout à coup, il les lève vers nous et nous jette cette question saugrenue:
—Savez-vous renifler?
Nous croyons avoir mal entendu, mais il ajoute, en riant de notre stupéfaction:
—C'est très utile, quand on a oublié son mouchoir.
—Je ne sais pas, moi! dit ma sœur, d'un air narquois; comment fait-on?
—Comme ça!...
Nous tournons le dos à ces messieurs, décidément bien singuliers.
—Faites-nous voir le rez-de-chaussée, dit le personnage brun de sa voix de basse.
Nous montons les deux marches, qui précèdent la porte vitrée, pour leur montrer la route.
La salle à manger n'a plus l'air si petite, maintenant que les rideaux drapent les fenêtres, que l'or des cadres rit sur les murs, et que les peintures y creusent des profondeurs. A travers les glaces du buffet, reluit une très belle argenterie ancienne: plateaux, théière, hanaps, coupes, objets d'art. Sur le poêle est posée une fontaine en vieux Rouen, qui emplit toute la niche; on y voit, sur un fond blanc, des tritons et des sirènes cambrant leurs torses.
Le monsieur blond va droit à un tableau qui représente des prunes.
—Mais c'est un Saint-Jean, cela! s'écrie-t-il, et en voilà un autre là-bas: des roses! J'aime mieux les prunes!
Nous traversons le vestibule pour entrer dans le salon.
En face de la porte, il est prolongé en reflet par une haute glace placée au-dessus d'une console dorée, sur laquelle est posé le buste en bronze de Lucius Verus. Les meubles Louis XIV, couverts de leur lampas rouge, font bon effet, rangés le long des murs, qui disparaissent sous les tableaux grands et petits. Sur la cheminée, dont la glace sans tain laisse voir d'épaisses verdures, la pendule de Boule arrondit son cadran aux chiffres bleus entre deux beaux vases à long col, en porcelaine de Chine blanche, illustrée de guerriers; mais leur monture dorée, ornée d'amours et de guirlandes, qui leur ajoute un bec et une anse, change complètement leur style.
Du côté de la rue, dans le coin sombre, près de la fenêtre, s'allonge un immense fauteuil en damas pourpre, qui fait penser à une baignoire. L'autre encoignure est emplie par un piano d'Érard, de forme surannée, carré et plat, sur lequel s'entassent toutes sortes de livres et de partitions.
Mais les visiteurs inconnus donnent toute leur attention aux tableaux. La Lady Macbeth et le Combat du Giaour de Delacroix, la Panthère Noire de Gérôme, les Diaz, les Rousseau, les Leleux, les intéressent vivement.
Devant la console est posée, sur un socle de bois noir, une statue en bronze, demi-nature, représentant une femme assise, qui tient un masque ricanant, et qui pleure, désespérément, le menton dans sa main.
—De qui est-ce, cela? demanda le grand brun.
—De Préault. C'est la Comédie humaine, un projet, je crois, pour le tombeau de Balzac; mais ça n'a pas servi, et Préault l'a donné à mon père.
—Elle a l'air joliment embêtée, la pauvre dame! tandis que son masque se fiche d'elle, dit le monsieur blond. Jean qui pleure et Jean qui rit!...
Brusquement il cherche la sortie:
—Car nous ne sommes pas entrés par la vraie porte....
Dans la rue, ils nous tendent la main.
—Nous reviendrons, dit le personnage brun.
—Moi, j'habite là, presque en face de la rue de Longchamp, de l'autre côté de l'avenue. Vous voyez, nous sommes voisins. Dites à papa, que ceux qui sont venus pour le voir, c'est le père Lavoix et le petit Dumas....
La maison s'arrange peu à peu: tout le monde y met la main. Marianne se multiplie, coud des rideaux, plante des clous, dégringole et remonte l'escalier vingt fois dans une heure.
Mon père a mis son monocle carré devant son œil et le retient d'un froncement de sourcil. Il surveille le travail, dirige la belle ordonnance des tableaux, d'après le principe établi: «Toujours aligner les cadres par le bas.»
Mais il est difficile de suivre la règle, sans exception. Il y a trop de choses à placer et certaines toiles se logent si bien dans les vides!
Déjà, les murs de l'escalier disparaissent sous les gravures et les esquisses: c'est très gai et on ne peut s'empêcher de flâner, en se laissant glisser le dos à la rampe, lorsqu'on descend. L'histoire d'Othello, racontée par Théodore Chasseriau en nombreuses eaux-fortes, qu'encadre une bande d'or grenu, se déroule de marche en marche, et, avant d'avoir lu le drame, je savais par cœur toutes les légendes des scènes illustrées.
Il y a aussi une gravure d'après le Laocoon, une tête de Léda plus grande que nature, très violacée, et qui lève de gros yeux humides vers le Cygne; une délicieuse Charlotte Corday, dont nous voudrions bien avoir le bonnet pour nous en coiffer Hamlet, qui crie: «Un rat! un rat!» et tant d'autres choses, qu'on ne finit pas de voir....
Les deux chambres, à gauche du palier, n'en forment plus qu'une: mon père a fait abattre la cloison, qu'il a remplacée par un rideau, en reps grenat sombre. Il est ainsi un peu plus à l'aise. Son grand lit Louis XIII, à colonnes torses, à baldaquin en chêne découpé à jour est placé dans l'angle, près de la fenêtre de la rue qui fait face à la glace sans tain. Le côté donnant sur le jardin est son cabinet de travail, qu'il peut isoler en fermant le rideau. Il y a installé la bibliothèque des livres reliés, et pendu aux murs les tableaux qu'il préfère. Mais tant de livres ne trouvent pas leur place; tant de toiles vont rester par terre!... La maison est trop petite. On va essayer de l'agrandir un peu.
Après des pourparlers avec le propriétaire, on a obtenu la permission—à la condition de tout payer, bien entendu!—d'embellir son immeuble, en surélevant une partie du second étage pour construire un atelier. Les ouvriers y sont déjà. Ce ne sera pas long. L'atelier, placé au-dessus du salon, à deux étages de distance, doit être de la même dimension: il n'aura pas d'ouverture sur la rue, mais un vitrage tiendra toute sa largeur du côté des grands peupliers.
Au jardin, bien fleuri maintenant, il y a un hamac, suspendu à deux acacias; une tonnelle, couverte de vigne, avec des ébauches de raisin, sous laquelle on prend quelquefois le café. Le tunnel inquiétant n'a plus de secrets pour nous. Il passe sous la terrasse et rejoint le sous-sol de la maison,—un large cellier, où des cloisons de chêne forment, d'un côté, deux caves fermées à clé.—Le long du tunnel sont rangés des pots à fleurs vides, la brouette et les outils du jardinier. Le poulailler est auprès, adossé au mur: une vingtaine de volailles s'ébattent dans un carré treillage; les plus remarquables sont des poules nègres, toutes blanches, mais qui laissent voir une peau bleue comme les prunes de Monsieur, quand on souffle dans leurs plumes, qui sont des poils.
Don Pierrot de Navarre est très heureux de son nouveau séjour: il bondit sur les pelouses, court après les papillons et s'intéresse beaucoup aux mœurs des oiseaux. Une chatte abandonnée a été recueillie et appelée Grognette. Il y a eu mariage entre elle et Pierrot, qui est père d'une jolie houppe à poudre de riz, laquelle à été nommée Séraphita.
Et Mlle Huet, notre institutrice au nez bourbonien?... qu'était-elle devenue? Elle avait disparu, dans ce bouleversement. Certainement, on avait assez d'elle. Le départ de Paris était un prétexte merveilleux de rupture et on ne le laissa pas échapper. Mais on ne nous expliqua rien. Mlle Huet ne revint pas, et on ne parla plus d'elle.
Nous avions repris, tout naturellement, notre vie de libre flânerie: tant de choses nous occupaient, si nouvelles encore! Et quand nous étions seules à la maison, fatiguées de tourner dans le jardin, de regarder les poules et d'aller voir vingt fois dans leur nid si elles avaient pondu, nous cédions aux instances de Marianne, qui nous suppliait de venir lui lire, un peu, comme autrefois.... Nous nous installions dans la cuisine, car Annette, la cuisinière, quoique moins lettrée que Marianne, voulait entendre aussi.
Annette était une petite personne mignonne et grassouillette, avec une poitrine rebondie, très serrée dans son corset, et un cou blanc sur lequel le menton se doublait quand elle baissait la tête; propre, un peu compassée et très susceptible, elle se fâchait pour rien.
Nous nous asseyions sur le rebord de la fenêtre ouverte, cette fenêtre donnant sur la cour, par laquelle nous passions si souvent, en des sauts prodigieux, et que les bonnes, revenant de la pompe, enjambaient péniblement.
C'était toujours George Sand qu'il fallait relire, et comme, à la fin, nous en étions lassées, nous imaginâmes déjouer quelques scènes des romans: c'était plus nouveau et bien plus amusant. Dans Valentine surtout, nous étions superbes, Marianne ne pouvait cacher son émotion: son petit nez en trompette frémissait, entre ses belles joues rouges, et ses jolis yeux noirs s'emplissaient de larmes. Annette elle-même était captivée: debout, la cuiller de bois à la main, elle semblait changée en statue. Mais c'était toujours elle qui rompait le charme:
—Ma julienne qui bout trop vite! s'écriait-elle tout à coup. Vous me rendez folle avec vos histoires!...
Et nous nous sauvions, pour aller lire quelque livre moins connu.
Mon père proclamait que la lecture est la clé de tout, et que la chose la plus merveilleuse, c'est qu'un enfant puisse apprendre à parler et à lire: aussi laissait-il la bibliothèque à notre disposition et nous poussait-il à y fouiller souvent. Nous avions déjà énormément lu. Après Walter Scott et Alexandre Dumas, c'étaient Victor Hugo, Balzac, Shakespeare,—à mesure que paraissait la traduction de François-Victor Hugo,—et, à travers le merveilleux style de Baudelaire,—Edgar Poë, qui nous passionnait spécialement.
Notre ardeur à dévorer les livres enchantait mon père, mais «les personnes sérieuses» trouvaient ce genre d'éducation parfaitement absurde et même criminel. Il n'aimait pas la discussion et ne savait guère imposer sa volonté. C'est pourquoi, à regret, il nous laissa mettre dans des pensionnats dont on lui vantait les mérites, l'avenue de Neuilly ayant le monopole des institutions de premier ordre. Externes d'abord, nous allâmes chez madame Liétard, une noble personne, qui, par amour des enfants et pour se consoler de la perte des siens, avait fondé cet établissement, où l'on était vraiment gâté plus que chez soi; puis pensionnaires, chez une madame Biré. Elle portait une perruque bouclée,—«un tour en acajou ronceux», disait mon père, qui avait une aversion spéciale pour cette dame.
Ces tentatives ne furent pas de longue durée: mon père trouvait vraiment la maison trop déserte et trop triste, sans le mouvement et le bruit que nous y mettions et, pour être sûr de nous garder, il eut un jour une triomphante idée, celle de faire lui-même notre éducation:
—J'en suis aussi capable que vos sous-maîtresses!... Et, bien que je ne sois pas même bachelier, si vous en saviez autant que moi, il me semble que ça ne serait pas mal.
Le principe ordinaire d'instruction qui consiste à entasser pêle-mêle dans la mémoire des notions succinctes sur toutes sortes de sujets lui semblait absurde:
—La science abrégée, et l'histoire ramenée à un point de vue général, n'intéressent pas, disait-il, et c'est pour cela que tout ce que l'on apprend en classe est si vite oublié. Ce travail si pénible, à un âge où l'on a un besoin impérieux d'activité physique, est, la plupart du temps, absolument perdu et l'on eût mieux fait de laisser les enfants jouer aux barres ou au cheval fondu, ce qui leur eût au moins procuré de l'agrément et donné de la vigueur. Il vaut mieux savoir une seule chose, à fond, que d'apprendre par cœur la liste de toutes celles qu'on ne saura jamais.
Il ne voulait donc enseigner qu'une seule chose à la fois et, cherchant quelle était la science la plus utile à connaître, celle par où il fallait commencer, il décida que c'était l'astronomie.
Alors, lui, le forçat de la «copie», lui qui détestait par-dessus tout écrire, même la plus courte lettre, il se mit à rédiger, chaque jour, une petite leçon, où il résumait, de la façon la plus claire, les premiers principes de la mécanique céleste. Cela faisait, de sa fine écriture, quinze à vingt lignes, sur une feuille de papier à lettre. Il développait, de vive voix, la leçon, que nous devions apprendre par cœur. De Paris, il nous apportait des images coloriées, enchâssées dans du papier noir, et transparentes. On y voyait le système solaire, les planètes et leurs satellites, Saturne avec ses anneaux, la lune et les éclipses. Cela nous intéressa énormément, à tel point même que, pour ma part, je trouvai bientôt la leçon trop courte, et j'en réclamai de plus longues, avec cette violence qui m'avait valu naguère le surnom d'Ouragan. Je voulais toute l'astronomie, tout de suite, et non pas miette à miette, comme cela, et jour à jour.
«Épilepsie—Catalepsie», avait coutume de dire mon père, pour définir mon caractère d'alors, qui me faisait tantôt exaltée et enthousiaste, tantôt morne, indifférente et dédaigneuse: il m'incitait, charitablement, à choisir un terme entre ces deux extrêmes. Mais je lui répondais que c'était là une idée digne d'un classique, et qu'un romantique comme lui savait bien que rien n'est plus bourgeois que le juste milieu.
Cette fois, il favorisa «l'épilepsie», en me livrant les meilleurs et les plus récents ouvrages sur l'astronomie.
Ce fut une vraie passion qu'il éveilla en moi. Il n'était plus question que de cela; je travaillais du matin au soir; les livres les plus arides, les plus obscurs ne me rebutaient pas, je m'acharnais à les comprendre, et bientôt je fus singulièrement renseignée sur les choses du ciel.
Mon père me fit alors cadeau d'un télescope, ce qui faillit me rendre folle de joie. C'était un bon instrument, qui permettait de voir les taches du soleil, les anneaux de Saturne, les satellites des planètes et les montagnes de la lune. Il était enfermé dans une boîte noire qui ressemblait assez à un cercueil d'enfant.
La nuit, à l'heure du lever des planètes, quand tout dormait dans la maison, je sortais de mon lit, et, avec mille précautions pour ne rien faire craquer, je descendais l'escalier. Dans le salon, je cherchais à tâtons le télescope, dont je connaissais bien la place, et j'empoignais la boîte très lourde que je pouvais à peine porter. C'était toujours la porte-fenêtre de la salle à manger qui, en grinçant, me trahissait: les volets, qu'il fallait pousser avec force, avaient, en s'ouvrant, une sorte de miaulement très particulier, que je ne pouvais éviter.
Aussi à peine avais-je monté le télescope sur son pied de cuivre, au bord de la terrasse, le seul endroit d'où l'on vit bien le ciel, que ma mère apparaissait, en chemise de nuit, une bougie à la main, dans le cadre de la porte.
—Qu'est-ce que tu fais là?...
—Je note la position des satellites de Jupiter.
—C'est une jolie heure pour réveiller les gens et courir la pretentaine!
—Est-ce ma faute si les étoiles ne brillent pas en plein midi?
—Tout cela est bel et bon, mais tu vas aller les voir dans ton lit.
Et il fallait remettre le télescope dans sa boîte noire, sans avoir vu Jupiter....
Dès le matin, quand nous dormons encore, retentissent dans la maison des déclamations bizarres et d'extraordinaires chansons.
C'est le père, qui, toujours levé bien avant les autres, charme sa solitude, et essaie aussi, sans en avoir l'air, de tirer les paresseux de leur sommeil.
Il s'ennuie tout seul, et surtout il a faim. Pourtant il professe le plus profond mépris pour ce que l'on appelle «le petit déjeuner»: il veut le grand, tout de suite. Après douze ou quatorze heures de jeûne, son appétit réclame autre chose que ces fallacieuses tisanes que l'on vous apporte au lit, comme à des malades, avec quelques minces feuilles de mie de pain beurrées. Il lui faut des nourritures autrement substantielles: le large bifteck, épais de trois doigts, et le copieux macaroni. Mais il lui est impossible d'obtenir ces choses avant dix heures: personne n'est prêt, la cuisinière ne peut pas arriver, elle prétend que les fournisseurs n'ouvrent pas leurs boutiques assez tôt.
Alors il chante, pour tromper sa faim.
Son répertoire est des plus variés et des plus étranges, et on ne sait pas d'où il lui vient; sauf pour quelques fragments des romances de Monpou, populaires pendant la jeunesse des romantiques, et quelques couplets de vaudeville, remarquables par leur bêtise, on ne retrouve pas les origines. D'ailleurs, cela n'est jamais complet: il n'a retenu que la phrase la plus baroque, le couplet le plus niais. Il a la voix juste,—n'en déplaise à la légende,—sans beaucoup de timbre, mais il sait l'enfler et la rendre tonitruante, quand on n'a pas l'air de vouloir s'éveiller.
On entend ce fragment, dit de l'accent traînard spécial aux pauvresses qui chantent dans les cours:
Otons nos bas, mettons-nous presque nue:
C'est pour ma mère, il me respectera....
Une complainte d'assassin succède, sans transition:
A l'Abbaye de Monte-à-r'gret,
Du Paradis l'on est tout près....
Ou bien, c'est une mélodie caverneuse des plus énigmatiques:
Léonore avait un amant
Qui lui disait: «Ma chère enfant,
J'éclaterai comme une bombe!
Je ressemble aux bénédictins,
Qui s'en vont tous les matins
Creuser leur tombe....
Je crois que ce morceau faisait partie d'un opéra qu'il avait voulu composer, paroles et musique, pour le théâtre qu'il avait construit lorsqu'il était adolescent.
Quand le temps menaçait, il redisait, à n'en plus finir, cette incantation de berger qu'il avait entendu chanter autrefois par une vieille fileuse, à Maupertuis, où il allait passer les vacances:
Pleut, pleut, mouille, mouille....
C'est le temps de la grenouille:
La grenouille a fait son nid
Dans l'étable à nos brebis;
Nos brebis en sont malades
Nos moutons en sont guéris....
D'autres fois, c'était ce pseudo-cantique, qui le ravissait:
Tout le monde pue
Comme une charogne,
N'y-a, n'y-a, n'y-a que mon Jésus
Qui ait l'odeur bogne!...
il prononçait «bogne», au lieu de «bonne», à cause de la rime.
Quand il avait assez de chanter, il déclamait. Ceci entre autres:
J'aime les bottes à l'écuyère
Et les pantalons de tricot...,
Et les romans de Walter Scott,
Il faut en avoir deux paires!...
Enfin l'on descendait à table. Le macaroni quotidien tordait dans le plat ses anneaux dorés de beurre et grumelés de parmesan; le juteux faux-filet saignait sur le persil, tout frais cueilli au jardin. Le lion affamé se calmait.
Il aimait que l'on fût gai au déjeuner, que l'on y vînt avec des visages souriants, des mines reposées et bienveillantes. Rien ne le tourmentait comme de découvrir un pli de maussaderie ou de préoccupation sur les figures, et il fallait lui expliquer longuement les motifs d'ennui ou d'inquiétude, pour qu'il pût les détruire au plus vite, si c'était possible. Quand l'air grognon persistait, il arrangeait les bouteilles sur la table, y appuyant un journal pour se faire un paravent et ne pas voir.
On se fâchait quelquefois de son insistance à étudier les plus fugitifs mouvements des traits, qui la plupart du temps n'avaient pas de cause explicable: alors il nous reprochait avec véhémence de ne pas lui rendre la pareille, de ne pas chercher à nous rendre compte, d'après sa physionomie, de l'état de son humeur et de sa santé. Et il nous répétait la légende du pain à cacheter vert, qu'il avait gardé trois jours au milieu du front, sans que personne le vît.
—Moi, j'ai la bosse de l'approbativité, disait-il; si vous saviez la phrénologie et si vous tâtiez mon crâne, vous verriez tout de suite que cette proéminence est presque monstrueuse chez moi. J'ai le besoin d'être approuvé, en tout et par tous, même par les bonnes, même par le chat. Je suis opprimé et malheureux à la moindre opposition, au plus petit désaccord, et la mauvaise humeur me semble toujours dirigée contre moi.
—Même quand on n'a pas faim, tu crois que c'est par méchanceté!
—Évidemment! Et j'ai raison. C'est une façon détournée, mais perfide, de faire ressortir mon appétit, de me faire paraître un goinfre, un glouton, un mâche-dru, capable de s'empiffrer plus que Gamache, Gargantua et l'ogre du Petit Poucet.
Souvent, au milieu de ces belles discussions, Dumas fils, qu'on n'avait pas entendu sonner, entrait et nous contemplait de la porte.
—Quelle drôle d'heure pour déjeuner! grognait-il.
Et il allait s'asseoir dans un coin, près d'une des fenêtres.
Alors mon père essayait de lui démontrer que cette heure était la meilleure possible pour prendre le premier repas, le seul sérieux; qu'elle avait l'avantage de ne pas couper la journée en deux et qu'elle permettait, même si l'on s'accordait l'indispensable flânerie de la digestion, de se mettre au travail, sans avoir l'estomac chargé, entre midi et une heure, ou de commencer les pérégrinations, si l'on était forcé de sortir.
Mais Dumas fils n'était pas du tout convaincu.
Un autre personnage, un vieil ami de la famille Hugo, que mon père connaissait aussi, était venu nous voir dès les premiers jours de notre installation à Neuilly et arrivait aussi pendant le déjeuner. C'était M. Robelin, un architecte, propriétaire de maisons. Il en avait à Paris, a Nevers et à Neuilly.... Nous avions visité celles-ci, qui étaient nombreuses, et assez bizarres. Pris dans le mouvement littéraire de 1830, très enthousiaste de romantisme, Robelin avait voulu, lui aussi, être révolutionnaire et moyenâgeux et, pour cela, il avait conçu le plan de maisons pas ordinaires: des toits à pic, qui mansardaient presque tous les étages; des tourelles en poivrières, dans lesquelles les escaliers avaient peine à tourner.... Amusantes à l'œil, ces constructions, édifiées dans un espace restreint, étaient à peu près inhabitables.
Cela n'empêchait pas M. Robelin d'être un homme fort agréable, un peu avare peut-être, ou plutôt feignant de l'être pour masquer des revers de fortune dus à des traits de générosité qu'il tenait secrets, mais, en tout cas, un avare aimable, se blaguant lui-même et ne redoutant pas de raconter des traits de son caractère. Par exemple, il achetait ses souliers à la livre, dans un endroit connu de lui; il boutonnait dix ans un veston de gauche à droite, avant de le boutonner de droite à gauche, ce qui lui faisait, disait-il, un habit neuf; il se promenait tous les matins au bois de Boulogne et ramassait des branches mortes, dont il faisait des tas: plus tard, sa vieille bonne, Rosalie, allait les ramasser, si quelques pauvresses ne les avaient pas trouvés et emportés.
—Alors, c'est tant mieux pour elles, disait-il: je suis philanthrope de bon cœur.
Tous les matins, donc, depuis noire arrivée, M. Robelin venait nous voir, vers la fin du déjeuner; et, pendant de longues années, il n'a jamais manqué à cette habitude.
Il entrait par la porte de la cour, dont on n'avait qu'à tourner le bouton et qui sonnait en s'ouvrant. C'était pour ne déranger personne; mais son entrée dans la salle à manger causait toujours, néanmoins, un indescriptible tumulte et un grand émoi: il avait à sa suite un chien de chasse blanc et gris et un vieil épagneul noir. Aussitôt la porte vitrée entr'ouverte, les chiens se précipitaient dans la salle à manger, où ils étaient accueillis par les jurements et les miaulements des chats épouvantés, et par des cris de toute espèce:
—Prenez garde aux chats!... N'entrez pas!... Tenez vos chiens!...
—Ici! Stop!... Tiby, allez coucher!...
Et, quand on était parvenu à refermer la porte sur les chiens expulsés, ils rentraient aussitôt, d'un bond, par la fenêtre, et les imprécations recommençaient de plus belle.
Chaque jour, la scène se renouvelait, au moment où l'on servait le café, sans que M. Robelin, en fût le moins du monde troublé.
Post prandium stabis, Seu passus mille meabis,
C'est mon père qui récite ce précepte de l'école de Salerne, en nous entraînant sur la terrasse, après le déjeuner, pour nous promener et causer.
—Il faudrait traduire cela en vers français, dit-il, mais ça n'est pas très commode.... Que penses-tu de ce distique, cependant?...
Après dîner, debout tu te tiendras,
Ou seulement mille pas tu feras.
—Hein! est-ce assez mirlitonesque et proverbial?
—C'est très bien!
—En tout cas, c'est exact et ça rime.
Et nous faisons les mille pas.
C'est l'heure la plus charmante de la journée, celle où le père est vraiment à nous, et qu'il prolonge d'ailleurs autant qu'il le peut.
La terrasse est extrêmement agréable pour ces lentes promenades. A l'angle de la salle à manger, elle s'épanouit et forme la cour, élargie qu'elle est de toute l'épaisseur de la maison: les fenêtres, de ce côté-là, font face au pavillon du jardinier, tout enguirlandé de vigne vierge. Plus loin, la terrasse reprend sa largeur initiale, en longeant la maison du propriétaire et une autre petite maison mitoyenne. Il n'y a pas de séparation, pas de barrière; là-bas, un escalier de pierre, qui fait pendant au nôtre, descend, lui aussi, vers les jardins, entre des vases de fonte, où les fuchsias alternent avec les géraniums. Rien ne gêne la vue, par-dessus le parapet, vers la fuite des allées et les vallonnements des pelouses où penchent des abricotiers.
Le propriétaire, un M. Achard, lapidaire, qui habite Paris, ne vient, avec sa famille, que du samedi au lundi; le reste de la semaine, tout est clos chez lui, et nous pouvons marcher d'un bout à l'autre de la terrasse, ce qui fait près d'une centaine de pas.
De notre côté, la promenade s'achève devant un mur assez élevé, couvert de lierre du haut en bas, et toujours agité d'un chamaillis de pierrots. Ce mur joint d'un bout notre maison et de l'autre le parapet de la terrasse. C'est le coin le plus frais et on y trouve toujours de l'ombre. Quand on est fatigué de marcher, le mur bas de la terrasse, avec ses larges dalles, offre un banc des plus commodes. Mon père s'y assied, le bout de son pied touchant encore le pavé; pour nous, c'est un peu plus haut: il nous faut prendre un élan, et, une fois assises, laisser pendre nos jambes.
C'est là que tous trois nous faisons assaut de mémoire, en récitant des vers de la Légende des siècles:
Charlemagne, empereur à la barbe fleurie ...
Et nous continuons, nous entr'aidant. Quand un ne sait plus, l'autre sait. Nous menons ainsi le poème assez loin. Puis, tout à coup, un vers nous arrête ... il se dérobe ... personne ne sait plus....
—Va prendre le bouquin! dit mon père.
—Non, non ... ça n'est pas de jeu!
Et nous cherchons, par des raisonnements, par l'alternance des rimes, tout fiers quand nous retrouvons enfin le vers.