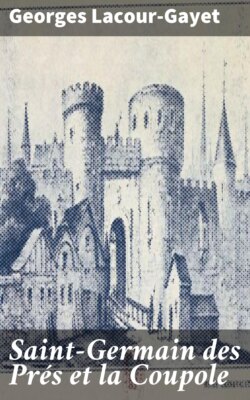Читать книгу Saint-Germain des Prés et la Coupole - Georges Lacour-Gayet - Страница 4
На сайте Литреса книга снята с продажи.
ОглавлениеI
Table des matières
L’Église Saint-Germain des Prés.
A l’époque romaine, une succession de prairies, de vergers et de vignobles s’étendait sur la rive gauche de la Seine, dans la partie septentrionale de notre VIe arrondissement; c’étaient les dépendances du palais des Thermes, dont les ruines subsistent toujours dans les jardins du musée de Cluny. Quand l’un des fils de Clovis, Childebert, était roi de Paris, c’est-à-dire au milieu du VIe siècle, une basilique, dite de la Sainte-Croix ou de Saint-Vincent, fut construite à l’extrémité occidentale de cette région.
D’une expédition qu’il avait faite au delà des Pyrénées avec son frère Clotaire contre les Wisigoths d’Espagne, le roi Childebert avait rapporté deux reliques précieuses, la tunique de saint Vincent, qui provenait de Saragosse, et une croix d’or enchâssée de pierres précieuses, ouvrage, disait-on, de Salomon, qui provenait de Tolède. D’après le conseil de saint Germain, qui était alors évêque de Paris, il fit élever, à l’emplacement de l’église actuelle, une basilique en forme de croix; les deux reliques y furent déposées; par suite, elle fut désignée sous un double nom. La décoration en était d’une grande richesse: pavés de mosaïques, murailles aux incrustations d’or et de marbre, toiture métallique aux reflets éclatants.
Childebert fit bâtir aussi un monastère attenant à la basilique, pour y loger des religieux. C’étaient des moines bourguignons, que saint Germain avait fait venir de son monastère de Saint-Symphorien d’Autun; Droctovée fut leur premier abbé. D’après la tradition, la dédicace de la basilique mérovingienne eut lieu le 23 décembre 558, le jour même de la mort de Childebert, son fondateur.
Le roi de Paris fut inhumé dans ce monument; pendant près de deux siècles, la basilique de la rive gauche devint comme la nécropole royale. Frédégonde y fut enterrée.
VUE DE L’ABBAYE, AVEC SON ENCEINTE FORTIFIÉE.
Cette vue est antérieure à la construction du palais abbatial, c’est-à-dire à l’année 1586.
Dès le commencement du VIIe siècle, les vocables de Sainte-Croix et de Saint-Vincent firent place au vocable de Saint-Germain. L’évêque de Paris, qui passait pour avoir conseillé à Childebert l’érection de la basilique, avait fait élever, au bas de l’édifice, du côté du midi, — à l’emplacement actuel de la chapelle des catéchismes, — un oratoire en l’honneur de saint Symphorien, le célèbre martyr d’Autun. Quand il fut mort, en 576, on l’enterra dans cet oratoire; les fidèles vinrent prier auprès de son tombeau, et la dévotion populaire donna bien vite à l’ensemble de l’édifice religieux le nom de Saint-Germain, ou mieux de Saint-Germain des Prés, Sancti Germani a Pratis ou pratensis.
La règle de saint Benoît, introduite en France par saint Maur, fut adoptée, au milieu du VIIe siècle, dans le monastère de la rive gauche de la Seine; ses moines, qui portaient le froc noir, furent dès lors les Bénédictins de Saint-Germain des Prés. Jusqu’à la Révolution française, il y eut à cet endroit une république monacale; on sait la place qu’elle devait tenir dans l’histoire de la science, à partir de l’époque (1631) où l’abbaye de Saint-Germain fut unie à la congrégation de Saint-Maur. Les Mabillon, les Montfaucon, les Ruinart sont restés la gloire de cette maison et de l’érudition française.
Les moines de Saint-Germain possédaient de vastes domaines, soit sur le territoire actuel des VIe et du VIIe arrondissements, soit dans la banlieue de Paris. Ceux-ci remontaient à une donation de Pépin le Bref, de l’année 754. L’abbé du monastère Landfroi avait demandé au nouveau roi des Francs de procéder à la translation des reliques de saint Germain; elles quittèrent l’oratoire de Saint-Symphorien, pour être déposées dans la partie orientale de l’église. A cette occasion, Pépin fit don à saint Germain, c’est-à-dire au monastère qui portait ce nom, de la terre de Palaiseau, près de Paris, avec toutes ses dépendances.
Les terres de l’abbaye, avec la basilique et les bâtiments claustraux qui en formaient le centre, furent ravagées à maintes reprises, au IXe siècle, par les pirates normands qui remontaient la Seine; en arrivant aux portes de Paris, ils étaient tentés par le riche aspect de l’édifice que le peuple avait baptisé Saint-Germain-le-Doré. En 845, à l’époque de Charles le Chauve, ils pillèrent, pour la première fois, Saint-Germain. Enhardis par l’impunité, ils revinrent, à la grande terreur des Parisiens; chaque fois, c’étaient des scènes de vandalisme et des incendies.
VUE DE L’ABBAYE SAINT-GERMAIN DES PRÈS ET DE SON MONASTÈRE BÉNÉDICTIN AU XVIIIe SIÈCLE.
A cette époque de misère se rattache le souvenir d’un moine, Gozlin, dont le nom est porté par une rue voisine. Devenu abbé, il entreprit de résister aux pirates; il remit en état les bâtiments dévastés; chancelier de Charles le Chauve, évêque de Paris, il prit une part énergique à la défense de la capitale contre les Normands; il mourut au cours du siège, en 886.
Un siècle environ plus tard, à l’époque de Hugues Capet, l’abbaye était gouvernée par Morard, vingt-neuvième abbé ; élu en 990, il mourut en 1014. Il fit démolir la basilique de l’époque mérovingienne, qui avait été «trois fois incendiée par les païens,» et il entreprit en entier la réédification de l’édifice; «il y construisit aussi la tour avec la cloche et beaucoup d’autres choses.» Sa tombe, placée au milieu du chœur, portait, en effet, cette inscription:
Morardus, bonce memorice abbas, qui, istam ecclesiam a paganis ter incensam everlens, a fundamenfίs novam reœdificavit, turrim quoque cum signo multaque alia ibi constтuxit.
Le dimanche 21 avril 1163, sous l’abbatiat de Hugues III de Monceaux, le pape Alexandre III, accompagné de douze cardinaux, faisait la dédicace solennelle de la nouvelle église, complètement achevée.
C’est donc au cours des XIe et XIIe siècles, pendant les deux premiers siècles de la dynastie capétienne, que fut construite l’église Saint-Germain des Prés, telle qu’elle se présente à nos regards. Elle fut commencée du côté de la place actuelle et terminée du côté de l’abside. La tour et la nef offrent les caractères du pur style roman du XIe siècle, tandis que le chœur et les chapelles de l’abside, avec la juxtaposition d’arcs en plein cintre et d’arcs brisés, offrent les caractères eu style ogival primitif du XIIe siècle.
Saint-Germain des Prés était l’église aux trois clochers. Chaque nef latérale était flanquée d’un clocher à la hauteur de la naissance de l’abside; depuis 1821-1822, il n’en subiste plus que les deux tours quadrangulaires, dans le style du XIe siècle, qui en constituaient les assises. La tour du midi (côté boulevard Saint-Germain) était la turris major ou magna, appelée aussi tour Sainte-Marguerite; la tour du nord (côté rue de l’Abbaye) était la turris minor ou parva, ou encore la tour Saint-Casimir. Au-dessus de chacune des tours s’élevait un clocher en pierre, haut de trois étages et terminé par une flèche. Les clochers, qui étaient crevassés en maints endroits, menaçaient ruine; force fut de les démolir jusqu’à la plate-forme des tours.
L’intérieur de l’église subit, à l’époque de Louis XIV, des transformations peu heureuses. Depuis l’origine de la construction, une charpente apparente, comme dans les églises romanes, couvrait la nef et les bas-côtés. On imagina de la remplacer, de 1644 à 1646, par des voûtes de pierre en ogive. Jusqu’à la même époque, les deux façades nord et sud du transept étaient percées chacune par deux baies en plein cintre, de la dimension et du style des baies qui éclairent encore la nef. On substitua alors aux deux baies de chaque côté une grande fenêtre ogivale à meneau central.
Pendant la Révolution, tout l’intérieur de l’église subit de gros dommages. La «ci-devant abbaye Germain» fut transformée, en 1794, en une raffinerie de salpêtre; on y établit aussi une usine à forer les canons de fusil. Rendue au culte en 1802, l’église fut entièrement restaurée à partir de 1819. Le nom d’un grand peintre est attaché, depuis le milieu du XIXe siècle, à l’histoire de l’antique abbaye. Hippolyte Flandrin exécuta, de 1842 à 1861, les peintures des deux côtés du sanctuaire, celles du chœur et celles des deux côtés de la nef.