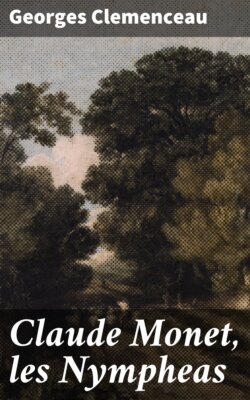Читать книгу Claude Monet, les Nympheas - Georges Clemenceau - Страница 6
CLAUDE MONET, PEINTRE
ОглавлениеJe ne puis éviter de présenter l’homme au lecteur.
De taille moyenne, avec le bel aplomb d’une robuste charpente bien emmanchée, l’œil d’agression souriante dans la fermeté d’une voix sonore, cela ne suffit-il pas à dire «un esprit sain dans un corps sain», un caractère de droite volonté ? Harmonieux développement de toutes les énergies en direction du but que l’organisme lui-même s’est spontanément assigné ! Prométhée, le Titan supplicié, vola le feu divin, caché dans le creux d’une férule. Monet, simple exemplaire d’humanité, a formé le dessein de conquérir la lumière du ciel pour nous faire une vision enchanteresse des choses, en créant de nouvelles interprétations de la vie changeante à nous assimiler.
Pour le demi-dieu, il y aura les fioritures de la légende, l’engendrement du merveilleux. Pour la simple démonstration d’un homme en œuvre humaine, ce n’est pas assez des défigurations du miracle. Il ne nous faut pas moins que la vérité. Regardez le puissant modelé de ce crâne. On dirait du travail de Vauban. Mais d’un Vauban d’offensive, qui ne protège son donjon d’énergie que pour mieux canonner les semonces du monde extérieur nous interrogeant en vue de se dérober. Ciel, plaines, vallées, montagnes, eaux, forêts, la vie universellement répandue, tout l’univers changeant s’offre à nous, à la seule condition de se reprendre aussitôt que nous prétendons le fixer. D’éblouissantes étapes dans les chemins d’une interprétation qui, même géniale, ne sera jamais qu’approchée.
Quand j’aurai dit que Claude Monet naquit à Paris, rue Laffitte, c’est-à-dire dans le quartier des marchands de tableaux — signe éventuel d’une prédestination —je n’aurai pas beaucoup avancé nos affaires. Mais si j’ajoute qu’il passa toute sa jeunesse au Hâvre, et là, s’éprit des brassements de lumière que l’océan tumultueux des côtes reçoit de l’espace infini, peut-être s’expliquera-t-on cette familiarité de l’œil avec les gymnastiques lumineuses d’une atmosphère affolée qui jette toutes les nuances de tous les tons au gaspillage des vagues et des vents.
Dès sa première jeunesse, Monet s’éprend des grands horizons de la mer. Pour un léger profit, il fait prosaïquement des croquis, des charges de son entourage. L’homme n’était pas né pour la caricature. «J’avais la passion du dessin,» écrit-il cependant, et voici, en effet, que son crayon lui permet d’économiser, à quinze ans, les frais d’un voyage à Paris.
Il fait, à Sainte-Adresse, la connaissance de Boudin, qui l’emmène peindre dans les champs. Ici, Monet rencontre la palette de la nature. Une flamme a jailli des profondeurs. Il se découvre une raison d’être. Il ne lui reste plus qu’à préciser la marge de ce qu’il veut à ce qu’il peut. Troyon, qu’il rencontre, lui conseille bizarrement d’entrer à l’atelier de Couture. Il préfère une académie libre où il fait la connaissance de Pissaro. A Paris, il se reproche ingénûment d’avoir trop fréquenté la Brasserie des Martyrs. Là, pourtant, il fit la connaissance d’Albert Glatigny, de l’inoubliable Théodore Pelloquet qui se battit en duel à l’épée pour les fleurs de l’Olympia , d’Édouard Manet, d’autres personnages encore: Alph. Duchêne, Castagnary, Delveaux, Daudet, Courbet, avec qui il se lia, plus tard, d’une étroite amitié.
En 1860, le tirage au sort l’envoie, pour deux ans, aux chasseurs d’Afrique — ce qui, déclare-t-il, lui fit moralement le plus grand bien. Utilisant ses ressources d’art, il faisait le portrait de son capitaine pour obtenir des permissions. Survient un congé de convalescence. Le père, vaincu par l’ardeur de son fils au travail, se décide à lui acheter un remplaçant. Et voilà Claude Monet follement dirigé sur l’atelier de Gleyre, mais s’attachant à suivre Jungkind et Boudin dans la campagne, pour voir les choses comme elles sont. 1864, Renoir, Basille, Sisley, répondent au cri de ralliement. «Aux Salons de 1865 et de 1866, mes premiers essais sont reçus avec succès,» écrit Monet. Et voilà Courbet qui arrive pour voir «le Déjeuner sur l’herbe», grand tableau de plein air par un jeune homme «qui peint autre chose que des anges». Ils demeurent amis, et Monet tient à dire que Courbet lui «a prêté de l’argent dans les moments difficiles».
L’Afrique est oubliée. L’artiste dit le pays admirable, mais la palette des couleurs ne l’a point retenu, comme Eugène Delacroix. Déjà, pourtant, s’agite en lui le monstre divin qui va prendre possession de sa chair, de son sang, de sa vie. Il semble que le sort en soit jeté, pour lui, de demander toujours et toujours des comptes aux envolées de lumière, et de ne jamais se lasser d’obtenir quelque révélation du grand secret.
Les panneaux de Nymphéas nous le montreront éperdûment tendu vers des réalisations de l’impossible. De sa main frémissante s’élancent des fusées de transparences lumineuses qui font jaillir, en pleine pâte, de nouveaux flamboiements de clartés. Le génie n’est pas moins dans l’offensive des pinceaux sur la toile que dans les brassements de la palette multicolore où Monet cueillera tout à coup, d’un geste résolu, les gouttes d’une rosée de lumière dont il fera l’aumône aux éléments qui n’ont souci de les garder. De près, la toile paraît en proie à une bacchanale de couleurs incongrues, qui, du juste point de vue, s’ordonnent, se rangent, s’associent pour une délicate construction de formes interprétatives dans la justesse et la sûreté de l’ordre lumineux. Nous aurons à reparler de ce prodige.
Un jour, je disais à Monet: C’est humiliant pour moi. Nous ne voyons pas du tout les choses de la même façon. J’ouvre les yeux et je vois des formes, des nuances de colorations, que je tiens, jusqu’à preuve du contraire, pour l’aspect passager des choses comme elles sont. Mon œil s’arrête à la surface réfléchissante et ne va pas plus loin. Avec vous, c’est une autre affaire. L’acier de votre rayon visuel brise l’écorce des apparences, et vous pénétrez la substance profonde pour la décomposer en des véhicules de lumières que vous recomposez du pinceau, afin de rétablir subtilement, au plus près de sa vigueur, sur nos surfaces rétiniennes l’effet des sensations. Et tandis qu’en regardant un arbre, je ne vois rien qu’un arbre, vous, les yeux mi-clos, vous pensez: «Combien de tons de combien de couleurs aux transitions lumineuses de cette simple tige?» Sur quoi, vous voilà désagrégeant toutes valeurs pour reconstituer et développer, à notre intention, l’harmonie finale de l’ensemble. Et vous vous tourmentez, à la recherche de la pénétrante analyse qui vous donnera la meilleur approximation de la synthèse interprétative. Et vous doutez de vous-même, sans vouloir comprendre que vous êtes lancé en projectile dans la direction de l’infini, et qu’il doit vous suffire d’approcher du but que vous n’atteindrez jamais complètement.
— Vous ne pouvez pas savoir, me répondit Monet, combien tout ce que vous venez de dire est véritable. C’est la hantise, la joie, le tourment de mes journées. A ce point qu’un jour, me trouvant au chevet d’une morte qui m’avait été et m’était toujours très chère, je me surpris, les yeux fixés sur la tempe tragique, dans l’acte de chercher machinalement la succession, l’appropriation des dégradations de coloris que la mort venait d’imposer à l’immobile visage. Des tons de bleu, de jaune, de gris, que sais-je? Voilà où j’en étais venu. Bien naturel le désir de reproduire la dernière image de celle qui allait nous quitter pour toujours. Mais avant même que s’offrît l’idée de fixer des traits auxquels j’étais si profondément attaché, voilà que l’automatisme organique frémit d’abord aux chocs de la couleur, et que les réflexes m’engagent, en dépit de moi-même, dans une opération d’inconscience où se reprend le cours quotidien de ma vie. Ainsi de la bête qui tourne sa meule. Plaignez-moi, mon ami.
L’œil de Monet, il n’était rien de moins que l’homme tout entier. Une heureuse table des plus délicates sensibilités rétiniennes ordonnait toutes réactions sensorielles pour des jeux de suprême harmonie où nous trouvons une interprétation des correspondances universelles. Ce phénomène est apparemment la qualité première chez tous les Maîtres de la peinture. Ce qui nous frappe en Monet, c’est que tous les mouvements de la vie viennent s’y subordonner.
Tendrement attaché aux siens, dont sa joie fut d’étendre le cercle pour y répandre la manne de la plus généreuse amitié, il trouvait dans l’affection dévouée de ses fils, de Mme Blanche Monet, sa belle-fille, qui manie le pinceau à ses heures, toutes les attentions que pouvait commander l’ordonnance d’une vie brûlée. Dès que la brosse s’arrêtait, le peintre courait à ses fleurs, ou s’installait volontiers dans son fauteuil pour penser ses tableaux.
Yeux clos, bras abandonnés, immobile, il cherchait des mouvements de lumière qui lui avaient échappé, et sur la défaillance, peut-être imaginaire, s’exerçait une âpre méditation sur des thèmes de labeur. Une plaisanterie soudaine annonçait le contentement, ou, tout au moins, une espérance. La brutalité du propos disait l’inquiétude du lendemain. Et la vie allait ainsi, toutes les facultés de l’être éperdûment tendues vers l’anticipation indéfinie des caresses de la lumière attendues de toute sa sensibilité. Car l’œil n’était que l’arc triomphal ouvrant accès à tous les frémissements commandés du dehors par toutes les exaltations de l’être que le rêve emporte au delà des réactions de ses facultés.
Je ne vois pas que Monet se soit jamais mis en tête d’expliquer sa peinture. Rien ne pouvait lui paraître moins nécessaire. Il était né palette en main, et ne concevait pas la vie autrement que devant une toile pour y inscrire les passages d’énergie lumineuse par lesquels l’univers protéiforme se résout, à son propre miroir, en des apparences de fixité. Sentir, penser, vouloir en peintre. Dans les voies du peintre, il n’était rien pour l’arrêter. L’arc bien tendu, la bonne flèche à l’encoche pour le déclic de volonté. Il voyait, comme doit voir un homme qui a besoin de rendre, d’exprimer le plus possible de sa sensation et qui ne sera jamais au bout de son émotivité.
Rien n’est plus beau, ai-je dit, que la parfaite convergence de toutes les diversités de l’homme vers l’idéalisme d’une réalisation supérieure où toutes les facultés de l’être se déploient en commune harmonie. C’est, sans doute, ce qu’on appelle le génie. Tout le mystère gît dans la totale convergence de nos synergies vers un complet épanouissement de grandeur et de beauté. Ce spectacle, nous gardons précieusement les noms de ceux qui nous en ont ébloui. Encore, souvent, le débat reste-t-il ouvert sur la valeur finale d’un effet de fortune dont se dérobe l’issue.
Le nombre des peintres de talent est incommensurable. Beaucoup même pourraient montrer leurs titres aux qualifications les plus enviées. Ce qui caractérise Monet, c’est qu’après avoir créé sa manière, il l’a développée, d’un progrès continu, jusqu’au prodige des Nymphéas, c’est-à-dire au delà même de ce que meules, peupliers, cathédrales, Tamise, permettaient de prévoir.
Le danger, en cette aventure, est que dans un tel effort d’interprétation évolutive, l’éréthisme nerveux de l’interprète dépasse de trop loin les correspondances requises des sensibilités secondaires chez un public insuffisamment préparé. C’est ce que voulait dire Monet quand il répétait: «On s’y fera, peut-être, mais je suis venu trop tôt.» Il n’avait pas fini sa phrase que deux yeux d’acier noir, fermement enchâssés dans le mortier des orbites, mitraillaient tous les champs de l’espace, pour ouvrir aux visions humaines un spectacle de trépidations lumineuses en voie de rapprocher de plus en plus, dans l’unité de la sensation, ce qui est et ce qui paraît être.
Sous toutes les formes de son activité d’art, c’est ce que n’a cessé de manifester Claude Monet.
A cette époque de sa vie, comment nous représenterons-nous le Monet au combat pour la conquête de la lumière? Nous n’en sommes qu’aux premières marques d’attention, puisque Durand-Ruel, expert et marchand, n’est pas encore venu. Quel aspect de ce jeune lutteur sous l’étreinte d’une ambition ardente trop souvent bafouée? Il n’y a de cette époque que le portrait de Claude Monet à dix-huit ans, par Déodat de Séverac. La figure est d’une dramatique énergie. Le front, qui se révélera si fermement modelé dans ses portraits trop rares, est ici dominateur. Le peintre commence par penser sa peinture, par la décomposer pour la reconstruire de ses yeux, en lui donnant une fermeté de transitions enchaînées. Tout le visage se subordonne à l’imposante audace du regard qui pousse droit au monde sans crainte et presque au delà de l’espoir, tant l’idée le soutient et l’emporte loin des contingences. En somme, nous avons le sentiment de la prise de possession d’une puissance. C’est bien là l’événement.
Le «Claude Monet peignant» (de 1875), que nous a laissé Renoir, n’est pas moins significatif. Le corps n’est pas construit. Adoucie l’expression du visage. En revanche, l’attitude au travail est-elle d’une jeune aisance que la virilité accentue déjà de résolution. La bouche n’est plus contractée. Les narines boivent l’air librement. Et les yeux, qui sont les flambées d’une interrogation débordante, se posent avec un irrésistible élan de pénétration sur des passages de lumière qui défendent leurs secrets. Ici, c’est vraiment le combat qui s’engage. La première impulsion d’offensive que rien ne pourra plus arrêter.
En 1884, nous avons un portrait de Monet par lui-même (quarante ans) , où l’homme se révèle dans toute l’éclatante force de sa simplicité. Rien de moins convenu, de moins apprêté, de moins «stylisé » que cette image de l’ouvrier à l’œuvre, tout au développement des sensations personnelles qu’il prétend exprimer. Puisqu’il ne demande la juste interprétation du monde qu’à l’ultime activité des ondes lumineuses, il ne saurait se départir d’une suprême conscience de rendement quand il se place lui-même au cœur du drame de l’interprétation. D’une ingénuité qui s’impose par la ferme détermination du regard, le bon «voyant» se présente, tranquille et sûr, pour une vision d’au-delà. Elle emporte tout l’être, imprégné d’une flamme sacrée, à la conquête d’un monde éperdu de lumière. Les plis du front disent l’irrésistible élan de toute une vie sans défaillance. Aucune indication de geste. L’homme est en pleine possession de lui-même, aux préliminaires de l’action. Il a vu, il a compris, il a résolu, il est en marche vers une fin souveraine. Voilà notre Monet, plus simple et mieux équilibré que jamais, prêt au débordement de l’action. Confiant dans la palette amie, ramassé sur lui-même pour le bond de maîtrise, tout au bord du départ de volonté, il est là vraiment dans toute l’intensité, dans l’ardeur ingénue d’un maître de la vision au combat pour la conquête de la lumière qui l’attire irrésistiblement et qu’il a résolu de dompter.
A ce moment, les premières formations de jeunesse sont accomplies. Toutes les puissances d’une humanité harmonieuse se sont définitivement agrégées, combinées pour des effets acquis. Le vainqueur du prochain jour n’a pas encore en main le plein de sa victoire, mais l’œil, assuré de puissance, a déjà pris la mesure du champ de bataille où va se développer, se couronner, le génie d’un accomplissement achevé. Il fallut l’approche de la mort pour apprendre à Auguste que «la comédie» était jouée. Monet, sans comédie, toujours doutant de lui-même (ce qui est le luxe de l’homme achevé), put voir le succès définitif de son drame tout en refusant de livrer ses Nymphéas au public avant sa mort. Dernier geste d’une géniale incertitude de lui-même, qui achève, dans sa noble candeur, le faste d’une énergie désintéressée.
Avant les Nymphéas, il avait fait trois autres portraits de lui-même (en 1917) dont il ne parlait qu’avec hésitation, peut-être parce qu’il y voyait le plus haut trait de sa vision dernière, et ne jugeait pas qu’au cours de ce qui lui restait de vie, il lui fût possible de le dépasser. Deux de ces toiles montraient le visage en pleine lumière, émergeant sous un grand chapeau de paille. Quand il me les fit voir il se donna la joie d’en parler méchamment:
— Je pourrais faire autre chose que ça, s’écriait-il avec dédain. Mais le temps ne m’en sera pas donné.
Je prévoyais trop bien ce qui arriva. Il avait pris depuis longtemps la redoutable habitude de lacérer à coups de râcloir, de déchirer à coups de pieds, les morceaux qui ne lui donnaient pas satisfaction. Des ébauches de panneaux, dans son atelier, nous offrent encore les blessures distribuées en des accès de fureur où il ne s’épargnait à lui-même aucune injure.
Le dernier portrait (celui qui est au Louvre), je n’en puis parler de sang-froid, tant il rend à miracle le suprême état d’âme de Monet épanoui en vue du triomphe entrevu, avant que s’abattît tragiquement sur lui l’effroyable menace de la cécité. Pour qui a connu la vie profonde de Monet, dans la pleine intensité de ses terreurs d’un insuccès final, et de ses explosions de joie quand lui venait la sensation de la difficulté vaincue, le doute est impossible. C’est la consécration intérieure du sursaut d’art qui va s’achever dans l’envolée des Nymphéas. Les deux portraits détruits doivent compter surtout comme des préparations, très poussées, du morceau triomphal. Ici, la victoire s’assure avant la bataille même. Fanfare anticipée du soldat maître de sa journée.
La solide construction de ce front que les catapultes des «Philistins» ne purent entamer, dit toute la tragédie de cette vie glorieuse. Entre deux larges tempes haut montées, les énergies crâniennes ont fixé l’empreinte des grandes luttes pour l’idéal. C’est l’assise du commandement, le siège impérieux de l’idée, de l’autorité Les yeux mi-clos pour mieux savourer le rêve intérieur. Les narines trépidantes, la gorge convulsée d’une explosion irrépressible, le maître-ouvrier vient de découvrir tout au fond de lui-même la claire conscience d’un achèvement ultime annoncée jusque dans le nimbe des reflets printaniers de la «barbe fleurie», labarum de Charlemagne, empereur d’un monde nouveau.
Avec tout le monde, j’ai déjà noté qu’à la distance où Monet se place nécessairement pour peindre, le spectateur n’aperçoit sur la toile qu’une tempête de couleurs follement brassées. Quelques pas de recul et voici que sur ce même panneau, la nature se recompose et s’ordonne à miracle, au travers de l’inextricable fouillis des taches multicolores qui nous déconcertaient à première vue. Une prestigieuse symphonie de tons succède aux broussailles de couleurs emmêlées.
Comment Monet, qui ne se déplaçait pas, pouvait-il saisir, du même point de vue, la décomposition et la recomposition des tons qui lui permettaient d’obtenir l’effet cherché ? Il s’agit là, sans doute, d’un état de sensibilité infiniment délicate, prompte à toutes réactions d’activités correspondantes qui font se succéder sur la rétine des séries d’instantanés par une agilité d’adaptations appropriées. C’est le don du peintre qu’il accepte le corps à corps avec la lumière, et se trouve capable de porter le poids du combat.
Il va sans dire que Monet n’entrait dans aucune considération de théorie à ce sujet. Il avait reçu de la nature un œil à la mesure de sa tâche, et n’acceptait pas d’autre arbitrage que celui de sa propre rétine dans les jugements qui le déterminaient. N’est-ce pas la première condition de l’heureuse journée?
Il s’installait en silence devant le modèle que ses yeux poignardaient d’interrogations, tandis que de légères contractions du visage accompagnaient le trajet de la pupille à l’objet, pour le vif retour à la palette et le bond de la brosse à l’écran. En cette heure du drame, il ne parlait pas vainement. Quelquefois une question à sa belle-fille, Mme Jean Monet, qui ne le quittait pas. Il s’agissait bien plus de s’interroger lui-même que d’attendre une réponse dont il faisait rarement cas. Comme à l’avion qui décolle, il fallait à l’artiste une certaine coordination d’efforts pour «gagner l’air» et entrer superbement dans l’action. C’était alors la soudaine détente de la brosse, comme l’épée qui pousse droit au corps dès que l’affaire est engagée.
Sans pièges de reflets, le portrait du Louvre, à mon sens, doit être tenu pour le dernier mot de Monet. Un éclair de joie triomphante a passé sur lui quand ses suprêmes essais ont montré qu’ayant pu concevoir au plus haut de lui-même, il serait en état d’exécuter. C’est cet éclair d’ambition surhumaine, que l’admirable portrait de la dernière heure a fixé.
L’intérêt historique de cette toile, c’est qu’elle nous montre, dans un ouragan de passion heureuse, l’homme de l’achèvement rêvé. Tout l’éclat du labeur triomphant s’inscrit en ce visage, convulsé dans l’éblouissement de la vision intérieure d’où semble enfin bannie la terreur d’un succès qui ne serait pas à la mesure de ce qu’il a voulu. Et la destinée a permis que cet éclat triomphal du plus beau jour nous fût transmis dans la plus haute exaltation de lumières où rayonnât jamais le pinceau de Monet.
L’idée des Nymphéas tenait Monet depuis longtemps. Silencieux, chaque matin, au bord de son étang, il passait des heures à regarder nuages et carreaux de ciel bleu passer en féeriques processions, au travers de son «Jardin d’eau et de feu». D’une tension ardente, il interrogeait les contours, les rencontres, les divers degrés de pénétration dans le tumulte des fusées lumineuses. Ce qu’il avait pu conquérir d’assimilation personnelle en vue d’une interprétation plus compréhensive, il cherchait à en fixer des moments par la détermination des aspects, à peine sensibles, d’une lumière des choses irradiée dans l’univers sans fin.
De ce magnifique effort, attesté par des études émouvantes, sont sortis les Nymphéas des Tuileries. C’est après les avoir longtemps regardés, critiqués, confrontés en mille façons, dans son «jardin d’eau», que Monet prit la résolution de tenter définitivement l’aventure des panneaux, et commença par faire bâtir son grand atelier (1916). Quand l’ordre fut donné, c’est que la résolution était prise, et pour que la résolution fût prise, il fallait que le peintre eût passé, non seulement par l’épreuve de sa plus sévère critique, mais encore par la finale pierre de touche de l’exécution.
De nombreuses toiles où s’inscrivirent les premiers nymphéas inaugurèrent la série des «Miroirs d’eau» qui allait prendre son plein essor dans le «lâchez-tout» des Tuileries. Pour tout dire, les panneaux actuels attestent un degré d’accomplissement très supérieur aux premiers essais qui virent le jour dans le grand atelier. Il y en eut de fort beaux, et des plus caractérisés, qui ont été malheureusement détruits dans les trahisons des débuts. Inévitablement, il arriva parfois qu’un effet cherché ne parut pas complètement obtenu. Comme l’amitié permet tout, il m’arrivait présomptueusement de risquer un avis. J’obtenais quelquefois un grognement de réponse, qui voulait dire: c’est à voir. D’autres fois le silence. D’une visite à l’autre, j’observais néanmoins que des effets laborieux où le pinceau s’obstinait, s’étaient merveilleusement «aérés.»
Ma critique informulée fut longtemps des nuages dont quelques parties me paraissaient lourdes. Je n’osais rien dire. Un jour, quelle surprise! Une irruption de nuages tout de légères vapeurs. Point de discours. Puis, je vis peu à peu se volatiliser de capricieuses nuées effilochées par les vents. Monet regardait si intensément qu’il ne se rendait pas volontiers aux critiques d’autrui. Mais il ne cessait pas de reconsidérer, de corriger, d’affiner son texte de son propre fond. Par raffinement de scrupule, n’a-t-il pas lâché dans ses nuages des formes animales vaguement ébauchées, comme celles que faisait défiler Hamlet aux yeux de Polonius effaré. On ne peut pas pousser la conscience plus loin.
Loin de céder à l’attirance du premier jet, Monet ne cessait de reprendre ses inspirations originelles, trouvant toujours quelque manière de maudire ses prétendues insuffisances. Car, de se gourmer violemment, il ne se faisait jamais faute, à toute heure, jurant que sa vie était une faillite, et qu’il ne lui restait plus qu’à crever toutes ses toiles avant de disparaître. Des études de premier ordre ont ainsi sombré dans ces accès de fureur. Beaucoup, qui sont montées très haut dans l’estime publique, furent chanceusement sauvées grâce aux efforts de Mme Monet. J’ai déjà dit que deux très beaux portraits de lui-même, en plein soleil, périrent ainsi en une malheureuse journée. La chance permit que celui qui est au Louvre fût sauvé. Un jour où quelques mauvais propos avaient été proférés par lui contre cette œuvre incomparable, il alla chercher la toile, au moment de mon départ, et la jetant dans ma voiture: «Emportez-le, dit-il d’un ton bourru, et qu’on ne m’en reparle plus.»
On eût dit qu’il cherchait à se prémunir contre la folie d’une nouvelle exécution sommaire. Et comme je lui annonçais que le jour de l’inauguration des panneaux nous irions, bras dessus, bras dessous, voir cette toile au Louvre:
— S’il faut attendre jusque-là, répliqua-t-il, je lui dis adieu pour jamais.
Hélas! Il fallut bien renoncer à cette visite heureuse, puisqu’il refusa de livrer les Nymphéas avant sa mort. Il nous reste ainsi deux portraits de sa main aux deux dates qui marquent les deux bonds du peintre à l’apogée de sa vision: les Meules, les Nymphéas.
Alors survint l’affreuse catastrophe de la double cataracte. Drame indicible! Grâce à une opération suivie d’habiles soins médicaux, l’effroyable tragédie de la cécité absolue put être provisoirement évitée. J’aurais voulu un traitement radical, mais Monet n’acceptait pas le risque de perdre la lumière. Il demeura donc dans un état de demi-vision qui lui permit d’en finir avec les Nymphéas.
Ce n’était pas beaucoup moins qu’un miracle, car tous les rapports d’éclairage inscrits sur une rétine profondément modifiée, se trouvaient différents de ce qu’ils étaient lorsque la besogne fut mise sur le chantier. Je n’avais qu’une crainte, c’est qu’une toile fût totalement perdue. Pour des causes inexpliquées, le travail s’acheva le plus heureusement sans que le passage d’un état rétinien à l’autre eût amené des malfaçons. Il arriva que la fortune chanceuse qui contracte des dettes envers toutes les grandes existences, s’acquitta, par mégarde, de son dû. Monet, ici, me paraît avoir été le bénéficiaire d’une «providentielle» inadvertance.
Encore un prodige supérieur devait-il s’accomplir. Tout le monde autour de Monet le suppliait de tenir pour achevé le travail des panneaux, car il y avait vraiment trop lieu de craindre un malheureux coup de brosse qui pouvait tout gâter. Mais il nous laissait dire, secouant la tête sans répondre.
Le temps passe, et voici qu’un jour il me prend par la main et m’amène devant l’une des toiles où se déroule l’infini des spectacles de la lumière dans l’étendue d’une eau dormante, coupée de reflets bleuâtres perdus dans des champs de teintes rosées.
— Eh bien, que dites-vous de ceci, s’écria-t-il, railleur. Vous n’avez pas osé me faire de critiques. Mais moi, je savais bien que cette eau était pâteuse. On l’aurait dite coupée au couteau. Tout l’ensemble des lumières était à reprendre. Je n’osais pas. Et puis je me suis décidé. Ce sera mon dernier mot. Vous aviez peur que je ne gâtasse ma toile. Et moi aussi. Mais je ne sais comment une confiance m’est venue dans mon malheur, et je voyais si bien, en dépit de mes voiles, ce qu’il fallait faire pour rester dans l’enchaînement des rapports, que la confiance m’a soutenu... Maintenant, regardez. Est-ce meilleur ou pire?
MAISON DE CLAUDE MONET A GIVERNY
— J’avais tort. Vous êtes si parfaitement peintre que vous achevez, avec des yeux désaccordés, les harmonies de vision où vous avaient conduit vos yeux ouverts aux suprêmes accords des couleurs.
— C’est un accident.
— Un accident que n’a pas connu le malheureux Turner.
— C’est fini. Je suis aveugle. Je n’ai plus de raison de vivre. Cependant, vous m’entendez bien, tant que je serai vivant, je n’accepterai pas que ces panneaux sortent d’ici. Je suis arrivé à un point où je redoute mes propres critiques plus que celles des yeux les plus qualifiés. Il y a toutes les chances pour que ma tentative soit au delà de mes forces. Eh bien, j’accepte de mourir sans savoir l’issue de la fortune qui peut m’être réservée. J’ai donné mes toiles à mon pays. Je m’en remets à lui du jugement.