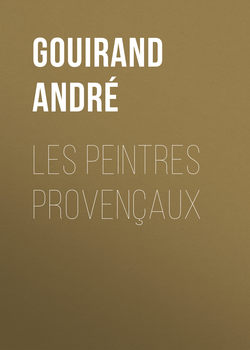Читать книгу Les Peintres Provençaux - Gouirand André - Страница 2
I
ÉMILE LOUBON ET SON TEMPS
ОглавлениеA Paul de Montvalon.
Les peintres animaliers les plus remarquables, les Cuyp, les Paul Potter, les Troyon, les Ch. Jacque, etc., etc., se sont surtout attaché – en outre du poème pictural – à montrer, par l'étude de l'ostéologie et de la myologie, par les recherches linéaires, le caractère physique des animaux. Parmi ces peintres, quelques-uns ont cherché par une observation plus aiguë à déduire le caractère moral de leur modèle: l'instinct. Mais il appartenait à Émile Loubon de savoir saisir – plus que tout autre – les animaux au passage, de fixer leur course capricieuse ou violentée par l'homme, au milieu de paysages rudes et lumineux, et de les y camper dans de beaux mouvements de vie intense, de vie exubérante, endiablée, jusqu'à l'affolement.
Dans le brouhaha de ses troupeaux en marche qui dévalent les pentes en avalanche, quand se heurtent les cornes et que la masse laineuse oscille – houle animale – entre les chemins creux, parmi les pierrailles des pentes ravinées, on a la forte sensation de la vie agitée. Et, de ces tableaux, dans lequel l'air est déchiré par le sifflement des fouets, les aboiements rageurs des chiens, le mugissement inquiet des bœufs, les bêlements doux des moutons, une sensation de sonorité se dégage. M. Arsène Alexandre observe avec raison que ces sensations de mouvement et de sonorité sont surtout produites dans les grandes œuvres d'art picturales ou sculpturales, dans toutes celles qui sont durables et auxquelles tout notre être est intéressé: «Nous entendons parfaitement, ajoute-t-il, le chant pur et gracieux que psalmodient les enfants dans les bas-reliefs célèbres de Lucca della Robbia. Dans le Naufrage de la Méduse, nos oreilles sont douloureusement effrayées par les lambeaux de cris d'appel qui nous parviennent, entrecoupés par le mugissement des vents de la mer. Prenez tous les temps, prenez tous les maîtres, et leurs œuvres, pour peu que vous les sentiez vivement et avec sincérité, vous apparaîtront avec cette triple qualité: la forme solide qui est l'apparence immuable et tangible que l'artiste leur a donnée, et, d'autre part, le mouvement et la sonorité qui sont des réalités invisibles, augmentant d'intensité en raison du reste de notre personnelle émotion6.»
Or, ces qualités de maître, Loubon les possède, car ses animaux sont dans un perpétuel mouvement, et de ses toiles un bruit constant sort. Jamais au repos, ses bœufs ne vont pas, comme avec Troyon, d'un pas nonchalant vers la ferme, dans le calme du soir, ou, au pré et à l'abreuvoir, sans hâte. Harcelés par l'homme et les chiens, ils foncent ou font des écarts brusques et dégringolent dans des raccourcis audacieux. Les moutons, en aucun moment, ne broutent silencieux, paisibles, comme avec Ch. Jacque, sous de beaux ombrages; constamment, ils vont en marche forcée, sur les routes calcaires, sous des cieux impitoyables, avec des bêlements plaintifs. Les chèvres, qu'on avait vues reproduites par certains avec des allures capricieuses, deviennent folâtres, grimacières, clownesques, sabbatiques.
En fait, l'animal, comme l'a compris Loubon, est vu à travers un vrai cerveau provençal, et peint par une imagination provençale. Il a le mouvement tour à tour emphatique, explicatif, emporté; l'attitude essentiellement mimique. Pourtant, cette exagération fougueuse du mouvement n'est jamais chez lui extravagante. Ce qui pourrait n'être qu'une charge habile, qu'une caricature artistique, devient une note d'art nouvelle. Et cette furie de vie, en pleine lumière méridionale, intéresse, passionne et retient.
* * *
A Aix, où ceux qui descendent du septentrion retrouvent une vague analogie de cité rhénale; à Aix, somnolente désormais dans la quiétude d'une vie accomplie; au sein de l'ancienne capitale de la Provence, où l'on peut encore évoquer les fastes glorieux et artistiques de son histoire écrits sur les murs des monuments, aux portes des églises et des anciennes demeures seigneuriales; dans une des petites rues silencieuses de la ville, aujourd'hui tranquille, aristocratique et universitaire, rues bien provinciales où l'herbe croît gentiment entre les pavés, Loubon (Charles-Joseph-Émile) vit le jour le 12 janvier 1809. Encore tout enfant, il fut vivement impressionné par quelques visites au musée de sa ville natale; et là, dans l'atmosphère presque monastique de ces salles, qui gardaient précieusement les œuvres de quelques glorieux ancêtres, sa vocation apparut évidente sous la chaleur de ses enthousiasmes juvéniles, sous l'émoi de ses premières et fortes joies d'art. Les sérieuses études classiques qu'il fit ensuite aux lycées de Marseille et d'Aix, la vie d'internat, auraient peut-être eu raison de ce goût pour la peinture chez une nature moins artiste, elles augmentèrent au contraire chez Loubon ses aspirations et son désir d'exprimer ses sensations par le langage du dessin. A la grande joie de ses condisciples, ses cahiers de latin et de grec se couvrirent, en marge, de figures et de paysages. L'élève interprétait Virgile à sa manière; et les tableaux champêtres du poète des Géorgiques étaient traduits par l'apprenti peintre sous la forme descriptive linéaire. C'était l'enseignement par l'image dont on a fait depuis une grande application; mais par l'image créée par un cerveau neuf et imaginatif. L'enfant étonnait, en outre, son professeur de dessin par sa facilité spirituelle et aisée de reproductions graphiques.
Fils d'un riche négociant, peu destiné par sa naissance à la carrière artistique, le jeune Loubon s'y livrait virtuellement, et, circonstance rare, ses parents semblèrent favoriser ses goûts. Car, rentré à Aix pour y faire son droit, il se mit à travailler avec ardeur le dessin, à l'École de cette ville, alors dirigée par Clérian le père, avec les conseils d'un maître incomparable, Constantin. En passant à Aix pour se rendre à Rome, le peintre Granet, ami de la famille Loubon, décida de l'avenir du jeune homme, par ses encouragements et ses appréciations louangeuses; il réussit d'ailleurs à obtenir de ses parents l'autorisation de l'emmener à Rome.
Loubon avait alors vingt ans. On s'imagine aisément ce que dut être ce voyage pour ce jeune Provençal d'imagination ardente, de culture lettrée, d'enthousiasme débordant pendant un long parcours, à travers le midi de la France et l'Italie, en compagnie d'un de ses amis et compatriote, Gustave de Beaulieu, qui fit plus tard du paysage, dans l'intimité affectueuse du maître commun Granet, artiste charmant, délicat, et dont les conseils judicieux consistaient surtout en longues causeries amicales.
Ce qui frappa Loubon à Rome, ce qui le retint deux années dans cette ville – qui était alors pour les artistes ce qu'est La Mecque pour les fanatiques musulmans – ce ne furent pas les chefs-d'œuvre de ses musées, les grands souvenirs historiques évoqués par ses ruines; mais bien la beauté de la campagne romaine déjà entrevue et pressentie dans les dessins de son premier maître Constantin. Et le jeune artiste, qui, dans les plus célèbres galeries, ne pouvait, en face des maîtres, tenir longtemps en place devant son chevalet, s'éprit d'un vif amour pour cette théâtrale nature. Il admira la beauté antique du geste du paysan romain; les scènes quasi virgiliennes auxquelles concouraient des animaux majestueux, dans la limpide atmosphère du ciel de la Romagne, au sein des grands paysages que décoraient les fonds hautains de ses collines augurales, et parfois, la plaine océanique de ses marais pontins. Il vit des scènes champêtres, où l'homme grave procède, ainsi que le dit Théophile Gautier, aux travaux de la terre comme aux cérémonies d'un culte. De ses yeux ravis, il observa les scènes de labour et de moisson, magnifiées par les vers, encore présents à sa mémoire, des poètes latins; les fins de journée glorieuse; la rentrée en apothéose des paysans et des paysannes, sur les hautes charrettes que traînent des bœufs majestueux. Intéressé par la nouveauté du costume, par la grandeur du paysage, par les beaux mouvements harmoniques qu'y font les hommes et les animaux, il va d'instinct vers ces choses. Ce qu'il admire vraiment à Rome, ce n'est pas le passé de la Ville Éternelle, ce ne sont pas Raphaël et Michel-Ange, c'est la vie au dehors, la vie dans la lumière, la vie remuante; et son désir se précise de l'exprimer sur la toile.
Cependant Granet forçait son élève à étudier les maîtres; il le trouvait, avec raison, encore peu suffisamment armé, non complètement éduqué, pour pouvoir se livrer à ses inspirations personnelles; si bien qu'après deux années de séjour à Rome, et à peine rentré à Aix, Loubon partit pour Paris y continuer son éducation artistique si bien commencée. De nos jours, il se serait immédiatement livré à l'art, sans plus augmenter ses connaissances classiques, car il est assez généralement admis, depuis, qu'apprendre son métier est inutile. Mais c'était le temps où l'artiste faisait un long apprentissage, avant d'oser ce qu'osent généralement aujourd'hui ceux qui ne savent pas assez. Par les hésitations, les longs tâtonnements qui caractérisent l'éclosion des talents de tant d'artistes modernes, arrêtés trop souvent dans leur marche, il faut bien reconnaître, après expérience faite, que rien ne se traduit, en peinture, sans l'éducation préalable, sans la possession complète des moyens techniques d'expression, que les peintres de génie ont toujours possédés mieux qu'aucuns.
A Paris, grâce à de nombreuses recommandations, grâce aussi à l'attrait sympathique qui émane de sa personne, Loubon se lie bientôt avec tous les artistes de son époque: Delacroix, Decamps, qu'il affectionne particulièrement; Rousseau, Corot, Diaz, Dupré. Par Roqueplan, son compatriote, duquel il subit pendant assez longtemps l'influence, et dont il semble s'être assimilé un certain temps la manière, il connut Troyon et devint bientôt son meilleur ami. C'est dans ce milieu fécondant que le peintre aixois, aidé par sa facilité intuitive, par les qualités de son intelligence, s'initiait, s'instruisait, en cherchant sa voie.
* * *
Loubon était trop personnel pour se mettre à la remorque de peintres remarquables et tracer longtemps sa route dans leur sillon. Malgré sa vive admiration pour Decamps, pour Roqueplan et pour Troyon, il cherchait maintenant à dégager sa personnalité. Saura-t-on jamais ce qui se passe en ces moments dans le cerveau d'un artiste? par quelle filiation d'idées, par quels éclairs subits, un peintre, après de nombreuses et diverses tentatives, va délibérément vers la voie qui lui est propre? On a prétendu que Loubon fut illuminé par un paysage de Rubens, et qu'à partir de cet instant, il n'hésita plus. Il est assez difficile d'établir comment le grand peintre anversois – que certains mettent au-dessus de tous – put conseiller Loubon, qui ne fut jamais coloriste. Il est admissible cependant que des génies aussi vastes que Rubens ont, dans tous les genres, des ressources émotives telles qu'elles peuvent se manifester par d'infinies façons, sur des tempéraments différents et même éloignés. Ce qu'il y a de certain, c'est que, dès 1835, quand Loubon, à vingt-six ans, exposa pour la première fois au Salon de Paris ses Troupeaux d'Arles descendant les Alpes à Saint-Paul-la-Durance, le peintre y apparaissait avec un faire à lui, et des qualités bien personnelles qui feront toujours, partout, reconnaître dans l'avenir un de ses tableaux, et, on peut ajouter, avec des audaces qu'il est difficile d'apprécier aujourd'hui. Du premier coup, Loubon s'était montré ce qu'il est resté dans ses meilleurs tableaux, avec son entente des belles lignes, son heureux choix des effets lumineux, sa connaissance exacte des grandes valeurs, son respect du ton local, sa conscience exagérée du dessin des premiers plans, et surtout sa superbe construction architecturale des terrains de son paysage.
Un peu exilé à Paris, comme tout bon Provençal qui l'habite pour la première fois, Loubon conservait du pays natal, avec les souvenirs d'enfance, l'image de tableaux qui, à distance, s'amplifiaient de lumière sous les ciels assez moroses du Nord. De loin, cette Provence lui apparut plus belle peut-être, plus inspiratrice; et il rêva de la peindre et de la faire aimer. Cette pensée, assez naturelle, de vouloir peindre son pays était, en 1835, plus méritante et plus osée qu'on ne pense. Aussi, le premier tableau que Loubon exposa à Paris «n'y fut point remarqué pour son caractère local, mais pour son animation7». Cette toile contenait en germe toutes les promesses que l'artiste réaliserait plus tard.
Devant ce troupeau qui marche de front sur vous, on a presque l'envie de se garer. Avec énervement, les bêtes et les gens luttent contre le vent qui fait envoler les capes et se dresser les toisons, au milieu d'un tourbillon de poussière dressé en cercle argenté jusqu'au ciel d'un bleu violent. Tout autour, le paysage franchement provençal «en pierres et en herbes grises»; au loin, la Durance caillouteuse avec la belle ligne de ses bords aux escarpements décoratifs.
La note était trouvée; elle était nouvelle, d'un pur accent. Loubon ne s'y tint pas. On lui reprocha, sans doute, sa crudité, sa violence, son naturalisme; et l'artiste n'eut pas de longtemps le courage de chercher son inspiration dans un pays qui ne plaisait à personne.
C'est en vain qu'alors, obéissant à ces considérations, l'artiste provençal court la France, qu'il essaie de peindre diversement: les Bords de la Seine à Maisons-Laffitte (Salon de 1841), et des Vues de Nantes et d'Étretat (Salon, 1843). C'est sans bonheur qu'il fait précédemment une incursion dans la peinture de genre: Braconniers jouant aux dés le gibier qu'ils ont tué (1838); Salvator Rosa chez un marchand brocanteur; Soldats jouant à la porte d'une prison (1839). Le portrait ne lui réussit pas mieux, et ceux de M. Ch. Duval et de M. P*** passent inaperçus au Salon de 1840. C'est même inutilement qu'il cherche à revivre et à reconstituer ses souvenirs d'Italie avec sa Mascarade sur l'Arno; Promenade aux Cassines, Florence. C'est à la Provence qu'il lui faudra résolument revenir; c'est elle qui va lui donner, à partir de l'année 1846, le motif de ses meilleurs tableaux, de ses paysages animés, aux environs d'Aix et de Marseille, qui le classeront parmi les bons artistes originaux de ce siècle, dont les œuvres résisteront au temps, et qui demeureront, tandis qu'auront disparu les hâtives et médiocres productions qui, comme une marée montante, envahissent toujours plus compactes, chaque nouvelle année, les Salons et les Expositions.
* * *
En 1845, Loubon, qui avait été médaillé au Salon de 1842, fut appelé à la direction de l'École gratuite de dessin, à Marseille. Il ne venait pas dans cette ville avec plaisir, car il lui fallait quitter le milieu alors si intéressant des ateliers parisiens, en pleine bataille artistique. Il céda toutefois aux instances de sa famille, très éprouvée par des revers financiers. L'événement fut heureux pour sa carrière. Le peintre, en contact obligé avec les paysages de son pays, vint de nouveau leur demander ses meilleures inspirations. Et nous allons le retrouver désormais dans ses toiles, cherchant à raconter les scènes des mœurs pastorales, les exodes d'animaux fuyant l'orage ou les razzias, les migrations de troupeaux en lutte contre le vent: «Émile Loubon, avec infiniment d'esprit, a dégagé le sens et fixé tout un côté de la physionomie du paysage provençal. Il fut par excellence le peintre de la Provence. Ses toiles nous en ont fait sentir le charme pittoresque. Nous y avons vu la couleur argentine du sol, la torsion spirituelle des arbres, le brusque contraste des ombres et de la lumière, le mouvement des êtres et des choses8.»
«Le mouvement des êtres et des choses.» Telle est bien la caractéristique du talent de Loubon. Le peintre aixois est un créateur essentiellement curieux d'un mouvement saisi dans son extrême rapidité et que l'artiste montre possible, admissible même dans sa déformation, sans l'arrêt maladroit, figé, qu'enregistre l'objectif, – car l'instantanéité photographique était alors inconnue. On ne saurait mieux pourtant faire comprendre quelques-unes de ses meilleures toiles qu'en disant qu'elles nous donnent une impression cinématographique virtuelle de ce qui s'y passe. En effet, au geste de l'homme on est tenté de donner sa destination, on veut voir le bœuf continuer sa descente, on suit le chien dans sa course folle…
Aussi bien est-il temps d'analyser les œuvres maîtresses de ce peintre qui figurèrent avec éclat aux Salons de Paris: les Bœufs sur la route d'Aix à Marseille (1853), musée de Marseille; les Menons en tête d'un troupeau de la Camargue (1853), musée d'Aix; le Col de la Gineste entre Marseille et Cassis (1855), (exposition centennale de l'art français, 1900); la Razzia (1857); Un troupeau en marche (1854). C'est à partir de 1853 que Loubon semble être arrivé à la possession de son art, et c'est à partir de cette année-là que son œuvre est intéressante à étudier, car elle est définitive.
Le tableau que possède le musée de Marseille: les Bœufs sur la route d'Aix à Marseille, est vraiment d'une composition savante, d'un art consciencieux et fort. Quant à l'action animée et bruyante, elle est là très suggestive. Dans le troupeau de bœufs qui est prêt à disparaître derrière le mamelon raviné, on devine la cohue. Comme dans une charge suprême, les bêtes se bousculent pour éviter le bâton. Sous la poussière, la tête du troupeau s'en est allée déjà dans la déclivité du terrain, pendant que les bouviers frappent et crient, et que les chiens au galop jappent avec fureur après les retardataires.
Ce qu'on peut appeler le champ d'action du tableau est une ligne très harmonieuse qui vient s'appuyer sur la courbe trouvée du premier plan. Le paysage qui encadre cette action est fait de beauté provençale. Au fond, sous le ciel, le pur dessin des collines grecques de Montredon et des îles Riou et de Maïre; plus proche, la croupe allongée de l'ancien fort Notre-Dame de la Garde, l'entrée du vieux port qu'indiquent la haute tour du phare Sainte-Marie, les vieilles maisons de la Tourette et de Saint-Jean; plus proche encore, la ligne accidentée et pittoresque du vieux Lazaret aujourd'hui disparu; enfin, les plans intermédiaires successifs où se déroulent les accidents d'un paysage agreste: des pins qui se penchent avec un mouvement souple; les bras d'un moulin à vent; des cheminées d'usine; l'oratoire provençal au coin de la route en zigzag sur laquelle vont, couvertes de leur tente en cerceau, les charrettes archaïques. Et sur la droite de la composition, le bleu intense de la Méditerranée qui creuse une cuvette triangulaire aiguë dans les dentelures avancées des caps minuscules.
Or, ce tableau qui n'a pas de prétentions aux effets aveuglants de ceux des peintres modernes, contient néanmoins, observé longuement, une lumière vive; et cela, malgré la couleur schisteuse de ses premiers plans, malgré la désagréable et peu aérienne teinte roussâtre, particulière au peintre, qui court un peu partout sur les végétations, malgré des ombres durement accusées, malgré la lourdeur des couleurs lointaines. Trois choses, trois vérités éternelles scrupuleusement observées, judicieusement appliquées, font oublier ces faiblesses: la conscience du dessin, le respect du ton local, la justesse des valeurs. Aussi, combien de peintures à la mode qui papillotent sous prétexte de vibrations solaires, et qui, isolées, semblent flamber et miroiter, s'éteindraient pourtant anéanties à côté du tableau de Loubon? Combien de ceux que l'on dit être des coloristes parce qu'ils font joli ou amusant, ou des impressionnistes parce que leur lumière est orangée et leurs ombres violettes, verraient leur œuvre s'effondrer, comparée à celle d'un peintre qui n'a aucune prétention à la couleur, qui n'est pas du reste un coloriste, mais qui savait dessiner, qui savait établir et qui connaissait son métier.
Cette comparaison, que l'on fait malgré soi en songeant à tout le bruit que provoquent certaines réputations de peintres modernes, alors que sont oubliés ces grands morts d'hier si modestes, on peut la faire encore plus probante avec, du même peintre, le grand paysage, le Col de la Gineste, qui triompha l'an dernier à l'Exposition centennale. On peut dire que Loubon ne construisit, dans aucune autre toile, avec plus de précision et de solidité les plans d'un tableau. Il faut admirer cette toile où l'œil aime à se reposer avec sécurité, l'audace extrême de son ciel tout en haut du cadre – audace que les impressionnistes érigeront plus tard en principes de composition – de son ciel qui n'est pas seulement dans ce court espace réservé à quelques nuages festonnés que le vent enroule, mais qui baigne aussi de lumière le creux des vallonnements successifs, qui éclaire les mamelons étagés où broutent les chèvres. La composition de ce tableau gagnerait peut-être encore à être débarrassée de ces taches noires d'animaux mièvres – qui semblent être mises après coup et qui n'ajoutent rien à la grandeur du paysage. N'importe, ce tableau demeurera, par la belle compréhension de sa lumière, par sa puissance, par sa solidité, parmi les œuvres intéressantes qui naquirent à la suite de l'évolution du paysage commencée avec Rousseau; évolution qui marque la plus grande manifestation picturale du xixe siècle.
Nous trouvons encore au musée de la ville natale du peintre, les Menons de la Crau, une grande toile, à la vérité, plus curieuse que parfaite de composition, mais où le peintre donna libre essor à son observation heureuse des chèvres. Loubon avait de tout temps affectionné cet animal, probablement pour l'excessive mobilité de son allure, et il ne résista pas au plaisir de le mettre en scène comme un personnage important, un acteur en vedette.
Les bergers provençaux ont la coutume de mettre à la tête des troupeaux qui se déplacent, des menons, chèvres barbues, cravatées du haut collier de bois où s'accroche la clochette lourde. C'est la musique officielle qui préside à la marche de l'indisciplinée caravane. Loubon nous a montré les chèvres, vues de front, peu soucieuses de l'importance de leur rôle, dans les poses les plus variées: les unes sérieuses, d'autres esquissant un entrechat comique, les jeunes prêtes à cosser, le regard mauvais; toutes disposées à une incartade imprévue. Et entre le dessin capricieux de leurs formes osseuses, derrière ce rideau sombre qu'accusent les pelages foncés, les oreilles et les arêtes vives des cornes, arrive le troupeau bêlant, en masse serrée, pendant que l'arrière-garde va se perdre dans une apothéose lumineuse enveloppée de brouillards poussiéreux. Les chèvres comptant seules dans ce tableau, il faut voir avec quel humour, quelle acuité dans la notation, le peintre a inscrit leurs moindres tressaillements, la souplesse de leurs articulations nerveuses et fines, et leur gaminerie simiesque.
L'œuvre par excellence où s'accélère encore le mouvement est l'importante toile de la Razzia, très remarquée au Salon de Paris de 1857. Gustave Planche avait écrit dans la Revue des Deux Mondes: «La Razzia de M. Loubon est une heureuse tentative dans le genre de Charlet et de Raffet. Il y a dans cette toile un entrain, une ardeur qui plairont aux hommes de guerre.»
Maxime du Camp renchérit: «J'avoue, dit-il, que j'aime beaucoup M. Loubon: il a de l'entrain, une furie méridionale qui fait plaisir à voir et qui constitue à ses compositions une bien réelle originalité. Sa Razzia a le diable au corps. Sur un terrain incliné, les veaux, les taureaux, les vaches, les chèvres, les brebis, les chiens se précipitent, se heurtent, cascadant du mufle à la queue et fuyant de leur galop saccadé devant leurs bergers montés sur des dromadaires lancés au grand trot. Toute cette avalanche dessinée en raccourci est d'un effet extraordinaire. Le troupeau ainsi chassé, est enveloppé d'une fine poussière blanche levée sur les terrains calcaires par le pied agile des bêtes effrayées. C'est grisâtre, mais d'une rapidité qui fait pardonner cette faiblesse de la couleur.» Nous n'avons rien à ajouter à ces quelques lignes exprimant si bien notre pensée.
Un tableau que Loubon a fait souvent dans sa carrière, comme des variations nombreuses sur un thème identique, c'est le Troupeau en marche du musée de Montpellier. Sur la route, au soleil, le troupeau vient de face, toujours malmené par l'homme et les chiens. Au milieu, dominant les moutons et les chèvres de sa haute stature, l'âne gris cendré de Provence, avec, surmontant le bât, les deux sacs de sparterie tressée qui oscillent, se haussent ou disparaissent dans le remous imprimé par la bousculade générale. Parmi les animaux effarés, l'âne seul semble échapper à la loi du mouvement exacerbé que l'artiste impose à tous. Que le chien jappe, gambade et morde même; que les moutons se pressent en galop de déroute, que les chèvres bondissent, que les mulets ruent, que les bœufs apeurés mugissent, que les chevaux que l'on tire trop durement avec la bride se cabrent, l'âne, comme un sage retiré dans sa tour d'ivoire, par seulement l'ironique balancement de ses longues oreilles, subit la bourrasque sans y participer. Il se laisse entraîner passif, philosophant peut-être; que sait-on? Et par ce rôle réservé à l'âne seul, le peintre aixois affirme encore davantage le côté particulier de son talent, la justesse de son observation.
* * *
Malgré leur couleur peu séduisante, l'abus de certains ocres lourds et opaques, la dureté des contours, le faire râpeux, les tableaux de Loubon sont remarquables encore par la belle ordonnance de la lumière que ce peintre tenait de Granet, par la belle ligne éloquente et simplifiée du maître Constantin, enfin par une harmonie de la composition générale qui semble lui avoir été révélée par les solennelles apparitions de la vie en mouvement au sein des décors de la campagne romaine. Sans doute, les recherches anatomiques ne furent pas poussées assez loin par l'artiste pressé d'exprimer sa pensée pétulante; mais il faut insister sur son originalité suprême: «sa furia méridionale», son esprit méridional, que recèlent toutes ses grandes œuvres et qui en sont la caractéristique indéniable.
Toujours nous la retrouverons dans la suite de ses productions avec le Souvenir de Savoie, le Traîneau (1858), où dans un mouvement plein de hardiesse, un paysan attelé à une sorte de véhicule rustique, descend du bois sur une pente excessive; dans Un chariot à Nevers (Exposition de Paris 1858), où, avec des efforts violents qui contractent leurs muscles et déforment leurs ossatures, «des bœufs cherchent à ramener le chariot embourbé hors de l'ornière profonde; dans Un temps de pluie (1859), où, par une débandade folle, les moutons et les vaches, sous la menace du nuage noir qui crève déjà à l'horizon, se précipitent vers l'abri9».
Dans les Porteurs de poissons qui courent pieds nus, Loubon choisira à dessein des gestes vifs; et on suit, intéressé, la course antique de ces beaux gars luttant entre eux de vitesse, le panier d'osier rempli de poissons sur l'épaule.
Dans son Mulet fourbu, il fait se plaindre lamentablement la misérable bête exténuée et rappelée par le bâton de l'homme aux dures nécessités de l'effort. Cédant sous le poids de son fardeau, le long de la route interminable, les pauvres jambes de l'animal flageolent en arc. Dans cette petite toile, Loubon écrit son dessin avec le burin comique d'un Callot.
Mais, longtemps, il ne saurait s'apitoyer sur le sort des bêtes de somme, et s'il les mène à l'abreuvoir (exposition de Lyon, 1857), il les presse, les heurte, dans une hâte fébrile. Il n'étudie pas l'animal en artiste attendri; il ne lui prête ni le sentiment, ni les affections, ni les regards auxquels notre désir d'humanité pour ces frères inférieurs, donne parfois une signification qu'ils n'ont peut-être jamais eue. Ce qui l'intéresse chez l'animal, c'est la curiosité de sa ligne mouvante, l'imprévu de ses formes qui se déplacent; et, encore, il le force à courir les routes: Troupeau de la Crau en marche (1856); à descendre hâtivement du pâturage estival pour rentrer à l'étable: Un troupeau de mérinos arrive des montagnes du Piémont au village d'Aureille (Salon de Paris, 1859).
Au besoin, il a les Ferrades, courses locales, qui lui permettent d'ébaucher, dans de vagues arènes, de curieuses attitudes; de satisfaire ses goûts méridionaux de geste dramatique; tel, la couleur en moins, un Goya provençal.
Il ose peindre la nature secouée par le vent qui tord les arbres et fait se lever sur la route les cyclones poussiéreux; alors, sous le ciel d'un bleu dur, il montre la lutte épique des bêtes et du paysan de Provence contre le mistral. Et on le voit ce vent implacable qui s'engouffre dans la houppelande de l'homme, on le sent dans l'effort qui saccade la marche de l'animal, avec le symbole de sa poussière argentée qui monte, dans le tableau, aux environs d'Aix-en-Provence, jusqu'au sommet de la chaîne de Sainte-Victoire.
Enfin Loubon accentue à tout propos la résistance animale qu'occasionnent la crainte, l'effroi, l'entêtement: le Gué que les brebis se refusent à traverser; Fuyant l'orage dans la montagne (Lyon, 1857) où roulent, comme une avalanche, les bœufs qu'aiguillonne la peur autant que les cris et les bourrades du conducteur; Un bac (environs de Paris) où, sur les rougeoiements d'un ciel de couchant pluvieux, il oppose les grandes silhouettes des veaux et des vaches qu'une paysanne pousse à grands coups de gaule, vers la barque, malgré eux.
Maintenant, avec les Souvenirs de Soumabre (1857) il se remémore la bataille d'un essaim de poules accourues vers la poignée de grains de blé que leur jette la fermière. Si quelques peintres de basses-cours les ont vues remuantes, Loubon y éveille tous les instincts les plus violents. Sous le coup de fouet de la faim, il excite le poulailler à une bousculade acharnée, à des écrasements, des combats où, dans des caqueteries de victoire, des piaulements de défaite, se hérissent les crêtes, s'arment les ergots, s'envolent les plumes.
* * *
«Pendant près de la moitié de ce siècle, alors que le retour à la nature avait déjà mis en honneur d'autres régions: la Suisse, la Bretagne, la Touraine; alors que les hautes cimes alpestres, les landes sauvages, les gras pâturages, les vieux châteaux historiques avaient leurs peintres et leurs poètes, qui se souciait de la Provence avec ses horizons de collines basses, ses chemins poudreux et ses maigres verdures10?» C'était la «Gueuse parfumée» qui n'était connue alors que par ses jasmins et ses orangers. La Gueuse parfumée et «ses basses terres brûlées du soleil et du vent avec la désolation des landes broussailleuses, les chênes-liège, les pins et les genévriers des silencieuses forêts vides d'oiseaux, la fraîcheur de ses ravins profonds où se mêlaient en impénétrables fourrés les houx, les myrtes, les lauriers aux fleurs roses et les silènes étoilés, les lavandes, les iris et les cistes à odeur d'ambre11».
L'heure de célébrité allait venir bientôt pour elle. Si cette gloire revient surtout à Mistral, à Daudet, à Paul Arène, aux félibres et à tous les littérateurs et artistes qui surent l'imposer au goût des Parisiens, on peut dire que Loubon est le premier parmi les peintres qui ait compris la beauté du paysage provençal et ait osé s'en servir pour y placer ses animaux. Dans le lit blanc de la rivière caillouteuse, il fait passer quand même et trébucher le troupeau; il agrémente la nudité de la route avec l'anecdote du minuscule oratoire où, dans sa niche peinte à la chaux, le saint repose entre deux bouquets de fleurs sauvages desséchées; il l'orne encore de rares oliviers ou d'un pin isolé qui la coupe de son ombre grêle. Le peintre s'entend à merveille pour déduire le pittoresque de cette nature un peu âpre et pour en agrandir le décor. Avec les collines pelées qui bordent la Durance, les masses bleuâtres du dôme rectangulaire de Sainte-Victoire, les pures silhouettes ioniennes qui jouxtent la mer bleue et ferment les golfes, il fait ses fonds. L'aridité, la désolation de la terre crevassée, assoiffée, lui servent pour ses premiers plans sérieusement étudiés. De cette Provence dont il a aimé le ciel, les arbres, les terrains, les montagnes, il a su montrer les aspects séduisants et rendre aimables même les tares. Voilà le signe certain de l'amour sincère du terroir. Toujours après ses courses à travers la France, une partie de l'Italie, de l'Espagne, il éprouve, à son retour, un sentiment plus intense de la poésie particulière au pays natal. Même après son voyage aux pays enchantés, après le souvenir des exquis paysages italiens et des verts pays de France, son affection pour la petite Provence s'augmente et s'affermit; car le peintre a découvert en elle des grâces non révélées aux profanes: à lui elle s'est montrée, à peine impudique, dans sa nudité de vierge grise de parfums, éclairée par la chaude et éclatante lumière de son soleil.
* * *
La maladie, un mal terrible, s'abat sur l'artiste en pleine gloire; et, circonstance aggravante, il ne trouve pas auprès de sa compagne le réconfort, la sollicitude dont certaines femmes savent entourer l'existence d'un être souffrant. Rien dans la vie d'un artiste ne saurait être négligé. Tous les événements ont sur son œuvre une importance plus ou moins heureuse ou néfaste qui réagit sur ses productions. Il faut donc dire la vérité, encore proche. Loubon n'avait pas épousé la femme qui pouvait le comprendre. Très belle, très gâtée par celui qui lui passait tous ses caprices d'enfant ingrate, l'ancien modèle ne sut pas donner à l'artiste un intérieur reposant. Il dut se réfugier dans l'amitié et même s'isoler souvent pour retrouver un peu de tranquillité et de paix. Mais son art pouvait suffire à remplir sa vie. Avec une énergie, un courage et une patience héroïques, Loubon lutte, les dernières années, avec la souffrance aiguë qui a prise sur son cerveau. Elle influe dès lors sur sa nature, sur ses productions. Peu à peu, une sorte de buée grise enveloppe ses toiles, le mouvement se ralentit et se fige presque dans ses dernières compositions. Les animaux qu'il y place marchent désormais mollement et comme sans bruit. C'est la vie qui, insensiblement, semble s'arrêter.
Dans son Après-midi d'automne, un de ses derniers tableaux, les moutons sont tristes et broutent sans faim, les chèvres vont sans joie, sans cabrioles, les chiens n'aboient plus, les gestes de l'homme sont indécis; et ce gai paysage des environs de sa ville natale est brumeux, effacé. La grandeur du style est encore dans la toile, où une couleur maladive s'affine d'une enveloppe aérienne que le peintre avait jusqu'alors ignorée.
Ce fut sa dernière œuvre: elle figurait à Paris au Salon de 1863 avec, sur le haut du cadre, le nœud en crêpe noir qui en augmentait encore – pour ceux qui avaient connu Loubon si vivant, si énergique – l'intense mélancolie.
Émile Loubon venait à peine de mourir (à Marseille, le 2 mai 1863), emporté, dit-on, par un cancer intestinal qui le suppliciait depuis cinq ans. Il avait été fait chevalier de la légion d'honneur en 1855.
* * *
Quand on voit au musée de Marseille la superbe et définitive ébauche qu'est le portrait de Loubon par son ami Gustave Ricard, on est attiré vers cette figure souriante, aux traits mouvants, au regard sympathique et droit; et tout de suite on se met à apprécier l'homme que l'on voit pour la première fois, comme si on avait vécu de longues années dans son intimité, comme si on l'avait toujours connu. Loubon y apparaît essentiellement bon, distingué et fin. Il fut vraiment tout cela. Il fut, en outre, un esprit combatif, intelligent, remuant, un artiste sincèrement convaincu et qui eut le don de l'apostolat.
6
Arsène Alexandre. Barye (Antoine Louis).
7
La Tribune artistique et littéraire d'Auguste Chaumelin.
8
Louis Brès. Le Paysage provençal et son influence au point de vue artistique et littéraire.
9
La Tribune artistique et littéraire d'Auguste Chaumelin, vol. 2, 3 et 4.
10
L. Brès. Le Paysage provençal.
11
Virgile Josz. Fragonard (Société du Mercure de France. Paris, 1901).