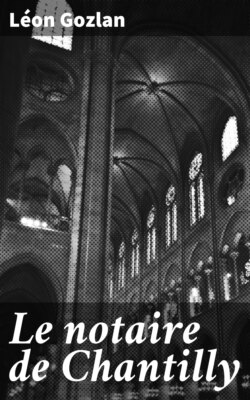Читать книгу Le notaire de Chantilly - Gozlan Léon - Страница 9
VII
ОглавлениеAu bout de quelques minutes de silence, M. Clavier poussa un profond soupir et commença:
—«La calomnie m'a poursuivi jusqu'ici, Maurice. Ne cherchez pas à me dissuader: je connais les hommes. Leur haine ne se brise que contre la tombe; le pied leur glisse sur le marbre; justice tardive qui n'est que l'oubli: ne croyez pas à leur pardon: je n'y crois pas. Quelques-uns cessent de se souvenir en vieillissant; voilà encore leur réparation: une infirmité.
»Dans cette solitude même ils m'ont flétri de leur silence: ils m'ont fui. J'ai vainement, pauvre vieillard, ouvert mon âme et ma porte à tous: aucun n'est venu. Alors je me suis enfermé, et je n'ai plus voulu voir la société, compagne de l'âme humaine, qu'à travers la grille de ma prison. Leur curiosité méchante s'est accrue de toute ma réclusion; ils ne passent jamais devant le jardin que j'ai planté, où le jour je travaille, où la nuit je pense, mon front dans la main, sans chercher mon visage derrière mes barreaux. Dans leur naïve terreur, ils s'étonnent sans doute de ce que je laisse vivre mes fleurs et de ce que je ne décapite pas mes arbres. La plupart,—mon jardinier me l'a rapporté,—ont remarqué des taches de sang à ma joue. Je suis le réprouvé du pays; ils m'appellent le régicide; ils craindraient de laisser tomber leur tête avec leur salut, s'ils honoraient de quelque signe de respect mes soixante-dix ans de vie. Mon ami, je n'ose embrasser les petits enfants à qui je ne fais pas encore peur; je frémirais d'épouvanter leurs mères.
»Ils doivent avoir d'étranges opinions sur l'ange, bâton fleuri, qui me soutient. Je ne leur pardonnerais pas cependant, moi si résigné pour moi-même, de souiller de leurs propos cette enfant qui croît à mes pieds comme une fleur au bas d'une tour, entre la pierre et le fer. Caroline est ma fille par la tendresse, par la reconnaissance; je n'ose ajouter par le sang. Si j'allais lui léguer pour ma dot ma renommée! Mieux vaudrait la laisser laide et sans pain au milieu de la rue: car mon nom est historique. Malheur, en politique, à ceux dont les noms restent, Maurice!»
La figure de M. Clavier était toujours pâle. Sa parole était presque tremblante d'embarras.
«J'ai besoin de m'assurer de vous, mon ami, un témoin à décharge qui déposera, après ma mort, contre des accusations terribles dont le contre-coup irait frapper Caroline: elle aussi doit être instruite. Vous l'instruirez. Si elle vous demandait un jour mon histoire, répétez-lui les paroles funèbres que je vais prononcer. Elle en sait déjà quelques-unes qu'elle n'oubliera point.
—Ceci promet, dit tout bas Victor à Léonide. Vous verrez, ma sœur, que notre essai sera heureux.
Léonide posa un doigt sur la bouche de son frère.
M. Clavier poursuivit:
«Mon adolescence fut terne; mon père voulut avoir un avocat dans la famille: je le devins. Après m'être marié, j'exerçai aussitôt ma charge dans un bourg situé aux frontières du Nord. C'était à l'époque où les états-généraux s'assemblèrent sur le vœu des parlements qui leur léguèrent l'alternative d'une banqueroute ou d'une révolution. Né du peuple, j'en partageai l'enthousiasme à ce lever si pur de notre émancipation. Disciple ardent de la philosophie nouvelle, ma conviction fut acquise à ces amis de l'humanité qui, les premiers, parlèrent de rendre la liberté à l'homme, à la pensée. J'avais vingt-quatre ans: jugez si je prêtai une attention passionnée aux discours prononcés aux états-généraux par les hommes de mon sang, de ma caste, par mes frères en esclavage. L'accusé innocent ne suit pas avec plus d'intérêt le plaidoyer de son défenseur. Quoiqu'à cent lieues de Versailles, pas une parole n'était perdue pour moi: je me rendais, la nuit, sous les allées de la petite promenade de notre bourg, et là, l'oreille collée à terre, comme la sentinelle lointaine, j'écoutais les bruits qui venaient du sud. J'imaginais entendre, j'entendais les pas pesants des députés du tiers entrant dans le Jeu-de-Paume; puis me relevant fièrement comme eux, j'enfonçais mon chapeau devant les députés de la noblesse et du clergé: ce que firent les députés de la nation, vous le savez. L'amour ne gonfle pas un cœur avec autant de plénitude que ces tableaux m'élevaient l'âme. En un jour, par l'effet de ce grand spectacle qui se préparait loin de moi, j'étais passé de l'indifférence de l'enfant à la sévérité du citoyen. Toutes mes passions se groupèrent autour d'une seule: celle-là devint formidable: la liberté! Je dus paraître bien ingrat à des amitiés délaissées. On ne me vit plus; je me cachai, j'étudiai, je pensai; ou plutôt je ne cessai d'être à Versailles, le bras tendu, la tête rejetée en arrière, le regard fier, répondant à Mounier: «Oui, je prête le serment de ne jamais me séparer de l'Assemblée, que la Constitution ne soit établie.»
»Rentré en moi-même, je ne tardai pas à m'apercevoir que si je m'isolais de la foule, c'est que mon opinion n'éveillait pas d'écho autour d'elle. Je finis par me convaincre, à de sinistres visages, à des paroles mystérieuses, à une inaction calculée, que j'étais seul à aimer cette opinion, seul à la défendre. Ancienne dépendance d'un seigneur issu de famille étrangère, notre bourg féodal, qui se composait au plus de deux cents habitants, me parut préférer un joug servile au bonheur d'en être délivré par quelques sacrifices. Placé aux extrêmes limites de la France, offrant aux étrangers, à la faveur du voisinage, la facilité de conspirer avec les ennemis de l'intérieur, notre bourg acquérait par la gravité des événements une importance extraordinaire. Je crois encore le voir avec sa colonie d'ouvriers plus allemands que français, avec sa population bâtarde comme toutes celles des frontières; gens conquis mille fois, sans avoir retiré d'autre avantage de la domination impériale et de l'occupation française, que des idées et un langage corrompus comme leurs mœurs. Je me rappelle surtout le vieux château bâti au temps de Charles-le-Téméraire, se dressant sur ses quatre tourelles, et prolongeant ses ailes crénelées aux flancs de notre bourg, qui n'en était que l'avenue, l'humble dépendance. De son balcon, le seigneur pouvait appeler les étrangers à ses fêtes: ils y venaient souvent étaler leurs débauches, et aider le maître à manger ses revenus. Le bourg était alors allemand, et passait de droit à l'empire. Songez, Maurice, à quels périls nous exposait cette fraternité à l'époque où nous vivions. Position militaire des plus redoutables, notre localité pouvait servir de plateau à une armée d'ennemis, de premier échelon pour descendre dans l'intérieur de la France. Et le bourg était sans défense, il était à eux.
»A Paris, on était trop occupé de Paris pour penser à se raffermir du côté des frontières: vous savez en quel état elles furent trouvées quand Luckner eut mission de les défendre. Perdue entre deux vallons, toujours couverte de brume, loin de la grande route, notre localité fut complétement oubliée. Les députés de la nation comptèrent trop d'abord sur une levée universelle de l'opinion à l'appui de leurs principes. Les habitants de beaucoup de villes, ceux du bourg que j'habitais, par exemple, n'envisageaient qu'en tremblant une autre manière d'être gouvernés; ils chérissaient leur obéissance sous un maître qui ne les tyrannisait plus, parce qu'il lui était impossible d'ajouter un anneau de plus à la chaîne. On l'estimait bon, de ce qu'il n'avait plus de méchancetés à commettre. Toute dignité était partie de ces corps battus de génération en génération. Sur leur dos courbé par l'avilissement, le mépris et le fouet avaient fait croûte.
»Oui, mon ami, l'abâtardissement de l'homme en était arrivé à ce point dans beaucoup de villes frontières, comme la nôtre: parce qu'elles avaient, à diverses époques de l'histoire, appartenu à l'Allemagne, elles s'imaginaient n'avoir aucun droit pour faire cause commune avec la France contre d'odieux abus. Comme si jamais le droit naturel qu'ont les peuples d'être libres et de se gouverner était susceptible de périr dans les transactions auxquelles ils n'ont pas souscrit!
»Mais, soit ignorance, soit engourdissement, mes concitoyens ne jugèrent pas que le moment était venu pour eux, non d'être Allemands ou Français, questions pour lesquelles avaient combattu leurs pères dans des guerres moins saintes, mais d'être hommes. J'élevai la voix pour répandre cette vérité: je ne fus pas compris.
»Alors je m'expliquai nettement deux vérités que l'histoire n'avait jamais dégagées pour moi de ses enseignements: l'une, que les temps d'esclavage finissaient quelquefois par être légitimes à force d'abnégation chez ceux qui s'y courbaient; l'autre, que ces temps avaient eu aussi des âmes énergiques qui, comme la mienne, s'étaient découragées dans une lutte inégale.
»Me voilà donc réduit à marcher seul avec mon opinion, rougissant presque de l'avouer, tant le silence qui l'accueillait la colorait d'une teinte paradoxale. On dira un jour l'histoire de la révolution française en province: elle ne sera ni moins curieuse ni moins tragique, ni moins morale surtout que la même histoire éternellement écrite à Paris et pour Paris. Si la torche de la révolution française,—il est superflu de l'avouer,—était Paris, chaque province était le miroir parabolique qui renvoyait des rayons de feu après avoir reçu des rayons de lumière. Revenons à moi. J'aurais mieux aimé combattre pour mon opinion à la lueur des canons, que de la laisser rouiller dans le silence. L'opinion, c'est la vérité; qui la possède doit la dire: c'est la foi: il faut la proclamer; en faire une ceinture pour soi, un drapeau pour les autres.»
Comme Maurice pressentit que, dans ce récit qui l'attachait vivement, sans doute à cause de ses convictions politiques, M. Clavier placerait les événements principaux de sa vie, il se leva pour s'assurer que les portes de communication étaient fermées. Dans cet examen, son visage effleura le drap où s'appuyait la joue attentive de sa femme.
Il retourna à sa place.
«Que j'aurais désiré d'appartenir à ce peuple de Paris qui ne se nourrissait plus que d'enthousiasme, attaché aux grosses lèvres de Mirabeau, parlant tout un jour! A force d'exaltation, je me crus à Paris. Je montais, au Palais-Royal, derrière la chaise de Camille Desmoulins, le brave jeune homme; et, comme lui, applaudi par cent mille mains, je piquais à mon chapeau la feuille d'un arbre, cocarde improvisée, symbole innocent et pur qui, deux jours après, devait passer par le sang et ne plus déteindre. Puis je sonnais le tocsin dans ma tête, j'illuminais mes yeux de l'incendie de Paris, et j'allais, suivi du bruit d'une ville, traînant avec moi des canons, fléchissant sous le poids des piques, jusque sous les murs de la Bastille que j'assiégeais. Couvert de la poussière de ses débris, je m'admirais, statuaire étrange, artiste procédant au rebours: la chute de la Bastille était bien la statue de la révolution, son premier chef-d'œuvre de destruction. Pour elle, détruire c'était faire; abattre c'était achever; anéantir c'était perfectionner. La Bastille détruite était donc une statue élevée. Dans les ères de révolution, l'œuvre de destruction est aussi une œuvre impérissable qui a ses noms d'artistes signés au bas. Au bas de notre statue nous écrivîmes: Peuple—Paris, 14 juillet.
»La pierre qui s'élève ou qui tombe, remarquez-le bien, c'est plus qu'une vengeance, et qu'une simple fondation commémorative: une phase de civilisation commence ou finit. C'est le bouleversement de la propriété; de la propriété du pouvoir ou de la propriété du sol. Laissez entre chaque borne des champs l'espace de cinq lieues, vous aurez tout de suite la féodalité; ne mettez entre chacune de ces bornes que la distance d'une lieue, apparaissent les majorats, la monarchie; rapprochez les bornes, ne comptez entre elles que l'intervalle de vingt pas, et vous avez l'industrie, la propriété divisée à l'infini, la république. La Bastille était la plus haute borne féodale. Elle abattue, les autres bornes furent poussées dans le fossé. L'arbre de la liberté fut planté à la place: image juste: la propriété recommençait par son attribut naturel: l'arbre!
»Quand les emblèmes tombent, les réalités qu'ils cachent ne restent guère debout. La Bastille, cet emblème, croule; et, à dix-sept jours de distance seulement et dans le court espace d'une nuit, on proclame sur ses ruines la liberté du serf, l'abolition des juridictions seigneuriales, la répartition égale des impôts, l'admission de tout le monde à tous les emplois, la destruction de tous les priviléges. Chose étrange! Tout le monde prêta ses deux mains à cette œuvre d'une nuit. On eût dit que ces hommes de la nation se hâtaient de peur que la lune ne vînt à se coucher; on eût dit encore que la lueur des flambeaux avait fasciné ceux qu'ils éclairaient. Pâles, fatigués, les bras nus, le front en sueur, ils brisèrent la féodalité avec la monarchie; la hache passait de main en main. Dieu employa sept jours à faire le monde: il suffit aux États-Généraux d'une nuit à Versailles pour le rendre libre. Dans cette mémorable nuit, chacun sacrifia aux yeux de tous, et jeta, au centre de cette salle où bouillonnaient tant d'idées, ses titres, ses aïeux, ses priviléges de dix siècles; on y précipita tout: le passé pour l'anéantir, le présent pour qu'il renaquît. Nuit de Versailles! nuit sublime! Le serf de dix-huit siècles tombant dans les bras, sur la poitrine d'un comte de Lally-Tollendal, et l'appelant: «Mon frère!» nuit qui enveloppa le chaos d'où un monde allait jaillir! On ne s'arrêta pas: l'œuvre marchait toujours pendant que le roi se livrait au sommeil dans son palais, et on l'enfanta debout; ainsi les femmes fortes accouchent. On manqua d'un tabouret pour faire asseoir le président. Dans ce chaudron sombre au fond duquel disparurent les membres dépecés de la vieille monarchie, personne n'hésita à remuer: prêtres avec la mitre, nobles avec l'épée, peuple avec le bâton. Ils travaillèrent ensemble et du même cœur, sans craindre de voir sortir de cette fusion quelque monstre portant tête de peuple et griffe d'hyène. Ils n'oublièrent qu'une seule chose: c'est qu'en abolissant la noblesse, ils avaient de fait aboli le roi; qu'en supprimant le privilége, on supprimait la royauté; et qu'en admettant tout le monde aux emplois, le peuple était l'égal du souverain ou bien le roi était du peuple. La nuit de Versailles fut la seconde œuvre de la révolution, autre chef-d'œuvre de négation comme la prise de la Bastille. On avait détruit d'abord la loi de pierre, on venait d'anéantir la loi écrite, il ne restait plus que la loi de chair.
»L'exemple de Versailles ne fut pas perdu pour la province. Les châteaux tombèrent, les titres furent brûlés; une poussière féodale s'éleva sur toute la France.
»Le château de notre canton resta debout. Vingt hommes de cœur ne se trouvèrent pas pour le renverser.
»Voulant enfin connaître au juste le nombre d'opinions que ralliait à ses principes dans notre bourg l'Assemblée constituante, je battis la caisse, et, au milieu du marché, je lus à haute voix la déclaration des droits de l'homme. Un seul paysan et un jeune marquis s'avancèrent pour m'écouter. Ensuite nous nous embrassâmes tous trois, comme Bailly, Lafayette et Grégoire; nous nous déclarâmes libres, le paysan refusa vingt sous de dîme au curé, deux heures de corvée au seigneur, et tua un pigeon dans la forêt. La révolution était accomplie chez nous. Quand le seigneur manda le paysan à son château, j'y parus moi-même et j'y lus la sanction royale donnée à la constitution. Je demandai ensuite l'arbre généalogique de la maison, et le jetai au feu.
»A quelques jours de là, j'instituai un club que je présidai: deux auditeurs y parurent, le marquis et le paysan.
»Le paysan nourrissait dans son âme la colère d'un peuple entier. Il avait six enfants nés de sa misère; géants de fer qui luttaient avec les ours, et dont la tête avait appris à s'abaisser sous le regard d'un enfant de leur maître. Quand je lui expliquai ses droits, il sembla les recouvrer, tant son instinct courut au-devant de la solution qu'il avait souvent pressentie sans la saisir. Dès cet instant, il comprit qu'il ne devait mettre sa force qu'au service de son intelligence, sa volonté qu'au pied de son libre arbitre, et que le droit naturel étant cela, l'acte politique qui le voilait était une tyrannie. Il rompit avec le passé dont il lava la souillure en se promettant plus d'une vengeance expiatoire. Il me détailla ses récriminations; il me fit l'histoire de sa famille: je crus encore entendre celle du peuple. Tout y était: la perpétuité de l'esclavage, de la misère, du travail, de la faim et de la honte: l'ignorance aggravait encore son abaissement. C'est une justice à rendre à la Providence: elle ne souffre l'esclavage qu'après l'abrutissement. Si elle consent à l'inégalité parmi les hommes, ce n'est qu'au prix de leur stupidité. Là où éclate la pensée, il y a vertu, courage, dignité. Dieu n'a toutes les libertés que parce qu'il a toutes les pensées; il n'est souverainement bon que parce qu'il est souverainement intelligent.
»J'avais rendu ce paysan mon égal et celui du jeune marquis; il comprit que je méritais d'être le sien. Nous réglâmes un bien qui était à nous trois. Ce jour fut notre fête de la fédération.
»Le marquis, que je désigne ici simplement par son titre, parce que sa famille vit encore, et parce que les délations n'ont qu'un temps, apportait avec nous, contre la monarchie, moins de raisons que de principes. L'exemple des Condorcet et des Montmorency l'avait entraîné. Il puisait ses griefs à une autre source que la nôtre. En apparence il sacrifiait plus que nous, mais il exigeait moins. En se constituant en révolte ouverte vis-à-vis de la royauté, il s'annulait: nous, au contraire, nous acquérions. Il était naturel qu'il s'arrêtât, une fois l'inégalité abolie, nous ne devions nous arrêter qu'après avoir constitué l'égalité. Homme de théorie, il agissait en vertu du principe généreux, mais vague, de la morale universelle, tandis que nous, nous travaillions pour nous-mêmes. Il réformait, nous détruisions. C'était un philosophe, nous des hommes. Il continuait Rousseau; nous, Rienzi.
»Les événements me confirmèrent bientôt que notre bourg était un nid de partisans de l'ancien régime. A l'époque où l'on parlait déjà du départ du roi pour Metz, quelques jours après la scandaleuse fête donnée à Versailles aux gardes-du-corps, je vis arriver et passer aux frontières des officiers de la maison du roi, mêlés à une foule d'hommes défiants qui entraient et sortaient pendant la nuit. Je crois vous l'avoir dit: par sa situation, notre bourg était admirablement placé pour favoriser l'évasion de la cour sur le territoire ennemi. Je proposai d'organiser la garde nationale. L'idée fut réalisée avec mépris, surtout par les gens du château, qui, par moquerie, me nommèrent le chef de cette milice. Si tous les habitants s'y enrôlèrent, il ne me fut pas difficile néanmoins de voir que pas un n'apportait sous les armes des dispositions patriotiques. J'avais armé des ennemis.
»J'acceptai le commandement qu'on m'avait donné par dérision, et je le partageai avec le marquis, le paysan et ses six enfants. En réalité, nous neuf seulement représentions l'effectif de cette singulière milice. Je m'arrangeai de manière, dans ma répartition des postes commis à la garde du bourg, que mon paysan et trois de ses fils feraient toujours partie de celui de la ville, tandis que ses trois fils, moi et le marquis veillerions à ceux des frontières, distantes d'une lieue, d'une demi-heure de marche.
»Cette mesure contint l'explosion d'une défection ouverte; elle força la trahison à s'observer. Neuf hommes déterminés en surveillaient deux cents: mais qui a jamais calculé la puissance d'une autorité soutenue par l'opinion; quelle est la ville qui n'est pas cent fois plus forte que sa garnison; quelle est la nation qui ne vaincrait pas sa propre armée? Appliquez un nom à cette force morale. Nous l'avions. J'eus besoin de m'en servir à l'époque où la noblesse française émigra en foule, nous menaçant de rentrer sous peu de jours à la suite de Condé. Ce prince, assurait-elle avec confiance, n'attendait plus pour marcher de Worms sur Paris que l'arrivée du roi dans une ville frontière; le roi, dont le danger était devenu plus imminent depuis la mort du comte de Mirabeau. Ces courtisans irrités ne semblaient déjà plus en France une fois dans notre bourg. Ils déguisaient à peine leur dégoût pour nos couleurs nationales qu'ils ne portaient pas, prompts à reprendre la cocarde blanche de l'autre côté des frontières.